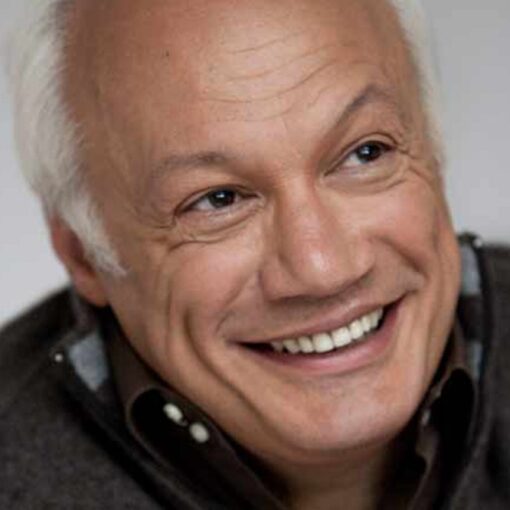Fiodor Mikhaïlovitch Dostoïevski naît le 11 novembre 1821 à Moscou. Il grandit dans le quartier de l’hôpital des pauvres où son père est médecin militaire. Très tôt, il se passionne pour la littérature grâce aux lectures que lui font ses parents et sa nourrice.
En 1837, sa mère meurt de tuberculose. La même année, son père l’envoie avec son frère aîné à Saint-Pétersbourg pour étudier à l’École des Ingénieurs militaires. Deux ans plus tard, son père meurt dans des circonstances troubles. Après ses études, Dostoïevski abandonne rapidement sa carrière militaire pour se consacrer à l’écriture.
Son premier roman, « Les Pauvres Gens » (1846), connaît un grand succès. Mais en 1849, son appartenance au cercle progressiste de Petrachevski lui vaut d’être arrêté et condamné à mort. Au dernier moment, sa peine est commuée en travaux forcés. Il passe quatre ans au bagne d’Omsk, une expérience qui le marque profondément et nourrit son œuvre future.
Libéré en 1854, il épouse Maria Dmitrievna Issaïeva en 1857. Il retrouve le succès avec « Crime et Châtiment » (1866), mais sa vie est marquée par les difficultés financières, l’addiction au jeu et l’épilepsie. Après la mort de sa première femme, il épouse sa sténographe Anna Grigorievna Snitkina en 1867, qui l’aide à stabiliser sa vie.
Les dernières années de sa vie sont les plus fécondes. Il publie ses chefs-d’œuvre : « L’Idiot » (1868), « Les Démons » (1871), et « Les Frères Karamazov » (1880). Son discours sur Pouchkine en 1880 en fait un héros national. Il meurt le 9 février 1881 à Saint-Pétersbourg, laissant une œuvre majeure qui influence profondément la littérature mondiale.
Ses romans, caractérisés par une psychologie très fouillée et des questionnements philosophiques et religieux, sondent la noirceur des esprits tout en gardant la foi en la rédemption. Son style novateur, notamment le concept de roman polyphonique, révolutionne l’art d’écrire.
Voici notre sélection de ses romans majeurs.
1. Crime et Châtiment (1866)
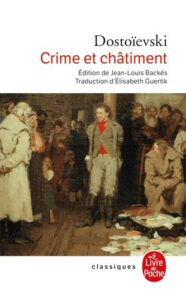
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
1865. Dans les ruelles sordides de Saint-Pétersbourg, un jeune homme rumine un projet macabre. Autrefois étudiant en droit tombé dans la misère, Rodion Raskolnikov s’est forgé une théorie : certains hommes, supérieurs au commun des mortels, auraient le droit de transgresser les lois pour accomplir leur destinée. Pour mettre cette idée à l’épreuve, il assassine une vieille usurière, puis sa sœur, venue par hasard sur les lieux du crime.
Le double meurtre, pourtant parfait, ne lui apporte ni la confirmation de sa théorie ni le soulagement espéré. Au contraire, Raskolnikov s’enfonce dans un abîme de fièvre et de paranoïa. Ses errances dans Saint-Pétersbourg le mènent à Sonia, une jeune prostituée qui incarne le sacrifice et la foi malgré sa condition misérable. Cette âme pure devient la seule confidente de Raskolnikov. Elle l’encourage à confesser son crime et à accepter sa peine, alors même qu’un innocent est sur le point d’être condamné à sa place. Convaincu par la foi inébranlable de Sonia, Raskolnikov finit par se dénoncer et est envoyé dans un bagne en Sibérie.
Les destins d’autres personnages s’entremêlent à cette trame principale : la sœur de Raskolnikov, courtisée par deux hommes aux intentions douteuses ; un inspecteur perspicace qui pressent la culpabilité du meurtrier sans pouvoir la prouver ; une famille déchirée par l’alcoolisme et la pauvreté.
Autour du livre
La genèse de « Crime et Châtiment » est indissociable des difficultés financières de Dostoïevski. À l’été 1865, acculé par les dettes, l’écrivain perd au casino de Wiesbaden ses dernières ressources et jusqu’à ses effets personnels. Dans ce dénuement extrême, il propose au conservateur Katkov, directeur du Messager russe, une nouvelle psychologique sur un crime. Le texte initial, rédigé à la première personne sous forme de confession d’un meurtrier, est entièrement brûlé en novembre 1865. Dostoïevski reprend alors son manuscrit de zéro, optant cette fois pour une narration à la troisième personne qui lui permet de mieux sonder les méandres psychologiques de son personnage.
La rédaction s’effectue dans l’urgence : Dostoïevski doit simultanément honorer un contrat avec l’éditeur Stellovski pour un autre roman, « Le Joueur ». Cette pression temporelle ne nuit pas à la qualité de l’œuvre. Les premières livraisons mensuelles dans Le Messager russe, début 1866, rencontrent un succès immédiat. Un fait divers vient amplifier la résonance du roman : peu après la publication des premiers chapitres, un étudiant moscovite assassine un usurier dans des circonstances étrangement similaires à celles décrites par Dostoïevski.
L’architecture du roman témoigne d’une construction méticuleuse. Les six parties s’organisent selon une symétrie parfaite autour d’un point de bascule central. Cette structure en « X aplati » reflète la transformation intérieure du protagoniste : les trois premières parties montrent un Raskolnikov dominé par l’orgueil et la raison, les trois suivantes dévoilent sa progressive descente vers l’humilité et l’irrationnel. L’épilogue, très discuté par la critique, parachève cette métamorphose spirituelle.
« Crime et Châtiment » s’inscrit dans un contexte idéologique brûlant. À travers son héros, Dostoïevski s’attaque aux théories nihilistes et utilitaristes qui séduisent alors la jeunesse russe. La « théorie » de Raskolnikov sur le droit des êtres supérieurs à transgresser les lois morales fait écho aux débats qui agitent les cercles intellectuels pétersbourgeois des années 1860. Le romancier pousse ces idées jusqu’à leurs ultimes conséquences pour en démontrer la dangerosité.
Saint-Pétersbourg joue un rôle crucial dans l’œuvre. La ville n’est pas un simple décor mais un personnage à part entière, avec ses tavernes sordides, ses ruelles étouffantes, sa chaleur suffocante. Cette topographie urbaine minutieuse reflète et amplifie les tourments intérieurs de Raskolnikov. Dostoïevski est l’un des premiers à saisir ainsi les potentialités symboliques du paysage urbain moderne.
L’impact de « Crime et Châtiment » sur la littérature mondiale est considérable. Nietzsche y voit une analyse psychologique inégalée. Les existentialistes, de Kafka à Camus, y puisent une part de leur inspiration. Le texte influence profondément la conception du roman psychologique au XXe siècle. Les techniques narratives novatrices de Dostoïevski – notamment sa façon de fondre la voix du narrateur dans la conscience du personnage – annoncent les expérimentations de James Joyce ou de Virginia Woolf.
« Crime et Châtiment » n’a cessé d’inspirer les artistes. Plus de 25 adaptations cinématographiques en ont été tirées, depuis le film muet de Robert Wiene en 1923 jusqu’aux versions contemporaines. Parmi les plus notables figurent celle de Josef von Sternberg (1935) avec Peter Lorre, qui transpose l’action dans l’Amérique contemporaine, et la version soviétique de Lev Kulidzhanov (1969), saluée pour sa fidélité psychologique à l’œuvre originale. Au théâtre, la première adaptation française date de 1888 au théâtre de l’Odéon. Plus récemment, des metteurs en scène comme Andreï Konchalovsky ou Frank Castorf ont proposé des lectures renouvelées du texte.
Les polémiques qui ont accompagné la publication initiale illustrent la puissance provocatrice du roman. Si certains critiques, comme Nikolaï Strakhov, en ont immédiatement saisi la portée morale, d’autres y ont vu une attaque contre la jeunesse progressiste. Le Contemporain, rival du Messager russe, a même mis en doute la vraisemblance psychologique du personnage principal. Ces débats témoignent de la capacité de l’œuvre à interroger les fondements moraux de toute société.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 704 pages.
2. Les Frères Karamazov (1880)
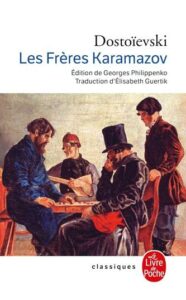
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
« Les Frères Karamazov » raconte l’histoire d’une famille russe de la fin du XIXe siècle, où trois frères aux tempéraments opposés se retrouvent liés au meurtre de leur père. Fiodor Pavlovitch Karamazov, propriétaire terrien cynique et débauché, entretient des relations tumultueuses avec ses fils : Dmitri, militaire né d’un premier mariage, Ivan, intellectuel torturé, et Alexeï, novice au monastère du coin. La rivalité entre Dmitri et son père atteint un point critique quand ils se découvrent épris de la même femme, la belle et mystérieuse Grouchenka.
À Skotoprigonievsk, petite ville de province, les tensions familiales s’exacerbent autour d’une dispute d’héritage. Une nuit, alors que Dmitri rôde près de la maison paternelle, Fiodor Karamazov est retrouvé mort. Tous les indices accusent Dmitri, qui est arrêté puis jugé. Mais l’assassin est en réalité Pavel Smerdiakov, serviteur et fils illégitime de la victime, secrètement influencé par les théories nihilistes d’Ivan sur la mort de Dieu et la permissivité morale.
Pendant ce temps, le plus jeune frère Alexeï, surnommé Aliocha, tente de préserver l’unité familiale. Son parcours spirituel, guidé par le starets Zossima, s’entremêle avec l’histoire d’un groupe d’écoliers dont l’un, Ilioucha, se meurt de tuberculose après avoir vu son père humilié par Dmitri.
Autour du livre
Les circonstances qui entourent la création des « Frères Karamazov » s’inscrivent dans une période particulièrement douloureuse pour Dostoïevski. Le décès de son fils Aliocha, emporté par l’épilepsie à l’âge de trois ans en mai 1878, constitue un tournant décisif dans l’écriture du roman. Cette tragédie personnelle se reflète dans le choix du prénom donné au plus jeune des frères Karamazov, mais aussi dans l’histoire bouleversante du capitaine Snegiriov et de son fils Ilioucha. La douleur paternelle imprègne ces pages où la mort d’un enfant devient le symbole de l’injustice divine contestée par Ivan Karamazov.
Le séjour au monastère d’Optina, quelques semaines après la perte de son fils, marque profondément l’orientation spirituelle du roman. La rencontre avec le père Ambroise, figure marquante de la spiritualité russe du XIXe siècle, inspire directement le personnage du starets Zossima. Les enseignements de ce dernier, centrés sur l’amour universel et la responsabilité de chacun envers tous, puisent leur substance dans la pensée de Tikhon de Zadonsk, saint orthodoxe du XVIIIe siècle.
La genèse des « Frères Karamazov » s’enracine également dans le passé carcéral de l’écrivain. Durant sa détention en Sibérie dans les années 1850, Dostoïevski rencontre un certain Ilinski, condamné pour parricide et dont l’innocence sera établie des années plus tard après la confession du véritable meurtrier. Cette histoire nourrit la trame narrative centrale autour de Dmitri Karamazov, injustement accusé du meurtre de son père.
Le roman se distingue par sa structure narrative novatrice. Le narrateur, qui se présente comme un chroniqueur local, brouille les frontières entre objectivité et subjectivité. Sa voix se fond imperceptiblement dans celle des personnages, créant une polyphonie narrative qui anticipe les techniques romanesques modernes. Chaque personnage possède son idiolecte propre, reflet de sa vision du monde et de sa personnalité sociale.
L’architecture du roman intègre des récits autonomes qui fonctionnent comme des mises en abyme philosophiques. La légende du Grand Inquisiteur, racontée par Ivan à Aliocha, constitue l’un des sommets de la littérature mondiale par sa densité intellectuelle et sa portée théologique. Ce texte, qui met en scène la confrontation entre le Christ revenu sur terre et un cardinal de l’Inquisition, cristallise les grandes questions sur la liberté et la foi qui traversent l’œuvre.
La réception des « Frères Karamazov » témoigne de son rayonnement exceptionnel. Einstein le considère comme l’accomplissement suprême de la littérature. Freud y consacre une étude majeure, « Dostoïevski et le parricide », où il analyse les névroses de l’auteur et leur influence sur l’intrigue. Franz Kafka se reconnaît comme un « parent par le sang » de Dostoïevski, particulièrement sensible au thème de la relation père-fils qui traverse le roman.
L’influence philosophique du roman se révèle considérable. Le personnage d’Ivan Karamazov devient une figure emblématique de la révolte existentialiste chez Albert Camus et Jean-Paul Sartre. Sa critique de la théodicée, son refus d’accepter un monde où souffrent les enfants innocents, résonne profondément dans la pensée contemporaine. Le caractère prophétique du roman frappe nombre de ses lecteurs. Hermann Hesse y voit l’annonce de « l’effondrement de l’Europe ». Les questions soulevées sur le nihilisme, la perte des valeurs traditionnelles et les conséquences de l’athéisme prennent un relief saisissant à la lumière des bouleversements du XXe siècle.
« Les Frères Karamazov » suscite des lectures multiples et parfois contradictoires. Si certains y voient une apologie de la foi orthodoxe à travers le personnage d’Aliocha, d’autres soulignent la force des arguments d’Ivan contre l’existence de Dieu. Cette ambivalence témoigne de la profondeur psychologique du roman qui refuse toute réponse simpliste aux questions qu’il soulève.
Les adaptations cinématographiques démontrent la permanence de sa force dramatique. La version de Richard Brooks en 1958, avec Yul Brynner dans le rôle de Dmitri, marque les esprits. La production soviétique d’Ivan Pyriev en 1969 propose une lecture plus fidèle au texte original.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 915 pages.
3. L’Idiot (1868)
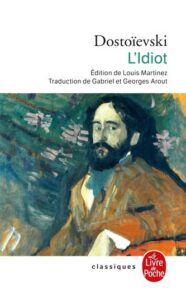
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
En novembre 1868, le prince Mychkine, jeune aristocrate épileptique de 26 ans, rentre en Russie après un long séjour dans un sanatorium suisse. Dans le train qui le ramène à Saint-Pétersbourg, il fait la connaissance de Parfion Rogojine, un marchand passionnément épris de Nastassia Filippovna, une femme d’une beauté troublante. Le prince découvre bientôt que cette dernière, recueillie orpheline par un noble qui en a fait sa maîtresse, est promise à un jeune ambitieux, Gania Ivolguine.
Le destin de ces personnages bascule lors d’une soirée mouvementée : Rogojine offre cent mille roubles pour « acheter » Nastassia, tandis que Mychkine, ému par sa détresse, lui propose le mariage. S’ensuit un triangle amoureux déchirant où Nastassia oscille entre Mychkine qu’elle aime mais dont elle se sent indigne, et Rogojine dont la passion destructrice l’attire inexorablement. La situation se complique encore quand le prince s’éprend d’Aglaïa Epantchine, une jeune demoiselle de la haute société. La confrontation entre les deux femmes précipite le drame.
Autour du livre
La genèse de « L’Idiot » s’inscrit dans une période tourmentée pour Dostoïevski. En septembre 1867, l’écrivain et sa jeune épouse Anna Grigorievna fuient la Russie pour échapper aux créanciers. Leur exil les mène successivement en Allemagne et en Suisse. Le couple vit dans le dénuement le plus total, régulièrement expulsé de ses logements pour loyers impayés. Dostoïevski, en proie à son addiction au jeu, dilapide leurs maigres ressources sur les tables de roulette. Les crises d’épilepsie qui le terrassent s’intensifient, notamment lors de la naissance de leur fille Sofia qui décède trois mois plus tard. Le romancier se sent responsable de cette perte tragique.
Les carnets de notes de 1867 révèlent les hésitations de Dostoïevski sur la direction à donner au roman. Les premières ébauches dessinent un Mychkine maléfique, coupable de crimes abominables dont le viol de sa sœur adoptive, avant de se convertir au christianisme. À la fin de l’année, l’écrivain opte pour une approche radicalement différente : il ne s’agit plus d’amener un homme vers la bonté mais de mettre en scène un être naturellement christique confronté aux complexités de la société russe moderne. Cette nouvelle orientation découle directement des circonstances personnelles de l’auteur qui, dans une lettre à Apollon Maïkov, confie que sa situation désespérée l’a « contraint » à s’emparer d’une idée qu’il méditait depuis longtemps sans oser s’y attaquer : « dépeindre un être humain absolument bon et beau ».
Le personnage du prince Mychkine incarne cette quête d’absolu moral. Sa simplicité évangélique n’est pas synonyme de naïveté mais traduit une compréhension profonde de l’âme humaine. Considéré comme « idiot » par une société superficielle, il manifeste une intelligence intuitive remarquable dans l’analyse des caractères. Sa compassion inconditionnelle pour les êtres souffrants, particulièrement pour Nastassia Filippovna, s’enracine dans une vision christique de l’amour qui transcende les conventions sociales.
L’expérience personnelle de Dostoïevski imprègne profondément le roman. En 1849, l’écrivain avait été condamné à mort pour ses activités au sein du cercle Petrashevski avant d’être gracié au dernier moment. Cette confrontation avec l’imminence de la mort ressurgit dans les réflexions du prince Mychkine sur la peine capitale. De même, l’épilepsie dont souffre le personnage principal fait écho aux crises qui affectaient l’auteur, décrites comme précédées d’instants d’extase mystique d’une intensité incomparable.
« L’Idiot » déploie une critique acerbe du catholicisme, perçu comme une dénaturation de l’enseignement christique originel. Pour Dostoïevski, l’Église romaine, en s’arrogeant le pouvoir temporel, a trahi sa mission spirituelle et engendré l’athéisme moderne. Cette thématique s’incarne notamment dans le destin d’Aglaya qui, sous l’influence d’un prêtre catholique, abandonne sa famille pour un prétendu comte polonais.
La structure apparemment chaotique du roman découle de la méthode d’écriture adoptée par Dostoïevski. Ne sachant jamais à l’avance comment les personnages allaient réagir dans une situation donnée, il laissait l’intrigue se développer librement. Cette approche extemporanée permet de préserver la liberté fondamentale des protagonistes et crée ce que le critique Mikhail Bakhtine nomme la « polyphonie » : chaque voix conserve son autonomie et sa vérité propre.
Dans ses notes, Dostoïevski se démarque des autres figures vertueuses de la littérature comme Don Quichotte ou Pickwick en mettant l’accent sur l’innocence plutôt que sur la dimension comique. Cette innocence sert d’instrument de satire sociale tout en révélant une compréhension profonde de la psychologie humaine. Le prince Mychkine possède le don singulier d’abolir les barrières hiérarchiques et de créer un contact authentique entre les êtres, relativisant ainsi tout ce qui divise les hommes et confère à la vie une fausse gravité.
La réception critique de « L’Idiot » à sa parution fut largement négative, tant en Russie qu’en Europe. Les lecteurs reprochaient au roman son caractère « fantastique » et son apparent manque de structure. Dostoïevski revendiquait pourtant un « réalisme fantastique » plus proche de la réalité contemporaine que le prétendu réalisme de ses détracteurs.
L’influence du roman s’est manifestée à travers de nombreuses adaptations. Le cinéaste Akira Kurosawa en propose en 1951 une transposition dans le Japon d’après-guerre. Andrei Tarkovski nourrissait le projet d’une adaptation cinématographique mais se heurta à la censure soviétique. Le compositeur Mieczysław Weinberg en tire son dernier opéra en 1986. Plus récemment, le chorégraphe Boris Eifman crée en 1980 un ballet sur la musique de la Symphonie n°6 de Tchaïkovski.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 934 pages.
4. Les Démons (1871)
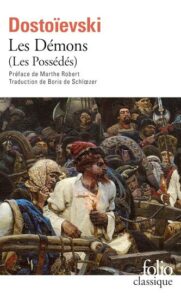
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Dans une petite ville de province russe des années 1870, Stepan Verkhovensky, intellectuel libéral vieillissant, vit depuis vingt ans sous la protection de la riche veuve Varvara Stavroguina. Le retour de leurs enfants respectifs va bouleverser la paisible existence de la communauté : Nicolas Stavroguine, jeune aristocrate au charisme trouble, et Pierre Verkhovensky, agitateur révolutionnaire manipulateur.
Pierre Verkhovensky constitue rapidement une cellule subversive avec quelques intellectuels. Il tente d’impliquer Stavroguine dans ses projets de soulèvement, voyant en lui un potentiel leader charismatique. Mais Stavroguine cache de lourds secrets : un mariage clandestin avec une femme handicapée mentale, Maria Lebiadkina, et un passé criminel qui le hante. Quand Maria et son frère sont assassinés, les événements s’enchaînent tragiquement. La spirale de violence culminera dans une nuit d’incendie et de meurtres.
Autour du livre
« Les Démons », ou « Les Possédés », paru en feuilleton dans Le Messager russe entre 1871 et 1872, naît de la convergence de deux projets distincts : une réponse littéraire à l’affaire Netchaïev, qui secoua la société russe en 1869, et un roman philosophique intitulé « La vie d’un grand pécheur ». L’assassinat de l’étudiant Ivan Ivanov par la cellule révolutionnaire de Netchaïev bouleversa Dostoïevski, qui y vit le symptôme d’une maladie morale profonde rongeant la jeunesse russe.
La genèse de l’œuvre coïncide avec un moment critique de la vie de l’auteur : exilé à Dresde pour échapper à ses créanciers, il traverse une période difficile marquée par la mort de sa fille et des crises d’épilepsie récurrentes. Cette expérience personnelle du chaos imprègne le roman d’une tension existentielle palpable.
Le choix du titre, « Bésy » en russe, renvoie aux démons du Nouveau Testament qui, chassés d’un possédé, se réfugient dans un troupeau de porcs. Cette métaphore biblique structure l’ensemble du roman : les idées occidentales – socialisme, athéisme, nihilisme – sont présentées comme des forces démoniaques qui s’emparent de l’âme russe pour la précipiter vers l’autodestruction.
La publication du roman suscita des réactions contrastées. Si le public l’accueillit favorablement, permettant à Anna Dostoïevskaïa de préparer rapidement une seconde édition, la critique progressiste y vit un pamphlet réactionnaire dénué de valeur littéraire. Sous le régime soviétique, le roman ne fut quasiment jamais réédité, sa critique du milieu révolutionnaire étant jugée incompatible avec l’idéologie officielle.
Le manuscrit original comportait un chapitre crucial, « Chez Tikhon », que l’éditeur Katkov refusa de publier. Cette censure amputa l’œuvre d’une dimension essentielle : la confession de Stavroguine au moine Tikhon, où il révèle avoir poussé une enfant au suicide, éclaire la nature profonde de sa déchéance morale. Ce chapitre ne fut publié qu’en 1922.
Les personnages du roman trouvent leurs modèles dans la réalité historique : Piotr Verhovenski est inspiré de Netchaïev, tandis que Karmazinov constitue une caricature à peine voilée de Tourgueniev. Le personnage énigmatique de Stavroguine puise certains traits chez Nikolaï Spechnev, membre du cercle Petrachevsski auquel Dostoïevski avait appartenu.
L’influence des « Démons » dépasse largement son contexte historique. Albert Camus, qui en tira une adaptation théâtrale en 1959, y voyait une des œuvres majeures de la littérature. Le philosophe André Glucksmann établit un parallèle entre la vision dostoïevskienne du nihilisme et le terrorisme contemporain dans son essai « Dostoïevski à Manhattan ». La structure narrative singulière du roman, analysée par Mikhaïl Bakhtine, inaugure ce qu’il nomme le « roman polyphonique » : les voix des personnages s’entremêlent sans qu’aucune ne domine, créant une tension dramatique qui reflète le chaos idéologique de l’époque.
La force prophétique des « Démons » ne cessa de s’affirmer au fil du XXe siècle. Des écrivains comme Soljenitsyne et Pasternak y reconnurent une préfiguration des mécanismes totalitaires, notamment dans la théorie politique du personnage Chigaliov, qui prône l’asservissement de 90 % de l’humanité au nom de l’égalité.
Le roman ne cessa d’alimenter la réflexion philosophique sur les liens entre athéisme et nihilisme politique. Le personnage de Kirilov, dont le projet de suicide philosophique impressionna particulièrement Camus, incarne cette quête désespérée d’une transcendance dans un monde sans Dieu. L’omniprésence du thème du suicide – quatre personnages se donnent la mort dans le récit – témoigne d’une préoccupation sociétale que Dostoïevski reliait directement à la perte de la foi religieuse et à la désintégration des structures sociales traditionnelles.
« Les Démons » connut de nombreuses adaptations : théâtrales avec la version de Camus, cinématographiques avec le film d’Andrzej Wajda en 1988, et même une adaptation en mini-série par la BBC en 1969. Chaque nouvelle lecture souligne la modernité d’une œuvre qui, au-delà de sa dimension politique immédiate, interroge les fondements mêmes de la civilisation.
Aux éditions FOLIO ; 759 pages.
5. Les Carnets du sous-sol (1864)
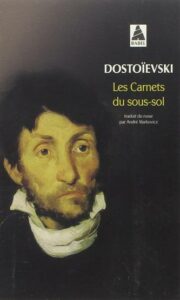
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
« Les Carnets du sous-sol » s’ouvre sur la confession d’un homme de quarante ans qui se présente d’emblée comme « malade, méchant et déplaisant ». Ce fonctionnaire retraité vit seul à Saint-Pétersbourg grâce à un modeste héritage. Il souffre du foie depuis vingt ans mais refuse tout traitement, « acte de rébellion » contre la médecine et la société. Sa misanthropie s’exprime à travers une hostilité permanente envers ses anciens collègues et le monde qui l’entoure.
Le récit se divise en deux parties. La première prend la forme d’un monologue fiévreux où le narrateur y développe sa philosophie. Il s’insurge contre l’idée que l’humanité puisse atteindre le bonheur grâce au progrès et à la raison. Pour lui, l’être humain cherche parfois délibérément la souffrance et peut agir contre son propre intérêt, simplement pour affirmer sa liberté. Il oppose ainsi la formule mathématique « 2+2=4 », symbole d’un monde rationnel, à un « 2+2=5 » qui représente le triomphe de la volonté individuelle sur les lois de la nature.
Dans la seconde partie, le narrateur relate deux épisodes de sa jeunesse. Le premier concerne sa vengeance mesquine contre un officier qui l’avait un jour bousculé : pendant deux ans, il le suit dans les rues pour finalement réussir à le heurter intentionnellement. Le second épisode relate sa rencontre avec Liza, une prostituée de vingt ans. Après avoir joué le rôle du sauveur et suscité son espoir d’une vie meilleure, il l’humilie cruellement lorsqu’elle vient le voir, allant jusqu’à lui jeter de l’argent au visage avant qu’elle ne s’enfuie en larmes.
Autour du livre
L’histoire éditoriale des « Carnets du sous-sol » s’inscrit dans un contexte particulièrement sombre. L’année 1864 s’avère dévastatrice pour Dostoïevski : le 15 avril, il perd sa première épouse Maria Dmitrievna, puis quelques mois plus tard son frère Mikhaïl, suivi de près par son ami et collaborateur Apollon Grigoriev. La situation financière de l’écrivain, déjà précaire en raison de ses dettes de jeu contractées à Hombourg, se dégrade davantage après le décès de son frère, dont il hérite des obligations financières.
La publication se fait dans la revue L’Époque, dirigée par Mikhaïl Dostoïevski. Ce périodique, moins libéral que son prédécesseur Le Temps, peine à trouver son lectorat. Dans ce contexte difficile, la décision de publier un texte aux idées impopulaires, qui s’oppose frontalement au roman « Que faire ? » de Tchernychevski, représente un risque éditorial considérable. Pourtant, Dostoïevski maintient son cap, convaincu de la puissance de son œuvre qu’il qualifie dans sa correspondance avec son frère de « texte vigoureux et franc ».
Le texte s’érige en opposition aux courants intellectuels dominants des années 1860. La Russie traverse alors une période d’intense absorption des idées occidentales, générant des débats passionnés entre occidentalistes et slavophiles sur l’avenir du pays. Les réformes libérales d’Alexandre II, notamment l’émancipation des serfs en 1861, créent un climat d’effervescence intellectuelle où s’affrontent différentes visions de la modernisation sociale.
L’impact des « Carnets du sous-sol » dépasse largement les frontières russes. Friedrich Nietzsche, qui découvre Dostoïevski à travers ce texte en traduction française, en fait l’éloge, le considérant comme une percée majeure dans la compréhension psychologique de l’être humain. Cette reconnaissance nietzschéenne ouvre la voie à une réception enthousiaste dans le monde germanophone.
Les critiques soviétiques, en revanche, manifestent une hostilité marquée envers l’œuvre. Son rejet explicite du socialisme utopique et sa représentation des êtres humains comme fondamentalement irrationnels et non coopératifs heurtent les principes du réalisme socialiste. L’affirmation selon laquelle les besoins humains ne peuvent être satisfaits par le progrès technologique contredit directement les thèses marxistes.
L’héritage littéraire des « Carnets du sous-sol » se manifeste dans plusieurs œuvres majeures du XXe siècle. Son influence se retrouve notamment dans « La Métamorphose » de Kafka et « L’Homme invisible » de Ralph Ellison. Les adaptations cinématographiques témoignent de sa résonance continue : de « Taxi Driver » de Martin Scorsese en 1976 à « Notes from Underground » de Gary Walkow en 1995, en passant par « Yeraltı » de Zeki Demirkubuz en 2012.
Cette œuvre charnière préfigure les grands romans ultérieurs de Dostoïevski. Les relations entre le narrateur et Liza annoncent celles de Raskolnikov et Sonia dans « Crime et Châtiment », ou encore de Stavroguine et Liza dans « Les Démons ». « Les Carnets du sous-sol » établit également les fondements psychologiques complexes qui caractériseront les protagonistes des œuvres majeures à venir.
Sur le plan philosophique, le texte anticipe les préoccupations de l’existentialisme. Jean-Paul Sartre y reconnaît une source d’inspiration directe. En remettant en question les certitudes du rationalisme et en affirmant la primauté de la liberté individuelle, même dans ses manifestations les plus irrationnelles, Dostoïevski pose les jalons d’une réflexion philosophique qui marquera profondément la pensée du XXe siècle.
Aux éditions ACTES SUD ; 192 pages.
6. L’Adolescent (1875)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Dans la Russie des années 1870, un jeune homme de dix-neuf ans, Arkadi Dolgorouki, arrive à Saint-Pétersbourg avec une ambition démesurée : devenir aussi puissant que les Rothschild, non par appât du gain mais par soif d’autonomie. Fils illégitime d’un aristocrate et d’une ancienne serve, il a grandi loin de sa famille, nourrissant ce rêve de puissance comme remède à ses blessures d’enfance. Son projet : économiser chaque kopeck jusqu’à atteindre une fortune colossale qui lui garantira une liberté absolue.
Le destin en décide autrement quand il retrouve son père biologique, Andreï Versilov, personnage ambigu qui suscite chez lui un mélange d’admiration et de répulsion. S’installe ainsi une relation tumultueuse, compliquée par leur attirance commune pour la belle Katerina Nikolaïevna Akhmakova. Arkadi se retrouve en possession de deux lettres compromettantes qui le placent au cœur d’intrigues familiales et financières. L’une d’elles menace directement Katerina, et le jeune homme hésite à l’utiliser comme moyen de pression.
Arkadi est rapidement dépassé par les événements. Sa sœur Lisa attend un enfant d’un prince ruiné par le jeu, son père sombre dans une passion destructrice, tandis que d’anciens camarades tentent de l’entraîner dans des manœuvres de chantage. Seule la présence de Makar Dolgorouki, son père légal devenu un humble pèlerin, lui offre un contrepoint spirituel à l’agitation mondaine qui l’entoure.
Autour du livre
La rédaction de « L’Adolescent » coïncide avec une période charnière pour Dostoïevski qui, après avoir quitté la direction du journal Grajdanine en avril 1874, consacre près de deux ans à l’écriture de ce roman. Il s’inscrit dans un moment particulier de l’histoire russe, marqué par les bouleversements sociaux consécutifs à l’émancipation des serfs de 1861. Le texte dialogue implicitement avec « Anna Karénine » de Tolstoï, publié simultanément en feuilleton : là où Tolstoï dépeint la famille aristocratique traditionnelle, Dostoïevski choisit de mettre en scène une « famille accidentelle », symptomatique des mutations sociales en cours.
La genèse du roman puise dans plusieurs sources autobiographiques. Le pensionnat Touchard, où étudie le jeune Arkadi, trouve son origine dans l’établissement tenu par Nicolas Souchard – dont le nom fut modifié par le tsar Nicolas Ier en Drachoussoff. Dostoïevski y étudia lui-même avec son frère, et cette expérience scolaire transparaît dans la description des humiliations subies par le protagoniste. Le personnage de l’adolescent bâtard s’inspire également d’un ancien camarade de classe de l’auteur.
Les critiques contemporains accueillirent fraîchement l’œuvre, lui reprochant sa « forme chaotique ». Cette réception mitigée explique en partie pourquoi « L’Adolescent » est longtemps resté dans l’ombre des autres grands romans de Dostoïevski. Hermann Hesse fut l’un des premiers à en reconnaître la valeur, louant particulièrement « l’art du dialogue, la clairvoyance psychologique et les passages révélateurs sur l’âme russe ». Il nota également l’originalité de son ton ironique, qui le distingue des autres œuvres du romancier.
« L’Adolescent » innove par sa structure narrative sophistiquée. Le récit à la première personne, sous forme de confession rétrospective, permet un jeu subtil entre deux temporalités : celle des événements et celle de leur mise en récit, un an plus tard. Cette construction crée une tension permanente entre l’immédiateté des sensations adolescentes et la distance réflexive du narrateur. La difficulté d’Arkadi à organiser son récit, ses digressions et ses retours en arrière reflètent la confusion d’une société en pleine mutation.
Les thématiques développées résonnent avec les préoccupations majeures de la Russie des années 1870. L’antagonisme entre père et fils illustre le conflit entre les « hommes des années 1840 », influencés par les idées occidentales, et la nouvelle génération des années 1860, plus radicale. La question de l’émancipation des serfs traverse l’œuvre en filigrane, notamment à travers le personnage de Sofia, mère d’Arkadi et ancienne serve. Dostoïevski interroge ainsi les possibilités d’une nouvelle identité russe, entre tradition orthodoxe portée par le personnage de Makar et influences occidentales incarnées par Versilov.
« L’Adolescent » se démarque également par son traitement du thème du suicide, récurrent chez Dostoïevski mais présenté ici sous des angles multiples : suicide philosophique de Kraft, convaincu de l’infériorité du peuple russe, suicide de désespoir d’Olia, tentative de suicide passionnel de Versilov. Chaque cas illustre une facette différente du mal-être social et existentiel de l’époque.
La modernité du roman réside dans sa peinture de la désagrégation des structures sociales traditionnelles. Les relations familiales complexes – père biologique/père légal, demi-frères et sœurs, enfants illégitimes – préfigurent les recompositions familiales contemporaines. Le thème de l’argent comme instrument de pouvoir et d’autonomie trouve également des échos dans notre société actuelle.
En 1983, le réalisateur soviétique Evgeni Tashkov adapte « L’Adolescent » pour la télévision, avec son fils Andreï dans le rôle d’Arkadi. Cette version en plusieurs épisodes s’attache particulièrement à restituer l’atmosphère psychologique de l’œuvre et la complexité des relations entre les personnages.
Aux éditions FOLIO ; 880 pages.
7. Les Pauvres Gens (1846)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Dans le Saint-Pétersbourg des années 1840, Makar Devouchkine, modeste copiste de quarante-sept ans, entretient une correspondance avec sa jeune parente éloignée, Varvara Dobroselova. Les deux personnages habitent dans la même rue, dans des logements misérables qui se font face. Lui occupe un recoin de cuisine, elle vit chez une couturière après avoir fui les mauvais traitements de sa logeuse.
Leurs lettres dévoilent peu à peu leurs existences parallèles. Malgré ses maigres appointements, Makar s’épuise à offrir rubans et sucreries à Varvara, s’enfonçant toujours plus dans les dettes. La jeune femme lui raconte son passé : une enfance paisible en province, puis la déchéance familiale, la mort du père, les vexations chez une parente sans scrupules. Un espoir de bonheur s’était présenté avec un étudiant, mais la mort l’avait emporté. Leur correspondance prend fin brutalement lorsque Varvara accepte d’épouser un riche veuf, Monsieur Bykov, laissant Makar à sa solitude.
Autour du livre
Ce premier roman de Dostoïevski émerge dans des circonstances personnelles tumultueuses. En 1844, le jeune lieutenant-ingénieur de vingt-trois ans, miné par son addiction au jeu et un train de vie somptuaire, accumule les dettes. Ses tentatives de traduction, notamment d’ « Eugénie Grandet » de Balzac et de « La dernière Aldini » de Sand, ne lui apportent pas les revenus espérés. Dans une lettre désespérée à son frère Mikhaïl, il écrit : « C’est simplement un cas de mon roman couvrant tout. Si j’échoue, je me pendrai. »
La rédaction des « Pauvres Gens » s’étale sur seize mois, de janvier 1844 à mai 1845, période durant laquelle Dostoïevski ne cesse de remanier son texte. Dans une correspondance à son frère datée du 5 mai 1845, il confie son obsession : « Ce roman m’a donné un tel travail que, si j’avais su, je ne l’aurais jamais entrepris […] Je me suis juré de ne plus y toucher. » L’inspiration initiale lui serait venue lors d’une promenade hivernale le long de la Neva, où surgit la vision « d’un cœur de conseiller titulaire, honnête et pur, et avec lui, une jeune fille offensée et triste. »
Le manuscrit connaît un destin remarquable grâce à Dmitri Grigorovitch, colocataire de Dostoïevski, qui le soumet au poète Nikolaï Nekrassov. Cette lecture nocturne provoque un enthousiasme tel que les deux hommes se précipitent chez l’auteur à trois heures du matin. Le lendemain, ils présentent le texte au redoutable critique Vissarion Belinski. Malgré son scepticisme initial – « Il pousse aujourd’hui des Gogol comme des champignons » – Belinski succombe à son tour et proclame Dostoïevski « nouveau Gogol ».
La publication dans le « Recueil pétersbourgeois » en janvier 1846 déclenche des réactions contrastées. Si Alexandre Herzen salue la première grande œuvre socialiste russe, Ivan Tourgueniev se montre plus critique, considérant sa glorification excessive. Cette divergence d’opinions préfigure la brouille définitive entre les deux écrivains qui éclatera en 1867 à Baden-Baden.
La structure épistolaire, inédite dans l’œuvre de Dostoïevski, permet une innovation narrative significative. Au lieu d’une description extérieure de la misère, les lettres offrent une immersion dans la conscience des personnages, créant une polyphonie de voix qui deviendra caractéristique du romancier russe.
Les influences littéraires se révèlent multiples : « Le Manteau » de Gogol, « Le Maître de poste » de Pouchkine, les « Lettres d’Abélard et Héloïse ». Mais Dostoïevski transcende ses modèles en insufflant une profondeur psychologique inédite à ses personnages. Il pose les jalons de thèmes qui traverseront toute son œuvre : l’humiliation sociale, la dignité des humbles, les interactions entre classes sociales.
Le succès dépasse rapidement les frontières russes. Dès août 1846, la « Sankt-Petersburgische Zeitung » publie une critique élogieuse, comparant l’œuvre aux « Souffrances du jeune Werther » de Goethe. Des traductions partielles paraissent en allemand, polonais et français. En 1894, la première traduction anglaise intégrale bénéficie d’une introduction de George Moore et d’une couverture d’Aubrey Beardsley.
Le roman inaugure également une nouvelle approche du « petit peuple » dans la littérature russe. Contrairement à ses prédécesseurs qui dépeignaient la pauvreté de l’extérieur, Dostoïevski donne la parole aux démunis eux-mêmes. Cette innovation narrative fait des « Pauvres Gens » non seulement le premier roman social russe, selon Belinski, mais aussi le précurseur d’une nouvelle sensibilité littéraire.
La modernité des « Pauvres Gens » se manifeste notamment dans le traitement de la culpabilité sexuelle, un thème alors peu abordé en littérature. Les allusions au passé trouble de Varvara et la suggestion d’un amour quasi incestueux entre les protagonistes annoncent les introspections psychologiques audacieuses des ouvrages ultérieurs.
Dostoïevski reviendra trois fois à son texte – en 1847, 1860 et 1865 – pour le retravailler, preuve de l’importance qu’il accordait à cette œuvre fondatrice qui, selon le critique Dobroliounov, contient déjà en germe les thèmes majeurs de ses futurs chefs-d’œuvre.
Aux éditions FOLIO ; 224 pages.
8. Le Joueur (1866)
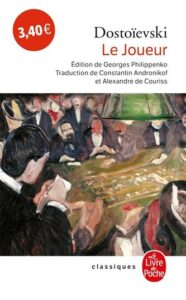
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
À Roulettenbourg, ville thermale allemande fictive des années 1860, le destin d’une famille russe désargentée repose sur la mort attendue d’une vieille tante fortunée. Le général, chef de famille endetté, rêve d’épouser une séduisante française, Mademoiselle Blanche, tandis que son précepteur, Alexeï Ivanovitch, voue un amour obsessionnel à Polina, la belle-fille du général.
L’intrigue s’emballe quand la tante, censée être mourante, débarque en pleine santé dans la petite ville. Bien vivante, furieuse des manigances autour de son héritage, elle découvre à son tour les attraits du casino. En quelques jours, elle dilapide une fortune à la roulette. Ces pertes colossales précipitent le départ de Mademoiselle Blanche et poussent Alexeï à tenter sa chance aux tables de jeu. Il y gagne une somme considérable qu’il offre à Polina, mais celle-ci le repousse violemment.
Autour du livre
Les conditions extraordinaires de la genèse du « Joueur » méritent qu’on s’y attarde. En 1866, Dostoïevski se trouve dans une situation désespérée : endetté par ses pertes au jeu, il signe un contrat avec l’éditeur Stellovski qui s’apparente à un pacte faustien. Les termes sont implacables : il doit livrer un roman pour le 1er novembre 1866, faute de quoi Stellovski obtiendra gratuitement les droits de toutes ses œuvres futures pendant neuf ans. L’urgence est telle que Dostoïevski doit recourir aux services d’une sténographe, Anna Grigorievna Snitkina, pour dicter le texte en seulement vingt-sept jours.
Le dénouement de cette course contre la montre prend des allures de thriller littéraire. Le 31 octobre, alors que Dostoïevski se présente chez son éditeur pour remettre le manuscrit, il découvre que ce dernier s’est délibérément absenté pour le faire échouer. Dans un éclair de lucidité, l’écrivain dépose son texte au commissariat, établissant ainsi légalement la date de remise. Cette péripétie administrative sauve non seulement le roman mais aussi la carrière de son auteur.
La dimension autobiographique du texte s’avère saisissante. Les séjours de Dostoïevski dans les villes thermales allemandes, ses pertes considérables à la roulette entre 1863 et 1871, nourrissent directement l’intrigue. Même la géographie du roman emprunte à son expérience : si la ville fictive de Roulettenbourg évoque Wiesbaden, où le romancier joua pour la première fois, plusieurs cités germaniques – notamment Bad Homburg – revendiquent ce titre.
Les relations amoureuses du protagoniste reflètent aussi celles de l’écrivain. La passion tourmentée d’Alexeï pour Polina transpose celle que Dostoïevski éprouva pour Apollinaria « Polina » Souslova. Cette dernière l’accompagna dans ses pérégrinations européennes avant de le quitter, tout comme l’héroïne du roman. Par un ironique retournement du sort, c’est Anna Snitkina, la sténographe qui l’aida à achever le livre dans les délais, qui deviendra son épouse.
« Le Joueur » dépasse toutefois le simple récit autobiographique pour livrer une critique mordante des sociétés européennes. Chaque personnage incarne un stéréotype national : le Français De Grieux symbolise la duplicité calculatrice, l’Anglais Astley représente la droiture flegmatique, tandis que les aristocrates allemands personnifient une rigidité hautaine. Face à ces figures occidentales, le tempérament russe se distingue par sa passion débridée mais authentique, comme l’illustre cette citation : « La négligence des Russes n’est-elle pas plus noble que la sueur honnête des Allemands ? »
Le texte se singularise aussi par son traitement des sommes en jeu. Dostoïevski mentionne diverses monnaies européennes du XIXe siècle – thalers, florins, francs, roubles – dont les équivalences précises permettent de mesurer l’ampleur des gains et des pertes. Ainsi, le gain majeur d’Alexeï s’élève à environ 61 000 roubles, somme colossale comparée aux 220 roubles de salaire annuel qu’il touchera plus tard comme secrétaire.
L’influence du « Joueur » ne s’est jamais démentie, comme en attestent ses multiples adaptations. En 1929, Sergueï Prokofiev en tire un opéra. Le cinéma s’en empare à plusieurs reprises : « The Great Sinner » (1949) avec Gregory Peck et Ava Gardner, « Le Joueur » (1958) de Claude Autant-Lara avec Gérard Philipe. Plus récemment, les films « Twenty Six Days from the Life of Dostoyevsky » (1981) et « The Gambler » (1997) se concentrent sur les circonstances extraordinaires de sa rédaction. Des adaptations radiophoniques par la BBC en 2010 et 2013 confirment sa résonnance contemporaine.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 272 pages.
9. Les Nuits blanches (1848)
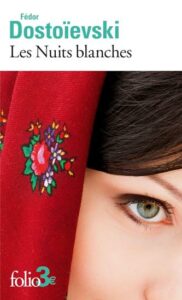
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Saint-Pétersbourg, années 1840. Un jeune homme solitaire de 26 ans erre la nuit dans les rues désertes. Fonctionnaire modeste, il mène une existence recluse, se décrit comme un « rêveur », créature à mi-chemin entre l’homme et le songe. Sa vie bascule lorsqu’il rencontre Nastenka, une jeune fille de 17 ans en larmes, appuyée contre un parapet. Après l’avoir secourue d’un importun, il engage la conversation. Elle accepte de le revoir le lendemain, à une seule condition : qu’il ne tombe pas amoureux.
Au fil de quatre nuits consécutives, les deux jeunes gens se retrouvent et se confient l’un à l’autre. Nastenka raconte son histoire : orpheline vivant avec sa grand-mère aveugle qui la surprotège, elle s’est éprise d’un locataire. Ce dernier est parti pour Moscou en lui promettant de revenir l’épouser un an plus tard. Le délai est désormais écoulé et elle attend toujours. Le narrateur, malgré sa promesse initiale, tombe éperdument amoureux de Nastenka qui, touchée par sa délicatesse, commence à lui rendre ses sentiments. Mais le destin en décide autrement.
Autour du livre
Rédigée entre septembre et novembre 1848, cette nouvelle s’inscrit dans une période intellectuellement féconde pour Dostoïevski qui fréquente alors les cercles littéraires pétersbourgeois. Sa publication dans la revue Otetchestvennye zapiski le 31 octobre 1848 intervient alors qu’il participe activement aux réunions du groupe des frères Beketov, avant de rejoindre le cercle de Mikhail Petrashevsky. Cette effervescence intellectuelle transparaît dans le texte à travers les réflexions philosophiques du narrateur.
L’histoire du manuscrit révèle des modifications significatives au fil des rééditions. En 1860, lors de la préparation de ses œuvres complètes, Dostoïevski retravaille en profondeur les monologues du protagoniste, leur insufflant une dimension plus marquée par l’influence de Pouchkine. Plus révélateur encore, son expérience du bagne le conduit à supprimer certains passages sur le repentir face au châtiment, témoignant d’une évolution profonde de sa pensée. La dédicace initiale à son ami Alexeï Plechtcheïev, maintenue dans l’édition de 1860, disparaît dans celle de 1865.
La réception critique immédiate se montre particulièrement favorable. Dans le Sovremennik de janvier 1849, Alexandre Droujinine salue une œuvre supérieure aux précédentes productions de l’auteur, notamment « Le Double » et « Les Pauvres Gens ». Il souligne la pertinence de l’analyse du « rêveur », figure qu’il considère comme représentative non seulement de la société pétersbourgeoise mais de toute une génération. Stepan Doudychkine, dans les Otetchestvennye zapiski, classe la nouvelle parmi les meilleures œuvres de 1848, louant particulièrement la finesse de son analyse psychologique.
L’originalité des « Nuits blanches » réside notamment dans son traitement du « rêveur », type social que Dostoïevski avait déjà esquissé dans ses feuilletons « Les Annales de Pétersbourg ». Le personnage principal incarne « cette créature de type intermédiaire » née, selon le romancier, de l’impossibilité pour la jeunesse russe de satisfaire sa « soif d’action » dans une société marquée par l’absence d’intérêts communs. Cette figure du rêveur, à la fois autobiographique et inspirée de Plechtcheïev, préfigure les futurs héros dostoïevskiens, notamment le narrateur des « Carnets du sous-sol ».
La structure temporelle s’articule autour du phénomène naturel des nuits blanches, période estivale où le soleil ne se couche que brièvement à Saint-Pétersbourg. Ce cadre temporel particulier crée une atmosphère suspendue propice aux confidences et aux épanchements sentimentaux. Le découpage en quatre nuits et un matin suit une progression dramatique qui culmine dans la désillusion finale du narrateur.
Les modifications apportées au texte lors des rééditions successives témoignent d’une maturation artistique. La suppression des passages les plus sentimentaux (« et fondit en larmes », « réprimant les larmes qui menaçaient de jaillir de mes yeux ») montre un souci croissant de sobriété dans l’expression des émotions. L’intégration plus marquée de références à Pouchkine dans l’édition de 1860 inscrit plus nettement l’œuvre dans la tradition littéraire russe.
La postérité remarquable des « Nuits blanches » tient sans doute à la manière dont elle conjugue une trame narrative simple avec une profonde réflexion sur la solitude et les illusions sentimentales. Au cinéma, la nouvelle inspire aussi bien des cinéastes européens majeurs comme Luchino Visconti (1957) et Robert Bresson (« Quatre nuits d’un rêveur », 1971) que des réalisateurs du monde entier, de l’Iran (Farzad Motamen, 2003) à l’Inde (Sanjay Leela Bhansali, « Saawariya », 2007), en passant par les États-Unis (James Gray, « Two Lovers », 2008). Le théâtre s’en empare régulièrement, tandis que plusieurs compositeurs en tirent des opéras, comme Youri Boutsko (1967) ou Evgueni Karmazine (2015).
Aux éditions FOLIO ; 112 pages.
10. Souvenirs de la maison des morts (1862)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Dans un bagne sibérien des années 1850, un noble condamné pour uxoricide découvre l’univers impitoyable de la détention. Alexandre Petrovitch Goriatchikov doit purger une peine de dix ans parmi des criminels issus des classes populaires qui le rejettent tout en maintenant une forme de respect paradoxal pour son rang social.
Après le choc initial de l’incarcération, Goriatchikov observe minutieusement la microsociété qui l’entoure. La « Maison des morts » – surnom donné à la prison d’Omsk -, abrite une galerie de personnages singuliers : Gazine le géant qui prenait plaisir à torturer des enfants, Akim Akimytch l’officier condamné pour avoir exécuté un prince caucasien, ou encore Petrov, capable de la plus extrême violence comme de la plus grande courtoisie. Entre les murs de la prison se côtoient meurtriers, voleurs et opposants politiques, une communauté régie par ses propres codes.
La vie s’organise autour du travail forcé, des trafics clandestins et des rares moments de répit. Les détenus bravent les interdits pour faire entrer de l’alcool, organisent des représentations théâtrales pendant les fêtes de Noël, trouvent dans ces activités interdites un semblant de liberté. La violence physique et morale est omniprésente, tant de la part des gardiens que des prisonniers entre eux.
Autour du livre
Premier roman consacré au système pénitentiaire russe, « Souvenirs de la maison des morts » s’inscrit comme une œuvre fondatrice de la littérature concentrationnaire. Sa genèse remonte à 1855, alors que Dostoïevski, encore en relégation à Semipalatinsk comme simple soldat, commence à coucher sur le papier son expérience du bagne d’Omsk où il vient de passer quatre années. Cette condamnation fait suite à son implication dans le Cercle Petrashevski, un groupe d’opposants à l’autocratie tsariste. Le 22 décembre 1849, à l’âge de 28 ans, il fait partie des 26 condamnés conduits sur le lieu de leur exécution. Au dernier moment, sa peine est commuée en travaux forcés par le tsar Nicolas Ier.
La publication s’échelonne sur plusieurs années : la première partie paraît en 1860, suivie de la seconde en 1862 dans la revue « Le Temps », éditée par son frère Mikhaïl. L’édition complète sort la même année et rencontre immédiatement un succès retentissant, comme le souligne André Markowicz dans sa présentation de l’œuvre.
L’originalité du texte réside dans sa structure qui rompt avec les codes romanesques traditionnels. L’absence d’intrigue conventionnelle laisse place à une succession de tableaux et de réflexions philosophiques, organisés par thèmes plutôt que selon une progression narrative classique. Cette architecture particulière permet à Dostoïevski de brosser une fresque monumentale de la vie carcérale, dressant le portrait d’environ 90 détenus et gardiens sur les 150 habitants du camp.
Le dispositif narratif s’avère sophistiqué : le récit est présenté comme les mémoires d’Alexandre Petrovitch Goriantchikov, découverts après sa mort par un narrateur anonyme qui les décrit comme « incohérents et fragmentaires… interrompus çà et là soit par des anecdotes, soit par d’étranges et terribles souvenirs surgissant convulsivement comme arrachés à l’écrivain. »
Dans une lettre à son frère Mikhaïl, Dostoïevski confie : « La quantité de types populaires et de caractères que j’ai rapportés du bagne suffira pour des volumes entiers. » De fait, nombres d’éléments et de personnages essaiment dans ses œuvres ultérieures. Le malfrat Pavlov Aristov inspire le personnage de Svidrigaïlov dans « Crime et Châtiment ». Le joaillier Isaï Boumstein réapparaît dans « Le Rêve de l’oncle ». L’histoire du vieux détenu qui simule une tentative de meurtre sur un sous-officier trouve un écho dans celle du peintre Dementiev de « Crime et Châtiment ».
Les réactions des contemporains témoignent de l’impact considérable du livre. Tolstoï, seul ouvrage de Dostoïevski qu’il admire, y voit « le modèle de l’art supérieur, religieux, provenant de l’amour de Dieu et du prochain ». Tourgueniev, pourtant peu enclin à louer les grandes œuvres dostoïevskiennes comme « Les Démons » ou « Crime et Châtiment », qualifie la scène des bains de « dantesque ». Alexandre Herzen pousse plus loin la comparaison en évoquant « une fresque dans l’esprit de Michel-Ange ». Le philosophe Ludwig Wittgenstein considère ce texte comme l’œuvre majeure de Dostoïevski.
En 1930, le compositeur tchèque Leoš Janáček en tire son ultime opéra. Deux ans plus tard, le réalisateur Vasili Fyodorov l’adapte au cinéma sur un scénario du critique Viktor Shklovsky, qui y tient également un rôle d’acteur.
Aux éditions FOLIO ; 512 pages.
11. Le Double (1846)
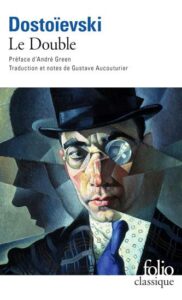
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
1846, une nuit de novembre glaciale à Saint-Pétersbourg. Le conseiller titulaire Iakov Petrovitch Goliadkine, petit fonctionnaire timide et asocial, se fait expulser sans ménagement du bal donné en l’honneur de Clara Olsoufievna, la fille de son supérieur hiérarchique. Il erre dans les rues enneigées de la capitale quand survient l’inexplicable : Goliadkine croise un homme qui lui ressemble trait pour trait.
Ce sosie, qui porte même son nom, est engagé le lendemain dans son service administratif. D’abord amical et complice, le double se révèle rapidement être l’exact opposé du protagoniste : charmeur, habile en société, il gravit rapidement les échelons professionnels tout en ridiculisant son double. Persuadé d’être victime d’un complot que personne ne semble remarquer, Goliadkine sombre peu à peu dans la folie.
Autour du livre
Achevé en 1846, juste après son premier roman « Les Pauvres Gens », « Le Double » marque une rupture avec l’accueil triomphal reçu par son œuvre précédente. Le jour de sa publication dans les Annales de la Patrie, Dostoïevski envoie une lettre enthousiaste à son frère Mikhaïl, où sa confiance transparaît : « Les nôtres disent que la Russie n’a rien connu de semblable depuis les Âmes mortes, que l’œuvre est géniale ». Cet optimisme se heurte rapidement à la réception mitigée du roman.
Dans les cercles littéraires de Saint-Pétersbourg, notamment celui du critique influent Belinski, la déception prédomine. Les lecteurs jugent le texte trop long, confus et difficile à suivre. Une fracture se crée entre les premiers auditeurs conquis par les chapitres lus en comité restreint et le public plus large qui découvre l’œuvre dans son intégralité. Comme le relate Dostoïevski à son frère en avril 1846 : « Tous, c’est le discours général, tous, c’est-à-dire les nôtres et l’ensemble du public, ont trouvé que Goliadkine était à ce point ennuyeux, mou, à ce point délayé qu’il était impossible à lire. »
L’échec cuisant du « Double » marque profondément Dostoïevski, au point qu’il tente à plusieurs reprises de le remanier. Une nouvelle version voit le jour en 1866, intégrant des modifications substantielles. Tourgueniev, peu indulgent, qualifie alors l’ouvrage de « nouvelle verrue sur le nez de la littérature russe ». Cette hostilité quasi unanime contraste avec le jugement ultérieur de Vladimir Nabokov qui, malgré son antipathie notoire pour Dostoïevski, considère « Le Double » comme sa meilleure réalisation.
Le roman s’inscrit dans une double tradition littéraire russe : celle du « pauvre fonctionnaire », héritée des « Nouvelles de Pétersbourg » de Gogol, et celle du « romantique sentimental ». La critique contemporaine souligne particulièrement cette filiation gogolienne, certains allant jusqu’à accuser Dostoïevski de plagiat. Le critique Konstantin Aksakov note ainsi que « Dostoïevski altère et répète entièrement les phrases de Gogol ». Néanmoins, cette apparente imitation masque une innovation narrative majeure : là où Gogol privilégie une perspective sociale, Dostoïevski opte pour une immersion psychologique.
Cette dimension psychologique se manifeste notamment dans la technique narrative polyphonique identifiée par Mikhaïl Bakhtine. Les événements sont principalement relatés à travers le prisme de la conscience troublée du protagoniste, créant une ambiguïté permanente entre réalité et hallucination. Cette construction complexe, qui déstabilisait les premiers lecteurs, préfigure les grandes œuvres ultérieures de Dostoïevski.
L’influence du « Double » se mesure à ses nombreuses adaptations dans différents médiums. Au cinéma, Bernardo Bertolucci s’en inspire pour « Partner » (1968), tandis que Richard Ayoade en propose une relecture contemporaine dans « The Double » (2013) avec Jesse Eisenberg. Un projet ambitieux de Roman Polanski avec John Travolta échoue en 1997. La BBC l’adapte également pour la radio en 2018, transposant l’intrigue dans un « Saint-Pétersbourg steampunk du XIXe siècle ».
Aux éditions FOLIO ; 288 pages.
12. Humiliés et offensés (1861)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Saint-Pétersbourg, années 1860. Un jeune écrivain, Ivan Petrovitch, croise le chemin d’un vieil homme mystérieux qu’il suit jusqu’à une confiserie. Après avoir assisté à la mort de cet homme, Ivan décide de louer sa chambre, où il rencontre bientôt Elena, une orpheline de treize ans à la santé fragile. Cette rencontre s’entremêle avec une autre histoire : celle de Natalia, dont Ivan est secrètement amoureux depuis l’enfance.
Natalia est la fille d’un intendant ruiné par un procès injuste intenté par son ancien employeur, le prince Valkovski. La jeune femme s’enfuit avec Aliocha, le fils du prince, provoquant la colère de son père qui la maudit. Ivan, épris de Natalia, met de côté ses sentiments pour aider le couple, tandis que le prince Valkovski manœuvre en coulisse pour marier son fils à une riche héritière.
Les deux intrigues convergent quand on apprend qu’Elena est la fille cachée du prince Valkovski, fruit d’une liaison avec une femme qu’il a abandonnée après l’avoir ruinée. La mort d’Elena, emportée par une maladie cardiaque après avoir révélé son histoire, permet la réconciliation entre Natalia et son père, mais ne peut empêcher Aliocha de finalement choisir le mariage arrangé par son père.
Autour du livre
« Humiliés et offensés » émerge dans un contexte historique particulièrement significatif : premier grand roman de Dostoïevski après son exil sibérien, il paraît en 1861, année charnière marquée par l’émancipation des serfs en Russie. Cette réforme majeure, loin d’améliorer véritablement le sort des paysans, les contraint à payer des impôts spéciaux tout en les reléguant aux terres les moins fertiles. Cette situation sociale tendue nourrit l’émergence d’un puissant mouvement révolutionnaire porté par l’intelligentsia, notamment incarnée par Nikolaï Chernichevski et Nikolaï Dobrolioubov.
Le roman est publié en feuilleton dans la revue Vremya, fondée par Dostoïevski avec son frère Mikhaïl. Cette contrainte éditoriale impose au romancier une écriture fragmentée, soumise aux impératifs des délais de publication. Chaque segment doit être livré pour le nouveau numéro, sans possibilité de révision. Ces conditions se reflètent dans la structure même du texte, qui emprunte aux codes du roman-feuilleton : chapitres aux fins abruptes destinées à maintenir le suspense, effets dramatiques prononcés, personnages parfois figés dans leur symbolisme.
« Humiliés et offensés » se positionne comme une réponse conservatrice au nihilisme cynique de l’époque, représenté par le personnage du prince Valkovski. Cette dimension idéologique se traduit par une défense des valeurs familiales traditionnelles et de l’orthodoxie russe face aux théories matérialistes alors en vogue. Le conflit entre le bien et le mal n’aboutit pas à une résolution manichéenne : si le prince Valkovski parvient à ses fins concernant son fils, et si l’abandon de la mère d’Elena reste impuni, la réconciliation familiale des Ikméniev offre une forme de rédemption.
La critique manifeste une certaine réserve, possiblement liée à la méfiance envers un écrivain tout juste revenu d’exil. Seul « Le Contemporain », journal d’orientation démocratique, salue les qualités du roman malgré ses défauts. Le public, en revanche, répond favorablement à cette œuvre qui préfigure plusieurs thèmes majeurs de la bibliographie dostoïevskienne, notamment dans le personnage d’Elena, dont la maladie et le destin tragique annoncent le personnage d’Ilyusha dans « Les Frères Karamazov ».
Le cinéma s’en empare dès 1922 avec une version allemande muette. En 1991, le réalisateur soviétique Andreï Echpaï en propose une adaptation avec Nastassja Kinski. Le cinéaste Akira Kurosawa s’en inspire partiellement pour « Barbe-Rouge » (1965), tandis qu’une adaptation hongkongaise de 1950 transpose l’intrigue dans le Shanghai d’après-guerre. La télévision italienne en propose également une version remarquée en 1958. La postérité du roman s’étend jusqu’au théâtre contemporain, comme en témoignent les adaptations scéniques de Frank Castorf aux Wiener Festwochen en 2001, de Sebastian Hartmann au Staatsschauspiel Dresden en 2018, ou encore de Sascha Hawemann au Volkstheater de Vienne en 2021.
Aux éditions FOLIO ; 624 pages.
13. L’Éternel Mari (1870)
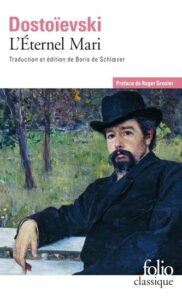
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Alexeï Veltchaninov, un aristocrate de Saint-Pétersbourg, remarque qu’un homme le suit depuis plusieurs jours dans les rues de la ville. Un soir, cet homme frappe à sa porte : il s’agit de Pavel Pavlovitch Troussotzky, le mari d’une femme avec qui Veltchaninov avait eu une liaison neuf ans plus tôt. Troussotzky est maintenant veuf. Il vient annoncer la mort de son épouse, mais surtout présenter à Veltchaninov sa fille Lisa, huit ans, dont il est en réalité le père biologique.
Veltchaninov, inquiet de voir sa fille sous la garde d’un homme instable et alcoolique, décide de placer Lisa dans une famille d’accueil. La petite fille, déjà malade, y meurt quelques jours plus tard. Mais l’histoire ne s’arrête pas là : Troussotzky, dans un mélange de fascination morbide et de haine envers l’ancien amant de sa femme, l’implique dans ses projets de remariage avec Nadia, une adolescente de quinze ans. Cette dernière, déjà secrètement fiancée à un jeune homme, refuse ses avances. La tension entre les deux hommes culmine lors d’une nuit où Troussotzky tente de tuer Veltchaninov avec un rasoir.
Autour du livre
« L’Éternel Mari », écrit durant le séjour de Dostoïevski à Dresde, s’inspire notamment des souvenirs de la relation entre A. E. Wrangel, ami de l’écrivain, et Ekaterina Iossifovna Gerngross, épouse du chef du district minier de l’Altaï. Pour le personnage de Troussotzky, Dostoïevski s’est inspiré de la personnalité de Stepan Ianovski, son médecin personnel qui connut des démêlés conjugaux.
L’œuvre dialogue avec plusieurs textes majeurs : les comédies de Molière « L’École des femmes » et « L’École des maris », « Madame Bovary » de Gustave Flaubert, ainsi que « La Provinciale » d’Ivan Tourgueniev. Le philosophe René Girard y décèle un exemple significatif de sa théorie de la médiation interne fondée sur le désir mimétique. Dans son analyse, il souligne l’absence de l’objet du désir (la femme) dans le triangle des relations, puisqu’elle est morte. Les protagonistes développent une relation ambivalente : Veltchaninov ressent le devoir de s’occuper de Troussotzky tout en souhaitant s’en éloigner, tandis que ce dernier recherche sa présence tout en nourrissant des désirs meurtriers à son égard.
Le livre a connu de nombreuses adaptations cinématographiques à travers l’Europe, notamment « L’Homme au chapeau rond » de Pierre Billon en 1946 avec Raimu, « La Vengeance d’une femme » de Jacques Doillon en 1990 avec Isabelle Huppert, et une adaptation télévisée en 1993 avec Roger Hanin. Henry Miller considérait cette œuvre comme sa préférée parmi celles de Dostoïevski, tandis que le critique Alfred Bem la qualifie d’une des réalisations les plus abouties du romancier en termes de composition et de développement.
Aux éditions FOLIO ; 286 pages.