Albert Camus naît le 7 novembre 1913 à Mondovi en Algérie française. Un peu moins d’un an plus tard, son père meurt à la guerre, laissant sa mère Catherine, à moitié sourde et analphabète, élever seule ses deux fils dans le quartier populaire de Belcourt à Alger. Grâce à son instituteur Louis Germain qui détecte ses talents, le jeune Albert obtient une bourse pour étudier au lycée. Malgré la tuberculose qui le frappe en 1930, il poursuit brillamment ses études.
En 1934, il épouse Simone Hié dont il divorce quelques années plus tard. Il commence alors une carrière de journaliste et publie ses premiers textes. En 1940, il se marie avec Francine Faure et s’installe à Paris. La publication de « L’étranger » et du « Mythe de Sisyphe » en 1942 le fait connaître. Pendant l’Occupation, il entre dans la Résistance et dirige le journal Combat. Dans l’après-guerre, il publie des œuvres majeures comme « La peste » (1947) et « L’homme révolté » (1951) qui provoque sa rupture avec Sartre.
Durant les années 1950, Camus prend position sur la guerre d’Algérie, plaidant pour une solution équitable qui préserverait la coexistence des communautés. En 1957, il reçoit le prix Nobel de littérature. Le 4 janvier 1960, il meurt dans un accident de voiture à Villeblevin, alors qu’il rentre à Paris avec son éditeur Michel Gallimard. Dans sa sacoche, on retrouve le manuscrit inachevé du « Premier homme » (1994).
Écrivain engagé, dramaturge, philosophe, Camus laisse une œuvre marquée par la question de l’absurde et de la révolte, ainsi qu’une réflexion profonde sur la condition humaine. Son style dépouillé et son humanisme continuent d’influencer la littérature et la pensée contemporaines.
Voici notre sélection de ses livres majeurs.
1. L’étranger (roman, 1942)
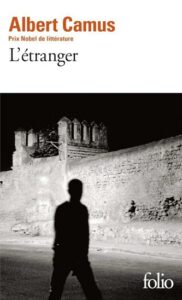
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
« Aujourd’hui, maman est morte. » Ainsi débute « L’étranger », le roman phare d’Albert Camus paru en 1942. Meursault, un modeste employé algérois, apprend le décès de sa mère. Lors de l’enterrement, pas une larme ne coule sur son visage. Le chagrin lui est étranger. Comme tout le reste. Il rencontre Marie, une jeune femme pétillante. Elle l’aime, lui propose le mariage. Mais Meursault demeure insaisissable, indifférent aux conventions sociales.
Un jour de canicule, sur une plage écrasée de soleil, Meursault abat un Arabe de cinq balles dans le corps. Lors de son procès, son crime passe au second plan. C’est son apparente insensibilité qui dérange. Son absence de remords. Son honnêteté dérangeante. Condamné à mort, Meursault refuse la consolation de l’aumônier. Seul face à l’échafaud, il embrasse « la tendre indifférence du monde », conscient de l’absurdité de son existence.
Autour du livre
« L’étranger » naît dans un contexte particulier : en pleine Seconde Guerre mondiale, alors qu’Albert Camus travaille comme journaliste à Paris-Soir avant de rejoindre la Résistance. Les premières traces du manuscrit remontent à 1938, mais c’est au début de 1940 que le texte prend sa forme définitive, après un travail intense qui s’étend jusqu’en 1941. Le roman s’inscrit dans un projet philosophique plus vaste que Camus nomme « cycle de l’absurde », comprenant également l’essai « Le mythe de Sisyphe » et les pièces de théâtre « Caligula » et « Le Malentendu ». Sa genèse révèle des échanges féconds avec d’autres figures littéraires majeures de l’époque. André Malraux, après lecture du manuscrit, transmet par l’intermédiaire de Pascal Pia des remarques stylistiques décisives sur la construction phrastique.
Dès sa parution, « L’étranger » suscite des réactions intellectuelles majeures. Jean-Paul Sartre lui consacre tout un article, « Explication de L’étranger », publié en 1943. Il y perçoit la volonté de faire ressentir au lecteur le « sentiment de l’absurde ». Camus apporte une nuance à cette interprétation : le roman ne cherche pas tant à démontrer l’absurdité du monde qu’à mettre en scène la confrontation entre l’irrationalité de l’existence et le désir de sens. Le philosophe Gabriel Marcel propose une lecture critique dans « Le refus du salut et l’exaltation de l’homme absurde », où il reproche à Camus son « monadisme radical ». Cette critique s’inscrit dans un débat plus large sur la dimension métaphysique du roman.
La dimension politique et coloniale de « L’étranger » soulève aussi des questions. Edward Saïd, dans « Culture et impérialisme », met en lumière l’ancrage historique du roman dans l’Algérie coloniale. Il note que les personnages arabes, jamais nommés, constituent un arrière-plan silencieux à la vie des personnages européens. Cette lecture mérite d’être contextualisée : dès 1945, Camus prend publiquement position contre le colonialisme.
Le succès du roman ne s’est jamais démenti. Il devient le deuxième plus grand succès des Éditions Gallimard, derrière « Le Petit Prince ». Traduit en soixante-huit langues, il se classe au troisième rang des romans francophones les plus lus dans le monde. En 1999, il atteint la première place du classement des cent meilleurs livres du XXe siècle réalisé par des journalistes du Monde et des libraires de la Fnac. Le Cercle norvégien du livre l’intègre en 2002 dans sa liste des cent meilleurs livres de tous les temps, établie à partir des propositions de cent écrivains issus de cinquante-quatre pays.
Les adaptations se multiplient dans différents domaines artistiques. Au cinéma, un premier projet ambitieux se dessine au début des années 1950 avec Jean Renoir à la réalisation et Gérard Philipe dans le rôle de Meursault. Les négociations échouent en février 1951, notamment en raison du montant des droits de cession. Ingmar Bergman manifeste ensuite son intérêt, mais le projet n’aboutit pas. C’est finalement Luchino Visconti qui réalise en 1967 l’adaptation cinématographique, avec Marcello Mastroianni dans le rôle principal.
En 1978, Robert Smith, leader des Cure, compose « Killing an Arab ». Le groupe Tuxedomoon crée le morceau « L’étranger » en 1982. Plus récemment, une performance musicale originale, « Albert Camus lit L’Étranger Remix », mêle des enregistrements originaux de Camus lisant son texte en 1954 à des compositions électroniques. La bande dessinée offre de nouvelles lectures avec les adaptations de José Muñoz et Jacques Ferrandez. En 2013, Kamel Daoud donne la parole au frère de « l’Arabe » tué par Meursault avec « Meursault, contre-enquête ». Ce livre remporte le prix Goncourt du premier roman en 2015 et manque de peu le Goncourt 2014.
Aux éditions FOLIO ; 192 pages.
2. La peste (roman, 1947)
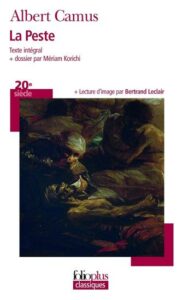
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Années 1940, Oran, Algérie française. Des rats meurent par centaines dans les rues. Bientôt, ce sont les hommes qui succombent, frappés par la peste. Le docteur Rieux pressent le danger, mais les autorités tardent à réagir. Quand elles se décident enfin, il est trop tard. La ville est mise en quarantaine, coupée du monde. Le fléau se propage. Peur, souffrances et séparations sont le lot des habitants. Le docteur Rieux, lui, soigne inlassablement les pestiférés. Avec quelques volontaires, comme Tarrou ou Rambert, il organise des formations sanitaires. Mais comment lutter contre un mal aussi absurde, qui condamne même les enfants innocents ? Comment garder espoir et humanité quand l’épidémie désagrège les liens et les âmes ?
Autour du livre
Dans les années 1930, Camus pose les premières pierres de ce qui deviendra « La peste » en notant dans ses Carnets des réflexions éparses sur « la peste libératrice ». Le roman ne prendra véritablement forme qu’en 1941, alors que la France vit sous l’Occupation. Cette gestation de cinq années, que ses biographes nomment les « années peste », coïncide avec une période mouvementée pour l’écrivain : engagement dans la Résistance, rechute de sa tuberculose, naissance de ses jumeaux Catherine et Jean.
La première version du manuscrit, rédigée au Panelier en Haute-Loire, près du village du Chambon-sur-Lignon – qui sera plus tard honoré comme « Village des Justes » – présente une structure narrative différente : quatre narrateurs se succèdent pour livrer leur vision des événements. Dans la version finale, seul subsiste le docteur Rieux, narrateur masqué qui ne révèle son identité qu’à la dernière page. Ce choix renforce la dimension testimoniale du récit, porté par celui qui fut au cœur de la lutte contre l’épidémie.
L’ancrage du roman dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale est manifeste dès l’épigraphe, empruntée à Daniel Defoe : « Il est aussi raisonnable de représenter une espèce d’emprisonnement par une autre que de représenter n’importe quelle chose qui existe réellement par quelque chose qui n’existe pas. » La date tronquée « 194… » renvoie explicitement aux années d’Occupation, tandis que l’évolution de la situation sanitaire dans Oran fait écho à la progression du nazisme en Europe : d’abord minimisée, la menace s’impose peu à peu jusqu’à transformer radicalement la vie quotidienne.
Cette lecture allégorique suscite néanmoins des controverses. Si Jean-Paul Sartre salue d’abord le roman dans « Qu’est-ce que la littérature ? », il critiquera plus tard l’assimilation des Allemands à des microbes, y voyant une forme de déresponsabilisation. Les formations sanitaires ne sauraient non plus être strictement assimilées à la Résistance : là où celle-ci fut armée et clandestine, celles-là opèrent au grand jour dans un cadre légal.
La question de la Shoah traverse également « La peste », notamment à travers les allusions aux fours crématoires. Mais Camus, qui avait lu « L’Univers concentrationnaire » de David Rousset en 1946, refuse de s’approprier une expérience qu’il n’a pas vécue : « Ce qui me ferme la bouche, c’est que je n’ai pas été déporté. Mais je sais quel cri j’étouffe en disant ceci. »
« La peste » marque une évolution significative dans la pensée camusienne. Si l’absurde reste central – notamment à travers la mort inexplicable d’enfants innocents – la solidarité émerge comme une réponse possible face au mal. Les personnages incarnent différentes attitudes : résistance active du docteur Rieux, conversion de Rambert à la cause collective, opportunisme de Cottard, interprétation théologique du père Paneloux. Leur confrontation dessine une réflexion sur les fondements de l’action morale dans un monde privé de transcendance.
Le succès ne se dément pas depuis 1947. Traduit dans une dizaine de langues, « La peste » devient le troisième plus grand succès des éditions Gallimard après « Le Petit Prince » et « L’étranger ». La pandémie de Covid-19 lui offre une résonance inattendue : les ventes triplent en Italie pendant le confinement de 2020, tandis que l’éditeur britannique Penguin Classics peine à répondre à la demande. Catherine Camus, fille de l’écrivain, souligne alors l’actualité du message : « Nous ne sommes pas responsables du coronavirus mais nous pouvons être responsables de notre réponse. »
Les adaptations témoignent de cette postérité féconde. En 1963, Roberto Gerhard, compositeur catalan exilé en Angleterre pour fuir le franquisme, en tire un poème symphonique. Le cinéma s’en empare à plusieurs reprises, notamment avec Luis Puenzo en 1992 et Kim Nguyen en 2010. Francis Huster le porte au théâtre en 2011-2012. En 2020, la BBC en propose une adaptation radiophonique pendant le confinement, les acteurs enregistrant leurs parties depuis leur domicile. Le manga s’en saisit en 2021 avec une version en quatre tomes signée Ryota Kurumado. En 2024, une mini-série française réalisée par Georges-Marc Benamou et Antoine Garceau actualise à nouveau le propos.
Cette multiplicité d’adaptations souligne la puissance universelle du roman. Par sa chronique lucide d’une ville confrontée au fléau, Camus interroge la nature humaine dans ses réactions face au mal, sans jamais céder au manichéisme. La conclusion du narrateur résonne comme un manifeste humaniste : « pour dire simplement ce qu’on apprend au milieu des fléaux, qu’il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser. »
Aux éditions FOLIO ; 400 pages.
3. La Chute (roman, 1956)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Amsterdam, années 1950. Dans un bar louche du quartier des marins, un ancien avocat parisien nommé Jean-Baptiste Clamence aborde un compatriote français. Au fil des verres et des jours, il lui confie son histoire : celle d’un homme qui régnait autrefois sur les prétoires parisiens, défendait la veuve et l’orphelin avec talent, multipliait les conquêtes féminines et les actes de générosité apparente.
Mais un soir, alors qu’il traverse le Pont Royal, Clamence voit une femme se jeter dans la Seine. Au lieu de lui porter secours, il poursuit son chemin, paralysé par la peur et l’indécision. Cet événement le hante et provoque sa chute morale. Il prend alors conscience de sa vanité, de son hypocrisie, de l’imposture de sa vie entière. Incapable de continuer à jouer son rôle d’homme vertueux, il quitte Paris pour les bas-fonds d’Amsterdam où il se livre à la débauche avant de devenir ce mystérieux « juge-pénitent ».
Autour du livre
Publié en 1956 chez Gallimard, « La Chute » occupe une place à part dans l’œuvre de Camus. Initialement destiné au recueil « L’Exil et le Royaume », le texte prend une ampleur inattendue pour devenir une œuvre autonome, ultime fiction achevée de l’auteur. Jean-Paul Sartre la qualifiera plus tard de « peut-être la plus belle et la moins comprise » des œuvres de Camus.
Le contexte de rédaction éclaire la genèse du roman. Camus l’écrit rapidement fin 1955, en réponse aux polémiques qui ont suivi la publication de « L’homme révolté » en 1951. Son essai, qui condamnait toute forme de violence politique, lui avait valu les foudres de nombreux intellectuels de gauche, Sartre en tête. À travers le personnage de Clamence, Camus règle ses comptes avec le milieu intellectuel parisien, tout en s’incluant dans cette critique acerbe.
Le choix d’Amsterdam comme décor ne doit rien au hasard. La ville sous le niveau de la mer contraste avec le goût de Clamence pour les hauteurs, symbolisant sa chute morale. Les canaux concentriques évoquent explicitement les cercles de l’Enfer dantesque, le quartier rouge et le bar Mexico City étant les points les plus bas de cette descente aux enfers moderne. Le bar a d’ailleurs réellement existé.
« La Chute » tire sa force de son dispositif narratif singulier : un monologue-confession adressé à un interlocuteur muet, dans lequel le lecteur se trouve piégé. Cette parole sans réponse crée un malaise croissant, renforcé par l’atmosphère brumeuse et déshumanisée d’Amsterdam. Le tableau volé des « Juges intègres » du retable de Gand, que Clamence garde chez lui, ajoute une dimension symbolique supplémentaire à cette méditation sur la culpabilité et le jugement.
La réception de l’œuvre dépasse le cadre littéraire : William Styron y voit le portrait saisissant d’un homme en proie à une profonde dépression, tandis que Romain Gary révèle que Camus lui-même traversait alors une période dépressive. Le groupe post-punk The Fall choisira son nom en hommage au roman, témoignant de sa résonance dans la culture populaire.
L’universalité du propos, qui interroge la possibilité même de l’innocence après la Seconde Guerre mondiale, confère à « La Chute » une actualité persistante. Le quartier juif d’Amsterdam où réside Clamence, vidé de ses habitants par les nazis, devient le lieu symbolique d’une réflexion sur la culpabilité collective et la capacité humaine au mal.
Aux éditions FOLIO ; 224 pages.
4. La mort heureuse (roman, 1971)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Dans l’Algérie des années 1930, Patrice Mersault, modeste employé du port d’Alger, mène une existence terne. Sa rencontre avec Zagreus, un homme fortuné devenu infirme après un accident, va tout bouleverser. Ce dernier, las de sa condition, propose à Mersault de le tuer en échange de son argent. Le crime est maquillé en suicide. Désormais riche, Mersault part pour l’Europe, séjourne à Prague puis à Gênes, avant de revenir en Algérie.
Entre relations amoureuses compliquées et quête obsessionnelle du bonheur, Mersault oscille. Il entretient une liaison avec Marthe, qui ne l’aime pas comme il le voudrait, puis épouse Lucienne, pour qui ses sentiments restent tièdes. La solitude finit par s’imposer comme un choix délibéré. Il s’installe dans une maison face à la mer, dans le Chenoua, où la maladie le rattrape. Dans ses derniers instants, face aux paysages lumineux d’Algérie, il atteint peut-être enfin cet état de plénitude tant recherché.
Autour du livre
« La mort heureuse » est la première tentative romanesque d’Albert Camus, rédigée entre 1936 et 1938, alors qu’il n’a que vingt-trois ans. Ce manuscrit, resté inédit jusqu’en 1971, soit onze ans après la disparition de l’écrivain, préfigure son chef-d’œuvre « L’étranger ». Les similitudes sont frappantes, à commencer par leurs protagonistes aux patronymes quasi identiques : Patrice Mersault pour « La mort heureuse », Meursault pour « L’étranger ».
Cette première œuvre puise abondamment dans les souvenirs de Camus : le quartier populaire de Belcourt où s’est déroulée sa jeunesse, la bataille de la Marne qui lui a ravi son père, la tuberculose qui l’a accompagné toute sa vie, jusqu’à son oncle tonnelier, sourd et quasi muet, qui trouve son double dans un personnage secondaire.
Les différences avec « L’étranger » s’avèrent néanmoins significatives. Le passage de la troisième personne dans « La mort heureuse » à la première personne dans « L’étranger » transforme radicalement la perspective narrative. Le meurtre, central dans les deux récits, change également de nature : prémédité et consenti par la victime dans « La mort heureuse », il devient gratuit et inexplicable dans « L’étranger ».
La quête du bonheur, thème cardinal de ce premier roman, se déploie à travers une réflexion sur les moyens de son acquisition. L’argent y apparaît comme un instrument paradoxal : nécessaire pour gagner le temps indispensable au bonheur, il ne peut pourtant le garantir. La solitude, d’abord fuie puis recherchée, devient la voie privilégiée vers une forme de plénitude, tandis que la mort, loin d’être une fin tragique, se métamorphose en ultime accomplissement.
Cette œuvre de jeunesse, si elle ne possède pas encore la maîtrise de « L’étranger », dévoile déjà les obsessions qui nourriront toute l’œuvre camusienne : l’absurdité de l’existence, la recherche du bonheur, la confrontation avec la mort, la quête d’authenticité face aux conventions sociales.
Aux éditions FOLIO ; 176 pages.
5. Le premier homme (roman autobiographique, 1994)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
« Le premier homme » est tiré d’un manuscrit d’Albert Camus, retrouvé inachevé dans sa sacoche lors de l’accident de voiture qui lui coûta la vie en janvier 1960. Ce roman autobiographique s’ouvre sur une nuit orageuse de 1913 dans un village algérien, alors qu’une femme met au monde un enfant dont le père mourra quelques mois plus tard dans les tranchées de la Grande Guerre.
Quarante ans après, Jacques Cormery, double romanesque de Camus, se rend sur la tombe de ce père qu’il n’a jamais connu. Face à la pierre tombale, une révélation le bouleverse : l’homme enterré là est mort plus jeune que lui. Cette prise de conscience déclenche en lui le besoin impérieux de comprendre qui était ce père, de reconstituer son histoire.
Il retourne alors en Algérie interroger sa mère, cette femme à demi-sourde et presque muette qui vit toujours dans le quartier pauvre de son enfance. Mais les réponses sont rares, et c’est plutôt vers ses propres souvenirs que Jacques se tourne : l’autorité de sa grand-mère, la tendresse maladroite de sa mère, les parties de football avec les copains, et surtout la figure lumineuse de son instituteur, M. Bernard, qui lui permit d’échapper à la misère grâce aux études.
À travers cette quête des origines se dessine le portrait d’une famille modeste dans l’Algérie coloniale, où la pauvreté n’empêche pas le bonheur, où le silence des êtres cache parfois leur profonde humanité. Le récit évoque avec pudeur et sensibilité cette enfance sous le soleil d’Alger, marquée par l’absence du père mais aussi par la force des liens familiaux.
Autour du livre
« Le premier homme » occupe une place singulière dans la bibliographie de Camus. Ce manuscrit inachevé, retrouvé dans la sacoche qu’il portait lors de son accident mortel le 4 janvier 1960, ne sera publié qu’en 1994 par sa fille Catherine. Sa genèse remonte à 1953, année où Camus commence à nourrir l’ambition d’écrire une fresque comparable à « La guerre et la paix » de Tolstoï. Il conçoit alors ce livre comme le premier volet d’une trilogie incluant « Don Faust » et « Le mythe de Némésis ».
Le texte s’articule autour de deux parties : « Recherche du père » et « Le fils ou le premier homme ». La première, minutieusement travaillée, entremêle la quête identitaire de 1953 aux réminiscences d’enfance. La seconde, moins aboutie, juxtapose des scènes d’enfance saisies sur le vif et des méditations sur la condition d’orphelin. Les notes de travail retrouvées suggèrent que l’ouvrage devait aborder plus largement les liens familiaux et la guerre d’Algérie, conflit qui déchirait alors le pays.
Le titre même revêt une dimension allégorique multiple : il évoque tant l’orphelin contraint de se construire sans modèle paternel que l’exilé devant réinventer son existence, ou plus universellement l’être humain perpétuellement en quête de lui-même. « Le premier homme » transcende ainsi la simple autobiographie pour atteindre une portée politique et symbolique, notamment à travers l’histoire de l’Algérie coloniale et le plaidoyer pour une coexistence pacifique entre les communautés.
La publication de 1994 a préservé l’état brut du manuscrit, y compris ses passages illisibles. Les éditions Gallimard prévoient une nouvelle édition enrichie grâce aux technologies modernes. « Le premier homme » a inspiré plusieurs adaptations : un film de Gianni Amelio en 2012 et deux versions en bande dessinée, l’une illustrée par José Muñoz en 2013, l’autre adaptée par Jacques Ferrandez en 2017.
Aux éditions FOLIO ; 380 pages.
6. Le mythe de Sisyphe (essai philosophique, 1942)
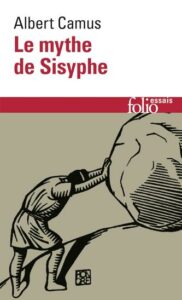
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Comment vivre dans un monde dépourvu de sens ? En 1942, « Le mythe de Sisyphe » bouscule la philosophie traditionnelle en plaçant le suicide au cœur de sa réflexion. Avec cet essai percutant, Albert Camus, alors jeune journaliste de vingt-huit ans, s’attaque à la question de l’absurdité de la condition humaine.
L’argument central se déploie autour du décalage entre notre soif de comprendre et l’opacité d’un univers qui refuse obstinément de livrer ses secrets. Cette confrontation fait naître l’absurde, notion clé qui traverse l’ensemble de l’ouvrage. Pour l’illustrer, Camus convoque la figure mythologique de Sisyphe, condamné par les dieux à pousser éternellement un rocher jusqu’au sommet d’une montagne, d’où il redescend invariablement.
Plutôt que de céder au désespoir ou de se réfugier dans des consolations métaphysiques, Camus propose une voie radicale : celle de la révolte lucide. Il s’agit d’embrasser pleinement la condition absurde sans renoncer à vivre intensément, transformer l’absence de sens en liberté absolue.
Autour du livre
Rédigé dans la France occupée de 1940, alors que des millions de réfugiés fuient devant l’avancée allemande, « Le mythe de Sisyphe » puise sa force dans ce contexte historique dramatique. L’absurdité de la guerre résonne avec la quête philosophique de Camus, même si l’essai n’y fait que rarement référence directe. Dédié à Pascal Pia, directeur d’Alger républicain où Camus fit ses débuts journalistiques, l’ouvrage s’inscrit dans un cycle plus large comprenant « L’étranger » et « Caligula », formant une trilogie sur l’absurde.
La structure de l’essai révèle une progression méthodique en quatre chapitres, couronnés par un appendice sur Kafka. Le premier chapitre pose les fondements du raisonnement absurde. Le deuxième dessine le portrait de « l’homme absurde » à travers trois figures emblématiques : Don Juan, l’acteur et le conquérant. Le troisième examine la création artistique face à l’absurde, notamment à travers l’œuvre de Dostoïevski. Le quatrième, point culminant, réinterprète le mythe de Sisyphe.
« Le mythe de Sisyphe » marque une rupture avec l’existentialisme traditionnel. Si Camus emprunte à Kierkegaard, Schopenhauer et Nietzsche, il s’en démarque en refusant tout « saut » vers la transcendance. Sa réflexion inaugure une philosophie originale qui influencera profondément la pensée contemporaine. La traduction anglaise de 1955 par Justin O’Brien étend cette influence au monde anglophone. La force du texte réside dans son refus du désespoir comme de l’espoir facile. En affirmant que « il faut imaginer Sisyphe heureux », Camus transforme la malédiction en défi. Cette formule célèbre, empruntée au philosophe japonais Shūzō Kuki, condense toute sa philosophie de la révolte lucide.
Les critiques contemporains ont parfois reproché à Camus ses lectures supposément superficielles des philosophes qu’il cite. Ces accusations manquent l’essentiel : la puissance d’une pensée qui, sans prétendre à l’exhaustivité universitaire, ouvre des perspectives neuves sur la condition humaine. L’influence du texte se mesure à ses innombrables échos dans la culture contemporaine, de la littérature au cinéma.
Le dialogue avec Kafka, relégué en appendice, mérite une attention particulière. En critiquant l’ « espoir » kafkaïen, Camus affine sa propre position : ni désespoir ni espérance, mais acceptation rebelle. Cette tension féconde nourrira ses œuvres ultérieures, notamment « L’homme révolté » (1951) qui prolonge et approfondit ces réflexions.
Aux éditions FOLIO ; 169 pages.
7. L’homme révolté (essai philosophique, 1951)
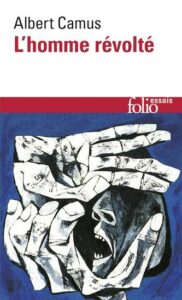
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Publié en 1951, « L’homme révolté » constitue le prolongement philosophique du « Mythe de Sisyphe », où Camus s’interrogeait sur l’absurdité de l’existence et le suicide. Dans cet essai, il interroge les fondements et les manifestations de la révolte à travers l’histoire occidentale, depuis les premières contestations bibliques jusqu’aux totalitarismes du XXe siècle.
La réflexion s’articule autour d’une question centrale : comment maintenir l’esprit de révolte sans sombrer dans le nihilisme meurtrier ? Pour y répondre, Camus convoque les grandes figures de la pensée révoltée : Sade, qui théorise la négation absolue ; les romantiques, qui défient Dieu ; Nietzsche, qui proclame sa mort ; jusqu’aux révolutionnaires qui, de Saint-Just à Lénine, rationalisent la violence au nom d’un idéal. À travers ce panorama, il montre comment la révolte légitime contre l’injustice peut dégénérer en révolution totalitaire quand elle perd de vue ses limites morales.
L’ouvrage s’achève sur « la pensée de midi », où Camus dessine les contours d’une révolte mesurée qui refuse aussi bien la tyrannie que le chaos nihiliste. Cette voie médiane repose sur la solidarité et le refus du meurtre, même justifié par l’idéologie.
Autour du livre
La publication de « L’homme révolté » en 1951 intervient dans un contexte de guerre froide et de tensions idéologiques croissantes, ce qui confère une résonance particulière à sa critique des totalitarismes. Camus y provoque une rupture retentissante avec Sartre et les existentialistes. La condamnation sans appel du marxisme-léninisme et la critique de la violence révolutionnaire lui valent l’hostilité de la gauche intellectuelle française. Cette controverse culmine en 1952 dans les pages des Temps modernes, où Sartre publie une réponse virulente qui marque la fin de leur amitié.
La pensée développée dans « L’homme révolté » reste d’une actualité saisissante. La distinction entre révolte et révolution éclaire les mouvements sociaux contemporains. La mise en garde contre la tentation totalitaire et la sacralisation de l’histoire résonne particulièrement avec les dérives idéologiques du XXe siècle. La force de l’argumentation réside dans son ancrage historique et philosophique. En convoquant aussi bien les dandys que les surréalistes, tant Épicure que Marx, Camus montre comment la révolte peut soit servir la dignité humaine, soit la sacrifier sur l’autel des abstractions. Sa réflexion sur les limites nécessaires de la révolte et son refus du « tout est permis » pose les bases d’une éthique de l’action politique.
La « pensée de midi », développée dans la dernière partie, offre une alternative aux extrémismes idéologiques. Cette sagesse méditerranéenne, fondée sur la mesure et le refus des absolus, propose une voie pour concilier justice et liberté. L’héritage de cette pensée nourrit encore aujourd’hui les réflexions sur la démocratie et la résistance aux oppression.
Aux éditions FOLIO ; 384 pages.
8. Caligula (pièce de théâtre, 1944)
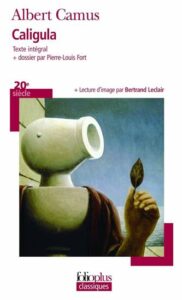
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Rome, an 41 après J.C. La mort de sa sœur et amante Drusilla bouleverse l’empereur Caligula. Cette disparition lui révèle une insupportable vérité : l’absurdité d’un monde où les hommes meurent sans avoir connu le bonheur. Après trois jours d’errance, il regagne son palais, habité par une vision nouvelle : puisque le monde n’a pas de sens, il exercera sa liberté de la manière la plus totale qui soit.
S’ouvre alors un règne de pure démence logique. Caligula tue au hasard, confisque les biens, force les patriciens à servir à sa table, prostitue leurs épouses. Il exige l’impossible – qu’on lui apporte la Lune – et met en scène des spectacles grotesques où il se travestit en Vénus. Dans ce chaos organisé, seules quelques voix s’élèvent : le jeune poète Scipion tente de le comprendre, l’intellectuel Cherea prépare sa chute, pendant que Caesonia et Hélicon le suivent aveuglément.
Cette trajectoire meurtrière s’achève comme elle devait s’achever : Caligula, qui a tout détruit autour de lui, orchestre sa propre fin. Face à son reflet dans le miroir, il reconnaît l’échec de sa quête effrénée de liberté absolue.
Autour du livre
Rédigée en 1938 et publiée en 1944, « Caligula » est la première pièce d’Albert Camus. Elle s’inscrit dans son « cycle de l’absurde » aux côtés de « L’étranger » et du « Mythe de Sisyphe ». Sa genèse remonte à la lecture de « Vie des douze Césars » de Suétone, dont Camus s’inspire tout en modifiant certains aspects du personnage historique : l’empereur y apparaît moins laid et moins cruel que dans les chroniques antiques, permettant une identification plus aisée du spectateur à sa quête philosophique.
« Caligula » connaît deux versions majeures. La première, datant de 1941, développe une réflexion pure sur l’absurde. La seconde, publiée en 1944, intègre la dimension politique née de l’expérience de l’Occupation : le personnage de Cherea y prend davantage d’importance, incarnant le refus du nihilisme au nom de la dignité humaine.
Le succès de la pièce ne s’est jamais démenti depuis sa création en 1945 à Genève. Sa première parisienne au théâtre Hébertot révèle Gérard Philipe dans le rôle-titre. Les mises en scène successives n’ont cessé de renouveler l’interprétation du personnage : jeune empereur ambigu en toge romaine chez Philipe, souverain vieillissant et décadent avec Charles Berling, tyran contemporain armé d’un revolver dans la version de Benedict Andrews à Londres.
L’internationalisation de l’œuvre témoigne de son universalité : traduite et jouée de l’Inde au Brésil, du Japon à la Hongrie, elle continue d’interroger le rapport entre pouvoir et nihilisme. Un projet d’épilogue retrouvé dans les Carnets de Camus éclaire sa portée : « Caligula n’est pas mort. Il est là, et là. Il est en chacun de vous […] Notre époque meurt d’avoir cru aux valeurs et que les choses pouvaient être belles et cesser d’être absurdes. »
Aux éditions FOLIO ; 176 pages.
9. Les Justes (pièce de théâtre, 1949)
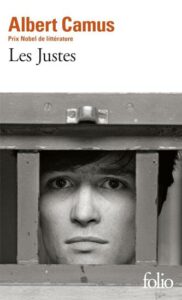
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
En février 1905, dans un appartement moscovite, cinq jeunes révolutionnaires préparent un attentat à la bombe contre le grand-duc Serge, figure autoritaire du régime tsariste. Le groupe se compose d’Annenkov, leur chef, du poète Kaliayev chargé de lancer l’explosif, de Dora qui fabrique les bombes, de l’intransigeant Stepan et du fragile Voinov. Unis dans leur lutte contre la tyrannie, ils divergent néanmoins sur les moyens à employer.
L’histoire bascule quand Kaliayev, au moment de commettre l’attentat, découvre deux enfants dans la calèche du grand-duc et refuse de les tuer. Cette décision provoque une crise au sein du groupe, notamment avec Stepan qui considère que la fin justifie les moyens. Deux jours plus tard, Kaliayev accomplit sa mission mais est aussitôt arrêté. Face aux propositions de grâce en échange d’une trahison de ses camarades, Kaliayev choisit la fidélité à sa cause et accepte la pendaison. Sa mort pousse Dora, qui l’aimait en secret, à reprendre le flambeau de la violence révolutionnaire.
Autour du livre
« Les Justes » naît d’une réflexion sur la légitimité de la violence politique. La pièce est construite en réponse directe aux « Mains sales » de Sartre, bien que Camus ait entamé son écriture auparavant. Les personnages s’inspirent de figures historiques réelles, notamment du groupe terroriste des socialistes révolutionnaires qui commit l’attentat contre le grand-duc Serge en 1905. Boris Savinkov, avec ses « Souvenirs d’un terroriste », constitue la source principale de documentation.
La première représentation a lieu le 15 décembre 1949 au théâtre Hébertot à Paris. La distribution réunit Maria Casarès dans le rôle de Dora, Serge Reggiani incarnant Kaliayev, et Michel Bouquet prêtant ses traits à Stepan. L’accueil mitigé des critiques se focalise notamment sur l’intrication de l’histoire d’amour avec la trame politique.
L’antagonisme entre Kaliayev et Stepan incarne le débat moral central. Leurs affrontements verbaux illustrent la tension entre deux conceptions du terrorisme révolutionnaire : l’une, absolue et impitoyable, portée par Stepan, l’autre, consciente de ses limites morales, défendue par Kaliayev. Cette opposition se cristallise notamment autour de la question des « enfants russes » dont Stepan justifie le sacrifice potentiel.
La pièce connaît plusieurs adaptations notables, dont une version en « tragédie musicale » signée Abd Al Malik en 2019 au théâtre du Châtelet. Cette réinterprétation contemporaine, enrichie d’un prologue, d’un épilogue et d’un chœur, souligne la résonance actuelle du texte avec les questionnements de la jeunesse face aux injustices sociales.
Aux éditions FOLIO ; 150 pages.




