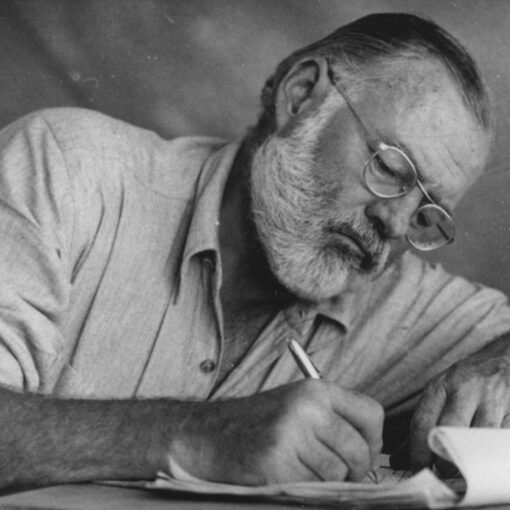Umberto Eco (1932-2016) est un universitaire et écrivain italien de renommée mondiale. Né à Alexandrie dans le Piémont, il obtient un doctorat en philosophie à l’université de Turin en 1954 avec une thèse sur Thomas d’Aquin.
Pionnier de la sémiotique, il devient professeur à l’université de Bologne où il occupe la chaire de sémiotique. Ses travaux universitaires portent principalement sur la sémiotique, l’esthétique médiévale, la communication de masse et la linguistique.
C’est avec son premier roman « Le Nom de la rose » (1980) qu’il connaît un succès international retentissant. Le livre, traduit en 43 langues, se vend à plusieurs millions d’exemplaires. Il publie ensuite d’autres romans à succès comme « Le Pendule de Foucault » (1988), « L’Île du jour d’avant » (1994) et « Le Cimetière de Prague » (2010).
Intellectuel engagé, il collabore régulièrement à divers journaux italiens dont L’Espresso et La Repubblica. Il est membre de nombreuses institutions prestigieuses, notamment le Collège de France où il occupe la chaire européenne en 1992.
Après avoir lutté pendant deux ans contre un cancer du pancréas, il s’éteint à Milan le 19 février 2016. Il laisse derrière lui une œuvre considérable mêlant érudition universitaire et littérature grand public, qui lui a valu de nombreuses distinctions dont le Prix Médicis étranger et une quarantaine de doctorats honoris causa.
Voici notre sélection de ses romans majeurs.
1. Le Nom de la rose (1980)
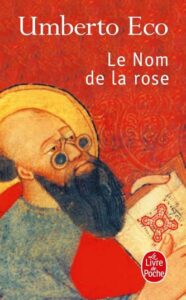
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Un matin de novembre 1327, Guillaume de Baskerville, moine franciscain et ancien inquisiteur, gravit les pentes d’une abbaye bénédictine nichée entre Provence et Ligurie. Accompagné d’Adso de Melk, son jeune secrétaire qui deviendra le narrateur de cette histoire, il doit y superviser une rencontre cruciale entre les émissaires du pape Jean XXII et les représentants de l’ordre franciscain. L’enjeu est de taille : trancher la question controversée de la pauvreté du Christ, qui divise profondément l’Église.
Mais à son arrivée, l’abbé lui confie une toute autre mission : enquêter sur la mort suspecte d’un jeune moine enlumineur, retrouvé sans vie au pied des murailles. D’autres décès suivent bientôt, selon une mise en scène macabre qui évoque les visions de l’Apocalypse. Au cœur de cette série de crimes se trouve la bibliothèque de l’abbaye, un édifice labyrinthique abritant la plus vaste collection de livres de la chrétienté. Gardée par Jorge de Burgos, un vieux moine aveugle aux convictions inflexibles, elle renferme des ouvrages jugés dangereux pour la foi.
Guillaume et Adso parcourent les couloirs de l’abbaye, interrogent les moines, déchiffrent les indices. L’arrivée de l’inquisiteur Bernardo Gui, qui nourrit une vieille rancune envers Guillaume, précipite les événements. Entre procès en hérésie et luttes de pouvoir, l’enquête se transforme en une course effrénée pour démasquer le meurtrier avant qu’il ne frappe à nouveau.
Autour du livre
Premier roman d’Umberto Eco, « Le Nom de la rose » naît d’une image qui obsède son auteur : celle d’un moine empoisonné pendant sa lecture. Cette vision, issue d’un séjour de jeunesse dans un monastère bénédictin, détermine l’orientation médiévale du récit. Avant d’écrire la première ligne, Eco consacre une année entière à dessiner des plans d’abbayes et à concevoir des labyrinthes, créant ainsi l’univers médiéval complexe qui servira de toile de fond à son intrigue policière.
Le livre s’inscrit dans une double tradition littéraire : celle du roman policier, avec ses références explicites à Sherlock Holmes à travers le personnage de Guillaume de Baskerville, et celle du roman historique. La structure narrative se révèle particulièrement sophistiquée : le récit se présente comme un manuscrit retrouvé puis traduit, créant ainsi quatre niveaux d’enchâssement narratif. Cette mise en abyme permet à Eco d’affirmer que « les livres parlent toujours d’autres livres » et que « chaque histoire raconte une histoire déjà racontée ».
L’onomastique y joue aussi un rôle central. Le titre lui-même fait l’objet de multiples interprétations, depuis la référence au « Roman de la Rose » médiéval jusqu’aux considérations philosophiques sur le nominalisme. Les noms des personnages constituent un réseau dense de références littéraires et historiques : Jorge de Burgos renvoie à Jorge Luis Borges, tandis que le duo Guillaume-Adso fait écho au couple Holmes-Watson.
Dans la conception du monastère, Eco puise son inspiration architecturale dans plusieurs édifices réels : la Sacra di San Michele pour l’abbaye elle-même, et l’abbaye de Saint-Gall pour le scriptorium. Le labyrinthe de la bibliothèque, véritable personnage du roman, trouve quant à lui son origine dans les gravures de Piranèse, notamment ses « Prisons imaginaires ».
Le texte se structure selon les heures canoniales de la vie monastique, chaque chapitre correspondant à un moment précis de la journée. Cette organisation temporelle stricte contraste avec la complexité des thèmes abordés : le pouvoir, la connaissance, le rire, la vérité. Le livre propose différents niveaux de lecture, du simple polar médiéval à la réflexion philosophique sur la nature du savoir et de la vérité.
« Le Nom de la rose » devient rapidement un phénomène éditorial international. Traduit dans plus de quarante langues, il s’écoule à cinquante millions d’exemplaires. Le succès critique accompagne le succès public : il reçoit le Prix Strega en 1981 et le Prix Médicis étranger en 1982. Le journal Le Monde le classe quatorzième dans sa liste des cent livres du siècle. Le Spiegel le qualifie de « livre le plus intelligent et le plus divertissant de ces dernières années ». Libération souligne sa richesse et ses multiples niveaux de lecture. The New York Review of Books loue son brio et son ironie. Quelques voix discordantes s’élèvent néanmoins, notamment dans les milieux catholiques qui critiquent sa représentation du Moyen Âge et du catholicisme médiéval.
Jean-Jacques Annaud en tire un film en 1986 avec Sean Connery dans le rôle de Guillaume de Baskerville. Une mini-série de huit épisodes voit le jour en 2019, avec John Turturro et Rupert Everett. Le roman inspire également plusieurs jeux vidéo, dont « La abadía del crimen » dans les années 1980, et une adaptation en bande dessinée par Milo Manara en 2023. Les Iron Maiden lui rendent hommage avec leur chanson « The Sign of the Cross » en 1995, tandis que le groupe Ten intitule son album de 1996 « The Name of the Rose ».
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 640 pages.
2. Le Pendule de Foucault (1988)
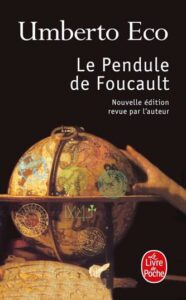
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Milan, années 1980. Trois intellectuels employés dans une maison d’édition se lancent dans un jeu dangereux. Casaubon, spécialiste des Templiers, Belbo, éditeur tourmenté, et Diotallevi, passionné de textes religieux, imaginent par divertissement une vaste théorie du complot. Leur échafaudage fictif mêle sociétés secrètes, ordres mystiques et événements historiques dans un plan de domination mondiale censé culminer en l’an 2000.
Si ce passe-temps cérébral relève initialement du divertissement, il prend une dimension troublante dès lors que leur fiction commence à rejoindre la réalité. Le plan qu’ils ont imaginé semble prendre vie, suscitant l’attention de groupes occultes persuadés qu’ils détiennent la clé d’un véritable complot millénaire. Le jeu vire au drame lorsque Belbo disparaît à Paris.
Autour du livre
Second roman d’Umberto Eco publié en 1988, « Le Pendule de Foucault » se distingue par sa structure narrative singulière, divisée en dix parties correspondant aux dix Sephiroth de la mystique juive. Cette architecture complexe s’articule autour de 120 chapitres, chacun s’ouvrant sur une citation relative à l’ésotérisme, l’alchimie ou les théories du complot.
La narration entrelace plusieurs temporalités, depuis les années 1970 jusqu’au point culminant dans la nuit du 23 au 24 juin 1984. Le récit principal émane de Casaubon qui, depuis une maison du Piémont oriental, remonte le fil des événements. Cette narration s’enrichit d’extraits des fichiers personnels de Belbo, rédigés sur son ordinateur Abulafia, créant ainsi un jeu de miroirs entre différentes strates temporelles et perspectives narratives.
Les choix chronologiques d’Eco ne relèvent pas du hasard. Dans « De la littérature », il explicite sa décision : les personnages devaient avoir vécu Mai 68, mais l’utilisation par Belbo d’un ordinateur personnel – élément crucial pour la dimension aléatoire et combinatoire du récit – imposait de situer l’action finale entre 1983 et 1984, période où ces machines commencent à se commercialiser en Italie.
La dimension satirique imprègne l’ensemble des pages, notamment dans son traitement de l’ésotérisme. Là où Dan Brown, des années plus tard dans « Da Vinci Code », prendra au sérieux les théories occultes, Eco les tourne en dérision. Le critique Anthony Burgess suggère même qu’un index serait nécessaire pour naviguer dans cette encyclopédie du savoir ésotérique et historique.
L’évolution psychologique des personnages occupe une place centrale. Le parcours de Belbo, marqué par son enfance sous le fascisme italien, sa relation tumultueuse avec Lorenza Pellegrini et ses ambitions littéraires refoulées, traduit une tension constante entre scepticisme initial et basculement dans la croyance. De même, la transformation d’Amparo, d’abord marxiste convaincue puis déstabilisée par sa confrontation avec l’irrationnel lors d’une cérémonie Umbanda, illustre la fragilité des certitudes idéologiques.
La symbolique du pendule de Foucault transcende sa fonction première d’instrument scientifique. Point fixe dans un monde en rotation, il incarne paradoxalement la relativité de tout point de référence puisque, comme le souligne le texte, n’importe quel point peut devenir ce centre immobile selon son point d’accroche. Cette métaphore sous-tend toute la réflexion sur la nature de la vérité et des croyances qui traverse le roman.
Les critiques divergent radicalement face à cette œuvre. Jacques Le Goff, dans L’Espresso, salue un « roman magique sur la magie, mystérieux sur le secret et la créativité de la fiction ». Ferdinando Camon compare sa lecture à une expérience si prenante qu’elle suspend le cours normal de la vie. À l’opposé, l’Osservatore Romano condamne violemment l’ouvrage, qualifiant Eco de « fléau » qui « déforme, parodie, désacralise et offense l’histoire humaine ».
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 656 pages.
3. Baudolino (2000)
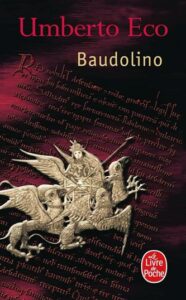
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Dans l’Italie médiévale du XIIe siècle, un jeune garçon du Piémont bouleverse le cours de l’Histoire par la seule force de son imagination. Baudolino, menteur virtuose aux multiples talents, séduit l’empereur Frédéric Barberousse qui décide de l’adopter. Devenu confident du souverain, il participe aux grands événements de son temps, de la fondation d’Alexandrie aux croisades.
Le récit s’ouvre en 1204, pendant le sac de Constantinople. Baudolino, désormais sexagénaire, raconte son histoire à Nicétas, un dignitaire byzantin qu’il vient de sauver. Il dévoile comment ses inventions ont pris corps dans la réalité : la quête du Graal, les circonstances troubles de la mort de Barberousse, et surtout son périple vers le mythique royaume du Prêtre Jean. Cette dernière aventure l’entraîne aux confins du monde connu, dans un Orient fantastique peuplé de créatures extraordinaires.
Autour du livre
Quatrième roman d’Umberto Eco, « Baudolino » marque le retour de l’auteur à l’époque médiévale après « Le Nom de la rose ». Cette œuvre singulière, publiée en 2000, s’inscrit dans la lignée du roman picaresque tout en proposant une réflexion sur la nature de la vérité historique et le pouvoir des récits.
La genèse de « Baudolino » trouve son origine dans un projet initial très différent. Eco travaillait initialement sur un roman contemporain intitulé « Numero zero », centré sur la création d’un nouveau journal. Après deux années d’écriture, il abandonne ce projet au profit de « Baudolino ». Une scène du projet original subsiste néanmoins : celle de la mort mystérieuse de Frédéric Barberousse dans une chambre close. L’inspiration principale pour le récit provient du livre « Le terre leggendarie », notamment ses chapitres sur le Prêtre Jean et les tribus perdues d’Israël. La couverture de l’ouvrage, représentant un sciapode, établit immédiatement un lien dans l’esprit d’Eco entre l’histoire du Prêtre Jean et la naissance d’Alexandrie, sa ville natale.
Le roman se distingue par sa structure narrative complexe et sa dimension métalittéraire. Les premières pages reproduisent la chronique de Baudolino, écrite en 1155 à la cour impériale de Ratisbonne. Cette expérimentation linguistique s’inspire des premiers textes en langue vernaculaire de la littérature italienne, comme la Carta di Capua ou le Cantique des créatures de Saint François d’Assise. Le texte intègre même une variation de l’Indovinello veronese dans les leçons de latin données à Baudolino.
La particularité majeure de l’œuvre réside dans son mélange entre faits historiques avérés et pure invention. Les éléments fantastiques s’inspirent largement des bestiaires médiévaux et des Chroniques de Nuremberg, peuplant l’univers du roman de créatures extraordinaires comme les sciapodes, les blemmyes et les panotéens. Cette mythologie médiévale sert de toile de fond à une réflexion sur les divergences théologiques du christianisme oriental.
Le rapport à la vérité historique constitue un axe central du récit. Le personnage de Baudolino influence les grands événements de son époque par ses mensonges et ses inventions : la canonisation de Charlemagne, l’identification du Graal, la création de la lettre du Prêtre Jean. Ces interventions du protagoniste dans l’Histoire soulèvent des questions fondamentales sur la nature de la vérité historique et le rôle de l’imagination dans la construction des récits collectifs.
La dimension culinaire mérite une mention particulière : les descriptions des plats de Nicétas Coniate s’appuient sur des recherches minutieuses concernant la gastronomie byzantine antique, consultées par Eco sur Internet. Ce souci du détail historique cohabite paradoxalement avec la dimension fantaisiste du récit.
L’accueil critique de « Baudolino » s’avère contrasté. La critique germanophone oscille entre condamnation sévère d’une œuvre jugée trop dense et éloges d’un panorama médiéval réussi. François Busnel de L’Express salue la « pantagruélique érudition » d’Eco et considère les cinquante dernières pages comme « éblouissantes, portant la marque d’un romancier de génie ». Antonia Susan Byatt du Guardian adopte une position plus nuancée, qualifiant « Baudolino » de paradoxe : le récit le plus lisible d’Eco serait aussi son moins satisfaisant, « un corps inconsistant structuré autour du fantôme d’une idée brillante ».
Le roman connaît une large diffusion internationale. Traduit en de nombreuses langues dès sa sortie, il présente des défis particuliers pour les traducteurs, notamment les dix pages écrites dans un langage inventé mélangeant latin, italien médiéval et autres dialectes.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 672 pages.
4. L’Île du jour d’avant (1994)
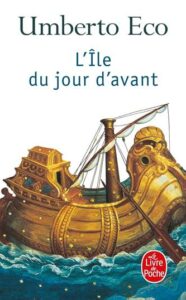
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
En plein XVIIe siècle, Roberto de la Grive, agent secret mandaté par Mazarin, s’embarque vers les antipodes. Sa mission : découvrir le secret des longitudes, clé de la suprématie maritime convoitée par toutes les puissances européennes. Le naufrage de son navire le mène jusqu’à la Daphné, un vaisseau mystérieusement déserté mais pourvu de vivres en abondance.
Ne sachant pas nager, Roberto se retrouve prisonnier de ce navire ancré face à une île qu’il ne peut atteindre. Cette terre se dresse précisément sur le 180e méridien, ligne imaginaire où le jour bascule dans la veille. Pour tromper sa solitude, il couche sur le papier le récit de son existence : les batailles de la guerre de Trente Ans, les intrigues des salons parisiens, ses rencontres avec les penseurs de son temps. Dans son isolement, il donne vie à Ferrante, un double imaginaire qui personnifie ses démons intérieurs.
Autour du livre
Dans « L’Île du jour d’avant », Umberto Eco déploie une intrigue qui embrasse sciences, philosophie et métaphysique au cœur du XVIIe siècle. Cette période charnière, marquée par le passage de l’alchimie à la chimie et l’émergence des premières théories scientifiques modernes, sert de toile de fond à une réflexion sur le temps, l’espace et la nature même de la réalité.
Le livre s’inscrit dans la lignée des grands récits maritimes, tout en s’en démarquant par sa dimension philosophique et scientifique. La quête du « punto fijo » (point fixe), cette méthode tant convoitée pour calculer la longitude en mer, devient le prétexte d’une méditation sur les limites entre hier et aujourd’hui. La présence symbolique de la ligne de changement de date, située entre le navire Daphné et l’île mystérieuse, transforme cette frontière temporelle en personnage à part entière.
La construction du récit repose sur une architecture qui entremêle trois instances narratives : un narrateur contemporain qui tente de reconstituer l’histoire à partir de documents anciens, un narrateur omniscient classique, et Roberto lui-même à travers ses lettres. Cette structure polyphonique permet de multiplier les perspectives et de jouer avec les temporalités.
Les personnages historiques peuplent les pages du livre : Mazarin, Colbert et Richelieu côtoient des figures plus discrètes mais non moins significatives. Le personnage de Saint-Savin emprunte ses traits à Cyrano de Bergerac, tandis qu’un jeune homme travaillant sur une machine à calculer évoque Blaise Pascal sans jamais le nommer. Cette galerie de portraits compose un tableau vivant de la société intellectuelle du Grand Siècle.
La présence d’une mystérieuse « Colombe Couleur Orange » – qui devait initialement donner son titre au roman – constitue un fil conducteur symbolique. Cette créature, décrite comme une « flèche qui vise le soleil », rappelle la figure biblique du Cantique des Cantiques et établit un lien subtil avec « Le Nom de la rose », précédent roman d’Eco où apparaît la même citation.
Le style de l’ouvrage épouse délibérément les codes de l’écriture baroque, jusqu’à adopter par moments une langue maniériste qui reflète les préoccupations esthétiques de l’époque. Les titres des quarante chapitres citent, de manière plus ou moins voilée, des œuvres baroques aujourd’hui largement oubliées, composant ainsi une bibliographie fantôme qui dialogue avec le récit principal.
La réception critique du roman s’est révélée contrastée. Certains ont salué l’originalité de l’intrigue et la densité des références culturelles, tandis que d’autres ont jugé le texte trop touffu. Le philosophe Kurt Flasch, dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung, y voit une « odyssée du grand siècle » qui met en scène l’émergence de la raison moderne et ses vertiges métaphysiques. Robert Kelly, dans le New York Times Book Review, considère que chaque époque obtient les classiques qu’elle mérite, espérant que son temps soit digne de « L’Île du jour d’avant ».
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 508 pages.
5. Le Cimetière de Prague (2010)
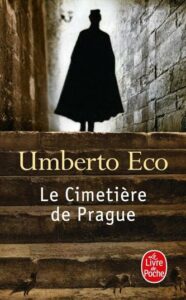
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
En 1897, un faussaire italien réfugié à Paris, Simon Simonini, découvre que quelqu’un s’introduit dans son appartement et annote son journal intime. Cet intrus mystérieux, l’abbé Dalla Piccola, semble connaître tous les détails de sa vie. Pour comprendre ce qui lui arrive, Simonini entreprend de coucher sur le papier ses souvenirs.
Son récit nous ramène dans l’Italie des années 1830, où il grandit entre les influences contradictoires d’un père carbonaro et d’un grand-père réactionnaire obsédé par les théories du complot. Sa maîtrise de la contrefaçon le propulse dans les arcanes de l’espionnage international. Il traverse les grands bouleversements du siècle : l’unification italienne, la Commune de Paris, l’affaire Dreyfus. Mais c’est surtout son antisémitisme féroce qui guide ses actes. Il élabore patiemment un faux document appelé à une sinistre postérité : « Les Protocoles des Sages de Sion », censés révéler un prétendu complot juif international.
Autour du livre
La parution du « Cimetière de Prague » en 2010 coïncide avec l’éclatement du scandale WikiLeaks, une synchronicité que l’auteur lui-même relève tant les thèmes de la falsification et de la confidentialité des documents traversent son œuvre. Dans la lignée du « Pendule de Foucault », Umberto Eco reprend et développe sa réflexion sur les théories du complot, mais sous un angle différent. La genèse du projet remonte à 2005, lorsque Will Eisner sollicite Eco pour préfacer sa bande dessinée « Le Complot », une demande qui déclenche chez l’écrivain l’envie d’approfondir la question de la naissance des « Protocoles des Sages de Sion ».
La narration s’articule autour d’une structure complexe à trois voix : celle du protagoniste Simonini à travers son journal intime, celle de l’abbé Dalla Piccola qui s’immisce dans les pages de ce même journal, et celle d’un narrateur omniscient qui commente et contextualise les événements. Cette architecture narrative sert à mettre en lumière la dissociation identitaire du personnage principal, seul être de fiction dans un roman peuplé de figures historiques réelles.
La singularité du projet réside dans ce choix audacieux de créer un protagoniste que l’auteur qualifie lui-même comme « le personnage le plus cynique et désagréable de toute l’histoire de la littérature ». À travers ce prisme déformant d’un être profondément antisémite, misogyne et misanthrope, Eco reconstitue les mécanismes de fabrication des faux documents et des théories conspirationnistes qui ont marqué la fin du XIXe siècle.
Le roman puise sa matière dans un vaste réseau d’influences littéraires. Les feuilletons d’Alexandre Dumas et d’Eugène Sue nourrissent l’imaginaire du protagoniste, tandis que des œuvres comme « Joseph Balsamo », « Le Juif errant » ou « Les Mystères du peuple » servent de sources d’inspiration pour la construction des faux documents. Cette intertextualité révèle comment la littérature populaire du XIXe siècle a pu servir de terreau aux théories du complot.
La réception critique divise profondément les lecteurs et la presse. Les ventes sont considérables avec 550 000 exemplaires écoulés en Italie dans les deux mois suivant la parution. Mais la polémique enfle rapidement. Le Vatican, à travers L’Osservatore Romano, accuse l’œuvre « d’antisémitisme involontaire ». Des historiens comme Anna Foa s’interrogent sur l’opportunité de publier une fiction sur la genèse des « Protocoles des Sages de Sion » sans fournir de distance analytique. Le rabbin Riccardo Di Segni soulève la question de l’ambiguïté du texte, craignant que l’excès dans la monstruosité du personnage principal ne finisse par le rendre sympathique aux yeux du lecteur. Pierre Assouline et Pierre-André Taguieff expriment leur inquiétude quant à la réception d’un tel ouvrage à une époque particulièrement réceptive aux théories du complot. À ces critiques, Eco répond qu’il n’est pas responsable du mauvais usage que certains pourraient faire de son livre.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 576 pages.
6. Numéro zéro (2015)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Milan, 1992. Colonna, un écrivain raté de cinquante ans, se voit proposer un poste de rédacteur en chef adjoint pour un nouveau quotidien baptisé Domani. Aux côtés de cinq autres journalistes, il doit préparer des numéros tests sous la direction de Simei, mandaté par un mystérieux commanditaire.
L’équipe s’attelle à la création d’articles anticipant l’actualité future, tout en évitant soigneusement les sujets qui pourraient froisser leur financeur. Mais Colonna découvre rapidement que le journal ne verra jamais le jour : il s’agit d’un instrument de chantage destiné à faire pression sur les puissants.
Parallèlement, l’un des journalistes, Braggadocio, mène l’enquête sur une théorie explosive : Mussolini n’aurait pas été tué en 1945, mais remplacé par un sosie. Lorsque Braggadocio est retrouvé mort, Colonna comprend que sa vie est en danger.
Autour du livre
Septième et dernier roman d’Umberto Eco, « Numéro zéro » puise ses racines dans une idée ancienne de l’auteur, antérieure même à la publication de « Baudolino » en 2000. Ce projet, initialement mis de côté, resurgit alors qu’Eco atteint ses quatre-vingts ans, moment où il s’interroge sur sa capacité à poursuivre l’écriture romanesque. Dans cette œuvre, il recycle notamment des passages écartés de son précédent roman « Le Pendule de Foucault », comme l’incipit et le parcours universitaire du protagoniste Colonna.
Cette satire du journalisme et de la presse à scandale se démarque dans la bibliographie d’Eco par sa concision – il s’agit de son roman le plus court. La trame narrative s’inscrit dans la lignée thématique du « Pendule de Foucault », partageant avec ce dernier l’immersion dans l’univers éditorial et la présence d’une enquête historique, bien que située dans une période plus contemporaine.
Le choix de situer l’action en 1992 à Milan n’est pas anodin : cette période charnière de l’histoire italienne permet à Eco d’entrelacer habilement fiction et réalité historique. À travers le personnage du Commandeur Vimercate, magnat des médias possédant chaînes de télévision, magazines et hôtels, transparaît une critique à peine voilée de Silvio Berlusconi. Le journal Domani, conçu comme une machine à chantage plutôt qu’un véritable organe de presse, illustre les dérives médiatiques de l’époque.
La figure de Mussolini et les théories du complot qui entourent sa mort servent de prétexte pour tisser des liens avec les zones d’ombre de l’histoire italienne d’après-guerre : l’opération Gladio, les hypothèses sur la mort de Jean-Paul Ier, les Brigades rouges et le coup d’État manqué de Borghese. Ces éléments historiques s’entremêlent avec une réflexion sur la manipulation de l’information et la fabrication du consentement.
La galerie de personnages gravitant autour du protagoniste Colonna compose un tableau saisissant des dérives journalistiques : Braggadocio l’obsédé des complots, Lucidi l’agent présumé des services secrets, Palatino le concepteur de mots croisés reconverti, ou encore Costanza l’ancien correcteur d’une époque où la qualité importait encore. Parmi eux, Maia Fresia se distingue comme seule figure féminine, dont l’apparente fragilité masque une personnalité érudite.
La réception critique de « Numéro zéro » divise profondément les commentateurs. La presse italienne propulse immédiatement le livre en tête des ventes, mais les avis oscillent entre enthousiasme et réserve à l’étranger. La Neue Zürcher Zeitung le considère comme « l’un des meilleurs romans d’Eco », tandis que le Deutschlandfunk fustige un texte « assemblé de manière fantaisiste et témoignant d’une méconnaissance flagrante des médias ». La Frankfurter Allgemeine Zeitung adopte une position médiane, saluant le talent de l’auteur pour la construction narrative tout en relevant la présence de personnages parfois schématiques.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 240 pages.