Salman Rushdie, né le 19 juin 1947 à Bombay, est un écrivain britannique d’origine indienne. Après avoir quitté l’Inde à 14 ans pour étudier au Royaume-Uni, il entame une carrière littéraire qui le propulsera parmi les auteurs les plus influents de sa génération.
Son roman « Les enfants de minuit » (1981) lui vaut le prestigieux Booker Prize et une reconnaissance internationale. En 1988, la publication des « Versets sataniques » déclenche une controverse majeure. Il fait l’objet d’une fatwa de l’ayatollah Khomeini qui le contraint à vivre sous protection policière.
Fervent défenseur de la liberté d’expression, il contribue à la création du « Parlement international des écrivains » en 1993. Son œuvre, marquée par le réalisme magique, comprend de nombreux romans acclamés par la critique, dont « Shalimar le clown » (2005) et « L’Enchanteresse de Florence » (2008).
Anobli par la Reine Elisabeth II, sa vie prend un tournant tragique le 11 août 2022 lorsqu’il est victime d’une tentative d’assassinat à New York, qui lui laisse de graves séquelles dont la perte d’un œil.
Voici notre sélection de ses romans majeurs.
1. Les enfants de minuit (1981)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Le 15 août 1947, à minuit sonnant, l’Inde devient indépendante. Au même instant naît Saleem Sinai, héros et narrateur de ce roman hors norme. Il fait partie des mille et un enfants nés durant cette première heure magique, tous dotés de pouvoirs extraordinaires. Lui peut pénétrer les esprits et créer un lien télépathique avec ses pairs. Cette capacité surnaturelle va tisser un lien indissoluble entre son histoire personnelle et celle de son pays.
Le récit commence trente ans plus tôt avec l’histoire de son grand-père, puis suit les tribulations de trois générations entre le Cachemire, Bombay et le Pakistan. À travers le regard de Saleem se dessine la fresque d’une époque tourmentée : la partition sanglante du territoire, les guerres, la montée en puissance d’Indira Gandhi et son autoritarisme croissant.
Autour du livre
Avec « Les enfants de minuit », son deuxième roman publié en 1981, Salman Rushdie marie la tradition orale indienne avec l’héritage romanesque britannique d’Austen et Dickens. La consécration arrive rapidement : Booker Prize en 1981, Booker of Bookers en 1993 et 2008. Le magazine Time l’inclut dans sa liste des 100 meilleurs romans de langue anglaise depuis 1923.
L’écriture de cette œuvre monumentale commence en 1975 quand Rushdie, muni d’une maigre avance de 700 livres sterling pour son premier roman « Grimus », parcourt l’Inde pendant plusieurs mois. De ces pérégrinations naît l’idée d’entrelacer le destin d’un personnage avec celui de son pays natal. Le manuscrit initial contenait deux problèmes majeurs, comme le révèle Rushdie dans sa préface à l’édition du 25e anniversaire : une seconde narratrice redondante et une chronologie défaillante. Son éditrice Liz Calder l’aide à corriger ces défauts structurels.
Le roman déploie une narration qui pulvérise les codes traditionnels. Rushdie consacre les 200 premières pages à l’exposition, retardant l’apparition des fameux enfants de minuit jusqu’à mi-parcours. Cette construction inhabituelle s’accompagne d’une narration à la première personne qui bascule parfois à la troisième, créant un jeu complexe de perspectives. Le narrateur Saleem s’adresse directement à Padma, son auditrice, tout en multipliant les clins d’œil au lecteur.
La dimension politique irrigue l’ensemble du texte. Rushdie vise particulièrement la période de l’État d’urgence sous Indira Gandhi (1975-1977). Cette critique lui vaut d’ailleurs des poursuites judiciaires de la part de Gandhi elle-même pour une unique phrase jugée diffamatoire concernant son fils Sanjay. Le différend se résout à l’amiable par la suppression du passage incriminé.
Plusieurs tentatives d’adaptation ont vu le jour. La BBC prévoyait une mini-série de cinq épisodes avec Rahul Bose dans le rôle principal, mais la pression de la communauté musulmane du Sri Lanka fait avorter le projet. En 2003, la Royal Shakespeare Company monte une version théâtrale. En 2012, une adaptation cinématographique voit enfin le jour sous la direction de Deepa Mehta, avec un scénario signé par Rushdie lui-même. Plus récemment, Netflix envisage une série TV mais abandonne le projet fin 2019, le réalisateur Vishal Bhardwaj refusant les compromis budgétaires imposés.
La réception du roman varie selon les cultures : les lecteurs occidentaux y perçoivent principalement une œuvre de fantaisie, tandis que le public indien y décèle un roman historique. Cette dualité d’interprétation souligne l’ambition de Rushdie d’évoquer la multiplicité inhérente à l’identité indienne. Le texte foisonne de références culturelles, de métaphores culinaires – notamment à travers l’image récurrente du chutney – et d’allusions mythologiques qui tissent un réseau de sens dense.
La réussite des « Enfants de minuit » réside dans sa capacité à transcender les genres. Le livre oscille entre saga familiale, conte oriental, satire politique et fresque historique. Cette hybridation reflète la complexité du sous-continent indien lui-même. Rushdie parvient ainsi à créer une œuvre qui, tout en demeurant profondément ancrée dans son contexte historique, atteint une dimension universelle.
Aux éditions FOLIO ; 816 pages.
2. Le dernier soupir du Maure (1995)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Dans l’Inde du XXe siècle, Moraes Zogoiby, surnommé « Le Maure », raconte l’histoire mouvementée de sa famille sur quatre générations. Né avec une main difforme et condamné à vieillir deux fois plus vite que la normale, il est le fils d’Aurora de Gama, une artiste flamboyante, et d’Abraham Zogoiby, un juif de Cochin devenu baron de la pègre.
Au cœur de Bombay et de ses plantations d’épices, Le Maure grandit sous l’emprise écrasante de sa mère qui fait de lui le sujet principal de ses tableaux. Entre ses trois sœurs aux destins tumultueux et les femmes qui traversent sa vie, il cherche à s’émanciper de l’influence maternelle.
Autour du livre
« Le dernier soupir du Maure » marque le retour de Salman Rushdie à la fiction pour adultes après la controverse des « Versets sataniques » et la fatwa qui en a découlé. Premier roman majeur publié depuis cette période tumultueuse, il témoigne d’une imagination intacte et d’une audace renouvelée face aux courants fondamentalistes qui traversent l’Inde des années 1990.
À travers la saga des Gama-Zogoiby, Rushdie réinvente l’espace culturel de la nation indienne en entrelaçant des histoires dissidentes et des récits dissonants. Se déployant sur près d’un siècle, la narration prend racine dans les comptoirs d’épices de Cochin pour s’étendre jusqu’aux ruelles sinueuses de Bombay, avant de se conclure dans une Andalousie mystérieuse. Cette géographie mouvante dessine une cartographie particulière où s’entremêlent les destins de personnages juifs, musulmans, hindous, chrétiens et parsis.
Le roman puise sa force dans un parallèle saisissant entre deux moments historiques : la reconquête catholique de Grenade au XVe siècle et la montée du fondamentalisme hindou dans l’Inde contemporaine. La figure historique de Boabdil, dernier sultan maure de Grenade, se réincarne symboliquement dans le personnage de Moraes Zogoiby, narrateur condamné à vieillir deux fois plus vite que le commun des mortels. Cette accélération biologique devient métaphore d’une Inde en mutation rapide, tiraillée entre tradition et modernité.
Les peintures d’Aurora, mère du narrateur, constituent un autre niveau de lecture essentiel. Ses toiles, notamment la série des « Maures », fonctionnent comme des palimpsestes où se superposent l’histoire personnelle et collective. L’art devient ainsi le lieu privilégié d’une résistance au nationalisme étroit incarné par le personnage de Raman Fielding, double à peine voilé du leader politique Bal Thackeray.
La dimension politique du texte se lit également dans son traitement de la langue. Les néologismes, les jeux de mots et l’hybridation linguistique reflètent la complexité d’une identité postcoloniale qui refuse de se laisser enfermer dans des catégories simplistes. Rushdie mêle habilement l’histoire officielle et la fiction : Nehru, Indira Gandhi ou encore Rajiv Gandhi côtoient des personnages imaginaires dans une narration qui brouille volontairement les frontières entre réel et imaginaire.
Couronné par le Prix Whitbread en 1995 et par le Prix Aristeion en 1996, « Le dernier soupir du Maure » s’inscrit dans la lignée des grands romans qui interrogent l’identité indienne contemporaine, aux côtés d’œuvres comme « Les enfants de minuit » du même auteur. Rushdie génère une tension permanente entre l’anamnèse – ce travail de la mémoire qui tente de reconstituer une histoire plurielle – et l’amnésie volontaire promue par les tenants d’un nationalisme exclusif.
Cette œuvre monumentale pose finalement une question centrale : comment préserver la multiplicité des voix et des histoires face aux tentations totalitaires qui traversent les sociétés contemporaines ? La réponse de Rushdie passe par une écriture qui refuse les simplifications et embrasse la complexité du réel, transformant le roman en acte de résistance créative face aux idéologies réductrices.
Aux éditions FOLIO ; 704 pages.
3. Haroun et la mer des histoires (1990)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Dans une ville si triste qu’elle en a oublié son nom, le jeune Haroun vit avec son père Rashid, un conteur hors pair, et sa mère Soraya. Leur bonheur vole en éclats le jour où Soraya s’enfuit avec leur voisin, M. Sengupta. Rashid perd alors son don pour raconter des histoires, lui qui puisait son inspiration dans une mystérieuse « mer des histoires ».
Une nuit, Haroun découvre l’existence de Kahani, une lune invisible de la Terre où se trouve cette fameuse mer. Il y rencontre des créatures extraordinaires : Iff le génie des eaux, une huppe mécanique, des poissons aux bouches multiples. Mais ce monde merveilleux est menacé par Khattam-Shud, le prince du Silence, qui veut empoisonner la source de toutes les histoires. Accompagné de ses nouveaux amis, Haroun se lance dans une quête périlleuse pour sauver la mer des histoires et redonner à son père le pouvoir de conter.
Autour du livre
Premier roman publié par Salman Rushdie après la fatwa réclamant son exécution, « Haroun et la mer des histoires » (1990) se lit comme une réponse lumineuse à ceux qui cherchent à museler la liberté d’expression. Cette fable onirique, dédiée à son fils Zafar dont il se trouve alors séparé, manifeste une inventivité narrative éblouissante.
Dans la tradition des « Mille et Une Nuits » dont il emprunte certains motifs – le protagoniste et son père portent d’ailleurs le nom du calife Haroun al-Rashid qui figure dans nombre de ces contes -, le récit mêle l’héritage oriental aux inspirations occidentales. Les références littéraires abondent : « Alice au Pays des Merveilles » de Lewis Carroll pour les jeux de mots et l’univers absurde, « Le Magicien d’Oz » de L. Frank Baum, ou encore « Le Seigneur des Anneaux » de J. R. R. Tolkien.
La dimension allégorique s’inscrit au cœur même de la géographie imaginaire : le pays d’Alifbay tire son nom des deux premières lettres de l’alphabet ourdou, tandis que les royaumes antagonistes de Gup et Chup symbolisent respectivement la parole (« gossip » en hindi) et le silence. Le personnage de Khattam-Shud, dont le nom signifie « complètement fini » en hindi, incarne les forces obscures de la censure : ses fidèles se cousent les lèvres et travaillent à empoisonner la Source des Histoires.
Rushdie multiplie les niveaux de lecture. Les enfants s’émerveillent des créatures fantastiques – poissons multilingues, oiseaux mécaniques télépathes, jardiniers flottants – quand les adultes décèlent une méditation sur la nécessité vitale des histoires face aux tentatives d’étouffement de l’imagination. La question lancinante « À quoi servent les histoires qui ne sont même pas vraies ? » résonne comme un défi lancé aux censeurs.
« Haroun et la mer des histoires » a connu plusieurs adaptations : une pièce de théâtre signée Tim Supple et David Tushingham créée en 1998 au Royal National Theatre de Londres, ainsi qu’un opéra composé par Charles Wuorinen sur un livret de James Fenton, donné en première au New York City Opera à l’automne 2004. Cette reconnaissance artistique s’accompagne d’une consécration critique avec l’obtention du Writers Guild of Great Britain Award en 1992.
La puissance du récit réside dans sa capacité à transcender son contexte d’écriture pour porter un message universel sur l’importance de la liberté d’expression. Le combat d’Haroun pour sauver la Mer des Histoires fait écho aux luttes contemporaines contre toutes les formes de censure et d’obscurantisme. À travers cette fable enchantée, Rushdie démontre que l’imagination constitue l’une des plus formidables armes contre l’oppression.
Aux éditions FOLIO ; 240 pages.
4. Quichotte (2019)
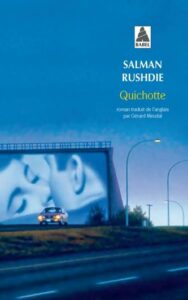
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Dans l’Amérique de Trump, Ismail Smile, un représentant en produits pharmaceutiques d’origine indienne, vit dans un monde façonné par la télévision. Enfermé dans sa bulle télévisuelle, il développe une passion maladive pour Salma R., une présentatrice célèbre. Pour la conquérir, il prend la route à travers les États-Unis au volant d’une vieille Chevrolet. Dans sa quête, il s’invente un fils imaginaire, Sancho, qui finit par prendre chair et l’accompagne dans son périple.
Cette histoire est en réalité écrite par Sam DuChamp, un auteur de romans d’espionnage minable. À travers son personnage de Quichotte moderne, il livre une critique acerbe de la société américaine contemporaine : le racisme ordinaire, la confusion entre réel et fiction, l’emprise des réseaux sociaux, les ravages des opiacés.
Autour du livre
En réinventant l’histoire de Don Quichotte dans l’Amérique contemporaine, Salman Rushdie compose une satire mordante de notre époque, où la frontière entre réalité et fiction s’estompe dangereusement. Si le héros de Cervantes perdait la raison à force de lire des romans de chevalerie, celui de Rushdie sombre dans la folie en regardant sans relâche des émissions de téléréalité et des talk-shows. Cette transposition audacieuse permet à l’écrivain d’ausculter les maux de la société américaine : l’addiction aux opioïdes, le racisme systémique, la prolifération des fake news, la tyrannie des réseaux sociaux.
La construction narrative s’apparente à un jeu de miroirs vertigineux. Le récit principal met en scène Ismail Smile, rebaptisé Quichotte, un représentant pharmaceutique d’origine indienne qui parcourt l’Amérique dans sa Chevrolet délabrée, accompagné de son fils imaginaire Sancho. Ce premier niveau de narration se révèle être une fiction écrite par Sam DuChamp, lui-même personnage créé par Rushdie. Cette mise en abyme permet d’interroger les liens entre l’auteur et ses créatures, tout en multipliant les échos entre les différentes strates du récit.
Le roman puise son inspiration dans un vaste répertoire littéraire qui va bien au-delà de Cervantes. On y trouve des références à « Rhinocéros » d’Ionesco, au « Pinocchio » de Collodi, à « La Conférence des oiseaux » de Farid-ud-Din Attar, ainsi qu’à la nouvelle de science-fiction « Les Neuf Milliards de noms de Dieu » d’Arthur C. Clarke. Cette intertextualité foisonnante s’accompagne d’innombrables allusions à la culture populaire contemporaine, de James Bond aux séries Netflix.
Ce quatrième volet du cycle new-yorkais de Rushdie (après « Furie », « Deux ans, huit mois et vingt-huit nuits » et « La Maison Golden ») dresse un portrait sans concession de l’Amérique trumpienne. L’écrivain y dépeint une nation en proie au délire collectif, où des citoyens ordinaires se métamorphosent en « mastodons », créatures monstrueuses symbolisant la montée du suprémacisme blanc et le rejet de l’autre.
La dimension indienne imprègne profondément le texte : tous les personnages principaux sont nés à Bombay avant d’émigrer aux États-Unis. Cette communauté diasporique n’échappe pas aux sarcasmes de l’auteur, qui raille ces « faux Indiens » accrochant désespérément leur identité aux murs de leurs appartements. Il y aborde frontalement les questions de déracinement, d’identité, d’appartenance culturelle.
Shortlisté pour le Booker Prize 2019, « Quichotte » divise la critique. Certains saluent sa virtuosité narrative et son humour corrosif, d’autres lui reprochent son exubérance parfois excessive. Cette divergence d’opinions reflète peut-être la nature même du projet : comme son illustre modèle, le roman de Rushdie refuse la mesure et la sagesse conventionnelle pour mieux dénoncer les folies de son temps.
L’œuvre s’inscrit dans une longue tradition de réécritures de « Don Quichotte », mais s’en distingue par son ambition de capturer l’essence de notre époque « post-vérité ». En brouillant constamment les frontières entre réel et imaginaire, Rushdie suggère que la fiction n’est pas un mensonge destiné à obscurcir la vérité, mais un moyen de la révéler. Dans un monde où les faits alternatifs prolifèrent, la littérature reste peut-être notre meilleur guide pour démêler le vrai du faux.
Aux éditions BABEL ; 512 pages.
5. L’Enchanteresse de Florence (2008)
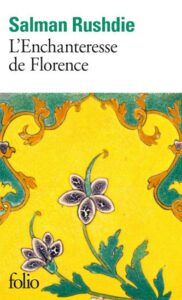
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
À la cour du Grand Moghol Akbar surgit un jour un jeune homme blond aux allures d’arlequin. Ce mystérieux voyageur qui se présente sous le nom de « Mogor dell’Amore » prétend être le fils d’une princesse moghole effacée de l’histoire officielle, ce qui ferait de lui l’oncle de l’empereur. Pour prouver ses dires, il entreprend de narrer l’extraordinaire destinée de sa mère.
Cette femme aux yeux d’ébène, Qara Köz, aurait possédé le don d’envoûter quiconque croisait son regard. Son histoire la conduit de la cour moghole à celle des Médicis, où sa beauté bouleverse Florence. Dans son sillage gravitent trois amis florentins : un condottiere converti à l’Islam, Nicolas Machiavel et un cousin d’Amerigo Vespucci.
Autour du livre
En 2008, « L’Enchanteresse de Florence » vient illuminer le parcours littéraire de Salman Rushdie. Sept années de recherches minutieuses ont nourri cette fresque où se rencontrent l’Occident et l’Orient du XVIe siècle, dans un entremêlement d’Histoire et de magie qui transcende les frontières géographiques et temporelles.
La constellation de personnages qui peuple ces pages mêle figures historiques et créations fictives. Machiavel, les Médicis, Akbar le Grand et Amerigo Vespucci se croisent dans ce kaléidoscope narratif où la réalité historique se fond dans l’imaginaire. Cette architecture complexe s’inscrit dans la lignée des « Mille et Une Nuits », avec ses récits enchâssés qui se déploient comme autant d’échos entre Florence et l’empire moghol.
La dimension philosophique irrigue chaque chapitre à travers les questionnements d’Akbar sur le pouvoir, la religion et l’identité. Ce souverain musulman éclairé incarne une modernité surprenante : il fait construire une maison des débats où toutes les opinions peuvent s’exprimer librement, jusqu’à la remise en question de l’existence divine. Son épouse préférée, Jodha, pure création de son esprit, symbolise le pouvoir de l’imagination qui traverse tout le récit.
La question du dialogue entre les cultures constitue la clé de voûte de l’œuvre. Si l’histoire retient le périple de Marco Polo vers l’Orient, Rushdie imagine ici le chemin inverse : celui d’une princesse moghole vers l’Europe. Cette inversion du regard traditionnel permet d’examiner l’exotisme dans les deux sens, l’Occident devenant aussi mystérieux pour l’Orient que l’inverse.
Les critiques soulignent la densité parfois excessive du texte, certains déplorant des digressions qui ralentissent le rythme. Le foisonnement des personnages et l’enchevêtrement des intrigues peuvent désorienter. Pourtant, cette complexité même reflète l’ambition du projet : tisser une tapisserie où s’entrelacent les fils de deux Renaissances, italienne et moghole, dans leurs similitudes insoupçonnées.
La dimension historique se double d’une réflexion sur le pouvoir des histoires et de la narration. Les personnages deviennent conteurs, magiciens des mots capables de transformer la réalité. Un peintre de cour disparaît littéralement dans sa propre œuvre par amour, tandis qu’une reine imaginaire prend vie par la seule force du désir royal.
La publication s’accompagne d’une bibliographie exhaustive, témoignage du travail documentaire considérable qui sous-tend la fiction. Cette assise historique solide n’empêche pas quelques libertés avec les faits, assumées par l’auteur « dans l’intérêt de la vérité ». Le succès critique de l’ouvrage culmine avec l’éloge d’Ursula K. Le Guin dans The Guardian, qui salue un « roman brillant, fascinant et généreux ».
Ce neuvième roman de Rushdie s’inscrit dans une période particulière de sa vie : installé à New York depuis 2000 après des années de clandestinité forcée suite à la fatwa de 1989, il adopte une écriture plus légère, plus scintillante, sans rien perdre de sa profondeur intellectuelle. La même année, « Les enfants de minuit » reçoit le Best of the Booker, consécration qui confirme la place centrale de Rushdie dans la littérature contemporaine.
Aux éditions FOLIO ; 480 pages.
6. Les versets sataniques (1988)
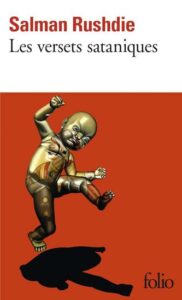
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Deux acteurs indiens, Gibreel Farishta et Saladin Chamcha, survivent miraculeusement à l’explosion de leur avion au-dessus de Londres. Leur chute vertigineuse marque le début de leur métamorphose : Gibreel se voit paré d’une auréole angélique tandis que Saladin développe des attributs démoniaques – cornes, sabots et une épaisse toison.
Le destin des deux hommes se sépare rapidement. Saladin, un immigré qui a passé sa vie à imiter la parfaite britannicité, se retrouve brutalisé par la police et traité comme un clandestin, malgré son passeport britannique. Réfugié dans un café bangladais, il observe avec amertume sa femme vivre une liaison avec son meilleur ami, persuadés tous deux de son décès dans l’attentat.
Gibreel, star de Bollywood ayant récemment perdu la foi, développe des visions où il incarne l’archange Gabriel. Ces songes constituent le cœur narratif du roman et se déploient en trois récits entrelacés : l’histoire de Mahound, un prophète fondant une nouvelle religion monothéiste dans la cité de Jahilia ; le périple d’Ayesha, une jeune mystique guidant tout un village indien dans une marche vers La Mecque ; et le portrait d’un imam exilé préparant son retour triomphal.
Ces rêves, qui occupent les chapitres pairs du roman, questionnent la nature de la révélation divine. Dans la trame principale, Gibreel tente de reconstruire sa vie à Londres auprès d’une alpiniste anglaise, Alleluia Cone. Sa santé mentale se dégrade progressivement, nourrie par une jalousie pathologique que Saladin, assoiffé de vengeance, attise par des appels téléphoniques anonymes.
Autour du livre
Quatrième roman de Salman Rushdie, « Les versets sataniques » émerge en 1988 dans un monde où le fondamentalisme musulman n’occupe pas encore le devant de la scène. L’imaginaire baroque de Rushdie s’épanouit dans une structure narrative sophistiquée qui fait dialoguer plusieurs récits parallèles. Ces histoires s’entrelacent selon une structure alternée : les chapitres impairs suivent les péripéties des protagonistes contemporains, tandis que les chapitres pairs plongent dans les songes de Gibreel Farishta. Cette architecture permet à Rushdie d’orchestrer un vaste jeu de miroirs entre différentes époques et cultures.
Timothy Brennan qualifie ce texte de « roman le plus ambitieux jamais publié sur l’expérience des immigrants en Grande-Bretagne ». Muhammad Mashuq ibn Ally souligne qu’il traite « d’identité, d’aliénation, d’enracinement, de brutalité, de compromis et de conformité ». Ces thèmes s’incarnent particulièrement dans le personnage de Saladin Chamcha, figure de l’immigrant qui renie ses origines indiennes pour embrasser une britannicité fantasmée.
La dimension onirique irrigue l’ensemble du texte, brouillant constamment les frontières entre réel et imaginaire. Les métamorphoses physiques des personnages – Gibreel en ange, Saladin en démon – matérialisent leurs conflits intérieurs et symbolisent la transformation identitaire inhérente à l’expérience migratoire. Cette dimension fantastique inscrit « Les versets sataniques » dans la lignée du réalisme magique de Gabriel García Márquez.
L’influence littéraire majeure revendiquée par Rushdie est « Le Maître et Marguerite » de Mikhaïl Boulgakov. On retrouve dans les deux œuvres une même utilisation du surnaturel pour questionner les certitudes religieuses et politiques. Les critiques ont également noté des similitudes avec les œuvres de James Joyce, Italo Calvino, Franz Kafka et Thomas Pynchon.
Shortlisté pour le Booker Prize et lauréat du Whitbread Award en 1988, le roman reçoit initialement un accueil critique élogieux. Harold Bloom le considère comme « la plus grande réussite esthétique de Rushdie ». Pourtant, dès sa parution, les protestations s’élèvent. En Inde, le gouvernement de Rajiv Gandhi interdit le livre dès octobre 1988, espérant gagner des voix musulmanes aux législatives. Une vingtaine de pays suivent.
La fatwa prononcée par l’ayatollah Khomeini le 14 février 1989 marque un tournant. Des manifestations violentes éclatent, des traducteurs sont agressés ou tués, des librairies sont incendiées. Ces incidents transforment durablement la réception du texte, éclipsant souvent sa valeur littéraire derrière les polémiques. Dix ans de vie clandestine s’ensuivent pour Rushdie, qui change 56 fois de domicile durant les six premiers mois. En 1998, le gouvernement iranien prend ses distances avec la fatwa, mais celle-ci n’est jamais officiellement levée. En 2022, une tentative d’assassinat contre le romancier prouve la persistance de la menace.
Le paradoxe veut que cette œuvre sur le déracinement ait contraint son auteur à une forme extrême d’exil. Plus de trente ans après sa publication, « Les versets sataniques » continue d’interroger notre rapport à la croyance et notre capacité à vivre ensemble malgré nos différences.
Aux éditions FOLIO ; 752 pages.
7. La Maison Golden (2017)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
New York, janvier 2009. Le jour où Barack Obama prête serment, une limousine Daimler dépose Nero Golden et ses trois fils devant leur nouvelle demeure de Greenwich Village. Ce septuagénaire énigmatique a quitté l’Inde dans des circonstances troubles après les attentats de Bombay. Ses fils portent des noms d’empereurs romains : Petronius, un développeur de jeux vidéo atteint du syndrome d’Asperger, Lucius Apuleius, un artiste tourmenté, et le jeune Dionysos en quête de son identité sexuelle.
De l’autre côté de la rue, René Unterlinden, un apprenti cinéaste de 25 ans, pressent que cette famille cache de lourds secrets. Il entreprend de percer leurs mystères pour en faire un film. L’histoire se complique avec l’apparition de Vasilisa, une Russe magnétique qui séduit le patriarche.
Autour du livre
En situant son treizième roman dans l’Amérique contemporaine, de l’élection d’Obama à celle de Trump, Salman Rushdie signe une œuvre singulière qui marque une rupture avec son réalisme magique habituel. L’originalité du projet tient à son architecture narrative qui entremêle histoire familiale et chronique politique américaine. René Unterlinden, narrateur aspirant cinéaste, observe ses voisins à travers sa caméra, dans une référence assumée à « Fenêtre sur cour » d’Alfred Hitchcock. Cette mise en abyme permet à Rushdie de questionner la frontière entre réalité et fiction, entre observation et invention.
La dimension politique se cristallise notamment autour de la figure de Trump, jamais nommé mais transfiguré en Joker, personnage de comics aux cheveux verts. Cette métamorphose du réel en fiction illustre l’ambition du roman : dépeindre une Amérique où la vérité elle-même devient matière à caricature. Les attentats de Mumbai de 2008, point de départ de l’exil des Golden, font écho aux bouleversements contemporains, inscrivant l’intrigue dans une réflexion plus large sur l’identité et le déracinement.
Rushdie y déploie un réseau dense de références culturelles, de l’Antiquité romaine au cinéma contemporain. Les noms des personnages – Néron, Petronius, Apuleius – créent un pont entre la Rome antique et l’Amérique moderne, suggérant des parallèles sur la décadence des empires. Cette intertextualité sophistiquée s’étend du « Satiricon » de Pétrone aux œuvres de Fitzgerald, en passant par les productions d’Hollywood.
La construction des personnages mérite une attention particulière. Chacun des fils Golden incarne une problématique contemporaine : l’autisme Asperger pour Petya, la quête artistique pour Apu, l’identité de genre pour D. Ces trajectoires individuelles s’entrecroisent pour former une mosaïque des questionnements identitaires actuels. Vasilisa, la jeune épouse russe, apporte une dimension supplémentaire en incarnant les stéréotypes de la femme fatale tout en les subvertissant.
La réception critique divise : certains saluent l’ambition et la portée du projet, tandis que d’autres pointent un certain éparpillement. Le Washington Post parle d’un « tas de phrases usées », quand The Guardian célèbre « une satire moderne du Bûcher des vanités ». Les critiques soulignent aussi l’érudition parfois écrasante du texte, certains y voyant un étalage de références qui peut nuire à la fluidité narrative. Pourtant, cette accumulation culturelle participe du projet même : dresser le portrait d’une époque marquée par la saturation informationnelle et le brouillage des repères.
« La Maison Golden » s’inscrit dans une tendance plus large de la littérature contemporaine qui tente de saisir les mutations de l’ère Trump. À la différence d’autres tentatives du genre, Rushdie choisit la voie de l’allégorie et de la satire, transformant la réalité politique en conte moral sur la corruption du pouvoir et la fragilité des démocraties.
Aux éditions BABEL ; 512 pages.
8. La Cité de la victoire (2023)
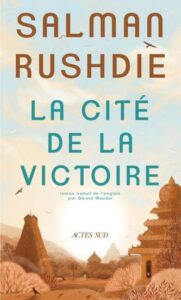
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Dans l’Inde du XIVe siècle, une fillette de neuf ans assiste impuissante au suicide collectif des femmes de son village, dont sa mère, après une défaite militaire. Pampa Kampana, bouleversée par ce drame, reçoit alors la visite d’une déesse qui lui confère des pouvoirs surnaturels et une longévité exceptionnelle : elle vivra 247 ans.
Dotée de facultés magiques, la jeune fille entreprend de créer une cité extraordinaire, Bisnaga, à partir de simples graines semées dans le sol. Par ses murmures, elle insuffle vie et mémoire aux habitants. Sa mission : bâtir un empire où les femmes seront les égales des hommes. Sous son influence, la ville prospère et s’impose comme une puissance régionale majeure.
Mais au fil des siècles, le rêve initial se fissure. Les luttes de pouvoir, les complots et le fanatisme religieux gangrènent peu à peu la cité. Pampa Kampana observe, impuissante, la montée de l’intolérance et le retour des vieilles traditions patriarcales qu’elle avait voulu abolir.
Autour du livre
Achevé quelques mois avant l’attentat qui a failli lui coûter la vie en août 2022, « La Cité de la victoire » se présente comme la traduction d’un manuscrit en sanskrit découvert dans une jarre enterrée. Cette mise en abyme initiale permet à Salman Rushdie d’insuffler à son texte une dimension métafictionnelle : un narrateur anonyme prétend simplifier et abréger une épopée de 24 000 vers, tout en commentant régulièrement le texte original avec une distance ironique.
S’inspirant de l’histoire réelle de l’empire de Vijayanagara qui domina le sud de l’Inde du XIVe au XVIe siècle, Rushdie tisse une fable aux multiples niveaux de lecture. Dans ce cadre historique, il insère le personnage de Pampa Kampana, une prophétesse qui vit 247 ans et dont le destin s’entremêle avec celui de la cité qu’elle fait naître magiquement. Cette fusion entre histoire documentée et réalisme magique sert de socle à une réflexion sur le pouvoir des mots face aux forces obscurantistes.
La construction narrative procède par cycles, à l’image des dynasties qui se succèdent dans la cité de Bisnaga. Les périodes de tolérance alternent avec des phases de régression, illustrant la nature cyclique des sociétés humaines. Cette structure permet d’aborder de manière allégorique des thèmes contemporains comme l’oppression des femmes, le fanatisme religieux ou la manipulation politique.
Le choix de donner à Pampa Kampana une durée de vie extraordinaire n’est pas qu’un simple artifice narratif : il permet d’observer les mêmes schémas se reproduire génération après génération, soulignant l’incapacité des civilisations à tirer les leçons du passé. « Se détourner de l’histoire, c’est rendre possible une répétition cyclique de ses crimes », note le narrateur.
La dimension féministe traverse l’ensemble du récit. Le traumatisme initial de Pampa – assister à l’immolation de sa mère – devient le moteur de son action : créer une société où les femmes ne seront plus victimes des traditions patriarcales. Mais Rushdie évite l’écueil d’une vision manichéenne en montrant la complexité des rapports de pouvoir, y compris entre femmes.
Rushdie questionne également la nature même du récit historique. En présentant plusieurs versions contradictoires des mêmes événements, il souligne comment le pouvoir s’approprie et réécrit l’histoire. La vérité devient alors une notion malléable, soumise aux impératifs politiques du moment.
La phrase finale – « Les mots sont les seuls vainqueurs » – prend une résonance particulière à la lumière de l’attentat dont Rushdie a été victime peu après avoir terminé ce livre. Elle affirme la victoire de la littérature sur les forces qui tentent de la faire taire, tout en reconnaissant la fragilité de cette victoire.
Certains lecteurs pourront trouver le rythme parfois lent, notamment dans les passages décrivant les intrigues de cour. Mais cette lenteur même participe au projet : montrer comment le temps long de l’histoire se déploie, comment les civilisations naissent, prospèrent et déclinent selon des motifs récurrents.
L’irruption ponctuelle de personnages portugais dans le récit permet d’introduire un regard extérieur sur cette civilisation imaginaire, tout en rappelant les contacts réels qui existaient entre l’Inde médiévale et l’Europe. Ces interactions culturelles nourrissent la réflexion sur l’identité et l’altérité qui traverse le livre.
« La Cité de la victoire » a reçu un accueil critique contrasté. Si certains y voient une œuvre majeure qui renouvelle le genre de l’épopée historique, d’autres regrettent une certaine lourdeur dans la narration. Le Harvard Crimson Review l’a notamment salué comme « une confrontation audacieuse de la religion, de l’histoire et de la tradition entrelacée avec une critique contemporaine de notre monde ».
Aux éditions ACTES SUD ; 336 pages.
9. Deux ans, huit mois et vingt-huit nuits (2015)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Le philosophe Ibn Rushd, grand défenseur de la raison dans l’Espagne musulmane du XIIe siècle, s’éprend de la belle Dunia sans deviner sa nature véritable. Cette princesse djinn lui donne de nombreux enfants avant de disparaître, laissant comme seule trace de son passage des descendants aux oreilles sans lobes qui se multiplient à travers les siècles.
Huit cents ans plus tard, le monde bascule dans le chaos quand une brèche permet à des djinns malfaisants d’envahir la Terre. Ces créatures de feu obéissent aux ordres posthumes d’Al-Ghazali, rival théologique d’Ibn Rushd qui voulait soumettre l’humanité par la terreur. Pour contrer cette menace, Dunia sort de sa retraite et part à la recherche de ses héritiers pour éveiller leurs pouvoirs latents.
Autour du livre
Publié en 2015, « Deux ans, huit mois et vingt-huit nuits » s’inscrit dans la continuité des préoccupations qui habitent l’œuvre de Salman Rushdie depuis la fatwa prononcée contre lui en 1989. Le titre crypté, qui totalise mille et une nuits, place d’emblée ce conte philosophique sous le signe de Shéhérazade, tout en lui insufflant une dimension politique contemporaine.
La structure narrative se déploie selon trois temporalités : le XIIe siècle avec la querelle entre Ibn Rushd (Averroès) et Ghazali, notre présent proche où surgissent les « étrangetés », et un futur situé mille ans plus tard d’où un narrateur collectif relate les événements. Cette architecture temporelle permet à Rushdie d’orchestrer une réflexion sur les enjeux de notre époque : montée des fondamentalismes, catastrophes climatiques, crise économique mondiale.
En convoquant la figure d’Ibn Rushd, dont le père de Rushdie avait emprunté le nom pour en faire le patronyme familial, l’écrivain tisse un lien intime avec son récit. Cette filiation symbolique s’incarne dans le personnage de Geronimo Manezes, le jardinier nostalgique de Bombay vivant à New York – un double à peine voilé de l’auteur lui-même.
La guerre entre les djinns qui traverse le récit reflète les tensions de notre monde contemporain. Les quatre ifrits maléfiques – Shining Ruby, Ra’im Blood-Drinker, Zabardast et Zumurrud – incarnent les forces obscures du fanatisme religieux, tandis que Dunia, la princesse des djinns, représente les valeurs de tolérance et de raison. Ce conflit cosmique fait écho aux bouleversements géopolitiques actuels, notamment la montée des extrémismes religieux.
L’humour constitue une arme puissante dans ce texte engagé. Rushdie manie l’ironie avec brio, notamment dans les scènes où les New-Yorkais réagissent avec leur flegme habituel aux phénomènes surnaturels qui envahissent leur quotidien. Cette légèreté apparente n’enlève rien à la gravité du propos : elle permet au contraire d’aborder des sujets brûlants sans tomber dans le didactisme.
Les critiques ont réservé un accueil contrasté à « Deux ans, huit mois et vingt-huit nuits », certains saluant sa virtuosité narrative quand d’autres lui reprochent une complexité excessive. Le magazine Book Marks lui attribue une note « B-« , synthèse d’avis partagés entre l’enthousiasme et la réserve. Ursula K. Le Guin, dans The Guardian, met en avant « les couleurs féroces, la vigueur, l’humour et le formidable punch » du roman.
Aux éditions BABEL ; 432 pages.
10. Furie (2001)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
À l’aube du troisième millénaire, Malik Solanka mène une vie en apparence idéale à Londres. Professeur d’université devenu millionnaire grâce à une marionnette télévisuelle de son invention, « Little Brain », cet intellectuel d’origine indienne cache pourtant un démon intérieur. Une nuit, submergé par une rage inexplicable, il se retrouve un couteau à la main près du lit où dorment sa femme et son jeune fils.
Effrayé par ses pulsions meurtrières, il s’enfuit à New York. Dans cette ville survoltée de l’an 2000, Solanka espère se perdre, s’oublier, recommencer à zéro. Mais sa fureur le poursuit. Elle prend d’abord la forme d’une série de meurtres de jeunes femmes, puis de relations amoureuses tumultueuses qui le précipitent dans un cauchemar éveillé.
Autour du livre
Huitième roman de Salman Rushdie publié en 2001, « Furie » marque un tournant significatif dans la bibliographie de l’écrivain britannique d’origine indienne. Premier roman entièrement situé aux États-Unis, il coïncide avec l’installation de Rushdie à New York, après des années d’exil forcé suite à la fatwa prononcée contre lui en 1989. Cette synchronicité entre fiction et réalité imprègne sensiblement le texte, au point que plusieurs critiques y décèlent des éléments autobiographiques à peine voilés.
La publication de « Furie » s’inscrit dans un moment historique particulier : le roman paraît quelques mois seulement avant les attentats du 11 septembre 2001. Cette proximité temporelle confère au texte une dimension prophétique troublante. À travers sa description d’une métropole new-yorkaise bouillonnante de colère, Rushdie pressent les tensions qui grondent sous la surface rutilante du capitalisme triomphant. Les tours jumelles se dressent encore, mais une menace diffuse plane déjà sur la ville. Les passages décrivant la violence latente qui couve dans la ville, les références à l’islam radical et l’omniprésence d’une fureur prête à exploser résonnent de manière saisissante avec les événements qui suivront sa publication. Cette prescience involontaire rappelle celle d’autres œuvres littéraires ayant capté, sans le savoir, l’esprit d’une époque à la veille d’un bouleversement majeur.
L’originalité de « Furie » réside dans sa fusion des genres littéraires. Le récit oscille entre conte philosophique et satire sociale, entremêle des références à la mythologie grecque – notamment les Érinyes qui donnent leur titre au roman – avec une critique musclée de la société de consommation américaine. Les poupées créées par le protagoniste Malik Solanka deviennent ainsi des métaphores de la marchandisation de la culture, tandis que la furie qui l’habite symbolise le malaise d’une civilisation au bord de l’implosion.
Les références culturelles qui émaillent le texte – de Jennifer Lopez à Tiger Woods, en passant par Madonna et le scandale Clinton-Lewinsky – ancrent fermement le récit dans son époque. Paradoxalement, cette volonté d’actualité immédiate risque aujourd’hui de dater le texte, comme le soulignent plusieurs critiques. Néanmoins, ces marqueurs temporels servent aussi de témoignage sur l’état d’esprit d’une Amérique au faîte de sa puissance, juste avant que les certitudes de l’ère Clinton ne volent en éclats.
La structure narrative de « Furie » reflète ainsi le chaos mental de son protagoniste. Les digressions multiples, les changements de ton abrupts et l’accumulation des références traduisent l’état d’esprit d’un homme – et d’une société – au bord de la rupture. Cette fragmentation formelle, si elle peut dérouter, participe pleinement au projet de Rushdie : donner à voir et à ressentir la confusion mentale d’une époque.
La réception critique s’avère particulièrement contrastée. Si certains saluent l’audace de cette plongée dans les travers de l’Amérique pré-11 septembre, d’autres déplorent un certain éparpillement narratif. The Guardian classe le roman dans la catégorie « Love It », tandis que The Independent, The Observer et le Times Literary Supplement le relèguent à « Ok ». Plus sévères encore, le Daily Telegraph, le Times et le Sunday Telegraph lui attribuent la mention « Rubbish ».
« Furie » marque le début d’une nouvelle phase dans la carrière de Rushdie, plus centrée sur l’Occident contemporain. Il préfigure certains thèmes qui seront développés dans ses romans ultérieurs comme « La Maison Golden » et « Quichotte », notamment la critique de l’Amérique moderne et les identités multiples dans un monde globalisé.
Aux éditions FOLIO ; 432 pages.




