Gustave Flaubert naît le 12 décembre 1821 à Rouen, dans une famille bourgeoise. Son père est chirurgien-chef à l’Hôtel-Dieu de Rouen. Le jeune Gustave passe une enfance plutôt sombre dans l’appartement de fonction de l’hôpital, mais trouve du réconfort auprès de sa sœur Caroline.
À l’adolescence, il manifeste déjà un goût prononcé pour l’écriture. Durant l’été 1836, il fait une rencontre déterminante : Élisa Schlésinger, dont il s’éprend d’une passion durable qui inspirera plus tard « L’Éducation sentimentale » (1869).
En 1841, Flaubert entreprend des études de droit à Paris, qu’il abandonne en 1844 suite à une crise d’épilepsie. Il s’installe alors à Croisset, près de Rouen, où il vivra la majeure partie de sa vie. La mort de son père en 1846 lui laisse une fortune qui lui permet de se consacrer entièrement à l’écriture.
Entre 1849 et 1852, il voyage en Orient avec son ami Maxime Du Camp, une expérience qui nourrira son œuvre. De retour en France, il se lance dans la rédaction de « Madame Bovary », qui paraît en 1856 et fait scandale. Le procès qui s’ensuit le rend célèbre. Il publie ensuite « Salammbô » (1862), « L’Éducation sentimentale » (1869), et « Les Trois contes » (1877).
Malgré sa notoriété, ses dernières années sont marquées par des difficultés financières et la perte de ses proches. Il meurt subitement le 8 mai 1880 à Croisset, laissant inachevé son dernier roman, « Bouvard et Pécuchet » (1881). Son influence sur la littérature française est considérable. Il est considéré comme l’un des plus grands romanciers du XIXe siècle.
Voici notre sélection de ses romans majeurs.
1. Madame Bovary (1856)
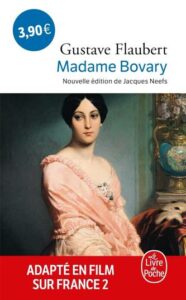
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Publié en 1857, « Madame Bovary » brosse le portrait d’une jeune femme de la bourgeoisie provinciale normande sous la Monarchie de Juillet. Emma Rouault, fille d’un fermier aisé, épouse Charles Bovary, officier de santé médiocre mais dévoué. Nourrie de lectures romantiques depuis son éducation au couvent, elle rêve d’une existence passionnée, bien loin de la vie monotone qui l’attend auprès de son mari dans leur petite ville d’Yonville.
Le mariage se révèle rapidement décevant pour Emma. Ni la naissance de leur fille Berthe, ni leur installation dans une nouvelle demeure ne parviennent à dissiper son ennui. Elle cherche alors à fuir sa condition à travers deux liaisons successives : d’abord avec Rodolphe Boulanger, un propriétaire terrien séducteur qui l’abandonne, puis avec Léon Dupuis, un jeune clerc de notaire. Parallèlement, elle accumule les dettes pour satisfaire son goût du luxe. Acculée financièrement et délaissée par ses amants, elle finit par s’empoisonner à l’arsenic.
Autour du livre
La genèse de « Madame Bovary » débute véritablement le 23 juillet 1851, lorsque Flaubert mentionne pour la première fois son projet d’écriture à Louise Colet. Louis Bouilhet, ami proche de l’auteur, lui avait suggéré de s’inspirer du suicide de Delphine Delamare, épouse malheureuse d’un officier de santé normand. Le roman trouve ses racines dans ce fait divers tragique, mais s’en éloigne considérablement pour créer une œuvre monumentale qui occupera Flaubert pendant cinq années de travail intense.
Le manuscrit original, qui comprend quatre mille pages de brouillons rédigés sur de grands feuillets, témoigne d’un processus créatif méticuleux. Flaubert retravaille chaque phrase avec une exigence maniaque, cherchant la perfection jusque dans les moindres nuances. Cette quête de précision absolue transparaît notamment dans la scène des comices agricoles, qui nécessite trois mois entiers de rédaction.
La publication en feuilleton dans la Revue de Paris, d’octobre à décembre 1856, déclenche un scandale retentissant. Le texte subit plusieurs censures, notamment la fameuse scène du fiacre jugée trop suggestive. Le 29 janvier 1857, Flaubert comparaît devant la sixième chambre du tribunal correctionnel de la Seine pour « outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs ». Son avocat, Jules Senard, plaide pendant quatre heures, mettant en avant la dimension morale d’une œuvre où l’héroïne adultère finit punie. Cette stratégie assure l’acquittement de Flaubert mais le laisse amer, car elle réduit son roman à une simple leçon de morale.
L’édition en volume chez Michel Lévy, en avril 1857, connaît un succès fulgurant : les 6 750 exemplaires sont écoulés en deux mois. Le roman bénéficie d’une réception critique contrastée mais passionnée. Victor Hugo, alors en exil à Guernesey, salue dans une lettre du 30 août 1857 « une œuvre » portée par « un des esprits conducteurs de la génération ». Charles Baudelaire loue quant à lui la logique interne du texte qui « suffit à toutes les postulations de la morale ».
Le roman s’inscrit dans une période charnière de l’histoire française, entre la monarchie de Juillet et le Second Empire. Cette époque troublée voit s’affronter légitimistes, orléanistes, républicains et bonapartistes. Ces tensions politiques trouvent un écho subtil dans le roman à travers les positions contrastées des personnages face au progrès, à la religion ou à l’éducation.
L’éducation d’Emma au couvent, nourrie de lectures romantiques comme « Paul et Virginie » de Bernardin de Saint-Pierre ou les œuvres de Walter Scott, constitue un élément crucial pour comprendre sa trajectoire. Cette formation sentimentale inadaptée à la réalité sociale de son époque préfigure sa chute. Les références littéraires qui émaillent le texte – de Lamartine à Chateaubriand – dessinent en creux une critique de la culture romantique et de ses effets délétères.
La postérité de l’œuvre s’avère exceptionnelle. « Madame Bovary » inspire de nombreuses réécritures, des « Incarnations de Madame Bovary » (1933) à « Madame Bovary’s Daughter » de Linda Urbach (2011). Les adaptations cinématographiques se succèdent, de Jean Renoir (1934) à Claude Chabrol (1991), en passant par Vincente Minnelli (1949). Le « Val Abraham » de Manoel de Oliveira (1993) transpose brillamment l’histoire dans le Portugal contemporain.
Le terme « bovarysme » entre dans le langage courant pour désigner cette insatisfaction chronique qui pousse à se rêver autre que l’on est. En 1992, Daniel Pennac inclut même le « droit au bovarysme » parmi les droits imprescriptibles du lecteur dans son essai « Comme un roman », définissant ce phénomène comme une « maladie textuellement transmissible ».
L’influence du roman sur la littérature mondiale demeure considérable. En témoigne sa présence dans la liste des cent meilleurs livres de tous les temps établie par le Cercle norvégien du livre en 2002, ainsi que dans les « 1001 livres à lire avant de mourir ». Henry James évoque sa « perfection » qui « excite et défie le jugement », tandis que Vladimir Nabokov loue « une prose qui fait ce que la poésie est censée faire ».
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 672 pages.
2. L’Éducation sentimentale (1869)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
En 1840, Frédéric Moreau, jeune provincial de dix-huit ans, quitte Paris pour retourner quelques mois dans sa ville natale de Nogent-sur-Seine. Sur le bateau qui l’y mène, il croise Marie Arnoux, épouse d’un marchand d’art parisien. Cette rencontre bouleverse sa vie : il tombe éperdument amoureux de cette mère de famille. De retour à Paris pour ses études de droit, il parvient à se rapprocher du couple Arnoux et devient un habitué de leur cercle.
Pendant près de trente ans, Frédéric va mener une existence marquée par cet amour impossible. Il fréquente la haute société parisienne, s’essaie à diverses carrières sans conviction, multiplie les aventures avec d’autres femmes : Rosanette, une courtisane ; Louise Roque, une jeune provinciale ; Madame Dambreuse, une aristocrate fortunée. Mais aucune ne lui fait oublier Marie Arnoux, qui reste son idéal inaccessible.
En toile de fond de ces errances sentimentales se dessine le Paris des années 1840-1870, avec ses bouleversements politiques majeurs : la fin de la Monarchie de Juillet, la révolution de 1848, l’avènement du Second Empire.
Autour du livre
« L’Éducation sentimentale » émerge après une longue gestation dans l’esprit de Flaubert. Trois essais de jeunesse la précèdent : « Mémoires d’un fou » en 1838, puis « Novembre » en 1842, et une première version rédigée entre 1843 et 1845. La version définitive, fruit d’un labeur acharné de septembre 1864 à mai 1869, transpose en partie l’expérience personnelle de l’auteur, notamment sa rencontre déterminante avec Élisa Schlésinger qui servira de modèle au personnage de Madame Arnoux.
Le projet initial se révèle ambitieux : dresser « l’histoire morale des hommes de ma génération ». L’ironie du titre annonce d’emblée la couleur – il ne s’agit nullement d’une éducation au sens classique mais d’une succession de désillusions. Cette démarche novatrice bouscule les codes du roman d’apprentissage traditionnel en proposant un anti-héros qui, loin de progresser, accumule les échecs.
La structure même du roman rompt avec les conventions narratives de l’époque. Point de progression dramatique classique ni d’apothéose finale, mais une mosaïque de scènes juxtaposées que Gérard Genette qualifie judicieusement de « cubiste ». Cette construction audacieuse, qui anticipe les expérimentations du XXe siècle, déconcerte les premiers lecteurs tout en ouvrant de nouvelles voies romanesques.
L’accueil initial s’avère effectivement mitigé. La critique peine à saisir la portée novatrice de l’œuvre, lui reprochant son absence de climax dramatique et son pessimisme. Henry James, pourtant admirateur de Flaubert, la juge sévèrement, la comparant à « la mastication de cendres et de sciure ». Il faudra attendre Marcel Proust pour que « L’Éducation sentimentale » soit reconnue comme une œuvre majeure, inaugurant une nouvelle approche du temps romanesque.
Le traitement de l’Histoire constitue l’une des grandes réussites du roman. La Révolution de 1848 et le coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte ne servent pas de simple toile de fond mais s’intègrent organiquement au récit. Cette fusion entre destin individuel et bouleversements collectifs influence profondément la littérature ultérieure. L’œuvre marque également un tournant dans la représentation de Paris. La ville n’y apparaît plus comme un simple décor mais comme un personnage à part entière, dont les transformations accompagnent et influencent le destin des protagonistes. Cette approche inaugure une nouvelle manière de mettre en scène l’espace urbain dans la littérature.
L’aspect sociologique mérite une attention particulière. Chaque personnage incarne un type social spécifique : le bourgeois parvenu (Jacques Arnoux), l’aristocrate financier (Dambreuse), l’artiste raté (Pellerin), le révolutionnaire dogmatique (Sénécal). Cette galerie de portraits compose une fresque saisissante de la société parisienne sous la monarchie de Juillet, au point que Pierre Bourdieu y puise matière à une analyse sociologique.
Les échos de « L’Éducation sentimentale » résonnent bien au-delà de son époque. Les naturalistes, Zola en tête, y voient un modèle de roman moderne. Huysmans le considère comme le « parangon du naturalisme », surpassant même « L’Assommoir ». Son influence s’étend jusqu’à la littérature contemporaine, notamment dans le traitement de l’échec amoureux et social. György Lukács y décèle une œuvre quintessentiellement moderne dans son traitement du temps. James Wood, en 2008, souligne son rôle fondateur dans l’établissement de la narration réaliste moderne.
Les tentatives d’adaptation à l’écran témoignent de la complexité de l’œuvre. En 1962, Alexandre Astruc propose une version modernisée avec Jean-Claude Brialy, qui divise la critique. Le feuilleton télévisé de Marcel Cravenne (1973), malgré la présence de Jean-Pierre Léaud, ne parvient pas à traduire toute la subtilité du roman. Plus récemment, James Gray s’en inspire librement pour « Two Lovers ».
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 668 pages.
3. Salammbô (1862)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
En 241 avant J.-C., Carthage panse ses plaies après sa défaite contre Rome. La cité phénicienne doit maintenant affronter la colère de ses mercenaires impayés qui, sous la conduite du chef libyen Mâtho, menacent de l’anéantir. Au cœur de ce conflit émerge la figure énigmatique de Salammbô, fille du général Hamilcar Barca et prêtresse de la déesse Tanit. Sa beauté bouleverse Mâtho qui, pour attirer son attention, commet un acte terrible : le vol du Zaïmph, le voile sacré protecteur de la cité. Ce sacrilège déclenche une guerre sans merci. Les mercenaires assiègent Carthage, multiplient les assauts brutaux contre ses murailles. Pour sauver sa ville, Salammbô doit s’aventurer dans le camp ennemi afin de récupérer le voile divin. Sa rencontre avec Mâtho scelle leur sort dans une passion fatale, tandis que les armées s’affrontent dans des batailles d’une violence inouïe.
Autour du livre
La gestation de « Salammbô » s’inscrit dans un contexte particulier. Après le scandale et le procès de « Madame Bovary » en 1857, Flaubert cherche à s’éloigner des controverses liées au réalisme contemporain. Le choix de Carthage au IIIe siècle avant J.-C. lui permet cette échappée temporelle, tout en satisfaisant sa passion pour l’Antiquité. Dans une lettre à Louise Colet dès 1853, il évoque déjà ce « conte oriental » qui lui revient « par bouffées ».
La préparation du roman témoigne d’une quête documentaire sans précédent. Flaubert consulte des textes antiques (Polybe, Appien, Pline, Xénophon), étudie les collections du Cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale et correspond avec l’archéologue Félicien de Saulcy. Le point culminant de ses recherches reste son séjour en Tunisie du 12 avril au 5 juin 1858, où il parcourt les sites archéologiques et s’imprègne des paysages. Cette expédition transforme radicalement sa vision du roman : « Carthage est complètement à refaire », écrit-il à Ernest Feydeau.
L’écriture elle-même s’avère éprouvante. Flaubert qualifie « Salammbô » de « maladie noire » et décrit son état physique dans sa correspondance : « Je sue du sang, je pisse de l’huile bouillante, je chie des catapultes et je rote des balles de fondeur ». Cette dimension corporelle du labeur se reflète dans la violence du texte, où les corps sont déchirés, crucifiés, sacrifiés.
La structure du roman repose sur des oppositions fondamentales qui se déclinent à tous les niveaux. À l’antagonisme géopolitique entre Carthage et les Barbares répond celui des divinités Tanit et Moloch, de la sensualité et de la violence, du féminin et du masculin. Le Zaïmph cristallise ces dualités : objet de désir et de mort, il lie les amants tout en précipitant leur perte. Cette architecture binaire culmine dans les scènes symétriques du festin initial et des noces finales.
La réception de l’œuvre en 1862 divise la critique. Charles-Augustin Sainte-Beuve pointe des inexactitudes historiques, tandis que George Sand loue la puissance évocatrice du texte. Victor Hugo et Hector Berlioz s’enthousiasment pour cette résurrection de Carthage. Le roman connaît un succès public immédiat et marque durablement les arts et la mode du Second Empire. Les descriptions des costumes inspirent la haute couture parisienne. L’intérêt pour l’archéologie nord-africaine s’intensifie. Les artistes s’emparent du personnage de Salammbô, particulièrement dans son rapport érotique au serpent, comme en témoignent les œuvres d’Alfons Mucha (1896) ou de Gaston Bussière (1907).
Les adaptations se multiplient dans tous les domaines artistiques. L’opéra s’empare du sujet avec Ernest Reyer (1890), tandis que Modeste Moussorgski laisse inachevée sa version. Le cinéma muet propose plusieurs interprétations : Domenico Gaido (1914), Pierre Marodon (1925) avec une partition de Florent Schmitt. La bande dessinée offre une relecture science-fictionnelle avec Philippe Druillet (1980-1986), qui transpose l’intrigue dans un univers cosmique.
Le traitement de l’espace dans le roman révèle une dramaturgie des positions et des regards. Les personnages évoluent selon des axes verticaux (haut/bas) et horizontaux (proche/lointain) qui matérialisent leurs rapports de force. Cette géométrie narrative souligne l’impossibilité de l’union entre Salammbô et Mâtho, figures astrales condamnées à ne jamais se rejoindre, à l’image de Tanit (la Lune) et de Moloch (le Soleil).
La dimension mythologique imprègne l’ensemble du récit. Salammbô, par son lien à Tanit, incarne une féminité lunaire et mystérieuse, tandis que Mâtho, dans sa fureur guerrière, se rapproche de Moloch. Le Zaïmph lui-même possède une valeur symbolique multiple : voile de la déesse, hymen virginal, frontière entre le sacré et le profane. Sa transgression déclenche une série de catastrophes qui mènent à l’anéantissement des amants sacrilèges.
Cette œuvre marque aussi un moment charnière dans l’évolution du roman historique. Sans renoncer à l’érudition, Flaubert crée une Carthage onirique où la documentation se mêle à l’invention. Cette approche ouvre la voie à une nouvelle manière d’écrire l’Histoire, où la reconstitution méthodique se double d’une dimension poétique et symbolique.
Aux éditions FOLIO ; 534 pages.
4. Bouvard et Pécuchet (1881)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Dans ce roman inachevé, publié après sa mort, Flaubert met en scène deux employés de bureau parisiens d’âge mûr, Bouvard et Pécuchet. Ces célibataires solitaires se rencontrent par hasard sur un banc du boulevard Bourdon lors d’une chaude journée d’été. Portés par leur passion commune pour le savoir et la connaissance, ils deviennent inséparables. Quand Bouvard hérite d’une petite fortune, les deux amis décident de quitter leur morne existence de copistes pour s’installer en Normandie.
Dans leur nouvelle demeure de Chavignolles, les deux compères se lancent avec enthousiasme dans une succession d’entreprises et d’apprentissages. Agriculture, jardinage, médecine, archéologie, littérature, philosophie, religion – aucun domaine n’échappe à leur curiosité dévorante. Mais leurs tentatives se soldent invariablement par des échecs cuisants, provoquant les moqueries des villageois. Naïfs et obstinés, ils persistent pourtant, passant d’une discipline à l’autre avec un entêtement qui confine à l’absurde.
Autour du livre
Cette œuvre posthume de Flaubert, publiée en 1881, trouve son origine dans une nouvelle de 1841, « Les deux greffiers » de Barthélemy Maurice. De cette trame simple – deux retraités à la campagne – Flaubert tire une œuvre monumentale qui lui demande près de vingt ans de travail acharné. La documentation colossale qu’il accumule – plus de 1500 ouvrages consultés – témoigne de son ambition : créer une « encyclopédie critique en farce » qui constituerait le pendant comique de « La Tentation de saint Antoine ».
Le roman se distingue par sa structure épisodique qui suit la progression des deux protagonistes à travers les différentes branches du savoir, du plus concret au plus abstrait. Cette ascension intellectuelle ratée dessine une critique acerbe des prétentions scientifiques et artistiques du XIXe siècle. La confusion permanente entre les signes et la réalité, caractéristique des personnages flaubertiens, atteint ici son paroxysme.
L’inachèvement même du roman participe à sa force : selon les notes de Flaubert, l’œuvre devait se conclure par un retour des deux amis à leur activité initiale de copistes. Cette circularité aurait parachevé la démonstration de l’inanité des tentatives d’accession au savoir. Le « Dictionnaire des idées reçues », prévu comme appendice, aurait constitué l’ultime vengeance des deux personnages contre la bêtise humaine.
« Bouvard et Pécuchet » a suscité l’admiration de nombreux écrivains. Jorge Luis Borges y voit une anticipation de l’absurde kafkaïen, tandis qu’Ezra Pound le considère comme un témoignage essentiel sur la mentalité du XIXe siècle. Les multiples adaptations – théâtrales, radiophoniques et télévisées – attestent de sa résonance contemporaine, notamment celles mettant en scène Jean-Pierre Marielle et Jean Carmet en 1989, ou plus récemment Jérôme Deschamps et Micha Lescot au Théâtre de la Ville en 2017.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 474 pages.
5. Un cœur simple (1877)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
En 1877, Flaubert publie ce court récit qui retrace le parcours de Félicité, une servante au destin modeste dans la Normandie du XIXe siècle. Après une jeunesse marquée par l’abandon et la pauvreté, cette jeune femme trouve une place de domestique chez Madame Aubain, veuve qui vit à Pont-l’Évêque avec ses deux enfants, Paul et Virginie.
L’existence de Félicité est rythmée par son dévouement sans faille envers ses maîtres et par une succession de pertes douloureuses. La mort frappe d’abord Virginie, à qui elle s’était particulièrement attachée, puis son neveu Victor, parti comme marin aux Amériques. Quand Madame Aubain disparaît à son tour, il ne reste plus à Félicité qu’un perroquet nommé Loulou. L’oiseau devient le centre de son univers affectif, et même après sa mort – elle le fait empailler – il continue d’occuper ses pensées jusqu’à se confondre dans son esprit avec l’image du Saint-Esprit.
Autour du livre
Rédigé en 1876, « Un cœur simple » s’inscrit dans une période douloureuse pour Flaubert. L’écrivain traverse alors de graves difficultés financières qui le contraignent à vendre sa propriété de Deauville. La mort de George Sand et de Louise Colet cette même année ajoute à son désarroi. Cette nouvelle constitue le premier volet des « Trois contes », aux côtés de « La Légende de saint Julien l’Hospitalier » et « Hérodias ».
L’inspiration du personnage de Félicité provient possiblement de la servante qui s’occupait de Flaubert enfant. Cette genèse autobiographique se double d’une résonance avec « Madame Bovary » : la bonne d’Emma portait déjà le prénom de Félicité. La nouvelle inverse cependant la perspective en plaçant au centre du récit non plus la maîtresse de maison mais sa domestique.
Flaubert y développe une tension constante entre réalisme social et mysticisme. D’un côté, il dépeint avec acuité la condition des domestiques au XIXe siècle : leur dévouement absolu, leur solitude affective, leur dépendance. De l’autre, il suit la progressive transformation de Félicité qui, par la force de son amour et de sa foi naïve, transfigure la banalité de son existence en expérience mystique. Le perroquet Loulou incarne cette ambivalence. Objet de dérision pour les autres personnages, il devient pour Félicité le réceptacle d’une transcendance authentique bien que teintée d’hérésie. Son empaillement grotesque n’empêche pas la puissance de la vision finale où il se confond avec le Saint-Esprit.
En 2008, Marion Laine adapte la nouvelle au cinéma avec Sandrine Bonnaire dans le rôle de Félicité et Marina Foïs dans celui de Madame Aubain. Si le film parvient à restituer la justesse psychologique des personnages, il peine nécessairement à traduire la subtile dialectique entre trivialité et sacré qui fait la force du texte original.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 94 pages.




