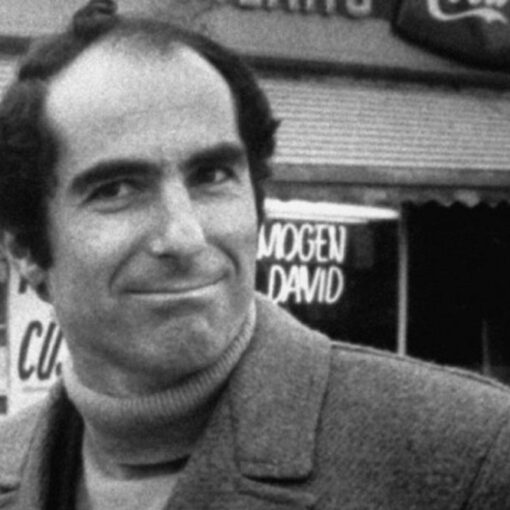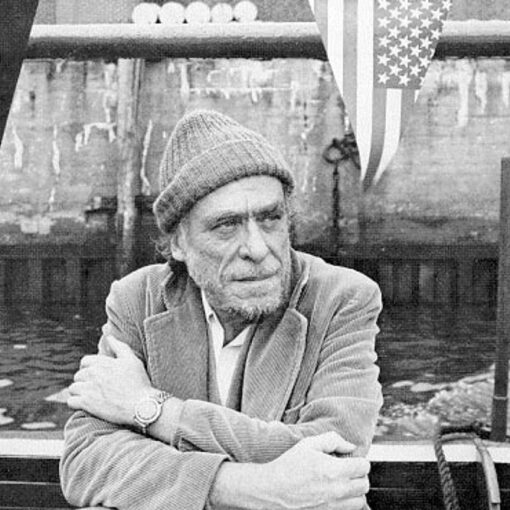James Joyce naît le 2 février 1882 à Dublin, dans une famille catholique. Aîné de dix enfants, il grandit dans un foyer marqué par les difficultés financières et l’alcoolisme de son père. Très tôt, il manifeste des dons intellectuels exceptionnels qui lui permettent d’étudier chez les jésuites au Clongowes Wood College, puis au Belvedere College.
Brillant étudiant à l’University College de Dublin, il s’immerge dans la littérature et le théâtre. À 22 ans, il fait la rencontre décisive de Nora Barnacle, qui deviendra sa compagne de vie. Le 16 juin 1904, date de leur premier rendez-vous, deviendra célèbre comme le jour où se déroule l’action d’ « Ulysse ».
Le couple quitte l’Irlande en 1904 pour un exil volontaire qui les mène d’abord à Trieste, où Joyce enseigne l’anglais. C’est là qu’il écrit « Gens de Dublin » et commence à parfaire son style. La Première Guerre mondiale les pousse à s’installer à Zurich, où Joyce travaille sur « Ulysse » tout en luttant contre des problèmes de vue qui s’aggravent.
En 1920, sur les conseils d’Ezra Pound, Joyce s’installe à Paris. La publication d’ « Ulysse » en 1922 par Sylvia Beach marque un tournant dans sa carrière. L’œuvre, révolutionnaire dans sa forme et son contenu, fait scandale mais assoit sa réputation d’écrivain majeur. Il se lance ensuite dans la rédaction de « Finnegans Wake », œuvre expérimentale encore plus radicale qui l’occupera pendant dix-sept ans.
Malgré une vie marquée par les difficultés financières, les problèmes de santé et la maladie mentale de sa fille Lucia, Joyce poursuit sans relâche son travail d’innovation littéraire. La montée du nazisme le pousse à quitter Paris pour Zurich en 1940. C’est là qu’il meurt le 13 janvier 1941, laissant derrière lui une œuvre qui révolutionne la littérature du XXe siècle.
Joyce reste célèbre pour avoir repoussé les limites du roman moderne, notamment à travers le monologue intérieur et le « stream of consciousness ». Son influence s’étend bien au-delà de la littérature, touchant la philosophie, la psychanalyse et même la physique, où le terme « quark » trouve son origine dans « Finnegans Wake ». Chaque année, le 16 juin, les admirateurs du monde entier célèbrent le « Bloomsday » en hommage à son chef-d’œuvre, « Ulysse ».
Voici notre sélection de ses livres majeurs.
1. Ulysse (roman, 1922)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Dublin, 16 juin 1904. Leopold Bloom, un agent publicitaire juif de 38 ans, prépare le petit-déjeuner tandis que sa femme Molly reste alanguie au lit. Cette journée prend une teinte particulière pour Bloom : il sait que Blazes Boylan, l’imprésario de Molly, doit lui rendre visite dans l’après-midi pour une liaison adultère. Rongé à cette idée, Bloom quitte son domicile et commence une déambulation solitaire à travers la ville.
Son errance le mène d’un endroit à l’autre : les funérailles d’une connaissance, les bureaux d’un journal où il tente de placer une annonce, un pub où il mange un sandwich au gorgonzola. Pendant ce temps, un jeune intellectuel, Stephen Dedalus, vit sa propre odyssée parallèle. Professeur désabusé, écrivain en devenir, il quitte la tour Martello où il vit avec son ami Buck Mulligan, hanté par le souvenir de sa mère récemment décédée. Les chemins de Bloom et Stephen se frôlent à plusieurs reprises sans jamais vraiment se croiser, jusqu’à leur rencontre nocturne dans le quartier des bordels. Bloom, qui a perdu son fils Rudy en bas âge, prend Stephen sous son aile et l’invite chez lui.
Le roman s’achève sur un extraordinaire monologue intérieur de Molly Bloom. Dans son lit, aux côtés de son mari endormi, elle laisse défiler ses pensées : sa liaison avec Boylan, ses souvenirs de jeunesse à Gibraltar, sa vie avec Leopold. Son flux de conscience culmine dans un « oui » final qui résonne comme une affirmation de la vie dans toute sa complexité.
Autour du livre
Publié en 1922, « Ulysse » transpose l’Odyssée d’Homère dans le Dublin du début du XXe siècle. Les sept années de rédaction, de 1914 à 1921, témoignent de l’ambition monumentale du projet. Joyce, installé à Trieste puis à Paris, reconstruit méticuleusement le Dublin de son exil, compilant cartes, annuaires et journaux pour garantir une exactitude topographique absolue. Le choix du 16 juin 1904 comme cadre temporel marque l’intersection du personnel et du littéraire : c’est le jour de sa première rencontre avec Nora Barnacle, qui deviendra sa compagne. Chaque année depuis, les admirateurs du livre célèbrent le « Bloomsday » le 16 juin en rejouant le périple dublinois de Leopold Bloom. La précision topographique du roman est telle qu’on dit qu’il permettrait de reconstruire Dublin si la ville venait à disparaître.
La publication s’inscrit dans une époque de bouleversements artistiques et sociaux. Les premières parutions en feuilleton dans The Little Review, dès 1918, provoquent un scandale retentissant. La revue subit des poursuites judiciaires pour obscénité, ses numéros sont saisis et brûlés par la poste américaine. C’est finalement Sylvia Beach, avant-gardiste propriétaire de la librairie Shakespeare and Company à Paris, qui prend le risque de publier l’intégralité du roman en 1922. Cette édition originale, limitée à 1000 exemplaires, devient instantanément un objet de collection.
Les réactions initiales oscillent entre admiration et répulsion. Le Sunday Express qualifie le livre de « plus infâmement obscène de toute la littérature ancienne ou moderne ». À l’opposé, T.S. Eliot salue une œuvre qui « ordonne le chaos de l’histoire contemporaine ». Cette polarisation reflète les tensions d’une époque où la littérature moderniste bouscule les conventions établies.
L’interdiction du livre dans les pays anglo-saxons jusqu’aux années 1930 participe paradoxalement à sa mythification. Des exemplaires circulent clandestinement, recopiés à la main ou importés sous de fausses couvertures. En 1933, le juge John M. Woolsey rend un arrêt historique autorisant la publication aux États-Unis, reconnaissant la valeur littéraire de l’œuvre par-delà les passages controversés.
La structure du roman révèle une architecture complexe dissimulée sous l’apparente anarchie narrative. Chaque chapitre correspond non seulement à un épisode de l’Odyssée, mais développe aussi un organe du corps humain, une couleur, un art et une technique littéraire spécifiques. Ces correspondances, révélées dans les schémas Linati et Gilbert, transforment le texte en véritable encyclopédie de la condition humaine.
Le monologue final de Molly Bloom, huit phrases s’étendant sur près de cinquante pages sans ponctuation, constitue l’aboutissement de cette quête formelle. Ce flux de conscience (stream of consciousness), ancré dans le corporel et le quotidien, transcende les artifices littéraires pour atteindre une forme de vérité brute du langage.
L’influence d’ « Ulysse » sur la littérature du XXe siècle s’avère déterminante. Virginia Woolf, malgré ses réserves initiales, intègre des techniques similaires dans « Mrs Dalloway ». Le roman inspire des écrivains aussi différents que Malcolm Lowry, Vladimir Nabokov ou Philip Roth. Son impact dépasse même le cadre littéraire : des compositeurs comme Luciano Berio et John Cage créent des œuvres basées sur sa structure musicale.
Le texte continue de susciter des interprétations nouvelles. Les études post-coloniales y décèlent une critique du colonialisme britannique. Les théoriciens féministes réévaluent le personnage de Molly Bloom. Les avancées en neurosciences permettent d’apprécier la précision avec laquelle Joyce reproduit les mécanismes de la pensée.
Plusieurs adaptations cinématographiques tentent de relever le défi de sa mise en images. Joseph Strick réalise en 1967 une version controversée, tandis que Sean Walsh propose en 2003 une interprétation plus expérimentale avec « Bloom ». En 2022, pour le centenaire de sa publication, une nouvelle traduction française ravive les débats sur la possibilité de transposer sa complexité linguistique.
Les manuscrits, conservés au Rosenbach Museum de Philadelphie, continuent d’être étudiés. Les chercheurs découvrent régulièrement de nouvelles références cachées, confirmant la prédiction de Joyce selon laquelle son livre occuperait les universitaires pendant des siècles. Cette densité herméneutique n’empêche pas une lecture plus immédiate, sensible à l’humanité profonde des personnages et à la poésie du quotidien.
Aux éditions FOLIO ; 1664 pages.
2. Portrait de l’artiste en jeune homme (roman, 1916)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Le premier roman de James Joyce narre le parcours de Stephen Dedalus, un jeune Irlandais issu de la bourgeoisie dublinoise de la fin du XIXe siècle. Tout commence au prestigieux pensionnat jésuite de Clongowes Wood, où l’enfant sensible et solitaire subit les brimades de ses camarades. Un soir de Noël, un dîner familial orageux révèle les premières fissures : sa tante Dante et son père s’affrontent violemment sur le rôle de l’Église dans la société irlandaise, un débat qui hantera longtemps le jeune garçon.
Les revers de fortune contraignent bientôt la famille à quitter leur demeure pour Dublin, où Stephen poursuit ses études au Belvedere College. L’adolescent se trouve alors déchiré entre sa foi catholique et l’éveil de ses désirs charnels. Après une phase de débauche qui le mène à fréquenter les prostituées, une retraite spirituelle le plonge dans une intense crise mystique. Les sermons terrifiants sur l’enfer le poussent à mener une vie d’ascète, au point que les jésuites lui proposent la prêtrise. Mais cette vocation religieuse ne résiste pas à son aspiration artistique grandissante. À l’University College de Dublin, il forge ses théories esthétiques et assume sa vocation d’écrivain, quitte à devoir s’exiler d’une Irlande qu’il juge sclérosée.
Autour du livre
Cette œuvre novatrice, publiée sous forme de feuilleton dans The Egoist entre 1914 et 1915, n’aurait peut-être jamais vu le jour sans l’intervention déterminante d’Ezra Pound. Le texte définitif émerge des cendres de plusieurs tentatives antérieures : un essai éponyme de 1904 et surtout « Stephen Hero », un manuscrit de 914 pages que Joyce abandonne en 1907 après en avoir écrit 25 chapitres sur les 63 prévus. En septembre 1911, dans un accès de rage face aux refus successifs des éditeurs de publier « Gens de Dublin », Joyce jette même le manuscrit au feu. Sa sœur Eileen parvient à le sauver in extremis.
La genèse tourmentée du « Portrait de l’artiste en jeune homme » reflète les bouleversements personnels de Joyce pendant sa rédaction. Entre 1904 et 1915, l’écrivain quitte l’Irlande avec Nora Barnacle, s’installe à Trieste où naissent leurs enfants Giorgio et Lucia, enseigne l’anglais pour subsister et lutte pour faire publier ses premières œuvres. Ces années d’exil volontaire nourrissent sa réflexion sur l’identité irlandaise et la nécessité de s’arracher aux déterminismes culturels.
La structure en cinq chapitres constitue une prouesse technique remarquable. Le texte mue littéralement, transformant ses moyens d’expression à mesure que la conscience du protagoniste s’éveille. Cette évolution stylistique n’est pas gratuite : elle incarne la théorie esthétique élaborée par Stephen lui-même, selon laquelle l’art doit atteindre une « radiance » qui transcende sa forme matérielle.
L’influence du roman sur la littérature du XXe siècle s’avère considérable. Il inaugure l’usage du monologue intérieur que Joyce perfectionnera dans « Ulysse ». La critique salue unanimement sa parution. T. S. Eliot, W. B. Yeats et H. G. Wells louent sa modernité. Lady Gregory y voit « une autobiographie modèle ». La première édition anglaise, tirée à 750 exemplaires, s’épuise en quelques mois.
Le choix du nom du protagoniste révèle la densité symbolique de l’œuvre. Stephen évoque le premier martyr chrétien, lapidé pour avoir défié l’orthodoxie religieuse. Dedalus renvoie à l’architecte mythologique qui s’échappe du labyrinthe grâce à des ailes de cire. Cette double référence cristallise les tensions du roman entre tradition et émancipation, entre ancrage terrestre et aspiration spirituelle.
La Modern Library classe « Portrait de l’artiste en jeune homme » au troisième rang des plus grands romans anglophones du XXe siècle, juste derrière « Ulysse » qui occupe la première place. Cette reconnaissance confirme son statut d’œuvre charnière entre le roman victorien et le modernisme. Le texte continue de susciter des exégèses pointues, comme en témoigne l’édition critique majeure établie par Hans Walter Gabler en 1993, qui répertorie minutieusement les variantes textuelles.
En 1977, Joseph Strick réalise une version cinématographique avec Bosco Hogan dans le rôle de Stephen. John Gielgud y livre une interprétation mémorable du sermon sur l’enfer qui bouleverse le protagoniste. En 2012, Léonie Scott-Matthews monte la première adaptation théâtrale au Pentameters Theatre. Plus récemment, des chercheurs de l’University College Dublin développent une édition multimédia qui cartographie les réseaux sociaux des personnages.
Les échos du « Portrait de l’artiste en jeune homme » résonnent dans nombre d’œuvres ultérieures. Dylan Thomas le pastiche dans « Portrait of the Artist as a Young Dog ». Joseph Heller s’en inspire pour « Portrait of an Artist as an Old Man ». Son influence s’étend jusqu’à la musique contemporaine : le groupe Antimatter lui rend hommage dans une chanson de l’album « Planetary Confinement ». Cette fécondité créatrice atteste la puissance d’un texte qui transcende les genres et les époques.
Aux éditions 10/18 ; 360 pages.
3. Gens de Dublin (recueil de nouvelles, 1914)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Publié en 1914 après de multiples refus d’éditeurs, « Gens de Dublin » se compose de quinze nouvelles qui s’articulent autour de moments charnières dans la vie de personnages ordinaires, révélant la paralysie morale et spirituelle qui étreint la société irlandaise de l’époque.
« Les Sœurs » inaugure le recueil en narrant la mort du Père Flynn à travers le regard d’un jeune garçon. Cette nouvelle, initialement publiée en 1904 dans The Irish Homestead sous le pseudonyme de Stephen Daedalus, provoqua immédiatement la controverse parmi les lecteurs catholiques, choqués par le portrait peu orthodoxe du prêtre. Joyce la remania considérablement en 1906 pour accentuer le thème de la paralysie spirituelle.
Dans « Une rencontre », deux écoliers en école buissonnière rencontrent un homme au comportement équivoque. La tension monte progressivement alors que l’homme tient des propos de plus en plus troublants sur la punition corporelle. Cette nouvelle s’inspire directement d’une expérience vécue par Joyce adolescent.
« Arabie » suit un jeune garçon épris de la sœur de son ami. Sa quête d’un cadeau pour elle dans un bazar oriental se solde par une désillusion amère. Le bazar « Araby » existait réellement à Dublin ; sa reconstruction minutieuse témoigne de l’attention obsessionnelle de Joyce aux détails topographiques.
« Eveline » présente une jeune femme paralysée par l’indécision au moment de fuir avec son amant Frank. La critique Hugh Kenner a démontré que le port mentionné dans la nouvelle n’est pas celui de Dublin mais de Liverpool, suggérant que Frank compte abandonner Eveline ou la prostituer.
« Après la course » raconte l’histoire de Jimmy Doyle, fils d’un boucher florissant, perdant son argent au jeu avec des Européens qu’il admire. Cette nouvelle fut remaniée plusieurs fois, Joyce renforçant progressivement la dimension politique de la relation entre l’Irlandais naïf et les continentaux manipulateurs.
« Deux galants » suit deux escrocs, dont l’un manipule une servante pour lui voler de l’argent. Cette nouvelle provoqua des remous lors des tentatives de publication, les imprimeurs refusant de la composer en raison de son contenu jugé immoral.
« La pension de famille » relate comment Mrs Mooney manœuvre habilement pour forcer un de ses locataires à épouser sa fille. La construction elliptique de la nouvelle, avec la scène centrale de confrontation remplacée par une simple ligne pointillée, illustre la maîtrise narrative précoce de Joyce.
« Un petit nuage » montre Little Chandler, petit fonctionnaire dublinois, confronté à la réussite de son ami émigré à Londres. La nouvelle anticipe plusieurs thèmes développés plus tard dans « Ulysse », notamment celui de l’exil.
Dans « Correspondances », un copiste alcoolique passe sa soirée à boire avant de rentrer battre son fils. La violence de la scène finale contraste avec l’humour noir qui imprègne le reste du récit.
« Argile » suit Maria, une vieille fille travaillant dans une blanchisserie, lors d’une soirée d’Halloween. Les jeux d’Halloween décrits correspondent aux traditions authentiques de l’époque à Dublin.
« Un cas douloureux » narre comment Mr Duffy repousse les avances de Mrs Sinico, avant d’apprendre sa mort quatre ans plus tard. Joyce s’inspira pour ce personnage des notes du journal de son frère Stanislaus.
« Ivy Day dans la salle des Commissions » se déroule le jour anniversaire de la mort de Parnell, alors que des militants politiques discutent dans une salle de réunion. La nouvelle saisit l’atmosphère de désillusion politique qui suivit la chute du leader nationaliste irlandais.
« Une mère » décrit une femme sabotant la carrière musicale de sa fille par excès d’orgueil. Cette nouvelle s’inspire directement d’événements dont Joyce fut témoin dans le milieu musical dublinois.
« De par la grâce » suit la tentative de réforme spirituelle d’un ivrogne par ses amis. La nouvelle parodie « La Divine Comédie » de Dante, de l’enfer (le pub) au purgatoire (la convalescence) jusqu’au paradis (l’église).
« Les morts », la plus célèbre des nouvelles, clôt le recueil avec Gabriel Conroy qui a une révélation métaphysique alors que son épouse évoque un amour de jeunesse. John Huston en tira son dernier film en 1987, avec sa fille Anjelica dans le rôle de Gretta Conroy. La nouvelle synthétise tous les thèmes du recueil : la paralysie sociale, la mort spirituelle, l’impossibilité d’échapper au passé.
Autour du livre
L’élaboration et la publication de « Gens de Dublin » constituent une odyssée éditoriale particulièrement houleuse. Le manuscrit, achevé entre 1904 et 1907, se heurte pendant près d’une décennie à une succession de refus. Les objections des éditeurs portent tant sur la morale que sur les risques de diffamation, Joyce ayant minutieusement reproduit la topographie dublinoise et mentionné des établissements existants. L’éditeur Grant Richards exige notamment la suppression de passages jugés scandaleux par ses typographes, comme l’emploi du mot « bloody » dans « Deux galants ». La maison Maunsel & Roberts pousse l’autocensure jusqu’à faire brûler l’intégralité des exemplaires déjà imprimés.
Cette adversité éditoriale reflète les tensions qui traversent l’Irlande du début du XXe siècle. Le pays, tiraillé entre son aspiration à l’indépendance et son assujettissement à l’Empire britannique, voit s’affronter diverses conceptions de l’identité nationale. Joyce prend ses distances avec le nationalisme irlandais, qu’il juge aussi paralysant que l’emprise de l’Église catholique. Cette position lui vaut l’incompréhension de certains de ses compatriotes, notamment Arthur Griffith, futur président du Sinn Féin, qui ne peut l’aider à publier l’ouvrage en Irlande.
La structure du recueil, méticuleusement agencée, suit une progression qui mime le développement de la conscience. Les trois premières nouvelles, centrées sur l’enfance, cèdent la place à quatre récits sur l’adolescence, puis quatre sur la maturité et trois sur la vie publique. Cette architecture culmine avec « Les morts », nouvelle plus ample qui transcende les divisions précédentes pour offrir une méditation sur la condition humaine.
Le concept d’épiphanie, que Joyce théorisera dans « Stephen le héros », trouve dans « Gens de Dublin » sa première expression accomplie. Ces moments de révélation soudaine permettent aux personnages de saisir une vérité essentielle sur eux-mêmes ou leur environnement. Joyce emprunte ce terme à la liturgie catholique, où il désigne la manifestation du divin, pour l’appliquer aux illuminations profanes de la vie quotidienne.
« Gens de Dublin » témoigne également d’une tension permanente entre réalisme et symbolisme. Si Joyce revendique une écriture objective, « un miroir bien poli » tendu à ses compatriotes, les épiphanies qui ponctuent les récits relèvent d’une dimension plus métaphysique. Cette dualité influence profondément la littérature moderniste, montrant comment transcender le quotidien sans renoncer à son observation minutieuse.
L’influence du recueil sur la littérature du XXe siècle s’avère considérable. Plusieurs personnages réapparaissent dans « Ulysse », créant une continuité entre les œuvres. Le « Uncle Charles Principle », technique narrative où le narrateur adopte le parler d’un personnage, inspire de nombreux écrivains. Les adaptations se multiplient : pièce de théâtre par Hugh Leonard (1963), film de John Huston (1987), comédie musicale primée aux Tony Awards (2000), sans compter les versions radiophoniques de la BBC et de RTÉ. En 2023, le duo folk Hibsen compose « The Stern Task of Living », album-concept dont chaque morceau correspond à l’une des quinze nouvelles.
La réception initiale s’avère pourtant mitigée. Joyce confie que seuls deux cents exemplaires se vendent les six premiers mois, vingt-six le semestre suivant, et sept le troisième. Cette indifférence du public contraste avec l’enthousiasme ultérieur des critiques. William York Tindall considère « Gens de Dublin » comme le prélude nécessaire au « Portrait de l’artiste en jeune homme » et à « Ulysse ». Anthony Burgess souligne l’importance du recueil comme réservoir de personnages secondaires pour les œuvres ultérieures.
Aux éditions 10/18 ; 312 pages.
4. Finnegans Wake (roman, 1939)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Publié en 1939 après dix-sept ans d’écriture, « Finnegans Wake » constitue l’ultime œuvre de James Joyce. L’intrigue se déroule à Dublin et dans sa périphérie, notamment dans le quartier de Chapelizod près de Phoenix Park. Au centre du récit se trouve la famille Earwicker : le père Humphrey Chimpden Earwicker (HCE), tenancier de pub, son épouse Anna Livia Plurabelle (ALP) et leurs trois enfants – les jumeaux Shem et Shaun, ainsi que leur sœur Issy.
L’histoire s’amorce avec la chute mortelle d’un maçon dublinois, Finnegan, du haut d’une échelle. Lors de sa veillée funèbre, du whisky éclabousse son corps, provoquant sa résurrection momentanée, avant que les personnes présentes ne le persuadent de retourner dans son cercueil. La narration bascule alors vers HCE, qui devient la figure centrale. Un mystérieux incident survenu à Phoenix Park, dont les détails demeurent flous mais qui semble impliquer deux jeunes filles, déclenche une série de rumeurs à son sujet. Pour le défendre, son épouse ALP rédige une lettre qu’elle dicte à leur fils Shem et confie à Shaun pour qu’il la livre. Cette missive, qui n’atteint jamais sa destination, structure une grande partie du récit à travers ses multiples versions et interprétations.
Les fils d’HCE incarnent deux forces antagonistes : Shem l’artiste rebelle contre Shaun le conformiste, tous deux rivalisant pour succéder à leur père et gagner l’affection de leur sœur Issy. Le livre se clôt sur un monologue d’ALP qui, telle la rivière Liffey se jetant dans la mer à l’aube, disparaît dans l’océan. La dernière phrase, incomplète, se raccorde au début du livre, formant un cycle perpétuel.
Autour du livre
« Finnegans Wake » représente l’aboutissement de dix-sept années d’écriture acharnée (1922-1939), période durant laquelle James Joyce, confronté à une cécité grandissante, doit dicter son texte à divers assistants, dont Samuel Beckett. Cette création monumentale émerge dans un contexte particulier : Joyce, épuisé par l’achèvement d’ « Ulysse », ne reprend l’écriture qu’après une année de silence complet.
L’élaboration du manuscrit témoigne d’un travail titanesque : plus de 25 000 documents relatifs à sa composition sont conservés, dont 14 000 notes à l’Université de Buffalo et 9 000 pages de manuscrits et d’épreuves à la British Library. Le texte paraît initialement par fragments dans des revues littéraires parisiennes sous le titre « Work in Progress », suscitant des réactions véhémentes. La publication sérielle dans la revue transition, dirigée par Eugene Jolas, joue un rôle crucial dans la maturation de l’œuvre.
Les premières réactions s’avèrent majoritairement hostiles. Même le frère de Joyce, Stanislaus, qualifie le texte « d’incompréhensible livre nocturne ». Oliver Gogarty y voit « la plus colossale mystification littéraire depuis l’Ossian de Macpherson ». Ezra Pound, pourtant fervent défenseur d’ « Ulysse », exprime son désarroi. H. G. Wells reproche à Joyce d’avoir « tourné le dos aux hommes ordinaires ». Face à ce déluge de critiques, un groupe d’écrivains incluant Samuel Beckett publie en 1929 « Our Exagmination Round His Factification for Incamination of Work in Progress », première tentative collective de défendre et d’élucider l’œuvre.
La construction du livre s’inspire profondément de la théorie cyclique de l’histoire développée par Giambattista Vico dans « La science nouvelle ». Cette influence structure l’ensemble du texte, qui adopte une forme circulaire où la dernière phrase incomplète se raccorde naturellement au début. Joyce incorpore également des éléments du « Livre des morts des anciens Égyptiens », de la légende de Tristan et Iseut, et de nombreuses références à la mythologie irlandaise.
L’innovation linguistique constitue la marque distinctive de « Finnegans Wake ». Joyce élabore un langage composite fusionnant une quarantaine de langues dans une matrice anglaise, créant des néologismes et des jeux de mots multicouches. Cette construction linguistique vise à reproduire la logique des rêves et les mécanismes de l’inconscient. Samuel Beckett décrit cette écriture comme « la quintessence du langage et de la peinture et du geste, avec toute l’inévitable clarté de la vieille inarticulation ».
L’influence du livre s’étend bien au-delà du domaine littéraire. Le physicien Murray Gell-Mann s’en inspire pour nommer les quarks d’après la phrase « Three quarks for Muster Mark ». Le compositeur John Cage crée plusieurs œuvres basées sur le texte, dont « Roaratorio », qui mêle collages sonores et musique traditionnelle irlandaise. Des adaptations théâtrales, comme « The Coach with the Six Insides » de Jean Erdman, témoignent de la fécondité artistique de l’œuvre.
Des traductions intégrales existent désormais en français, allemand, chinois, japonais et plusieurs autres langues, malgré la difficulté considérable de l’entreprise. Les artistes contemporains continuent d’explorer ses possibilités créatives : en 2000, les artistes danois Michael Kvium et Christian Lemmerz créent une adaptation cinématographique de huit heures.
Les archives révèlent l’ampleur du travail préparatoire : Joyce employait jusqu’à cinq professeurs de norvégien pour parfaire ses références scandinaves, consultait des dictionnaires étymologiques, et incorporait systématiquement ses recherches dans un système complexe de notes. Cette méthode méticuleuse contraste avec l’apparente anarchie du texte final.
« Finnegans Wake » suscite toujours des lectures nouvelles. Le philosophe Jacques Derrida y trouve les fondements de sa théorie de la déconstruction. Les études récentes mettent en lumière sa dimension politique, ses innovations narratives et sa pertinence dans le contexte de la mondialisation culturelle. En 2010, une édition critique établie par Danis Rose et John O’Hanlon propose 9 000 corrections au texte original, témoignant de la vitalité continue des études joyciennes.
La dimension musicale du texte mérite une attention particulière. Joyce insistait sur l’importance de la lecture à voix haute, considérant que la sonorité des mots révélait des significations inaccessibles à la lecture silencieuse. Cette musicalité intrinsèque a inspiré de nombreux compositeurs, de Samuel Barber à André Hodeir.
Aux éditions FOLIO ; 923 pages.