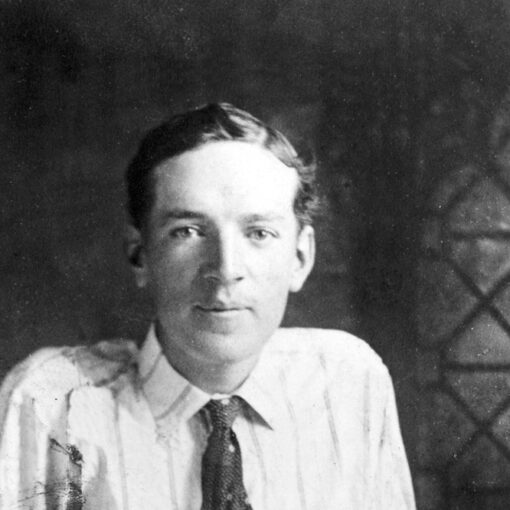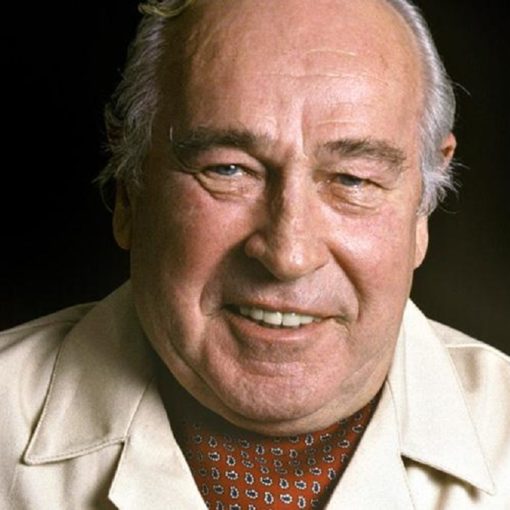Homère vit probablement à la fin du VIIIe siècle avant J.-C. Plusieurs villes d’Ionie, notamment Chios, Smyrne, Cymé et Colophon, revendiquent sa naissance. La tradition le décrit comme un aède aveugle, surnommé « le Poète » par les Anciens. Son nom même, qui signifie « otage », reste mystérieux et n’est attesté que bien plus tard dans l’histoire.
On lui attribue la paternité des deux premières œuvres majeures de la littérature occidentale : l’Iliade et l’Odyssée. Il compose ces épopées dans une langue poétique déjà archaïque pour son époque, mêlant différents dialectes grecs. Sa poésie se transmet d’abord oralement, portée par des formules rythmiques caractéristiques comme les célèbres épithètes homériques.
Au VIe siècle avant J.-C., le tyran athénien Pisistrate ordonne la première transcription écrite de ces œuvres. C’est à cette époque qu’Homère devient officiellement l’auteur reconnu de l’Iliade et de l’Odyssée, même si la question de son existence historique fait débat dès l’Antiquité.
Son influence est considérable : il représente à lui seul le genre épique de cette période et son œuvre inspire des générations de poètes, d’artistes et de penseurs. Les philosophes grecs, puis les savants de toutes les époques, ne cessent d’interpréter ses textes, y cherchant des significations allégoriques sur la nature, les dieux et la condition humaine.
Voici notre sélection de ses livres majeurs.
1. Iliade
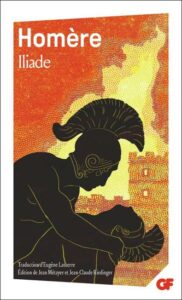
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
La dixième année du siège de Troie s’amorce sous de sombres auspices pour les Achéens. Une terrible peste, envoyée par Apollon, décime leurs rangs en représailles du refus d’Agamemnon de libérer Chryséis, la fille d’un prêtre troyen. Le roi des rois consent finalement à rendre la captive, mais exige en compensation Briséis, la prisonnière d’Achille. Cette décision provoque la fureur du plus redoutable guerrier grec qui, humilié, se retire des combats avec ses Myrmidons. Par l’entremise de sa mère, la déesse Thétis, il obtient de Zeus que les Troyens prennent l’avantage dans la guerre.
Dès lors, sous la conduite du valeureux Hector, les Troyens repoussent progressivement leurs ennemis. Les tentatives de négociation avec Achille échouent malgré les présents somptueux promis par Agamemnon. La situation devient critique lorsque les assaillants troyens franchissent les remparts du camp grec et menacent d’incendier la flotte. Patrocle, ami le plus proche d’Achille, ne peut rester insensible au sort de ses compagnons d’armes. Il supplie le héros de lui prêter son armure pour insuffler un nouvel élan aux Achéens.
Revêtu des armes célèbres, Patrocle parvient à repousser l’assaut, mais grisé par ses succès, il outrepasse les consignes d’Achille et poursuit les Troyens jusqu’aux murailles de leur cité. C’est là qu’Hector, soutenu par Apollon, met fin à son ardeur guerrière. La mort de son compagnon bien-aimé transforme la colère d’Achille en rage dévastatrice. Équipé de nouvelles armes forgées par Héphaïstos, il retourne au combat, assoiffé de vengeance. Un affrontement titanesque se prépare entre les deux plus grands héros de leur temps, tandis que les dieux eux-mêmes se divisent pour soutenir leur champion…
Autour du livre
Composé entre 850 et 750 avant J.-C., l’Iliade est considéré comme l’un des premiers récits de la littérature occidentale. D’abord transmise oralement par les aèdes, l’œuvre ne fut fixée par écrit qu’au VIe siècle avant J.-C. Elle constitue en réalité un fragment d’un cycle épique plus vaste, le cycle troyen, dont seuls l’Iliade et l’Odyssée ont survécu jusqu’à nous. Contrairement aux idées reçues, le poème ne relate ni l’enlèvement d’Hélène, ni la ruse du cheval de Troie, ni même la chute de la cité. Il se concentre sur quelques semaines de la dixième année de guerre, articulées autour de la colère d’Achille.
Le texte est remarquable par son traitement novateur des dieux, qui s’immiscent constamment dans les affaires des mortels. Zeus, Héra, Athéna, Aphrodite et les autres divinités prennent parti pour l’un ou l’autre camp, trompent et trichent sans vergogne pour favoriser leurs protégés. Leurs querelles sur l’Olympe font écho aux combats qui se déroulent sur terre. Cette dimension surnaturelle s’entremêle avec une représentation saisissante de la brutalité de la guerre : les affrontements sont décrits avec une précision anatomique glaçante, tandis que le poème s’attarde sur la douleur des mères et des épouses.
Les héros homériques transcendent la simple dimension guerrière. Achille incarne la complexité de la nature humaine : sa colère démesurée cohabite avec une profonde sensibilité, comme en témoignent ses larmes à la mort de Patrocle. Hector, lui, apparaît comme une figure tragique, conscient de sa mort prochaine mais déterminé à défendre sa cité. Le poème atteint des sommets d’émotion lors de ses adieux à son épouse Andromaque, scène de tendresse au cœur du fracas des armes.
Dès l’Antiquité, l’Iliade acquiert le statut de texte fondamental dans l’éducation des jeunes Grecs. Selon le mot de Socrate, Homère devient « l’éducateur de la Grèce ». Le poème inspire de nombreux artistes à travers les siècles, de Virgile qui s’en inspire pour composer l’Énéide jusqu’aux créateurs contemporains. Les hellénistes et historiens continuent d’ailleurs à débattre de la « question homérique » : l’œuvre est-elle le fruit d’un seul poète ou la compilation de plusieurs traditions orales ?
L’Iliade a fait l’objet de nombreuses adaptations cinématographiques, dont la plus notable reste « Troie » (2004) de Wolfgang Petersen. Le film, qui prend certaines libertés avec le texte original en gommant notamment la présence des dieux, propose néanmoins une vision spectaculaire de l’affrontement entre Achille (Brad Pitt) et Hector (Eric Bana). Une adaptation qui témoigne de la persistance du mythe dans l’imaginaire contemporain, même si elle s’éloigne de la portée philosophique du poème originel.
Aux éditions FLAMMARION ; 704 pages.
2. Odyssée
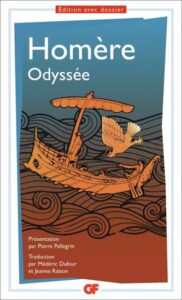
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Après avoir participé à la guerre de Troie pendant dix ans, Ulysse, roi d’Ithaque, entame son retour vers son royaume où l’attendent sa femme Pénélope et son fils Télémaque. Mais le destin s’acharne contre lui lorsque Poséidon, furieux qu’Ulysse ait aveuglé son fils le cyclope Polyphème, décide d’entraver son périple. Le héros grec se trouve alors prisonnier de la nymphe Calypso sur une île lointaine, tandis qu’à Ithaque, des dizaines de prétendants, persuadés de sa mort, s’installent dans son palais et pressent Pénélope de choisir un nouvel époux.
La situation semble sans issue jusqu’à ce qu’Athéna, protectrice d’Ulysse, convainque Zeus d’intervenir. Sur ordre du roi des dieux, Hermès enjoint Calypso de libérer son captif. Parallèlement, Télémaque, devenu un jeune homme, part en quête d’informations sur son père auprès des anciens compagnons d’armes de celui-ci. Il se rend chez le sage Nestor puis chez Ménélas et Hélène à Sparte, où il apprend qu’Ulysse serait toujours en vie.
C’est alors qu’Ulysse, enfin libre, construit un radeau et reprend la mer. Après un naufrage, il échoue chez les Phéaciens où il raconte ses périlleuses aventures des dix dernières années : sa rencontre avec les Lotophages dont la nourriture fait oublier le désir du retour, son affrontement avec Polyphème qu’il aveugle après l’avoir enivré, son passage chez Éole qui lui offre une outre contenant les vents contraires, son escale sur l’île de la magicienne Circé qui transforme ses compagnons en pourceaux, sa descente aux Enfers pour consulter le devin Tirésias, son stratagème pour résister au chant mortel des sirènes, et sa navigation périlleuse entre les monstres Charybde et Scylla.
Les Phéaciens, émus par son récit, décident de le ramener à Ithaque. Mais Athéna, soucieuse de sa sécurité, le métamorphose en vieux mendiant méconnaissable. Sous ce déguisement, Ulysse retrouve d’abord son fidèle porcher Eumée, puis son fils Télémaque à qui il révèle sa véritable identité. Ensemble, père et fils commencent à préparer leur vengeance contre les prétendants qui, depuis des années, dilapident les richesses du palais et harcèlent Pénélope…
Autour du livre
Probablement composée au VIIIe siècle avant J.-C., l’Odyssée s’inscrit dans la tradition des poèmes épiques transmis oralement par les aèdes, ces chanteurs qui se produisaient accompagnés d’un instrument à cordes. Si son attribution à Homère persiste encore aujourd’hui, deux hypothèses divisent les spécialistes : l’existence d’un poète unique ou celle d’un groupe d’aèdes dont les compositions auraient été rassemblées sous ce nom. Les grammairiens d’Alexandrie ont joué un rôle crucial dans l’établissement du texte canonique tel que nous le connaissons, en procédant à une reconstruction critique de la version originale.
L’épopée déploie une structure narrative étonnante pour son époque. Loin de suivre une chronologie linéaire, le récit alterne entre trois fils narratifs : la « Télémachie » qui suit le fils d’Ulysse dans sa quête, les aventures maritimes du héros contées en flash-back lors de son séjour chez les Phéaciens, et sa vengeance finale à Ithaque. Cette architecture sophistiquée s’articule en vingt-quatre chants, division établie ultérieurement par les érudits alexandrins.
Les épisodes emblématiques qui ont marqué l’imaginaire collectif – la ruse du cheval de Troie, l’aveuglement du cyclope, le chant des sirènes ou la fidélité de Pénélope – ne constituent qu’une partie d’une œuvre qui aborde des thèmes universels : l’intelligence face à la force brute, la quête identitaire, la loyauté conjugale, ou encore le rapport entre mortels et divinités. La figure d’Ulysse incarne l’idéal grec de la « mètis », cette intelligence rusée qui permet de triompher des obstacles par l’ingéniosité plutôt que par la seule force.
Les indianistes et mythologues comme Georges Dumézil ont mis en lumière les analogies frappantes entre l’Odyssée et les grandes épopées indiennes comme le Mahâbhârata, suggérant des origines mythologiques indo-européennes communes. Nick Allen, professeur à Oxford, souligne notamment les correspondances précises entre les rencontres féminines d’Ulysse et celles décrites dans le Mahâbhârata.
La postérité de l’Odyssée se manifeste à travers d’innombrables réécritures et adaptations. Dante, dans la « Divine Comédie », place Ulysse aux Enfers. James Joyce structure son roman « Ulysse » (1922) comme une odyssée moderne dans Dublin. Le cinéma s’en est également emparé, du péplum « Ulysse » (1954) de Mario Cameriniaux réinterprétations comme « O’Brother » (2000) des frères Coen. Christopher Nolan prépare actuellement « The Odyssey » pour 2026, avec une distribution prestigieuse comprenant Zendaya et Tom Holland. Cette pérennité témoigne de la puissance intemporelle d’une œuvre qui, selon la formule de Victor Bérard, constitue l’un des « poèmes fondateurs » de la culture occidentale.
Aux éditions FLAMMARION ; 528 pages.