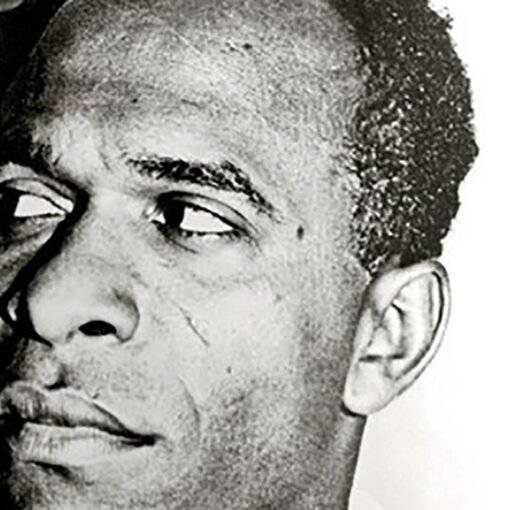Jules Maigret est un personnage de fiction créé par Georges Simenon. Il apparait dans 75 romans policiers et 28 nouvelles publiés entre 1931 et 1972. Né en 1887 à Saint-Fiacre dans l’Allier, il perd sa mère très jeune. Après des études de médecine inachevées à Nantes, il rejoint la police parisienne à 22 ans. Il gravit les échelons jusqu’au poste de commissaire à la brigade spéciale du 36 quai des Orfèvres.
Homme imposant et bourru, grand amateur de pipe et de bonne chère, il est connu pour sa méthode d’investigation particulière : plutôt que de s’appuyer sur les indices matériels, il cherche à comprendre la psychologie des protagonistes en s’immergeant dans leur milieu. Sa devise : « Je ne crois rien ». Marié à Louise, il habite boulevard Richard-Lenoir à Paris.
Le personnage a connu un immense succès, à l’origine de nombreuses adaptations au cinéma et à la télévision, où il fut notamment incarné par Jean Gabin, Jean Richard et Bruno Cremer.
Voici notre sélection de ses meilleures enquêtes. Voir aussi : Romans durs de Georges Simenon (hors Maigret).
1. Pietr-le-Letton (1931)
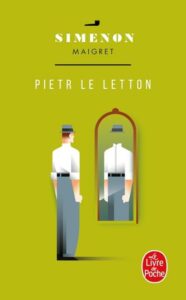
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Paris, novembre 1931. Le commissaire Maigret reçoit l’alerte de l’arrivée imminente d’un dangereux escroc international, Pietr-le-Letton. À la gare du Nord, alors qu’il repère un homme correspondant au signalement descendre de L’Étoile-du-Nord, on découvre dans les toilettes du train le cadavre d’un individu lui ressemblant trait pour trait. Maigret suit le suspect jusqu’au Majestic, un palace où celui-ci rencontre un milliardaire américain, Mortimer-Levingston. L’enquête mène ensuite le commissaire dans les bas-fonds parisiens puis à Fécamp, où il observe l’homme mener une double vie sous différentes identités. Quand son fidèle inspecteur Torrence est assassiné et que lui-même est blessé par balle, Maigret intensifie sa traque.
Autour du livre
Premier roman de la série des Maigret publié par Fayard en 1931, « Pietr-le-Letton » marque la naissance officielle du célèbre commissaire sous la plume de Georges Simenon. La genèse de ce texte fondateur s’entoure d’un certain mystère : si l’auteur a toujours affirmé l’avoir écrit à Delfzijl aux Pays-Bas en septembre 1929, d’autres sources situent sa rédaction à bord de la péniche L’Ostrogoth près de Morsang-sur-Seine en mai 1930.
Le manuscrit connaît d’abord un parcours semé d’embûches, essuyant le refus de cinq maisons d’édition avant d’être finalement publié en feuilleton dans l’hebdomadaire Ric et Rac durant l’été 1930, puis en volume chez Fayard en mai 1931. Cette difficile entrée en matière n’empêchera pas Maigret de s’imposer comme l’une des figures majeures du roman policier du XXe siècle.
Dès ce premier opus, les traits caractéristiques du commissaire sont posés avec une remarquable précision : sa silhouette massive, son pardessus noir, son chapeau melon, son goût pour la pipe et la bière, son attachement au poêle de son bureau. Sa méthode d’investigation singulière, privilégiant l’observation patiente et l’immersion dans le milieu des suspects plutôt que les techniques scientifiques, s’affirme déjà. Comme le note Simenon lui-même, Maigret cherche avant tout la « fissure » révélatrice dans la personnalité du criminel.
Le commissaire apparaît ici plus physique que dans les romans ultérieurs, n’hésitant pas à poursuivre son enquête malgré une blessure par balle. Sa relation avec Madame Maigret, présente fugacement à la fin du récit, commence à se dessiner sous les traits d’une épouse dévouée et discrète. L’équipe du 36 quai des Orfèvres prend forme également, avec notamment l’inspecteur Torrence, dont la mort tragique sera « oubliée » par Simenon dans les romans suivants, où il réapparaîtra bien vivant.
« Pietr-le-Letton » se distingue par son atmosphère particulièrement sombre, entre les couloirs du palace Majestic et les ruelles poisseuses du Marais, sous une pluie battante qui ne cesse de tremper le commissaire. Le Paris des années 1930 y est dépeint sans concession, avec ses contrastes sociaux marqués. Certains passages reflètent malheureusement les préjugés antisémites de l’époque, notamment dans la description du quartier juif et du personnage d’Anna Gorskine.
L’intrigue, plus complexe et mouvementée que dans les Maigret ultérieurs, puise encore dans les ressorts du roman populaire avec son histoire de sosies et de jumeaux. Néanmoins, la psychologie des personnages occupe déjà une place centrale, notamment à travers la relation tourmentée entre les frères Johannson.
« Pietr-le-Letton » constitue ainsi un jalon clé dans l’histoire du roman policier, posant les fondements d’une série qui comptera finalement 75 romans et 28 nouvelles, publiés entre 1931 et 1972, faisant de Maigret l’un des enquêteurs les plus prolifiques de la littérature policière. Le roman a connu plusieurs adaptations télévisées, dont un téléfilm britannique en 1963 avec Rupert Davies et une version française en 1972 avec Jean Richard. En 1999, il a été sélectionné par Le Monde parmi les cent livres du siècle.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 190 pages.
2. Le charretier de la Providence (1931)
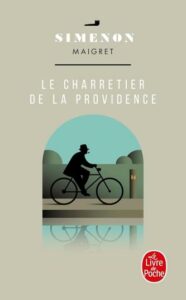
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Au début des années 1930, le long du canal latéral à la Marne, deux charretiers découvrent le corps d’une femme élégante étranglée dans une écurie près de l’écluse 14 de Dizy. Le commissaire Maigret prend en charge l’enquête et identifie rapidement la victime : Mary Lampson, épouse d’un colonel anglais à la retraite qui navigue sur les canaux à bord de son yacht, le Southern Cross. L’équipage du yacht intrigue Maigret : Sir Walter Lampson, aristocrate alcoolique de 68 ans, semble indifférent à la mort de son épouse, tandis que Willy Marco, son homme de confiance de 25 ans, entretenait une liaison avec la défunte. Quand Marco est retrouvé mort à son tour, les soupçons se portent sur le charretier taciturne de la péniche « La Providence », Jean Liberge.
Autour du livre
Rédigé durant l’été 1930 à bord de L’Ostrogoth près de Morsang-sur-Seine, « Le charretier de la Providence » est le deuxième volet des enquêtes du commissaire Maigret. La publication intervient en mars 1931 chez Fayard, dans la première série des romans policiers de Simenon. Le manuscrit original n’existe plus, détruit par l’auteur lui-même. Seule subsiste une enveloppe de teinte terre de Sienne comportant les noms de onze personnages, des annotations relatives à l’intrigue et la mention de trois types de bateaux, conservée dans le Fonds Simenon à Liège.
L’intrigue se déroule dans un cadre inhabituel qui témoigne d’un monde aujourd’hui disparu : celui de la batellerie des années 1930, où les péniches, encore souvent tractées par des chevaux sur les chemins de halage, côtoient les premiers bateaux à moteur. Cette tension entre l’ancien et le moderne se manifeste notamment dans les rivalités entre différents types d’embarcations.
Les critiques louent particulièrement le traitement de l’espace comme créateur d’atmosphère. L’omniprésence de la pluie, le canal rectiligne, la vie quotidienne des éclusiers et des mariniers engendrent une ambiance lourde et mélancolique qui sert admirablement l’intrigue. Le contraste social entre le monde laborieux des mariniers et l’univers oisif des plaisanciers ajoute une dimension sociologique au récit.
La modernité de Maigret se révèle notamment dans l’utilisation d’outils d’enquête novateurs pour l’époque, comme le bélinographe, alors que paradoxalement, il enquête dans un environnement archaïque en parcourant à vélo les soixante-huit kilomètres qui séparent Dizy de Vitry-le-François.
« Le charretier de la Providence » a connu plusieurs adaptations télévisées notables : une version britannique en 1963 sous le titre « The Crime at Lock 14 » avec Rupert Davies ; une adaptation française en 1980 par Marcel Cravenne avec Jean Richard ; une version franco-belge en 2001 titrée « Maigret et la Croqueuse de diamants » avec Bruno Cremer.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 188 pages.
3. Le pendu de Saint-Pholien (1931)
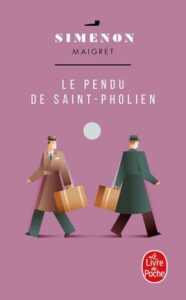
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Le commissaire Maigret, intrigué par le comportement suspect d’un homme dans un café bruxellois, le prend en filature. L’inconnu, qui vient d’expédier une forte somme d’argent, voyage jusqu’à Brême. Sur un coup de tête, Maigret substitue à sa valise une autre identique. Cette initiative provoque le suicide de l’homme, qui s’avère être Jean Lecocq d’Arneville, alias Louis Jeunet. Dans la valise originale : un costume ensanglanté. L’enquête révèle l’existence des « Compagnons de l’Apocalypse », une confrérie d’étudiants liégeois dont faisaient partie Lecocq et quatre autres hommes. Une nuit de Noël, dix ans plus tôt, l’un d’eux commit un meurtre. Tandis que certains réussirent leur vie, Lecocq, rongé par la culpabilité, se mit à faire chanter ses anciens camarades. Maigret devra bientôt choisir entre justice et compassion.
Autour du livre
Quatrième enquête de la série des Maigret, « Le pendu de Saint-Pholien » puise ses racines dans la jeunesse liégeoise de Georges Simenon. Il s’inspire d’un drame réel : le suicide du peintre Joseph Jean Kleine, membre comme Simenon d’un groupe d’artistes bohèmes nommé La Caque, qui se pend le 2 mars 1922 à la clenche de l’église Saint-Pholien. Cette tragédie marque profondément le jeune Simenon, qui transforme ce souvenir en une enquête où la frontière entre fiction et autobiographie s’estompe.
La singularité de ce récit réside dans son point de départ inhabituel : le commissaire Maigret, par un geste impulsif, provoque indirectement un suicide. Cette culpabilité initiale teinte l’ensemble de l’enquête d’une tonalité sombre et mélancolique. Contrairement aux intrigues policières classiques qui débutent par un crime à élucider, Maigret poursuit ici une quête plus personnelle, cherchant à comprendre les ramifications d’un geste qu’il regrette.
La ville de Liège occupe une place centrale dans le récit. Simenon recrée avec minutie l’atmosphère de sa ville natale, ses ruelles tortueuses, ses impasses, et particulièrement le quartier d’Outremeuse où la rivalité entre les paroisses Saint-Nicolas et Saint-Pholien insuffle une tension sous-jacente au récit. Cette géographie urbaine n’est pas qu’un simple décor : elle incarne la mémoire des personnages et leurs tourments.
La dimension psychologique prend le pas sur l’enquête policière traditionnelle. Les « Compagnons de l’Apocalypse » représentent une jeunesse idéaliste confrontée à ses propres démons. Leur trajectoire illustre différentes réponses face à la culpabilité : certains s’enterrent dans une vie bourgeoise confortable, d’autres sombrent dans l’autodestruction. Le personnage de Lecocq d’Arneville incarne cette impossibilité à échapper au passé, consumant l’argent du chantage comme pour expier une faute indélébile.
Cette enquête marque une évolution notable dans le traitement des personnages par Simenon. Maigret y apparaît sous un jour plus vulnérable, ses certitudes ébranlées par sa responsabilité dans le drame initial. Sa décision finale de ne pas poursuivre les coupables, motivée par la présence d’enfants innocents, révèle un humanisme qui transcende les règles strictes de la justice.
La structure narrative se déploie comme une spirale qui remonte le temps. Partant d’un suicide apparemment inexplicable à Brême, l’enquête traverse plusieurs villes européennes avant de revenir à Liège, où tout a commencé. Ce mouvement circulaire renforce l’idée d’un passé qui ne cesse de hanter le présent.
Rédigé à l’automne 1930 à Concarneau, « Le pendu de Saint-Pholien » a connu plusieurs adaptations télévisées, notamment en 1961 pour la BBC avec Rupert Davies, et en 1981 pour Antenne 2 avec Jean Richard. Cet opus annonce déjà les romans dits « durs » qui marqueront la suite de la production littéraire de Simenon. La tension entre le versant policier et psychologique du récit préfigure cette évolution.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 192 pages.
4. Le chien jaune (1931)
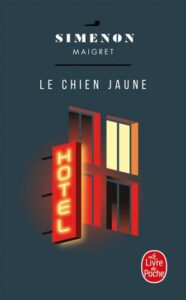
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Novembre 1931. Dans le port breton de Concarneau, un notable sort de l’Hôtel de l’Amiral tard dans la nuit. Alors qu’il s’abrite du vent pour allumer sa pipe, Mostaguen reçoit une balle dans le ventre. Le commissaire Maigret arrive de Rennes pour enquêter. Très vite, d’autres incidents surviennent : une tentative d’empoisonnement au Pernod, la disparition d’un journaliste puis l’assassinat d’un autre notable. Un mystérieux chien jaune rôde autour des lieux des crimes, accompagné d’un vagabond colossal. La ville s’affole, le maire s’impatiente. L’enquête de Maigret le mène vers Emma, serveuse de l’Hôtel de l’Amiral, et son amant Léon Le Guérec, un ancien marin victime d’une machination qui l’a conduit à la prison de Sing-Sing.
Autour du livre
Rédigé en mars 1931 à l’hôtel La Michaudière dans le château de Guigneville-sur-Essonne, ce sixième opus met en scène un commissaire encore en construction. La publication intervient en avril 1931, dans une période extrêmement prolifique où Simenon publie onze romans Maigret en une seule année.
La ville de Concarneau sert de toile de fond à cette intrigue, ses remparts et son port créant une atmosphère claustrophobe propice au drame. Les descriptions sobres mais percutantes des ruelles embrumées, du crachin breton et du vent marin participent à l’ambiance pesante qui caractérise le récit.
Simenon y dissèque les rapports sociaux dans une petite ville de province. Les notables corrompus s’opposent aux humbles, victimes de leurs machinations. Le personnage d’Emma incarne cette dichotomie sociale, serveuse soumise aux désirs des clients aisés mais secrètement fidèle à son amour de jeunesse.
La peur collective qui s’empare de Concarneau constitue un autre fil conducteur majeur. La présence énigmatique du chien jaune cristallise les angoisses des habitants, devenant un symbole des forces obscures qui menacent l’ordre établi.
La force du récit réside dans sa construction en crescendo. Les événements s’enchaînent avec une tension grandissante, tandis que Maigret, imperturbable, laisse la vérité émerger plutôt que de la forcer. Sa méthode intuitive contraste avec l’approche scientifique prônée par son jeune adjoint Leroy, fraîchement sorti de l’école de police.
« Le chien jaune » impose déjà la figure caractéristique de Maigret : bourru mais sensible aux injustices, plus enclin à comprendre qu’à juger. Son humanité transparaît notamment dans sa décision finale de protéger Emma, complice par amour. Les critiques soulignent la qualité du roman dans la construction de son atmosphère oppressante et sa peinture sans concession des mœurs provinciales.
Le roman connaît un succès immédiat. Il fait l’objet de multiples traductions et adaptations. Dès 1932, Jean Tarride le porte à l’écran, son père Abel incarnant Maigret. Deux versions télévisées suivront avec Jean Richard dans le rôle-titre (1968 et 1988).
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 190 pages.
5. L’affaire Saint-Fiacre (1932)
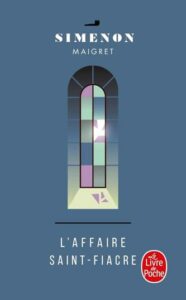
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Dans les années 1930, le commissaire Maigret revient à Saint-Fiacre, village de son enfance, après avoir reçu l’annonce anonyme d’un crime à venir pendant la première messe du Jour des morts. La comtesse locale meurt effectivement durant l’office, victime d’une crise cardiaque provoquée par la lecture d’un faux article de presse annonçant le suicide de son fils Maurice. Ce dernier arrive pourtant peu après au village, comme à son habitude, pour demander de l’argent à sa mère. L’enquête révèle une situation complexe : le domaine périclite, dilapidé par Maurice et les nombreux amants-secrétaires de la comtesse. Maurice organise alors un dîner au château pour démasquer le coupable parmi les suspects.
Autour du livre
Rédigé en janvier 1932 à la Villa Les Roches Grises du Cap d’Antibes, « L’affaire Saint-Fiacre » occupe une place singulière dans la série des Maigret. Pour la première fois, le commissaire se trouve confronté à son passé en revenant sur les terres de son enfance. Cette dimension autobiographique puise dans l’expérience de Simenon lui-même : entre 1923 et 1924, le jeune écrivain travaillait comme secrétaire du marquis de Tracy au château de Paray-le-Frésil, qui servit de modèle au domaine de Saint-Fiacre. Le régisseur du château, nommé Tardivon, inspira quant à lui le personnage du père de Maigret.
La narration se distingue des autres enquêtes par la passivité inhabituelle du commissaire, submergé par ses souvenirs d’enfance. Ce retour aux sources paralyse ses capacités d’investigation au point qu’il laisse Maurice de Saint-Fiacre mener l’enquête à sa place. Cette mise en retrait volontaire du protagoniste traduit sa réticence à porter atteinte à l’image idéalisée qu’il conserve de ce lieu et de ses habitants, notamment de la comtesse qu’il admirait enfant.
L’originalité du crime réside dans son mode opératoire : ni arme conventionnelle, ni poison, mais une simple coupure de journal porteuse d’une fausse nouvelle. Cette mort « naturelle » provoquée artificiellement place l’enquête dans une zone grise où la justice traditionnelle se révèle impuissante. Le final, digne d’un roman gothique avec sa réunion des suspects dans la bibliothèque du château, emprunte davantage aux codes du roman à énigme qu’au réalisme habituel des Maigret.
L’intrigue sert aussi de prétexte à une peinture sociale de la France rurale des années 1930, où la noblesse désargentée côtoie une bourgeoisie montante avide de s’approprier ses terres. Les personnages incarnent les mutations d’une société en transition : la comtesse et son fils représentent une aristocratie sur le déclin, tandis que les Gautier symbolisent l’ambition d’une classe moyenne cherchant à s’élever socialement. Cette chronique d’une déchéance rappelle d’autres romans de Simenon comme « La maison du canal » ou « La veuve Couderc », où le destin de grandes familles se trouve intimement lié à celui de leurs domaines.
Le succès de « L’affaire Saint-Fiacre » ne s’est jamais démenti, comme en témoignent ses multiples adaptations à l’écran. La plus célèbre reste le film de Jean Delannoy (1959) avec Jean Gabin, dont les dialogues signés Michel Audiard ont marqué les esprits. La télévision s’est également emparée de l’histoire à plusieurs reprises, notamment avec Rupert Davies (1962), Jean Richard (1980) et Bruno Cremer (1995).
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 186 pages.
6. Le fou de Bergerac (1932)
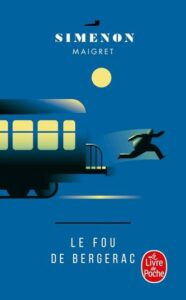
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Mars 1932. Dans l’express de nuit Paris-Bordeaux, le commissaire Maigret ne parvient pas à trouver le sommeil, dérangé par le comportement agité d’un mystérieux voyageur occupant la couchette supérieure. Lorsque l’inconnu profite d’un ralentissement pour sauter du train, Maigret le suit d’instinct et reçoit une balle dans l’épaule. Transporté à l’hôpital de Bergerac, il découvre que la ville est terrorisée par un tueur surnommé « le fou de Bergerac », responsable de l’assassinat de deux femmes. Cloué au lit pendant sa convalescence, Maigret mène l’enquête à distance, assisté par sa femme et son ami Leduc. Le commissaire s’intéresse particulièrement au mystérieux docteur Rivaud, dont le passé semble étrangement lié à celui de Samuel Meyer, un faussaire international retrouvé mort dans un bois.
Autour du livre
Simenon écrit « Le fou de Bergerac » en mars 1932 à l’Hôtel de France et d’Angleterre de La Rochelle, établissement qu’il scinde en deux dans son récit pour créer les principaux hôtels de Bergerac. Particularité notable : parmi les 19 premiers Maigret publiés entre 1931 et 1934, c’est le seul dont Simenon n’a pas visité le cadre avant d’écrire.
Cette contrainte donne naissance à un dispositif narratif ingénieux : cloué au lit, Maigret découvre Bergerac à travers les yeux de sa femme, les descriptions des habitants et les cartes postales. Ce huis clos forcé transforme le roman en un exercice de « armchair detective » (détective en fauteuil), où le commissaire résout l’énigme depuis sa chambre, à l’instar d’un Nero Wolfe ou du Poirot d’Agatha Christie. La comparaison avec « Fenêtre sur cour » d’Hitchcock s’impose naturellement, bien que le film soit postérieur.
Madame Maigret trouve ici son premier rôle d’importance dans la série. Habituellement cantonnée aux tâches domestiques, elle devient les yeux et les jambes de son mari, parcourant la ville pour recueillir indices et témoignages. Cette collaboration inédite offre un éclairage nouveau sur leur relation conjugale.
Simenon joue habilement avec les codes du polar provincial, mettant en scène une petite ville bourgeoise aux apparences trompeuses. Les notables cachent des secrets inavouables derrière leurs façades respectables, tandis que la figure du « fou » terrorise la population. Cette configuration permet à Simenon de disséquer les hypocrisies et les non-dits d’une société provinciale figée dans ses conventions. En limitant le champ d’action de son héros, il parvient paradoxalement à élargir sa palette d’observation sociale et psychologique.
La construction narrative, marquée par l’immobilité forcée du protagoniste, impose un rythme particulier. L’enquête progresse par cercles concentriques, chaque nouvel élément révélant une strate plus profonde de mensonges et de dissimulations. Le dénouement, liant un drame familial à une affaire criminelle internationale, illustre la capacité de Simenon à entrelacer l’intime et le spectaculaire.
« Le fou de Bergerac » connaît plusieurs adaptations télévisées notables. Rupert Davies incarne Maigret dans la version britannique de 1962, suivi par Gino Cervi en Italie (1972), Jean Richard en France (1979), et Bruno Cremer dans une version franco-belge en 2002, qui transpose l’action à Sainte-Clothilde.
Les critiques soulignent la qualité de l’atmosphère provinciale et la construction psychologique des personnages, même si certains jugent l’intrigue parfois tirée par les cheveux. Le roman révèle néanmoins des aspects problématiques, notamment dans son traitement des personnages juifs, reflet des préjugés caractéristiques de l’époque de sa rédaction.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 192 pages.
7. L’écluse n°1 (1933)
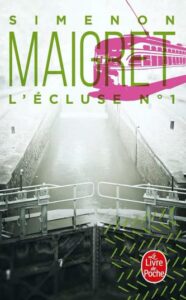
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Dans le Paris des années 1930, le commissaire Maigret, à quelques jours de sa retraite, mène sa dernière enquête. Par une nuit d’avril à Charenton, le vieux Gassin, marinier alcoolique, chute dans le canal. En tentant de le secourir, on découvre un second corps : celui d’Émile Ducrau, riche armateur fluvial, blessé d’un coup de couteau dans le dos. Ce dernier, patron tyrannique qui règne sur le canal de Saint-Maurice, refuse de dénoncer son agresseur. Rapidement, deux morts suspectes surviennent : Jean, le fils fragile de Ducrau, se pend en s’accusant de la tentative de meurtre de son père, puis Bébert, l’aide-éclusier, est retrouvé pendu. En parallèle de ces événements, Maigret s’intéresse à Aline, la fille simple d’esprit de Gassin.
Autour du livre
« L’écluse n°1 » occupe une place particulière dans la série des Maigret. Rédigé en avril 1933 à Marsilly en Charente-Maritime, ce dix-huitième opus devait marquer la fin des aventures du commissaire. Simenon, désireux de se consacrer à des romans plus littéraires, prévoyait d’abandonner son personnage fétiche pour rejoindre la prestigieuse maison Gallimard, qui publiait alors Marcel Proust et André Gide. Cette tentative de mettre fin aux enquêtes de Maigret échouera : face à la pression du public et des éditeurs, Simenon reprendra la série après une pause de huit ans. Ce roman marque néanmoins un moment charnière qui montre toute l’ambivalence de l’auteur envers sa création la plus célèbre.
Le monde des canaux, des péniches et des mariniers, si présent dans ce récit, n’est pas choisi au hasard. Simenon connaissait intimement cet univers qu’il avait découvert lors de ses premières pérégrinations parisiennes en 1923. Cette connaissance intime transparaît dans la précision des descriptions de l’écluse, des bistrots de mariniers et de l’atmosphère particulière qui règne sur les quais.
La figure d’Émile Ducrau domine le récit. Cet homme issu du peuple, devenu puissant armateur, incarne une réussite sociale qui ne procure aucun bonheur. Sa brutalité, son mépris pour sa famille et sa quête perpétuelle de reconnaissance sociale en font un personnage tragique. Ernest Hemingway lui-même fut séduit par ce portrait psychologique, « L’écluse n°1 » aurait été son premier contact avec la bibliographie de Simenon.
Les critiques soulignent la dimension shakespearienne du drame qui se noue autour de l’écluse. Les thèmes de la paternité cachée, de la trahison et de la culpabilité s’entrelacent dans une atmosphère de plus en plus oppressante. Le roman se distingue des enquêtes habituelles du commissaire : Maigret apparaît presque comme un personnage secondaire face à la force dramatique de Ducrau.
Plusieurs curiosités émaillent toutefois ce roman. Le commissaire y est prénommé Joseph et non Jules, son prénom habituel. Son adresse fluctue entre le boulevard Edgar-Quinet et le boulevard Richard-Lenoir, incohérence qui ne sera corrigée que dans les éditions ultérieures. Ces imprécisions témoignent du rythme d’écriture soutenu de Simenon et de son rapport encore incertain avec son personnage.
Quatre adaptations télévisées majeures ont vu le jour : britannique en 1961 avec Rupert Davies, italienne en 1968 avec Gino Cervi, française en 1970 avec Jean Richard, et franco-belge en 1994 avec Bruno Cremer.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 160 pages.
8. Maigret se fâche (1947)
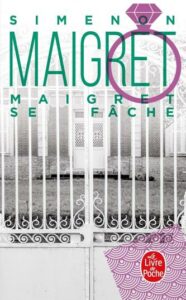
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
En ce mois d’août 1945, Maigret savoure sa retraite depuis deux ans quand une vieille dame impérieuse bouleverse sa tranquillité. Bernadette Amorelle, 82 ans, refuse de croire au suicide de sa petite-fille Monita, excellente nageuse retrouvée dans la Seine. L’ancien commissaire se laisse entraîner à Orsenne, fief de la famille Amorelle où trois luxueuses propriétés abritent une dynastie déchirée. Il y retrouve Ernest Malik, ancien condisciple devenu un puissant homme d’affaires sans scrupules. Tandis que Maigret tente de percer les secrets bien gardés de cette famille, il découvre que Georges-Henry, le fils d’Ernest, est séquestré par son père.
Autour du livre
Rédigé en 1945 à Saint-Fargeau-Ponthierry et publié initialement en feuilleton dans France-Soir en 1946, « Maigret se fâche » marque la deuxième tentative de Simenon de mettre son commissaire à la retraite, après un premier essai en 1934. Ce retrait ne durera pas : Maigret reprendra du service pendant la Seconde Guerre mondiale avant une nouvelle retraite, pour finalement ne raccrocher définitivement qu’en 1972.
Le récit s’inscrit dans une tradition chère à Simenon : celle des secrets enfouis qui remontent inexorablement à la surface. La force du roman tient moins dans la résolution de l’énigme que dans la dissection implacable d’une bourgeoisie provinciale gangrenée par l’argent et les apparences. Le contraste entre Maigret, homme du peuple resté fidèle à ses origines, et l’arriviste Ernest Malik cristallise cette opposition sociale qui traverse les pages.
Les lieux participent activement à l’atmosphère du roman : la Seine majestueuse, les propriétés luxueuses d’Orsenne et leurs parcs immenses créent un décor en trompe-l’œil où la respectabilité masque la corruption. La description initiale de Maigret en retraite – « à pieds nus dans ses sabots de bois » avec « un derrière d’éléphant » dans son pantalon de toile – souligne d’emblée le décalage avec ce monde d’apparences.
Simenon excelle dans la construction de personnages originaux. La figure de Bernadette Amorelle, cette octogénaire indomptable qui prend la justice en main, illustre parfaitement cette capacité à créer des protagonistes qui échappent aux stéréotypes. Le personnage d’Ernest Malik incarne quant à lui une noirceur rare dans la série : manipulateur, calculateur et prêt à tout pour assouvir ses ambitions.
Simenon innove en confrontant Maigret à une enquête non officielle, sans le soutien habituel de la machine policière. Cette position d’outsider renforce le sentiment d’isolement du commissaire face à une caste sociale qui le rejette. Les interventions ponctuelles de ses anciens collègues soulignent d’autant plus sa solitude dans cette affaire. Le récit se distingue également par son traitement de la justice : en laissant Bernadette Amorelle se substituer à la loi des hommes, Simenon questionne les limites de la justice institutionnelle face aux crimes moraux qui échappent aux codes pénaux. Cette dimension éthique, servie par une tension croissante, culmine dans un dénouement aussi brutal qu’inattendu.
« Maigret se fâche » a connu deux adaptations télévisées notables : une version britannique en 1962 avec Rupert Davies, intitulée « The Dirty House », et une adaptation française en 1972 avec Jean Richard. Publié initialement aux Presses de la Cité en 1947 aux côtés de la nouvelle « La pipe de Maigret », le roman témoigne de la période d’après-guerre où Simenon, de retour à Paris, préparait son départ pour l’Amérique.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 160 pages.
9. Maigret à New York (1947)
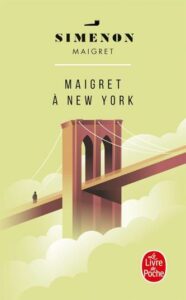
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Dans les années 1940, le commissaire Maigret, fraîchement retraité à Meung-sur-Loire, reçoit la visite impromptue de Jean Maura, un étudiant en droit de dix-neuf ans. Accompagné de son notaire, le jeune homme supplie Maigret d’enquêter sur la situation de son père, un riche homme d’affaires new-yorkais dont les lettres récentes trahissent une profonde angoisse. Maigret accepte de traverser l’Atlantique, mais à peine débarqués à New York, Jean Maura s’évanouit dans la nature. Son père, surnommé Little John, accueille Maigret avec une froideur glaciale tandis que son secrétaire, Jos Mac Gill, tente de l’éconduire. Cette hostilité ne fait qu’aiguiser la curiosité du commissaire qui, épaulé par son vieil ami du FBI, le capitaine O’Brien, met au jour une sombre histoire de meurtre, de secret de famille et de chantage remontant à vingt ans.
Autour du livre
Rédigé entre le 27 février et le 7 mars 1946 à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson au Québec, ce vingt-septième opus de la série transpose pour la première fois le commissaire sur le sol américain. Cette délocalisation n’est pas anodine : Simenon vient lui-même de s’installer en Amérique du Nord, ce déracinement du personnage fait écho à son propre exil.
La particularité de « Maigret à New York » réside dans sa construction atypique. Maigret, privé de ses repères habituels et de son réseau parisien, doit composer avec un environnement qui lui est profondément étranger. Son anglais scolaire, sa méconnaissance des codes américains et l’absence des concierges si précieux à ses enquêtes parisiennes créent un décalage constant. Cette inadaptation devient paradoxalement un atout : elle permet à Maigret d’observer la société américaine avec un regard neuf et critique.
Le succès commercial du roman, notamment aux États-Unis où il s’est vendu à plus de 230 000 exemplaires sous le titre « Maigret in New York’s Underworld », témoigne de sa capacité à transcender les frontières culturelles. En France, il dominait encore les ventes de Simenon en 1962 avec 92 000 exemplaires écoulés.
Les critiques se divisent toutefois sur la réussite de cette transposition. Si certains saluent le renouvellement des situations et le portrait sans concession de la société américaine d’après-guerre, d’autres regrettent l’absence des ambiances parisiennes caractéristiques de la série. La résolution de l’énigme, qui passe par un improbable interrogatoire téléphonique transatlantique, cristallise particulièrement les réserves.
« Maigret à New York » a connu une adaptation télévisuelle en 1990 avec Jean Richard dans le rôle-titre. Elle s’inscrit dans la longue série des téléfilms Maigret qui ont contribué à populariser le personnage auprès du grand public.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 189 pages.
10. Les vacances de Maigret (1948)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
À la fin des années 1940, le commissaire Maigret et son épouse posent leurs valises aux Sables-d’Olonne pour des vacances bien méritées. Leur séjour bascule dès les premiers jours quand Madame Maigret doit subir une opération d’urgence pour une appendicite. Dans la clinique tenue par des religieuses où elle est hospitalisée, Maigret reçoit un mystérieux message le suppliant de s’intéresser à la patiente de la chambre 15. Le lendemain, cette jeune femme de 19 ans, Hélène Godreau, meurt des suites d’une chute survenue deux jours plus tôt en tombant de la voiture de son beau-frère, le docteur Philippe Bellamy. Ce dernier, notable de la ville connu pour sa jalousie maladive envers sa jeune épouse Odette, attire les soupçons du commissaire. L’enquête officieuse de Maigret le mène sur la piste d’une liaison entre Odette et un jeune journaliste disparu, Émile Duffieux, avant que la sœur de celui-ci ne soit retrouvée étranglée.
Autour du livre
« Les vacances de Maigret » se démarque par sa genèse singulière : Georges Simenon l’écrit en dix jours, du 11 au 20 novembre 1947, à Tucson en Arizona, soit à près de 9 000 kilomètres des lieux qu’il décrit. Cette distance géographique n’altère en rien sa capacité à reconstituer l’atmosphère des Sables-d’Olonne, station balnéaire qu’il connaît intimement pour y avoir séjourné à plusieurs reprises, notamment en 1927 après sa liaison avec Joséphine Baker, puis plus longuement entre septembre 1944 et avril 1945.
Cette vingt-huitième enquête du commissaire Maigret se démarque par son cadre inhabituel. Pour la première fois, le lecteur découvre un Maigret en vacances, déstabilisé par l’inaction forcée et l’environnement médical. L’intrigue substitue progressivement l’ambiance méthodique de l’enquête à celle de la détente estivale. Le commissaire se trouve confronté à un double défi : mener une investigation non officielle tout en composant avec les codes d’une petite ville de province où les notables font corps autour des leurs.
Dans cet opus, la psychologie des personnages prime sur l’action. La jalousie morbide du docteur Bellamy constitue le moteur dramatique du récit. Ce notable provincial, malgré son intelligence et sa position sociale, se révèle incapable de maîtriser ses pulsions possessives envers son épouse. Cette obsession destructrice rappelle celle du docteur Alavoine dans « Lettre à mon juge », écrit par Simenon quelques mois plus tôt.
Le romancier belge met également en lumière les contrastes sociaux. D’un côté, l’univers aseptisé de la clinique religieuse et les demeures cossues des notables ; de l’autre, les quartiers modestes où vivent les victimes. Entre les deux, Maigret navigue avec son flair habituel, multipliant les verres de blanc sec dans les bistrots du port pour mieux observer et comprendre.
La première édition française paraît aux Presses de la Cité en 1948. Une réédition limitée à 100 exemplaires sur papier alfa cellunaf voit le jour en 1956. « Les vacances de Maigret » connaît une adaptation en bande dessinée dans l’hebdomadaire Samedi-Soir en 1952-1953, avec des illustrations de Jacques Blondeau. Il figure aujourd’hui dans plusieurs éditions collectives, notamment « Tout Simenon » et « Tout Maigret » aux éditions Omnibus. Dès 1956, une adaptation télévisée canadienne voit le jour, suivie par des productions britannique (1961), néerlandaise (1968), et française avec Jean Richard (1971) puis Bruno Cremer (1995) dans le rôle-titre. La BBC propose même sa propre interprétation sous le titre « On Holiday ».
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 190 pages.
11. Maigret et la vieille dame (1950)
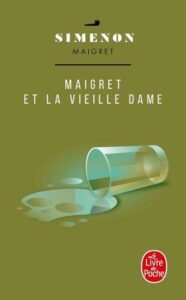
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
En septembre 1950, Valentine Besson, une dame de soixante ans à l’allure distinguée, sollicite l’aide du commissaire Maigret. Sa domestique Rose vient de succomber à un empoisonnement à l’arsenic après avoir bu un verre de somnifère préparé pour sa maîtresse. Le décès suspect conduit l’enquêteur à Étretat. Dans cette petite ville côtière de Normandie où les derniers vacanciers profitent encore de la plage, Valentine habite une simple maison en viager. Le jour du drame, sa famille était réunie pour son anniversaire : Arlette sa fille, qui la déteste, et les deux fils de son défunt mari – Charles, devenu député, et Théo, qui dilapide ce qui lui reste. Sous les brumes d’automne, entre les falaises et le ressac, Maigret tente de comprendre qui pouvait souhaiter la mort de cette veuve prétendument sans le sou.
Autour du livre
Simenon rédige « Maigret et la vieille dame » en dix jours à peine, entre le 29 novembre et le 8 décembre 1949, depuis Carmel-by-the-Sea en Californie. Cette distance géographique – près de 9000 kilomètres séparent l’auteur d’Étretat où se déroule l’action – ne nuit aucunement à la précision des descriptions normandes qui imprègnent le récit.
La romancière américaine Patricia Highsmith place Valentine Besson, personnage central du roman, dans une lignée de « scélérats » féminins qui peuplent l’univers de Maigret, de la tigresse Aline dans « La patience de Maigret » à la figure de rapace dans « Signé Picpus ». Cette vieille dame qui séduit initialement le commissaire par son apparente candeur s’avère une manipulatrice redoutable, prête à éliminer sans scrupule ceux qui menacent ses secrets.
La méthode d’investigation de Maigret prend ici le contrepied des conventions du roman policier classique. Point de relevés d’empreintes ni de recherches dans les fichiers de police : le commissaire privilégie les conversations avec l’entourage, la famille, les proches. Cette approche psychologique, caractéristique de Simenon, s’éloigne délibérément du modèle holmésien basé sur l’accumulation d’indices matériels.
Le décor d’Étretat y devient un personnage à part entière. La ville balnéaire de septembre, ses derniers touristes, ses pêcheurs qui se prêtent aux photos, sa corne de brume qui perce l’obscurité nocturne composent une toile de fond où la nostalgie le dispute à la mélancolie. Cette atmosphère fait écho aux réflexions de Maigret sur l’impossibilité de retrouver, une fois adulte, la magie des lieux qui nous ont enchantés enfants.
Le portrait social de la France d’après-guerre transparaît en filigrane à travers l’opposition entre deux mondes : celui des nantis d’Étretat et celui des pêcheurs de Fécamp. La distance géographique entre les deux villes symbolise l’abîme social qui sépare leurs habitants. Ce contraste s’incarne particulièrement dans le personnage de Rose, la domestique issue du milieu des pêcheurs, dont les aspirations intellectuelles – elle lit Freud – heurtent sa condition sociale.
La temporalité du récit mérite attention : l’enquête se déroule sur deux jours seulement, les 6 et 7 septembre. Cette concentration temporelle, inhabituelle dans la série des Maigret, impose un rythme soutenu à l’action tout en laissant place aux digressions contemplatives du commissaire. La consommation répétée de calvados par Maigret, qui inquiète son collègue normand Castaing, participe paradoxalement à cette double temporalité : elle ralentit la réflexion du commissaire tout en précipitant le dénouement à travers un accès de colère révélateur.
L’originalité de « Maigret et la vieille dame » réside aussi dans sa dimension théâtrale : la maison de Valentine, surnommée « La Bicoque », devient une scène où chaque personnage joue un rôle soigneusement étudié. Cette dimension dramatique n’a pas échappé aux critiques qui rapprochent l’œuvre des films de Claude Chabrol, maître dans l’art de disséquer la bourgeoisie provinciale. Les adaptations télévisées témoignent aussi de son potentiel dramatique : Rupert Davies (BBC, 1960), Jean Richard (1979), Bruno Cremer (1994), en passant par une adaptation russe de 1974 avec Boris Tenin.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 188 pages.
12. L’amie de Madame Maigret (1950)
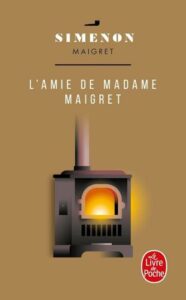
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Paris, mars 1949. Une lettre anonyme conduit la police à perquisitionner chez Frans Steuvels, un relieur de la rue de Turenne. Dans son calorifère sont découvertes deux dents humaines. L’homme est arrêté, mais l’enquête s’enlise rapidement. Un jeune avocat ambitieux, Me Liotard, s’empare de l’affaire puis attaque Maigret dans la presse. Au même moment, Mme Maigret vit une étrange mésaventure au square d’Anvers. Une jeune femme élégante qu’elle croise régulièrement lui confie son enfant « pour une minute » avant de disparaître pendant des heures. Cette femme, Gloria Lotti, était au service d’une comtesse italienne récemment assassinée. Ces deux affaires vont peu à peu s’entremêler. Par un curieux hasard, c’est Mme Maigret qui va mettre son mari sur la piste de la vérité.
Autour du livre
Rédigé en neuf jours, du 13 au 22 décembre 1949, à Carmel-by-the-Sea en Californie, « L’amie de Madame Maigret » marque une originalité dans la série des Maigret. Pour la première fois, l’épouse du commissaire sort de son rôle traditionnel de femme au foyer pour prendre part à l’enquête. Cette participation ne relève pas d’une volonté délibérée mais découle d’une situation fortuite : ses rendez-vous hebdomadaires chez le dentiste la mettent en contact avec une mystérieuse jeune femme dont le comportement énigmatique finira par croiser l’affaire sur laquelle travaille son mari.
Dans ce trente-quatrième opus de la série, Simenon bouleverse les codes en ne faisant pas intervenir Maigret dès les premières pages. Le premier chapitre est entièrement consacré aux mésaventures de son épouse. Cette construction narrative démontre l’ambition de l’auteur belge d’insuffler un nouveau dynamisme à sa série en déplaçant momentanément le centre de gravité de l’intrigue.
Louise Maigret, habituellement cantonnée à la préparation des repas et aux inquiétudes conjugales, se révèle une observatrice perspicace. Son regard féminin note des détails significatifs comme l’élégance des chaussures de sa mystérieuse connaissance, qui contrastent avec sa mise modeste. Sans le savoir, elle met le doigt sur une incohérence qui se révélera cruciale pour l’enquête.
« L’amie de Madame Maigret » inaugure également l’arrivée d’un nouveau personnage appelé à devenir récurrent : l’inspecteur Lapointe. À 24 ans, ce jeune policier fait ses premiers pas au Quai des Orfèvres. Sa fougue et son désir de bien faire séduisent Maigret qui, sans enfant, développera progressivement avec lui une relation quasi paternelle.
La particularité de ce roman réside aussi dans sa structure narrative qui entremêle deux fils conducteurs : l’enquête officielle sur le relieur Steuvels et l’incident apparemment anodin du square d’Anvers. Cette construction en miroir permet à Simenon de jouer avec les temporalités, l’aventure de Madame Maigret survenant dix-neuf jours après l’arrestation du relieur.
Le cadre spatial se déploie dans un Paris minutieusement cartographié : square d’Anvers, rue de Turenne, rue Lepic, avenue des Champs-Élysées, boulevard Pasteur. Cette géographie précise ancre l’intrigue dans une réalité urbaine qui participe pleinement à la tension narrative. Les déplacements des personnages dessinent une cartographie du crime qui épouse la topographie parisienne.
La critique anglophone souligne la complexité inhabituelle de l’intrigue, tout en saluant la qualité des personnages secondaires et l’évocation du Paris de l’époque. Le Publishers Weekly note que malgré une construction plus lâche que d’habitude, l’atmosphère caractéristique de l’univers maigretien demeure intacte.
Les adaptations télévisuelles témoignent du succès international de ce titre : Rupert Davies l’incarne pour la BBC en 1962, Kees Brusse pour la télévision néerlandaise en 1965, Jean Richard pour Antenne 2 en 1977 et Kinya Aikawa pour la télévision japonaise en 1978. La radio allemande s’en empare également avec une adaptation produite par le WDR en 1957 sous le titre « Frau Maigret als Detektiv », mettant en scène Leonard Steckel dans le rôle du commissaire.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 187 pages.
13. Maigret au Picratt’s (1951)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Par une nuit d’hiver des années 1950, Arlette, effeuilleuse au Picratt’s, un cabaret de Pigalle, se présente éméchée au commissariat. Elle rapporte une conversation inquiétante : un dénommé Oscar projette de tuer une comtesse. La police ne prend pas au sérieux ses déclarations confuses. Le lendemain, on la retrouve étranglée chez elle. Une autre femme subit le même sort : la comtesse von Farnheim. Maigret prend ses quartiers au Picratt’s. Entre champagne frelaté et numéros de danse, il scrute les habitués de ce bar où règne une ambiance presque familiale. Son attention se porte sur Oscar Bonvoisin, un ancien chauffeur devenu truand. L’homme a été l’amant des deux victimes. La comtesse, jadis figure mondaine de la Riviera, s’est peu à peu enfoncée dans la morphine après avoir dilapidé sa fortune.
Autour du livre
Simenon rédige « Maigret au Picratt’s » en à peine neuf jours, du 30 novembre au 8 décembre 1950, dans sa propriété de Shadow Rock Farm à Lakeville, dans le Connecticut. Il y recrée l’atmosphère des quartiers de Pigalle et Montmartre depuis son exil américain, à près de 6000 kilomètres de la capitale française.
Le cadre du Picratt’s, cabaret dont le nom joue sur l’argot « picrate » désignant un vin rouge médiocre, s’avère emblématique dans l’œuvre de Simenon. Ce lieu quasi mythique apparaît dans plusieurs de ses romans antérieurs publiés sous divers pseudonymes, notamment « Aux vingt-huit négresses » (1925), « La noce à Montmartre » (1925), « Le feu s’éteint » (1927), et « Miss Baby » (1928). Dans cette nouvelle incarnation, le cabaret devient le quartier général de Maigret, qui y passe de longues heures à observer et à questionner la faune nocturne.
Simenon met en scène un jeu d’oppositions saisissant entre ses personnages. La jeune Arlette, strip-teaseuse sensuelle au pouvoir troublant sur les hommes, incarne une dualité : femme de la nuit qui entretient son appartement en parfaite ménagère. Elle s’oppose à la comtesse déchue, dont la décrépitude physique et morale se reflète dans son taudis. Le jeune inspecteur Lapointe, amoureux sincère, contraste avec Philippe, toxicomane et figure marginale du Paris nocturne. Le traitement des personnages secondaires s’écarte des conventions du genre. L’inspecteur Lognon, surnommé « Inspecteur Griesgram », apparaît ici pour la première fois dans la série Maigret après quelques apparitions dans d’autres romans. Son caractère malheureux et sa rivalité avec la Police Judiciaire ajoutent une touche d’humour grinçant au récit.
L’enquête elle-même tranche par sa construction atypique : les deux victimes sont déjà mortes quand débute l’investigation, tandis que le meurtrier n’apparaît qu’à la toute fin pour se faire abattre. La modernité du roman pose toutefois question à travers son traitement de certains personnages, notamment dans sa représentation de l’homosexualité et de la toxicomanie, qui reflète les préjugés de son époque. Ces aspects contrastent avec l’habituelle bienveillance de Maigret envers les marginaux, une dissonance qui interroge sur les limites de l’humanisme siménonien.
Le succès de cette intrigue se mesure au nombre impressionnant d’adaptations qu’elle a suscitées. Pas moins de sept versions télévisées ont vu le jour entre 1960 et 2018, dans quatre pays différents : de Rupert Davies (BBC, 1960) à Rowan Atkinson (ITV, 2018), en passant par Jean Richard (Antenne 2, 1985) et Bruno Cremer (1992). Le grand écran n’est pas en reste avec une adaptation franco-italienne en 1967, « Maigret à Pigalle », où Gino Cervi incarne le commissaire.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 185 pages.
14. Maigret et l’homme du banc (1953)
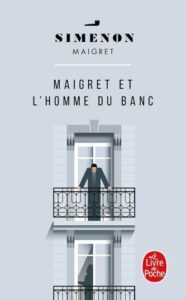
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Par un matin pluvieux d’octobre, dans une impasse du boulevard Saint-Martin à Paris, on découvre le corps de Louis Thouret, poignardé. L’homme portait des souliers jaunes et une cravate rouge que sa femme affirme ne jamais avoir vus. En menant son enquête, le commissaire Maigret apprend que la victime, un modeste magasinier de Juvisy, ne travaillait plus depuis trois ans. Thouret, terrorisé à l’idée d’avouer son licenciement à son épouse autoritaire qui le méprisait, avait maintenu l’illusion d’une vie professionnelle normale. Chaque matin, il prenait son train, passait ses journées sur un banc des Grands Boulevards et rapportait un salaire fictif le soir. Pour financer cette mascarade, il s’était associé à un cambrioleur.
Autour du livre
Dans ce quarante-et-unième opus de la série Maigret, Simenon s’écarte des sentiers battus du polar traditionnel. L’intrigue démarre sur le boulevard Saint-Martin, à Paris, où un homme apparemment sans histoire gît, poignardé. Mais la véritable énigme ne réside pas tant dans l’identité du meurtrier que dans la double vie de la victime, Louis Thouret.
Rédigé en seulement huit jours à Shadow Rock Farm, dans le Connecticut, à plus de 5 500 kilomètres de Paris où se déroule l’action, ce roman se démarque par sa dimension sociologique. La trame narrative décortique minutieusement le quotidien d’un petit employé prisonnier d’une existence étriquée, sous l’emprise d’une épouse qui le méprise pour sa condition sociale modeste. Le personnage de Mme Thouret incarne une bourgeoisie mesquine obsédée par les apparences, elle qui ne pardonne pas à son mari de n’être qu’un simple magasinier quand ses sœurs ont épousé des fonctionnaires.
La force du récit tient dans ses symboles : les souliers jaunes et la cravate rouge que porte le mort représentent sa tentative maladroite de s’émanciper, tandis que le banc public où il passe ses journées devient paradoxalement un espace de liberté. Ces éléments matériels prennent une dimension presque fétichiste, notamment les chaussures qui rappellent à Maigret lui-même ses propres désirs de jeunesse contrariés par son épouse.
L’atmosphère parisienne, rendue par la pluie omniprésente et le brouillard jaunâtre, crée un décor mélancolique qui souligne l’absurdité du destin de Thouret. Celui-ci, même dans sa rébellion contre une vie étouffante, ne parvient pas à échapper à la médiocrité : sa maîtresse ressemble physiquement à son épouse, et sa chambre de la rue d’Angoulême reste aussi morne que son pavillon de banlieue.
Le thème du petit employé perdant son travail et le cachant à son épouse n’est pas nouveau chez Simenon – il l’avait déjà traité dans « On ne tue pas les pauvres types » en 1946. Mais ici, la trajectoire du personnage bifurque vers une criminalité presque ludique, où le protagoniste compense son déclassement social par l’observation méthodique des failles dans la sécurité des commerces.
La méthode d’enquête de Maigret atteint dans ce roman une dimension presque mystique : le commissaire en vient à imiter les gestes et attitudes de la victime, au point que sa propre épouse peine à le reconnaître lors d’une sortie au cinéma. Cette empathie poussée à l’extrême caractérise plusieurs enquêtes de la série, notamment « Félicie est là » et « Maigret et la jeune morte ».
« Maigret et l’homme du banc » a connu un succès durable, comme en témoignent ses nombreuses adaptations télévisées : de Rupert Davies en 1962 à Bruno Cremer en 1993, en passant par Jean Richard en 1973, sans oublier des versions soviétique et japonaise.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 191 pages.
15. Maigret a peur (1953)
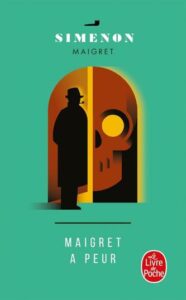
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Au début des années 1950, le commissaire Maigret fait halte à Fontenay-le-Comte pour rendre visite à son ami d’enfance, le juge Chabot. Il découvre une ville en état de choc : deux meurtres ont été commis en quelques jours. Un aristocrate désargenté, Robert de Courçon, et une sage-femme à la retraite. À peine arrivé, Maigret apprend qu’un troisième corps vient d’être découvert, celui d’un marchand de peaux de lapin.
Dans cette petite ville de province où les tensions sociales sont vives, la population accuse la famille Vernoux, des notables locaux. Des comités de vigilance se forment, l’atmosphère devient électrique. Même Maigret, d’ordinaire si imperturbable, se sent gagné par un sentiment d’inquiétude. Bien qu’il ne soit pas officiellement chargé de l’enquête, le commissaire observe et analyse. Ses réflexions et ses initiatives discrètes vont peu à peu faire émerger une vérité surprenante, dans une société provinciale gangrenée par les préjugés et la haine de classe.
Autour du livre
Entre le 20 et le 27 mars 1953, Georges Simenon rédige « Maigret a peur » depuis sa propriété de Shadow Rock Farm à Lakeville, dans le Connecticut, soit à plus de 5500 kilomètres de Fontenay-le-Comte où se déroule l’action. Cette distance géographique n’empêche pas Simenon de livrer une radiographie de la société provinciale française d’après-guerre, ses tensions et ses non-dits.
La ville de Fontenay-le-Comte ne constitue pas un simple décor : Simenon y a vécu entre 1940 et 1942, louant une aile du château de Terre-Neuve pendant l’Occupation. Cette expérience transparaît dans la description sans concession d’une cité scindée entre deux mondes qui se toisent et se détestent : d’un côté les notables, incarnés par la famille Vernoux de Courçon, de l’autre une population hostile menée par l’instituteur Chalus, militant « anti-bourgeois ».
Le commissaire Maigret se trouve pris dans ce maelström social alors qu’il rend simplement visite à son ami le juge Chabot. Pour la première fois peut-être, il éprouve un sentiment inhabituel : la peur. Non pas une peur physique face au danger, mais une appréhension diffuse devant cette atmosphère délétère où la haine de classe se mêle aux lettres anonymes et aux comités de vigilance. Cette dimension politique, rarement aussi présente dans la série, donne au roman une tonalité particulière.
Le personnage du juge Chabot permet à Simenon d’approfondir la psychologie de Maigret. Les retrouvailles avec cet ami de jeunesse révèlent un commissaire vieillissant – il est à trois ans de la retraite – qui pose un regard désabusé sur son passé. L’admiration qu’il portait autrefois à Chabot s’est muée en une forme de pitié pour ce célibataire vieillissant qui vit encore chez sa mère. Ce thème du déclassement social irrigue tout le roman, touchant aussi bien les aristocrates ruinés que les parvenus ou les transfuges de classe.
La publication en feuilleton dans Le Figaro, du 19 mai au 6 juin 1953, précède de peu la sortie en librairie aux Presses de la Cité en juillet. « Maigret a peur » fait l’objet de trois adaptations télévisées : en 1963 pour la BBC avec Rupert Davies, en 1976 sur Antenne 2 avec Jean Richard, et en 1996 avec Bruno Cremer.
La présence d’anglicismes dans le texte (« pamphlets » pour « brochures », « night cup » pour « dernier verre ») trahit l’environnement américain dans lequel Simenon écrit. Ces petites imperfections n’altèrent en rien la force d’un récit qui, selon le New Yorker, compte « parmi les plus subtils » de la période. Il constitue une pièce singulière dans la série des Maigret, tant par son atmosphère oppressante que par la position d’observateur impuissant dans laquelle se trouve le commissaire.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 188 pages.
16. Maigret se trompe (1953)
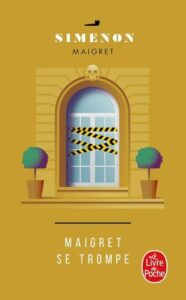
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Par un matin brumeux de novembre, le commissaire Maigret enquête sur le meurtre de Louise Filon dans un appartement cossu de l’avenue Carnot à Paris. Cette ancienne prostituée du quartier de la Chapelle, surnommée Lulu, menait une existence confortable grâce à son amant, le professeur Gouin, un éminent chirurgien qui l’avait installée dans l’immeuble où il résidait avec son épouse. La victime entretenait aussi une relation avec Pierrot, un modeste musicien de musette. Elle était enceinte au moment de sa mort. Qui a appuyé sur la détente ? L’amant de cœur désargenté ou le brillant médecin ? À moins que la vérité ne soit ailleurs…
Autour du livre
Dans « Maigret se trompe », rédigé du 24 au 31 août 1953 à Shadow Rock Farm dans le Connecticut, Georges Simenon peint un portrait saisissant de la dualité sociale du Paris des années 1950, où s’entrechoquent deux mondes : celui du quartier populaire de la Chapelle et l’univers bourgeois des Ternes. Cette opposition géographique et sociale constitue la toile de fond d’une enquête qui transcende le simple polar pour devenir une étude psychologique captée à travers le prisme du commissaire Maigret. Le récit se déroule en novembre, mais fait notable, la météo ne pèse pas autant que d’habitude sur l’ambiance.
Le titre même du roman joue sur une ambiguïté. Contrairement à ce qu’il suggère, Maigret ne commet pas d’erreur à proprement parler – il hésite simplement à confronter le professeur Gouin, repoussant constamment leur rencontre. Cette hésitation inhabituelle chez le commissaire provient d’une identification troublante avec ce chirurgien qui partage ses origines modestes et son parcours d’autodidacte. Les deux hommes se présentent comme « des contraires de valeur équivalente », selon les mots mêmes du texte.
La figure du professeur Gouin émerge comme le véritable centre de gravité du récit. Ce chirurgien sexagénaire incarne un type de personnage rare dans la série : un homme brillant mais dépourvu d’humanité, qui considère les femmes comme de simples objets interchangeables. Son harem, constitué de son épouse, de son assistante et de diverses maîtresses, gravite autour de lui dans une chorégraphie malsaine d’adoration et de protection. Cette constellation féminine rappelle d’autres œuvres de Simenon comme « Maigret et la vieille dame », où le personnage de Valentine Besson présente un narcissisme comparable.
La confrontation finale entre Maigret et Gouin constitue l’acmé du récit. Cette scène, qui n’intervient qu’au huitième chapitre, représente l’affrontement de deux intelligences, de deux visions du monde. La franchise glaciale du chirurgien, son cynisme assumé et son mépris pour l’humanité créent un effet de miroir déformant avec l’empathie caractéristique de Maigret.
Le succès du roman se mesure à ses nombreuses adaptations télévisées internationales. De Rupert Davies en Angleterre (1960) à Bruno Cremer en France (1994), en passant par Kees Brusse aux Pays-Bas (1964) et Kinya Aikawa au Japon (1978), chaque pays a proposé sa lecture de cet opus. La version française de 1981, avec Jean Richard dans le rôle-titre et Georges Marchal incarnant le professeur Gouin, mérite une mention particulière pour sa fidélité au texte original.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 190 pages.
17. Maigret et le corps sans tête (1955)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Un corps découpé en morceaux émerge des eaux du canal Saint-Martin, à Paris. Nous sommes en mars 1955 et le commissaire Maigret doit résoudre cette sombre affaire. Son enquête le conduit dans un modeste bistrot du quai de Valmy où règne une atmosphère pesante. La patronne, Aline Calas, interpelle le policier par son comportement distant et son penchant pour l’alcool. Son époux a disparu depuis plusieurs jours, prétendument parti s’approvisionner en vin. Maigret découvre peu à peu l’existence dissolue de cette femme qui entretient de nombreuses liaisons extraconjugales. L’affaire progresse quand on découvre que le corps sans tête porte la même cicatrice d’appendicite qu’Omer Calas, le mari de la bistrotière.
Autour du livre
Dernier roman composé par Georges Simenon sur le sol américain en janvier 1955, « Maigret et le corps sans tête » marque un tournant dans la vie de l’écrivain. Insatisfait de son existence aux États-Unis et préoccupé par l’état psychologique de sa seconde épouse Denyse, Simenon quitte définitivement le continent américain peu après l’achèvement de ce texte, incapable de répondre à une question simple du journaliste Hamish Hamilton : pourquoi vit-il en Amérique ?
Le cadre choisi pour cette enquête – le canal Saint-Martin bordé par les quais de Valmy et de Jemmapes – constitue l’un des points névralgiques du Paris populaire des années 1950. Simenon y recrée avec minutie l’atmosphère des bistrots de quartier, des écluses où s’attardent les péniches, des petits commerçants et des infirmiers de l’hôpital Saint-Louis tout proche. Cette unité de lieu, concentrée dans un périmètre restreint, permet au commissaire Maigret de s’imprégner totalement de l’environnement social où se déroule le drame.
La force du récit réside essentiellement dans le personnage d’Aline Calas, tenancière du bistrot où se noue l’intrigue. Cette femme énigmatique, « maigre, sans âge, avec un visage maussade », exerce sur Maigret une attraction intellectuelle qui transcende le cadre habituel de l’enquête policière. Entre eux s’établit une relation singulière, presque une joute psychologique, où chacun reconnaît en l’autre une égale expérience de la vie. Le commissaire perçoit d’emblée qu’Aline dissimule sous son apathie alcoolique et sa froideur apparente le poids d’un lourd passé.
Le duel entre ces deux personnages structure l’ensemble du récit. Maigret, qui avoue avoir rêvé dans sa jeunesse d’être un « raccommodeur de destinées », se trouve confronté à une femme qui a délibérément choisi de briser la sienne. Née dans l’aristocratie provinciale, Aline a fui son milieu d’origine pour épouser un domestique, s’enfonçant progressivement dans une déchéance sociale qu’elle semble cultiver comme une revanche contre son passé. Cette dimension psychologique fait basculer l’enquête policière vers une étude de caractère où le mystère principal n’est plus tant l’identité du meurtrier que les motivations profondes qui ont conduit une femme à s’autodétruire méthodiquement. La complexité de ce face-à-face oblige finalement Maigret à rompre physiquement avec Aline en la remettant au juge Coméliau. Ce retrait tactique lui permet paradoxalement de mieux comprendre les ressorts du drame en s’imprégnant des lieux qu’elle a habités.
L’architecture temporelle du récit, construite autour d’une chronologie entre le vendredi où disparaît Omer Calas et le mardi où son corps est découvert, contribue à densifier l’intrigue. Cette structure narrative souligne l’importance du temps dans l’enquête policière tout en servant de contrepoint à l’immobilité apparente d’Aline, figée dans son bistrot comme le chat roux près du poêle.
L’excellence de ce roman lui vaut d’être considéré par de nombreux spécialistes comme l’un des meilleurs de la série Maigret. Les quatre adaptations télévisées qu’il a suscitées, notamment celle avec Jean Richard où Suzanne Flon incarne magistralement Aline Calas, témoignent de sa force dramatique. Il a également fait l’objet d’une adaptation en bande dessinée en 1997 par Frank Brichau et Odile Reynaud.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 190 pages.
18. Maigret s’amuse (1957)
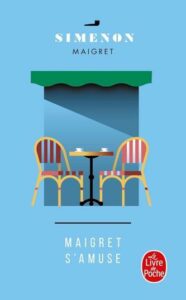
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
En ce mois d’août à Paris, le commissaire Maigret doit prendre du repos sur ordre de son médecin. Il choisit de passer ses vacances dans la capitale désertée, aux côtés de son épouse. Les matins, il lit la presse en terrasse pendant que Madame Maigret s’occupe de l’appartement. Un crime secoue soudain la ville : une femme est retrouvée morte, nue, dans le placard d’un cabinet médical. Il s’agit de Madame Jave, l’épouse d’un médecin réputé. L’affaire s’annonce complexe car la victime était supposée être en vacances à Cannes avec son mari. En l’absence de Maigret, c’est l’inspecteur Janvier qui dirige l’enquête. Le commissaire ne peut s’empêcher de suivre l’affaire dans les journaux. Il envoie même, sous couvert d’anonymat, quelques indices à son collègue.
Autour du livre
Le cinquantième opus de la série Maigret marque une rupture avec les codes habituels du genre. Pour la première fois, le commissaire endosse le rôle d’un simple citoyen qui suit une enquête criminelle à travers la presse. Cette inversion du point de vue transforme radicalement la narration : Maigret ne dirige plus l’investigation mais l’observe depuis l’extérieur, tel un spectateur privilégié.
La genèse de « Maigret s’amuse » s’inscrit dans un cadre particulier. Simenon le rédige en une semaine, du 6 au 13 septembre 1956, dans sa propriété cannoise baptisée « Golden Gate ». Le texte paraît d’abord en feuilleton dans Le Figaro, du 4 février au 1er mars 1957, avant sa publication en volume aux Presses de la Cité. Cette sérialisation influence la structure narrative, rythmée par la parution des journaux qui alimentent la progression de l’enquête.
Le Paris du mois d’août constitue un personnage à part entière. Les descriptions des promenades du couple Maigret dans une capitale désertée par ses habitants révèlent une ville méconnue, propice aux errances et aux observations. Les terrasses des cafés, les restaurants, les cinémas dessinent une cartographie intime de la capitale française des années 1950.
La figure de Madame Maigret prend une épaisseur inédite dans ce roman. Son omniprésence aux côtés du commissaire en vacances permet d’entrevoir les subtilités de leur relation conjugale. Son effacement volontaire, sa discrétion et son dévouement absolu reflètent les codes sociaux de l’époque. Ses interventions, minimales mais toujours pertinentes, servent de caisse de résonance aux réflexions de son époux.
L’inspecteur Janvier occupe pour la première fois le devant de la scène en dirigeant l’enquête. Sa promotion temporaire au bureau de Maigret symbolise le passage de témoin entre deux générations de policiers. Les lettres anonymes que lui adresse le commissaire illustrent la transmission du savoir-faire policier, une forme de tutorat à distance.
Le livre interroge également le rapport entre la presse et la police. À travers les articles du jeune journaliste Lassagne, Simenon dépeint les mécanismes de l’information judiciaire et la manière dont les médias façonnent la perception publique des affaires criminelles. Cette mise en abyme permet d’explorer les coulisses du fait divers et son traitement médiatique.
Les critiques saluent unanimement l’originalité du dispositif narratif. Le renversement de perspective permet de redécouvrir le personnage de Maigret sous un angle nouveau, tout en offrant un regard acéré sur les mécanismes de l’enquête criminelle. « Maigret s’amuse » démontre la capacité de Simenon à renouveler sa série sans en trahir l’essence.
Une erreur de l’auteur s’est d’ailleurs glissée dans le texte : Simenon situe l’enfance de Maigret à Paray-le-Frésil, oubliant que depuis « L’affaire Saint-Fiacre » (1932), le commissaire est officiellement né à Saint-Fiacre. Cette incohérence témoigne des difficultés à maintenir la cohérence d’une série s’étendant sur plusieurs décennies.
La BBC propose une adaptation télévisée en 1963 avec Rupert Davies dans le rôle-titre, tandis que Jean Richard incarne le commissaire dans l’adaptation française de 1983.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 160 pages.
19. Maigret voyage (1957)
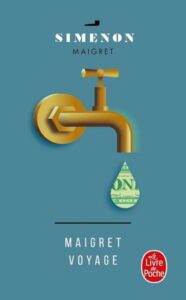
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Dans les années 1950, un meurtre secoue l’hôtel George V à Paris. Le colonel David Ward, un industriel anglais fortuné, est retrouvé noyé dans sa baignoire. La veille, sa future épouse, la comtesse Palmieri, a tenté de se suicider dans ce même palace avant de s’enfuir vers Nice. Le commissaire Maigret doit mener l’enquête dans un univers qui lui est étranger : celui de la haute société internationale qui fréquente les palaces. Entre Paris, Nice et la Suisse, il observe cette faune mondaine, ses codes et ses apparences. Dans ce milieu où tout n’est que convention et faux-semblants, le commissaire devra percer à jour les secrets de chacun.
Autour du livre
Premier roman écrit par Simenon après son installation en Suisse en juillet 1957, « Maigret voyage » conjugue l’univers des palaces et la psychologie des milieux privilégiés dans une enquête où le commissaire doit s’adapter à un monde qui le met profondément mal à l’aise. Le manuscrit, rédigé en une semaine du 10 au 17 août 1957 au château d’Échandens dans le canton de Vaud, ne connaît pas de version préalable : Simenon le tape directement à la machine sur du papier japon ocre.
L’intrigue se déroule dans un univers inhabituel pour le commissaire : celui de la haute finance internationale et des palaces. Le George V à Paris, l’Hôtel de Paris à Monte-Carlo et le Lausanne Palace constituent les décors successifs d’une enquête qui propulse Maigret dans les sphères du grand luxe. Cette incursion dans les milieux fortunés permet de mettre en lumière un commissaire déstabilisé, lui qui préfère d’ordinaire les bistrots populaires aux bars feutrés des établissements prestigieux.
La dimension sociale occupe une place prépondérante. Le petit personnel des hôtels, les rituels mondains, les conventions et l’immoralité des élites sont disséqués avec acuité. La thématique de « l’homme nu », chère à Simenon, se matérialise littéralement : le colonel Ward est découvert mort dans son bain, tandis que Van Meulen reçoit Maigret allongé nu sur une table de massage. Ces mises en scène dépouillent les personnages de leur vernis social pour révéler leur véritable nature.
Les femmes y incarnent des figures complexes, à l’image de la comtesse Palmieri qui, malgré ses allures mondaines, « boit le whisky au goulot comme une pocharde des quais boit un grand coup de rouge ». Cette description illustre l’effondrement des apparences sociales qui masquent mal les angoisses existentielles des protagonistes. La narration se double d’une étude minutieuse de l’alcool comme marqueur social. Un recensement méticuleux établit pas moins de quatre-vingts mentions de boissons alcoolisées tout au long des 192 pages, du whisky au champagne, du martini au calvados. Cette omniprésence de l’alcool souligne tant la sociabilité des élites que leurs failles intimes.
L’enquête se clôt significativement dans l’environnement familier du Quai des Orfèvres, comme si Maigret avait besoin de retrouver ses repères pour dénouer définitivement les fils de l’affaire. Cette conclusion ramène les protagonistes des palaces à leur condition d’êtres humains ordinaires, dépouillés de leur prestige social, confirmant ainsi la volonté de Simenon de mettre à nu les ressorts psychologiques de ses personnages.
La genèse du roman révèle quelques particularités intéressantes : initialement intitulé « Maigret et la petite comtesse », puis envisagé sous le titre « Maigret au George V » pour sa publication en feuilleton dans Le Figaro, le roman trouve finalement son titre définitif avec « Maigret voyage ». Il connaît deux adaptations télévisées : un téléfilm britannique en 1963 sous le titre « Another World » avec Rupert Davies, puis une version française en 1987 avec Jean Richard.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 192 pages.
20. Maigret et les témoins récalcitrants (1959)
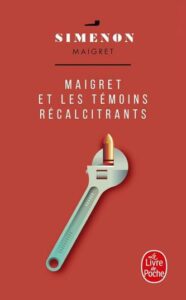
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Le commissaire Maigret enquête sur le meurtre de Léonard Lachaume, directeur d’une biscuiterie familiale située quai de la Gare à Ivry. La victime a été retrouvée dans sa chambre, une balle en plein cœur. Tout semble indiquer un cambriolage qui aurait mal tourné, mais cette version des faits ne convainc pas Maigret.
L’affaire se complique : la famille fait bloc et refuse de coopérer. Dans la grande demeure décrépite des Lachaume, où le temps semble s’être arrêté, le commissaire découvre peu à peu une entreprise au bord de la faillite, qui ne survit que grâce à la fortune de Paulette, épouse d’Armand, le frère de la victime.
À deux ans de la retraite, Maigret doit composer avec un jeune juge d’instruction zélé qui entend diriger l’enquête à sa place. Dans cette atmosphère glaciale de novembre, entre les murs moisis d’une maison qui transpire la déchéance, le commissaire devra percer les secrets d’une famille autrefois prestigieuse, aujourd’hui rongée par les non-dits.
Autour du livre
Dans « Maigret et les témoins récalcitrants », Simenon place son commissaire dans une posture singulière : à deux ans de la retraite, ce policier chevronné se heurte aux mutations de son métier, incarnées par un jeune juge d’instruction fraîchement diplômé qui prétend lui dicter sa conduite. Cette confrontation générationnelle trouve son écho dans le décor principal de l’intrigue : une antique demeure bourgeoise où survit la famille Lachaume, cramponnée aux vestiges de sa gloire passée.
La rédaction du roman s’inscrit dans une période tourmentée de la vie de Simenon, qui traverse alors son divorce avec Denyse Ouimet. Cette circonstance personnelle imprègne peut-être l’atmosphère du récit, où prédominent les thèmes du délitement familial et de la fin d’une époque. Le manuscrit naît en octobre 1958 au château d’Échandens, dans le canton de Vaud en Suisse, bien que Simenon indique mystérieusement « Noland » comme lieu d’écriture.
L’ambiance crépusculaire qui baigne le récit ne tient pas seulement à la mélancolie de Maigret face aux changements qui s’opèrent dans la police. La maison des Lachaume, avec ses meubles Empire recouverts d’étoffes inadaptées et ses tentures moisies, constitue une métaphore saisissante de la déchéance d’une classe sociale. Cette demeure « morte et pourtant vivante » y devient un personnage à part entière, témoin silencieux d’une tragédie familiale où l’honneur d’un nom prime sur toute considération humaine.
Le portrait de la bourgeoisie déchue prend une dimension acerbe à travers le système des dots, encore vivace dans la France des années 1950. Les mariages arrangés des frères Lachaume avec des héritières de fortunes récentes révèlent la survivance d’usages quasi médiévaux dans une société en pleine modernisation. Cette critique sociale s’incarne particulièrement dans le personnage de Véronique Lachaume, qui a préféré l’indépendance au mariage de convenance qu’on voulait lui imposer.
La dimension psychologique du récit s’enrichit d’une réflexion sur l’évolution de la justice pénale. À travers l’opposition entre Maigret et le juge Angelot, Simenon questionne l’efficacité d’une approche purement théorique du crime, déconnectée des réalités sociales. Cette interrogation résonne avec une actualité particulière dans la France des années 1950, où la modernisation administrative s’accompagne d’une professionnalisation des forces de l’ordre.
Ce cinquante-troisième opus marque ainsi un certain virage. Le commissaire n’y apparaît plus seulement comme le défenseur de la justice, mais comme le témoin mélancolique d’un monde qui s’efface. Sa victoire finale laisse un goût amer, tant elle souligne l’inadéquation croissante entre ses méthodes intuitives et les nouvelles exigences bureaucratiques de sa profession.
« Maigret et les témoins récalcitrants » a connu un succès international, comme en témoignent ses multiples traductions et adaptations télévisées. Quatre versions ont vu le jour : britannique (1962), française avec Jean Richard (1978), japonaise (1978), et française à nouveau avec Bruno Cremer (1993). Cette dernière adaptation est considérée comme la plus fidèle à l’esprit du roman.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 192 pages.
21. Maigret et le voleur paresseux (1961)
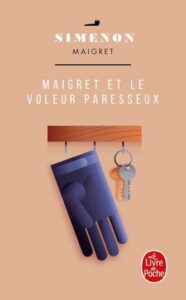
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Par une nuit glaciale d’hiver à Paris, le commissaire Maigret est tiré du lit pour examiner un cadavre découvert au bois de Boulogne. Il reconnaît aussitôt Honoré Cuendet, un cambrioleur suisse qu’il a déjà croisé. Le Parquet ordonne toutefois à Maigret de se concentrer sur une série de hold-up spectaculaires qui secoue la capitale.
Mais le commissaire ne peut s’empêcher de s’intéresser au destin de ce voleur atypique. Cuendet travaillait avec méthode : il étudiait les appartements luxueux dans les magazines, louait une chambre en face de sa cible et observait pendant des semaines avant d’agir. Sans violence, avec une lenteur presque nonchalante.
Entre son enquête officielle sur les braquages et ses recherches officieuses sur la mort de Cuendet, Maigret affronte aussi une nouvelle génération de magistrats. Ces jeunes diplômés imposent leur vision aseptisée de la justice, bien loin de l’humanité du commissaire.
Autour du livre
Rédigé en à peine sept jours dans sa résidence suisse d’Echandens en janvier 1961, « Maigret et le voleur paresseux » s’inscrit dans la continuité de « Maigret et les témoins récalcitrants ». Le commissaire, à deux ans de la retraite, se trouve confronté à une institution policière en pleine mutation. La vieille garde des policiers de terrain cède progressivement la place à une nouvelle génération de magistrats issus des grandes écoles, privilégiant les procédures administratives au détriment du travail d’enquête traditionnel.
Cette tension institutionnelle constitue la toile de fond sur laquelle se dessine une double enquête : d’un côté, une série de braquages spectaculaires qui mobilise toute l’attention du Parquet, soucieux de protéger les intérêts financiers ; de l’autre, l’assassinat d’un cambrioleur solitaire que la hiérarchie s’empresse de classer comme un banal règlement de comptes. Cette dualité illustre la mutation des priorités de la justice, où les crimes contre les biens prennent le pas sur les atteintes aux personnes – une évolution que Simenon souligne avec une ironie mordante à travers la voix de son commissaire.
Le personnage d’Honoré Cuendet incarne parfaitement cette époque charnière. Ce cambrioleur méthodique, qui prend le temps d’étudier ses cibles pendant des semaines, représente une forme presque artisanale de criminalité, en opposition aux méthodes brutales et expéditives des braqueurs modernes. Sa particularité de ne voler que lorsque les occupants sont présents révèle une dimension presque voyeuriste, comme s’il cherchait à participer furtivement à la vie de ses victimes.
L’intrigue se déroule dans un Paris hivernal où les self-services remplacent peu à peu les bistrots traditionnels chers au commissaire. Cette transformation du paysage urbain fait écho aux changements sociétaux que Simenon décrit. Les longues conversations entre Maigret et son épouse prennent une nouvelle dimension : privé de ses méthodes d’investigation habituelles par les nouvelles procédures, le commissaire trouve en elle sa principale confidente pour développer ses théories.
Le roman propose une résolution atypique : si l’enquête officielle sur les braquages aboutit à des arrestations, l’affaire Cuendet, elle, reste officiellement non résolue malgré l’identification des coupables. Cette impunité, protégée par les liens avec la haute société, illustre les limites d’une justice à deux vitesses. Le geste final de Maigret, qui aide à préserver le butin de Cuendet pour sa mère, prend alors une dimension presque subversive.
« Maigret et le voleur paresseux » a fait l’objet de plusieurs adaptations télévisées, notamment par la BBC en 1962 avec Rupert Davies, et en France en 1988 avec Jean Richard.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 160 pages.
22. La colère de Maigret (1963)
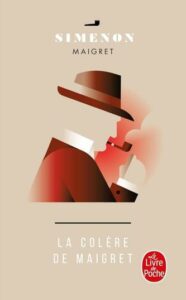
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Le corps d’Émile Boulay, propriétaire de cabarets montmartrois, gît sur un trottoir parisien. L’autopsie révèle qu’il a été étranglé trois jours plus tôt. Le commissaire Maigret hérite de cette affaire qui commence comme une banale histoire de règlement de comptes. Mais rien ne colle. Boulay était un patron prudent et méthodique qui tenait ses établissements d’une main ferme. Père de famille attentionné, il vivait simplement avec sa femme Marina, leurs enfants et sa belle-famille italienne. La veille de sa mort, il avait retiré une importante somme d’argent et multiplié les appels téléphoniques. Dans les ruelles de Pigalle, entre néons criards et façades défraîchies, Maigret remonte la piste.
Autour du livre
Rédigé en à peine une semaine, du 13 au 19 juin 1962 à Echandens en Suisse, « La colère de Maigret » frappe par sa construction méthodique. Le tapuscrit original, conservé par le Fonds Simenon à Liège, révèle un travail directement effectué à la machine, sans manuscrit préalable, preuve de la dextérité acquise par Simenon. La publication en feuilleton dans Le Figaro, du 28 juin au 22 juillet 1963, précède la sortie en librairie, pratique courante à l’époque qui permettait aux lecteurs de découvrir l’œuvre par épisodes.
Au cœur de Montmartre, dans la moiteur de juin 1963, Simenon place son commissaire dans une atmosphère où la P.J. baigne déjà dans une ambiance de vacances. Cette parenthèse estivale sert de toile de fond à une enquête qui marque une nouveauté dans la série : Maigret se retrouve confronté non pas aux figures traditionnelles du crime mais à un représentant de la bourgeoisie respectable, un avocat dont les méthodes vont provoquer une rage sans précédent chez le commissaire.
Dans ce soixante-et-unième opus de la série, Simenon délaisse les ressorts habituels du polar pour déployer une intrigue qui questionne l’intégrité même des institutions. Le titre ne prend son sens qu’au dernier chapitre, quand le commissaire découvre que son nom a servi à extorquer de l’argent à des accusés. Cette colère, inhabituelle chez un personnage connu pour sa placidité, constitue le point d’orgue d’une enquête qui sort des sentiers battus du crime organisé.
Le quartier de Pigalle, avec ses clubs de strip-tease et ses rues mal famées, y est central. Maigret y retrouve ses marques comme un chien de chasse sur un territoire familier, humant « l’air de ce Montmartre-là, qu’il n’avait pas respiré depuis des années ». Cette enquête marque aussi un Maigret plus vulnérable, contraint par son médecin de modérer sa consommation d’alcool, ce qui l’humanise encore davantage.
Dans la lignée des romans judiciaires qui se développeront plus tard, notamment ceux de John Grisham, « La colère de Maigret » anticipe les thèmes de corruption au sein du système judiciaire. La fin du roman, avec le suicide de l’avocat en cellule, pose la question de la responsabilité morale du commissaire. A-t-il sciemment laissé à Gaillard les moyens de mettre fin à ses jours ? Cette ambiguïté morale, rare dans la série, ajoute une profondeur psychologique supplémentaire au personnage de Maigret.
Les adaptations télévisuelles du roman témoignent de son succès international : une version japonaise en 1978 avec Kinya Aikawa, suivie d’une adaptation française en 1983 avec Jean Richard.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 186 pages.
23. Maigret à Vichy (1968)
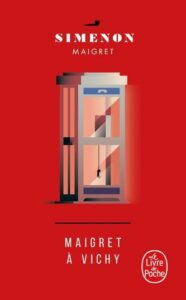
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Le docteur Pardon l’a ordonné : Maigret doit partir en cure à Vichy. À 53 ans, le commissaire du Quai des Orfèvres ne peut plus ignorer les signaux d’alarme envoyés par son corps malmené par l’alcool et la bonne chère. Le voilà contraint de troquer ses bières contre des verres d’eau minérale. Entre deux sources, il observe avec sa femme le ballet des curistes. Une silhouette retient leur attention : une femme élégante en tenue lilas, au visage fermé. Quand cette dernière est retrouvée étranglée dans son appartement, Maigret ne peut s’empêcher de s’intéresser à l’enquête menée par son ancien subordonné, le commissaire Lecœur.
Autour du livre
Dans cet opus atypique de la série Maigret, Simenon transpose son commissaire hors de son territoire habituel parisien. À 53 ans, Maigret se trouve confronté aux premiers signes de l’âge et doit se résoudre à suivre une cure thermale à Vichy sur prescription de son ami le docteur Pardon. Cette mise en situation n’est pas fortuite : Simenon écrit ce roman en septembre 1967, juste après avoir lui-même séjourné à Vichy avec sa compagne Teresa et ses enfants. Une rencontre lors de ce séjour inspire directement l’intrigue : une femme solitaire au visage dur, aperçue quotidiennement près du kiosque à musique, éveille la curiosité de l’écrivain qui imagine alors diverses hypothèses sur son identité et son histoire.
La particularité de « Maigret à Vichy » réside dans le positionnement inhabituel du commissaire face à l’enquête. Pour la première fois, il n’endosse pas le rôle principal d’investigateur mais celui d’observateur et de conseiller auprès de son ancien subordonné Lecœur. Cette posture en retrait modifie considérablement la dynamique narrative : le melon caractéristique du commissaire cède la place à un chapeau de paille, et les verres de bière s’effacent au profit des eaux thermales. Madame Maigret acquiert également une présence plus marquée qu’à l’accoutumée, un véritable personnage secondaire qui accompagne son mari dans ses déambulations quotidiennes.
La ville de Vichy, avec ses kiosques à musique, ses sources thermales et ses rituels de cure, prend chair. Elle insuffle un rythme particulier à la narration, entre les contraintes des soins et les promenades régulières du couple Maigret. Cette atmosphère thermale contraste délibérément avec la noirceur de l’intrigue qui se dévoile progressivement. Le cadre paisible de la station thermale sert d’écrin à une histoire sordide où la manipulation et le mensonge s’étendent sur plusieurs années.
Les références littéraires, inhabituelles dans la série, prennent ici une dimension significative. La victime, Hélène Lange, se révèle être une lectrice assidue des romantiques – Chateaubriand, Vigny, Sandeau, Constant, Musset, Sand – mais rejette Balzac qu’elle juge « trop brutal ». Cette mention n’est pas anodine : elle souligne le contraste entre les aspirations romantiques du personnage et la brutalité de son destin.
La transformation physique et psychologique de Maigret transparaît tout au long du récit. Le commissaire prend conscience de sa vulnérabilité et accepte, non sans une certaine résignation, les contraintes liées à son âge. Cette évolution personnelle s’accompagne d’une réflexion sur sa méthode d’investigation : alors que Lecœur privilégie une approche factuelle, Maigret maintient sa technique d’immersion et d’empathie, cherchant à comprendre la victime au-delà des simples faits.
« Maigret à Vichy » a bénéficié d’une adaptation télévisée en 1984 par Alain Levent, avec Jean Richard dans le rôle-titre.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 188 pages.
24. Maigret hésite (1968)
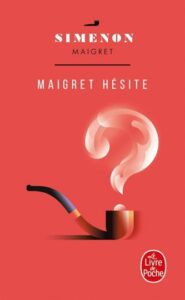
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Un matin de mars, Maigret découvre sur son bureau une lettre qui prédit un assassinat. Le papier, d’une qualité rare, le conduit chez maître Parendon, un avocat réputé dont l’appartement se dresse à deux pas de l’Élysée. Le commissaire s’installe dans cette demeure où cohabitent l’avocat, un petit homme laid, son épouse née Gaussin de Beaulieu qui le méprise, leurs deux enfants et la séduisante secrétaire Antoinette Vague. Dans ce huis clos étouffant, chacun dissimule ses secrets. Deux nouvelles lettres arrivent bientôt, plus pressantes. Le crime devient inéluctable.
Autour du livre
Rédigé à Épalinges dans le canton de Vaud en Suisse entre le 24 et le 30 janvier 1968, « Maigret hésite » tranche des autres enquêtes du commissaire par sa construction atypique. La première moitié du récit ne comporte aucun meurtre, mais s’articule autour d’une menace anonyme qui place le commissaire dans une position inconfortable : celle d’enquêter sur un crime qui n’a pas encore eu lieu.
Le titre initialement envisagé, « Maigret marche sur des œufs », traduit avec justesse la délicatesse de la situation. Dans l’appartement cossu de l’avenue Marigny, à deux pas de l’Élysée, le commissaire évolue en terrain miné. L’investigation préliminaire permet de cerner les protagonistes tout en posant, avant même que le meurtre n’advienne, la question centrale de la responsabilité du criminel.
L’intrigue s’enracine dans le contraste saisissant entre les époux Parendon. Lui, petit homme laid mais brillant juriste, se passionne pour l’article 64 du Code pénal qui traite de la responsabilité criminelle en cas de démence passagère. Elle, née Gassin de Beaulieu, incarne la grande bourgeoise hautaine qui méprise son mari et le considère comme un cas psychiatrique. Entre eux, la secrétaire Antoinette Vague joue un rôle pivot : maîtresse occasionnelle de l’avocat, elle devient la victime d’un crime que Maigret, malgré sa présence, ne parvient pas à empêcher.
La dimension psychologique prend le pas sur l’action pure. Simenon creuse les malentendus au sein d’un couple désaccordé par leurs origines et leur éducation différentes. L’article 64 du Code pénal, obsession de l’avocat Parendon, irrigue l’ensemble du récit et soulève une question essentielle : jusqu’où va la responsabilité d’un criminel ? Le texte de loi, qui stipule qu’il n’y a « ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action », résonne particulièrement avec le dénouement.
« Maigret hésite » marque également un tournant dans la série : le commissaire s’y montre plus vulnérable, plus humain. Son échec à prévenir le meurtre, malgré sa présence dans la maison, le touche profondément. Son empathie pour la victime transparaît lorsqu’il peine à assister à la levée du corps, fait rare dans sa carrière. Simenon met en scène un Maigret qui doute, qui tâtonne, qui hésite – justifiant ainsi pleinement son titre définitif.
Le roman a connu plusieurs adaptations télévisées notables : en 1975 avec Jean Richard, en 1981 dans une version soviétique avec Boris Tenin, et en 2000 avec Bruno Cremer sous le titre « Maigret chez les riches ». Cette dernière version s’est d’ailleurs révélée la plus populaire de la série avec Bruno Cremer.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 192 pages.
25. Maigret et l’homme tout seul (1971)
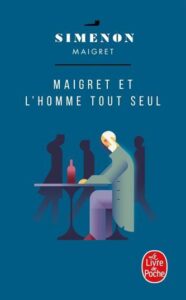
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Paris suffoque sous la chaleur d’août 1965. Dans une maison délabrée du quartier des Halles, on découvre le corps d’un clochard abattu de trois balles. Le commissaire Maigret est intrigué : la victime, malgré ses haillons, arbore une barbiche soignée et des mains manucurées. Qui était cet homme qui vivait seul, à l’écart des autres vagabonds ? L’homme s’avère être Marcel Vivien, un ancien artisan de Montmartre. En 1945, il avait abandonné sa femme et sa fille de huit ans. Depuis, il menait une vie solitaire dans ce quartier populaire, évitant tout contact. Pourquoi ce choix radical ? Et qui pouvait encore lui en vouloir après tant d’années ?
Autour du livre
Rédigé en février 1971 à Epalinges dans le canton de Vaud, « Maigret et l’homme tout seul » constitue l’antépénultième opus de la célèbre série. Le titre initial, inscrit sur l’enveloppe des notes préparatoires, devait être « Maigret le pauvre bougre » avant que Simenon ne le modifie en faveur de la solitude comme thème central.
La structure narrative s’articule autour d’une double enquête qui s’étend sur deux décennies, avec une particulière attention portée aux retours dans le passé. Cette construction temporelle complexe permet à Simenon d’entrelacer deux meurtres – celui de Nina Lassave en 1946 et celui de Marcel Vivien en 1965 – tout en maintenant une cohérence remarquable dans la progression de l’intrigue.
Le Paris des années 60 se dessine en toile de fond, avec une attention particulière au quartier des Halles à l’aube de sa transformation. Cette période charnière, juste avant le transfert des Halles vers Rungis, confère au récit une dimension historique significative. Les descriptions des petits restaurants familiaux, où les habitués disposent encore de leur propre casier pour leur serviette, et des ateliers logés dans les cours des immeubles haussmanniens, composent un tableau d’une époque révolue.
Le commissaire Maigret apparaît ici dans une phase plus tardive de sa carrière, comptant désormais ses bières sur conseil médical, tout en conservant son humanité caractéristique. Sa méthode d’investigation privilégie toujours la compréhension des êtres à la simple résolution technique du crime. Simenon dévoile également des éléments de sa vie privée, notamment sa préférence pour une maison de campagne plutôt que les vacances balnéaires, du fait de son incapacité à nager.
La figure du clochard, récurrente dans la bibliographie de Simenon, prend ici une dimension particulière. Marcel Vivien incarne une forme atypique de marginalité : propre sur lui, ne buvant pas, maintenant une certaine dignité malgré sa déchéance sociale volontaire. Cette solitude choisie comme expiation représente une variation originale sur le thème de la clochardisation, déjà traité dans « Maigret et le clochard » ou « Le charretier de la Providence ».
Le roman entrelace plusieurs motifs chers à Simenon : la double vie (présente aussi dans « Monsieur Gallet, décédé » et « Maigret et l’homme du banc »), la passion destructrice, et la vengeance qui traverse les années sans perdre de sa force. La présence d’un grain de beauté sur la joue de Nina Lassave, détail apparemment anodin, devient le catalyseur émotionnel qui maintient vivace le désir de vengeance pendant vingt ans.
Quelques incohérences mineures parsèment le récit, comme la présence anachronique de pièces de 25 centimes dans les poches du cadavre, ou l’origine jamais élucidée du coup de téléphone anonyme qui oriente l’enquête. Ces imperfections, relevées par les critiques, n’entament cependant pas la cohérence générale.
Deux adaptations télévisées ont transposé « Maigret et l’homme tout seul » à l’écran : une version japonaise en 1978 avec Kinya Aikawa, et une française en 1982 avec Jean Richard.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 224 pages.