André Gide (1869-1951) est l’un des écrivains français majeurs du XXe siècle, couronné par le prix Nobel de littérature en 1947. Né dans une famille bourgeoise protestante à Paris, il passe une jeunesse marquée par le puritanisme et une éducation discontinue en raison de sa santé fragile.
Sa carrière littéraire débute en 1891 avec « Les cahiers d’André Walter ». Sa rencontre avec Oscar Wilde et un voyage initiatique en Afrique du Nord en 1893 le font rompre avec le protestantisme et assumer son homosexualité. En 1895, il épouse sa cousine Madeleine Rondeaux, un mariage qui ne sera jamais consommé.
Ses œuvres majeures incluent « Les nourritures terrestres » (1897), « L’immoraliste » (1902), « La porte étroite » (1909), « Les caves du Vatican » (1914), « La symphonie pastorale » (1919) et « Les faux-monnayeurs » (1925). Dans ces romans, il aborde des thèmes comme la quête de liberté individuelle, la morale religieuse et les conflits de conscience.
Dans les années 1920, il publie « Corydon » (1920), un essai sur l’homosexualité, et « Si le grain ne meurt » (1924), son autobiographie. Son voyage au Congo (1925-1926) le sensibilise aux abus du système colonial, qu’il dénonce dans « Voyage au Congo » (1927). Dans les années 1930, il s’intéresse au communisme avant d’être déçu par le régime soviétique, comme il le relate dans « Retour de l’U.R.S.S. » (1936).
Pendant la Seconde Guerre mondiale, il s’exile en Afrique du Nord. Après la guerre, malgré les controverses qui ont jalonné sa carrière, il reçoit la consécration du prix Nobel. Il meurt en 1951 à Paris, laissant une œuvre considérable qui inclut romans, essais, journal intime et écrits autobiographiques.
Voici notre sélection de ses romans majeurs.
1. Les faux-monnayeurs (1925)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Publié en 1925, « Les faux-monnayeurs » raconte l’histoire de Bernard Profitendieu, un lycéen qui découvre qu’il est un enfant illégitime. Dans un élan de révolte, il quitte brutalement le domicile familial et se réfugie chez son ami Olivier Molinier. Le Paris des années 1920 sert de toile de fond à ce récit où s’entrecroisent les destins d’une multitude de personnages issus de la bourgeoisie.
Au centre de l’intrigue se trouve Édouard, l’oncle d’Olivier, un écrivain qui travaille sur un roman intitulé « Les faux-monnayeurs ». Bernard devient son secrétaire et l’accompagne en Suisse, ce qui provoque la jalousie d’Olivier. Ce dernier, vexé, tombe sous l’influence néfaste du comte de Passavant, un auteur mondain aux intentions douteuses. En arrière-plan se déroule une affaire de faux-monnayage impliquant des lycéens, dont Georges, le frère cadet d’Olivier.
Autour du livre
« Les faux-monnayeurs » occupe une place singulière dans l’œuvre de Gide : bien qu’il ait déjà publié de nombreux textes comme « Les caves du Vatican », il considère ce livre de 1925 comme son « premier roman », qualifiant ses écrits précédents de simples « récits » ou « soties ». Cette distinction n’est pas anodine – elle marque une rupture délibérée avec les codes narratifs traditionnels.
La construction du récit bouleverse les conventions en multipliant les points de vue et en tissant un réseau complexe d’intrigues qui s’entrelacent autour d’une histoire centrale. Cette architecture sophistiquée permet de remettre en question la capacité même du roman à dépeindre fidèlement la réalité. À travers le personnage d’Édouard, qui tente d’écrire son propre roman intitulé « Les faux-monnayeurs », Gide met en scène les limites inhérentes à toute tentative de transcription du réel dans la fiction.
L’homosexualité innerve profondément l’œuvre, que ce soit dans la rivalité entre Robert et Édouard, l’enlèvement d’Olivier ou l’attirance des jeunes pour leurs aînés. Cette thématique fait écho aux essais que Gide publie à la même période : « Corydon » et « Si le grain ne meurt ».
La genèse du roman se dévoile dans « Journal des faux-monnayeurs », publié en 1927. Ce document met au jour le travail quotidien de l’écrivain et révèle deux sources d’inspiration majeures : une affaire de trafic de fausses pièces d’or survenue au jardin du Luxembourg en 1906, et le suicide d’un lycéen nommé Nény au lycée Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand en 1909.
L’importance des « Faux-monnayeurs » dans l’histoire de la littérature se confirme par son inclusion en 1950 dans la liste du Grand prix des Meilleurs romans du demi-siècle. Son influence se prolonge jusqu’aux expérimentations du Nouveau Roman. En 2010, Benoît Jacquot en propose une adaptation télévisuelle de 120 minutes, diffusée sur France 2 en 2011 et disponible en DVD depuis 2018.
L’œuvre se distingue notamment par sa mise en abyme : un écrivain, Édouard, rédige un roman portant le même titre que celui de Gide, avec pour protagoniste un romancier. Cette structure réflexive souligne l’impossibilité pour la littérature de se contenter d’être un simple miroir du monde. « Les faux-monnayeurs » s’affirme ainsi comme une œuvre d’art créatrice à part entière, libérée des contraintes du roman traditionnel.
Aux éditions FOLIO ; 377 pages.
2. La symphonie pastorale (1919)
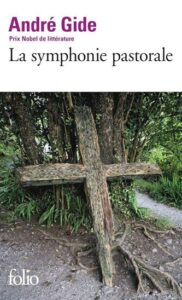
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Dans le Jura suisse des années 1890, un pasteur protestant découvre une jeune fille aveugle lors d’une visite à une mourante. Gertrude, une orpheline de quinze ans qui n’a jamais appris à parler ni à communiquer, vit recluse dans un état quasi-sauvage. Mu par la compassion, l’homme décide de la recueillir chez lui, malgré les réticences de son épouse Amélie.
Le pasteur entreprend alors l’éducation de Gertrude avec patience et dévouement. Sous sa tutelle, la jeune fille s’éveille rapidement à la vie intellectuelle et spirituelle. Il lui décrit le monde avec poésie, lui fait découvrir la musique, notamment la Symphonie pastorale de Beethoven.
Peu à peu, le pasteur développe pour sa protégée des sentiments qui dépassent la simple charité chrétienne. Son fils aîné Jacques n’est pas indifférent non plus aux charmes de la jeune aveugle. Le jour où une opération permet à Gertrude de recouvrer la vue, les masques tombent.
Autour du livre
Avec sa structure de journal intime, « La symphonie pastorale » puise ses racines dans la lecture du « Grillon du foyer » de Dickens. L’influence de plusieurs penseurs majeurs transparaît aussi : Hegel et sa conception de la conscience malheureuse, mais aussi Rousseau et Condillac pour leurs théories sur l’éducation. Ces références philosophiques nourrissent la complexité psychologique du pasteur, dont les choix et les positions se trouvent constamment conditionnés par son interprétation de la Bible.
La dimension religieuse y occupe une place centrale, notamment à travers l’opposition entre protestantisme et catholicisme incarnée par le conflit entre le pasteur et son fils Jacques. Cette tension religieuse se double d’une réflexion sur la cécité, tant physique que morale : si Gertrude souffre d’une cécité littérale, le pasteur manifeste un aveuglement moral face à la nature de ses sentiments, créant ainsi un parallèle saisissant entre les deux personnages.
La question du péché traverse l’ensemble du récit, notamment dans le paradoxe d’un homme d’église qui condamne l’amour de son fils pour Gertrude tout en nourrissant lui-même des sentiments inappropriés envers sa pupille. Cette contradiction morale souligne l’écart entre les apparences sociales et la réalité des sentiments, entre les devoirs religieux et les pulsions.
Le titre de l’œuvre établit un dialogue avec la Sixième Symphonie de Beethoven. Cette référence musicale ne se limite pas à un simple emprunt : elle structure le récit lors d’une scène cruciale où Gertrude, transportée par la « scène au bord du ruisseau », interroge le pasteur sur la beauté réelle de la nature comparée à celle suggérée par la musique. Cette mise en abyme soulève la question centrale du rapport entre perception et réalité.
Le succès de « La symphonie pastorale » se mesure notamment à travers ses nombreuses adaptations cinématographiques et télévisuelles à travers le monde. De la version japonaise de 1938 avec Setsuko Hara à celle de 1946 réalisée par Jean Delannoy avec Michèle Morgan, en passant par des versions turque, brésilienne, australienne et argentine, le roman n’a cessé d’inspirer les créateurs.
Aux éditions FOLIO ; 149 pages.
3. Les caves du Vatican (1914)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Rome, 1890. Un escroc du nom de Protos lance une rumeur sensationnelle : le pape aurait été enlevé et serait séquestré dans Les caves du Vatican. Un imposteur aurait pris sa place. Pour le libérer, Protos et sa bande réclament de l’argent aux fidèles. L’arnaque est simple mais redoutable.
Cette rumeur attire le candide Amédée Fleurissoire, un bourgeois de province qui compte bien délivrer le souverain pontife. À peine arrivé à Rome, le jeune homme tombe dans les filets des escrocs qui se font passer pour des hommes d’église.
Autour du livre
Publié en 1914 chez Gallimard, ce texte que Gide qualifie lui-même de « sotie » – terme désignant une farce médiévale – se démarque par son caractère délibérément décousu et sa dimension satirique. « Les caves du Vatican » provoque immédiatement un scandale dans les milieux catholiques, tout en suscitant l’admiration des surréalistes qui y voient une célébration du jeu et de l’humour noir érigés en principes de vie.
La théorie de l’acte gratuit, centrale dans l’œuvre, puise ses racines dans la pensée de Nietzsche et Dostoïevski. À travers le personnage de Lafcadio, jeune homme séduisant aux origines aristocratiques qui commet un meurtre sans mobile apparent, Gide interroge les limites de la liberté et ses conséquences morales. Cette réflexion prolonge les questionnements déjà présents dans « La porte étroite » et « L’immoraliste ».
Le personnage de Lafcadio se révèle particulièrement complexe : capable de sauver des enfants d’un incendie un jour et de précipiter un inconnu hors d’un train le lendemain, il incarne une forme de dandysme amoral. Son portrait pourrait avoir été inspiré par le poète et aventurier français Arthur Cravan, ou encore par le personnage de Rakhmetov du roman « Que faire ? » de Nikolaï Tchernychevski.
« Les caves du Vatican » a connu une adaptation théâtrale significative : Gide lui-même l’a transformée en pièce de deux actes et dix-sept tableaux, montée à la Comédie-Française le 13 décembre 1950 sous la direction de Jean Meyer. Cette version met notamment en scène une jeune Jeanne Moreau dans le rôle d’une prostituée.
Leonardo Sciascia, écrivain italien, lui rend hommage dans son roman « Todo modo » (1974) en intégrant une longue citation sur le thème du meurtre gratuit, établissant ainsi un parallèle entre Lafcadio et son propre personnage principal.
La dimension psychologique du personnage de Lafcadio apparaît étonnamment moderne : ses comportements d’autopunition, ses sentiments de vide existentiel, son rapport ambigu à la sexualité et ses perversions esquissent le portrait d’une personnalité trouble qui préfigure les études contemporaines sur les troubles psychiatriques.
Aux éditions FOLIO ; 250 pages.
4. L’immoraliste (1902)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Dans « L’immoraliste », André Gide raconte l’histoire de Michel, un intellectuel qui épouse Marceline pour exaucer le souhait de son père. Leur mariage sans passion les mène en Algérie, à Biskra. Michel y contracte la tuberculose et manque de mourir. Sa femme le soigne avec dévouement jusqu’à sa guérison.
Cette maladie transforme Michel. Son rapport au monde change : il rejette son éducation puritaine et s’éveille aux plaisirs des sens. Dans les ruelles de Biskra, il s’intéresse de plus en plus aux jeunes garçons. En France, malgré une brillante carrière universitaire, il s’égare. Les discours de Ménalque sur la liberté absolue le confortent dans son rejet des conventions sociales.
Quelques temps plus tard, Marceline fait une fausse couche et tombe gravement malade. Michel, devenu étranger à lui-même, la traîne de ville en ville avant de revenir à Biskra. Son indifférence croissante précipite la mort de sa femme. Perdu, il supplie ses amis de lui venir en aide.
Autour du livre
Publié en 1902, « L’immoraliste » naît en parallèle de « La porte étroite », les deux textes formant un diptyque dans l’esprit d’André Gide. Cette œuvre s’inscrit dans la veine des récits d’éducation qui fleurissent au début du XXe siècle, tout en subvertissant leurs codes habituels. En effet, contrairement aux schémas traditionnels du genre, le protagoniste Michel possède déjà une position sociale établie et une érudition considérable au début de l’histoire – il maîtrise sept langues et enseigne au Collège de France.
La dimension autobiographique transparaît nettement : la tuberculose de Michel fait écho à la découverte par Gide de son homosexualité la même année. Gide déploie cette thématique avec tact, à travers un système de métaphores et d’allusions voilées : l’attirance de Michel pour les jeunes gens de condition modeste, son admiration pour Moktir, le baiser volé au conducteur sicilien. La fin du récit évoque plus directement sa préférence pour Ali plutôt que pour sa sœur.
L’œuvre se démarque radicalement des romans à thèse de Paul Bourget et Maurice Barrès, tenant du nationalisme et du traditionalisme. Dans sa préface, Gide refuse explicitement de faire de Michel un modèle ou un contre-modèle, préférant « peindre et éclairer [sa] peinture » plutôt que d’asséner une morale. Cette indécision volontaire vise à bousculer le lecteur, l’incitant à forger son propre jugement.
La construction narrative se révèle particulièrement sophistiquée : le récit principal est enchâssé dans une lettre adressée à un président du conseil, créant un effet de mise en abyme. Le narrateur, l’un des trois amis de Michel, rapporte les confidences entendues, donnant ainsi corps et sens à ces « moments éclatés de vie ».
L’influence de Nietzsche imprègne fortement le texte, notamment dans sa seconde moitié où s’affirme une exaltation croissante de la vie. Bien que Gide ait nié toute dépendance directe envers le philosophe allemand, l’œuvre dialogue manifestement avec sa pensée, comme l’illustre la célèbre formule de Ménalque « On croit que l’on possède, et l’on est possédé » qui fait écho à l’aphorisme nietzschéen.
Une adaptation théâtrale a vu le jour à Broadway en 1954, mise en scène par Daniel Mann avec James Dean, Louis Jourdan et Geraldine Page dans les rôles principaux. Edward Saïd a par ailleurs analysé « L’immoraliste » sous l’angle post-colonial, y décelant les ambiguïtés des relations entre la France coloniale et l’Algérie française.
Aux éditions FOLIO ; 181 pages.
5. La porte étroite (1909)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
« La porte étroite » raconte une histoire d’amour impossible entre deux cousins, Jérôme et Alissa, dans une famille protestante de la bourgeoisie normande au début du XXe siècle. Orphelin de père, Jérôme passe ses vacances près du Havre, dans la demeure familiale de Fongueusemare. Il y développe une relation privilégiée avec sa cousine Alissa, fondée sur leur goût commun pour la littérature et leur sensibilité religieuse.
Cette idylle vacille le jour où Alissa apprend que sa sœur cadette Juliette est aussi amoureuse de Jérôme en secret. Par abnégation, elle commence à prendre ses distances. Même après le mariage de Juliette avec un autre homme, Alissa continue de repousser toute idée d’union avec Jérôme. Elle s’enferme peu à peu dans une quête mystique de vertu absolue.
Autour du livre
Premier grand succès littéraire de Gide en 1909, « La porte étroite » suscite d’emblée un malentendu révélateur entre l’auteur et son public. Alors que l’œuvre se veut le pendant de « L’immoraliste » et illustre l’autre versant d’un même excès, la critique assimile Gide à son héroïne Alissa et croit déceler dans ce livre un retour à la vertu. Francis Jammes et d’autres catholiques y voient même une possible conversion de l’auteur, tandis que certains dénoncent un livre « morbide et malsain » qui pousse trop loin le « raffinement de vertu ».
La narration s’articule autour d’un choix significatif : Gide abandonne la position du narrateur omniscient pour confier le récit à Jérôme, protagoniste incapable de percer les mystères qui l’entourent. Cette technique crée une tension constante entre ce que Jérôme perçoit et ce qui lui échappe, notamment concernant les sentiments de Juliette à son égard. Ce n’est qu’à la fin, à travers le journal d’Alissa, que certaines zones d’ombre s’éclaircissent.
« La porte étroite » trouve son origine dans une intention satirique – celle du sacrifice de soi – mais Gide finit par être « conquis par son héroïne » selon Henri Ghéon. Cette ambivalence constitue l’une des forces du livre : il oscille entre la critique d’un excès de vertu et la fascination pour cette quête de pureté absolue qui consume Alissa.
Des parallèles ont été établis avec « Le Lys dans la vallée » de Balzac, dont l’héroïne Henriette présente des similitudes avec Alissa dans son renoncement à l’amour terrestre au profit d’une aspiration céleste. Mais « La porte étroite » ne prend son sens complet que dans sa relation dialectique avec « L’immoraliste » : les deux œuvres forment les deux faces d’une même médaille, illustrant des excès opposés mais également destructeurs.
Le livre connaît une édition illustrée en 1939 par Étienne Cournault, publiée à la demande d’Albert Mermoud pour la Guilde du Livre à Lausanne, attestant de son rayonnement durable dans le cercle littéraire.
Aux éditions FOLIO ; 185 pages.
6. Paludes (1895)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Dans le Paris littéraire de 1895, un écrivain anonyme entreprend la rédaction d’un roman intitulé « Paludes ». Son texte met en scène Tityre, un personnage solitaire qui vit près d’un marais. Mais ce que nous lisons n’est pas ce roman – c’est plutôt le récit d’une semaine dans la vie de cet auteur qui ne cesse de dire à tous qu’il écrit « Paludes ».
Entre les réunions mondaines où il croise des intellectuels prétentieux, les conversations avec son amie Angèle et ses tentatives d’organisation méticuleuse de son agenda, le narrateur s’enlise dans une existence aussi stagnante que les marécages de son propre roman. Il rêve d’action, projette un déplacement à Montmorency qui tournera court sous la pluie.
Autour du livre
L’écriture de « Paludes » débute en Afrique du Nord, puis se poursuit à La Brévine en Suisse, où Gide s’astreint à un emploi du temps draconien : cinq heures quotidiennes consacrées au piano, deux heures de randonnées montagnardes, deux heures d’exercices physiques et de bains, avant de se consacrer à l’écriture et à la lecture. Sous les dehors d’une ironie mordante, le texte dissimule en réalité le désespoir qui habite Gide à cette époque.
Cette « sotie », comme la qualifie Gide lui-même, porte initialement le sous-titre évocateur de « Traité de la contingence ». Cette dimension philosophique transparaît dans la construction même de l’œuvre, qui instaure la contingence comme principe fondamental de sa composition romanesque. Cette innovation formelle ouvre la voie au roman contemporain français, comme le soulignent plusieurs figures majeures de la critique littéraire.
Roland Barthes insiste sur la nécessité d’une réévaluation de « Paludes » à l’aune de la modernité, tandis que Nathalie Sarraute y décèle les prémices du nouveau roman, louant particulièrement la vivacité des sensations qui émergent d’une construction « sur rien ». Mallarmé, quant à lui, salue « la goutte aigrelette et précieuse d’ironie » qui imprègne le texte, ainsi que son « affabulation spirituelle » qu’il juge inimitable.
La publication s’effectue dans un cadre intimiste, avec un tirage initial limité à 400 exemplaires numérotés à la Librairie de l’art indépendant. Cette quatrième œuvre de Gide marque également la fin de sa collaboration avec l’éditeur Edmond Bailly, après la parution des « Poésies d’André Walter », du « Traité du Narcisse » et du « Voyage d’Urien ».
L’originalité de « Paludes » réside notamment dans sa capacité à transformer la monotonie en principe esthétique, tout en maintenant une distance critique constante avec le processus créatif lui-même. Cette mise en abyme de l’acte d’écriture, couplée à une réflexion sur la nature même de la création littéraire, en fait une œuvre fondatrice de la modernité littéraire française, comme le confirme Henri Ghéon qui souligne son caractère inépuisable à chaque relecture.
Aux éditions FOLIO ; 147 pages.
7. Isabelle (1911)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Dans la campagne normande des années 1890, un jeune intellectuel parisien pousse la porte du château de la Quartfourche. Gérard Lacase, qui prépare un doctorat sur Bossuet, vient consulter la bibliothèque de Monsieur Floche. Il y découvre un monde figé dans le temps : une noble demeure où survivent deux familles déclassées, dont un enfant handicapé du nom de Casimir et son précepteur, l’abbé Santal.
L’atmosphère particulière des lieux éveille l’instinct romanesque de Lacase. Une photographie d’Isabelle, la mère mystérieusement absente de Casimir, le fascine. Une lettre découverte entre deux lambris lui dévoile un drame passionnel : une liaison interdite, un meurtre dans les bois, une femme reniée par sa famille. Le jeune homme se laisse emporter par son imagination et développe une obsession pour cette inconnue.
Autour du livre
La genèse d’ « Isabelle » s’étend sur près de deux décennies, depuis une première ébauche mentionnée dans une correspondance avec Henri de Régnier en 1893, jusqu’à sa rédaction finale en 1910 et sa publication en feuilleton dans la NRF au début de l’année 1911.
L’œuvre se distingue par sa construction en mise en abyme : le récit principal émane de Gérard Lacase qui le relate à ses amis, dont Francis Jammes, ce dernier composant une élégie à la fin de la narration. Cette structure crée un jeu de miroirs entre les différents niveaux de narration.
« Isabelle » se classe dans la catégorie de la « sotie », genre médiéval satirique que Gide réinvente ici. Le protagoniste Gérard incarne la figure du « sot » : jeune intellectuel parisien qui se laisse bercer par ses illusions romantiques avant de subir une brutale désillusion. Son comportement frise parfois le ridicule, notamment lorsqu’il erre dans le parc en appelant le nom d’Isabelle alors qu’il ne l’a jamais rencontrée.
L’ironie traverse l’ensemble des pages, à commencer par l’onomastique : le nom « Isabelle » évoque la chasteté tandis que « Saint-Auréol » fait référence au nimbe des saints, créant un décalage satirique avec la nature véritable des personnages. Le contraste entre les aspirations romantiques du héros et la réalité sordide qu’il découvre structure l’ensemble du récit.
Le château de la Quartfourche constitue un microcosme décadent où s’entremêlent les destins de personnages excentriques : des aristocrates ruinés, un couple de bourgeois cultivés qui les entretient, un enfant handicapé, un abbé précepteur, et des domestiques impliqués dans un drame passionnel. Cette configuration spatiale et sociale permet à Gide de dresser un tableau critique de la société provinciale française de la fin du XIXe siècle.
« Isabelle » a fait l’objet d’une adaptation télévisuelle en 1970 sur la deuxième chaîne de l’ORTF, avec Robert Etcheverry et Béatrice Arnac dans les rôles principaux. Gide lui-même a supervisé la correction des épreuves de son texte à Bruges, comme en témoigne son journal à la date du 8 mai 1911.
La critique littéraire considère souvent cette œuvre comme une étape importante dans l’évolution de Gide vers ses grands romans ultérieurs, notamment par sa narration épurée qui se développe selon une progression linéaire maîtrisée.
Aux éditions FOLIO ; 160 pages.




