Tom Sharpe (1928-2013) est un écrivain satirique britannique né à Londres. Fils d’un pasteur unitarien strict, il grandit dans un environnement rigide où la littérature jeunesse et les bandes dessinées sont interdites, le poussant vers des auteurs classiques comme Walter Scott et Melville.
Après des études à Cambridge et un service militaire dans les fusiliers marins, il s’installe en Afrique du Sud en 1951. Son expérience dans le township de Soweto, où il travaille dans un hôpital, le marque profondément. Révolté par l’apartheid, il documente la vie des populations noires par la photographie et écrit des pièces de théâtre contestataires, ce qui lui vaut d’être expulsé du pays en 1957.
De retour en Angleterre, il enseigne l’histoire au College of Art and Technology de Cambridge de 1963 à 1972. Cette expérience inspire son personnage le plus célèbre, Henry Wilt, héros d’une série de cinq romans. Son œuvre satirique, reconnue pour son humour féroce, s’attaque notamment au racisme, au snobisme britannique et aux travers de la société anglaise. En 1986, il reçoit le Grand Prix de l’humour noir pour l’ensemble de son œuvre.
Il passe ses dernières années en Catalogne, où il meurt à Palafrugell en 2013, laissant derrière lui une œuvre marquante dans la littérature humoristique britannique.
Voici notre sélection de ses romans majeurs.
1. Wilt 1 ou Comment se sortir d’une poupée gonflable et de beaucoup d’autres ennuis encore (1976)
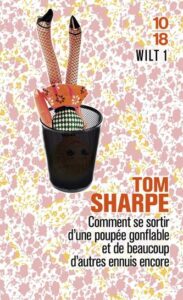
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Dans l’Angleterre des années 1970, Henry Wilt enseigne la culture générale dans un lycée technique. Ses journées se partagent entre des cours donnés à des apprentis bouchers, plâtriers et imprimeurs peu intéressés par la littérature, et une vie conjugale pesante aux côtés d’Eva, son épouse survoltée qui enchaîne les lubies et ne manque jamais une occasion de lui reprocher son manque d’ambition.
Lorsqu’Eva se lie d’amitié avec Sally, une Américaine adepte de la libération sexuelle, le quotidien déjà morose de Wilt bascule dans l’absurde. Une soirée chez ce nouveau couple d’amis tourne au fiasco quand il se retrouve coincé dans une poupée gonflable. Humilié, il décide de se débarrasser de l’objet du délit en l’enterrant sur un chantier près de son lycée. Mais quand les ouvriers aperçoivent une silhouette féminine sous le béton et qu’Eva disparaît mystérieusement, Wilt devient le suspect numéro un d’une enquête pour meurtre.
Autour du livre
À sa parution en 1976, « Wilt » de Tom Sharpe fait l’effet d’une bombe dans le paysage littéraire britannique. Ce premier tome d’une série qui en comptera cinq puise sa matière dans la propre expérience de l’auteur comme professeur au Cambridge College of Arts and Technology. La causticité du propos et les situations rocambolesques qui s’enchaînent propulsent rapidement le livre au rang de best-seller.
L’humour noir qui imprègne chaque page s’attaque sans concession aux travers de la société britannique des années 1970 : le système éducatif sclérosé, la petite bourgeoisie conformiste, les théories libératrices venues d’Amérique. Le personnage d’Henry Wilt incarne parfaitement cette Grande-Bretagne en pleine mutation sociale et culturelle. Sous ses dehors de anti-héros falot se cache un esprit acéré qui utilise l’absurde comme arme de résistance face à une réalité devenue insupportable.
Les dialogues percutants entre Wilt et l’inspecteur Flint constituent l’un des points culminants du livre. Ces joutes verbales révèlent toute la virtuosité rhétorique d’un personnage qui semblait jusque-là écrasé par son existence médiocre. Le flegme tout britannique avec lequel il manie l’art du quiproquo et de la digression transforme les interrogatoires en véritables morceaux de bravoure comique.
En 1989, le roman est adapté au cinéma avec Griff Rhys Jones et Mel Smith dans les rôles principaux. Plusieurs versions audio voient également le jour, dont une remarquable interprétation par Andrew Sachs. En 1986, Tom Sharpe reçoit le Grand Prix de l’humour noir pour l’ensemble de son œuvre, consacrant définitivement sa place dans le panthéon des grands auteurs comiques britanniques.
Les critiques saluent unanimement cette satire sociale qui manie avec brio le grotesque et l’absurde sans jamais tomber dans la vulgarité. La construction millimétrée des situations et la montée progressive vers le chaos final témoignent d’une maîtrise narrative qui transcende le simple divertissement pour atteindre une véritable dimension critique de la société.
Aux éditions 10/18 ; 288 pages.
2. Wilt 2 ou Comment se débarrasser d’un crocodile, de terroristes et d’une jeune fille au pair (1979)
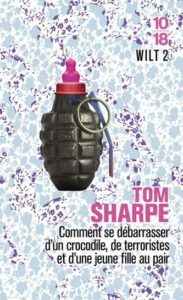
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Dans ce second volet des aventures de Henry Wilt, notre antihéros a gravi les échelons : le voilà directeur du département de culture générale au Tech. Il s’est aussi embourgeoisé puisqu’il habite désormais une grande maison dans un quartier huppé. Mais ce nouveau statut social s’accompagne de responsabilités dont il se serait bien passé : la gestion de quatre fillettes survoltées, fruit de ses rares rapprochements avec son épouse Eva, et les lubies écologiques de cette dernière qui a transformé leur demeure en laboratoire du développement durable.
L’arrivée d’une ravissante jeune fille au pair allemande dans leur grenier bouleverse ce fragile équilibre. Tandis que Wilt succombe peu à peu au charme de cette locataire mystérieuse, il doit aussi gérer une crise au Tech : un de ses professeurs s’est lancé dans la réalisation d’un film érotique mettant en scène un crocodile gonflable. Ces deux épisodes vont bientôt s’entremêler.
Autour du livre
« Wilt 2 » s’inscrit remarquablement dans son époque, celle des années 1970, en abordant frontalement la question du terrorisme qui secoue alors l’Europe. Tom Sharpe ne se contente pas d’en faire un simple ressort narratif : il dissèque avec une perspicacité mordante la psychologie des terroristes, qu’il dépeint comme des « poseurs politiques dont l’ennemi est la vie ». Cette dimension politique et sociale confère au roman une profondeur inattendue, sans jamais sacrifier l’humour qui fait sa marque.
La force comique du livre réside dans sa capacité à transformer des situations banales en catastrophes démesurées. Les personnages secondaires participent pleinement à cette mécanique du chaos : les quadruplées, héritières du tempérament de leur mère et du vocabulaire de leur père, deviennent des « haut-parleurs quadriphoniques » qui amplifient chaque péripétie. Mrs Frackas, vestige de l’empire colonial britannique, apporte une touche d’absurdité supplémentaire qui enrichit considérablement la narration.
Le livre se structure en deux temps distincts : une première partie qui enchaîne les situations cocasses autour du crocodile et des mésaventures de Wilt, puis un long huis clos lors de la prise d’otages. Si certains critiques trouvent ce second acte un peu étiré, il permet à Sharpe de déployer tout son talent dans l’orchestration du chaos et la multiplication des quiproquos.
L’écologie naissante des années 1970 n’échappe pas à la plume acérée de Sharpe : les lubies environnementales d’Eva, avec ses toilettes organiques explosives et son compost, témoignent d’une vision satirique étonnamment prémonitoire des préoccupations contemporaines. Cette critique sociale s’étend également au monde académique, cible privilégiée à travers les « professeurs bourgeois marxistes » qui peuplent l’établissement où travaille Wilt.
La dimension farcesque du roman ne doit pas occulter sa construction méticuleuse : les différentes intrigues s’entremêlent progressivement pour culminer dans un final explosif où le compost écologique joue un rôle déterminant. Cette architecture narrative sophistiquée distingue « Wilt 2 » d’une simple succession de gags.
Si le premier tome avait surpris par sa nouveauté, cette suite réussit à maintenir le niveau d’inventivité tout en approfondissant les personnages. L’inspecteur Flint, confronté une nouvelle fois à l’exaspérante honnêteté de Wilt, incarne parfaitement cette continuité qui satisfait les lecteurs du premier opus tout en restant accessible aux nouveaux venus.
Aux éditions 10/18 ; 320 pages.
3. La route sanglante du jardinier Blott (1975)
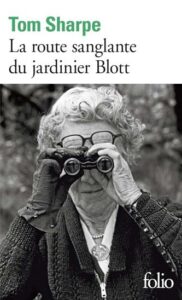
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Dans la campagne anglaise des années 1970, Sir Giles et Lady Maud Handyman forment un couple mal assorti. Lui a épousé cette aristocrate autoritaire pour son château et son siège au Parlement, elle l’a choisi pour perpétuer sa lignée. Mais leur mariage n’a jamais été consommé, Sir Giles préférant les plaisirs du bondage à ses devoirs conjugaux.
Lassée d’attendre un héritier, Lady Maud menace de divorcer. Pour garder le contrôle du domaine sans céder aux exigences de son épouse, Sir Giles imagine une solution radicale : faire passer une autoroute en plein cœur de la propriété. Les indemnités d’expropriation lui permettraient de quitter son épouse sans perdre au change. C’est sans compter sur la résistance acharnée de Lady Maud qui, épaulée par son dévoué jardinier Blott, compte transformer le domaine en parc animalier pour contrecarrer le projet.
Cette guerre conjugale déclenche une série d’événements aussi absurdes que destructeurs. Entre photos compromettantes, chantage, explosions à la dynamite et lions en liberté, le conflit dégénère en bataille rangée qui embrase tout le comté.
Autour du livre
Entre « Porterhouse ou la Vie de collège » (1974) et « Wilt » (1976), Tom Sharpe publie « La route sanglante du jardinier Blott » (1975), une satire mordante qui décortique avec jubilation les travers de la société anglaise des années 1970. Ce récit farcesque se positionne dans la grande tradition de l’humour britannique, tout en poussant ses mécanismes jusqu’à l’absurde.
La trame narrative s’inscrit dans un contexte historique particulier : les années 1970 voient se multiplier les projets d’extension du réseau autoroutier britannique, suscitant de vives protestations. Cette thématique inspire d’ailleurs Douglas Adams qui, quelques années plus tard, en fera le point de départ de son célèbre « Guide du voyageur galactique ». Sharpe transforme cette réalité sociale en une comédie échevelée où s’entrechoquent aristocrates déchus, bureaucrates zélés et jardiniers germaniques reconvertis.
L’art du quiproquo atteint ici des sommets vertigineux. Les personnages s’enlisent dans des situations de plus en plus rocambolesques, entre photos compromettantes, lions affamés et missiles anti-chars. La construction s’apparente à celle d’une horloge suisse, chaque élément s’imbriquant parfaitement dans un mécanisme d’une précision diabolique.
Le succès du livre conduit à son adaptation en série télévisée par la BBC en 1985. David Suchet y incarne magistralement Blott, tandis que Geraldine James prête ses traits à l’imposante Lady Maud. Le tournage se déroule principalement dans la région de Ludlow, dans le Shropshire, où plusieurs bâtiments servent de décor, notamment Stanage Park qui devient à l’écran le majestueux Handyman Hall.
Les illustrations de Paul Sample pour les couvertures des éditions Pan capturent parfaitement l’esprit déjanté du texte. Ses dessins fourmillent de détails tirés directement du récit, créant des tableaux grotesques qui synthétisent visuellement le chaos narratif orchestré par Sharpe.
La critique salue unanimement cette farce sociale qui mêle avec brio humour grivois et satire politique. Certains y voient même l’un des meilleurs opus de Sharpe, le comparant à P.G. Wodehouse pour la mécanique narrative, tout en notant une tendance plus marquée à la vulgarité assumée, rappelant l’esprit des émissions de Benny Hill.
Aux éditions FOLIO ; 352 pages.
4. La grande poursuite (1977)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Dans le Londres des années 1970, Frensic, agent littéraire de profession, reçoit un mystérieux manuscrit intitulé « Pitié, ô hommes, pour la vierge ». Le texte raconte l’histoire d’amour entre un jeune homme de 17 ans et une octogénaire. L’auteur exige de rester anonyme, mais l’œuvre pourrait devenir un best-seller.
Pour monétiser cette aubaine, Frensic et sa collaboratrice Sonia Futtle montent une imposture : ils recrutent Peter Piper, un écrivain sans talent, comme prête-nom. Le manuscrit est vendu à prix d’or à deux éditeurs : Geoffrey Corkadale en Angleterre et le richissime Hutchmeyer aux États-Unis. Mais la supercherie dérape quand Hutchmeyer exige une tournée promotionnelle aux États-Unis. Entre Baby Hutchmeyer qui séduit le faux auteur, un gourou qui monte une secte, et la véritable écrivaine qui menace de tout révéler, la situation s’emballe dans un tourbillon de quiproquos.
Autour du livre
Avec « La grande poursuite » publié en 1977, Tom Sharpe déploie une satire musclée du monde de l’édition britannique et américaine. Cette comédie grinçante s’inscrit dans la grande tradition de l’humour britannique, tout en poussant les situations jusqu’à l’absurde avec un cynisme jubilatoire.
L’originalité de l’œuvre réside dans sa critique acerbe du milieu littéraire, notamment à travers le personnage de Dr Louth, transposition à peine voilée du célèbre critique F.R. Leavis. Cette figure austère incarne l’establishment académique qui prône une conception élitiste de la littérature, rejetant les auteurs populaires comme Dickens ou Trollope au profit d’un canon restreint composé d’Austen, James et Conrad. La virulence de cette attaque contre Leavis, encore vivant lors de la publication, témoigne de l’audace de Sharpe et de son rejet des diktats littéraires imposés pendant ses études à Cambridge.
Les personnages incarnent différentes facettes de l’industrie du livre : Frensic, l’agent littéraire cynique, Hutchmeyer, l’éditeur américain décrit comme « l’Al Capone de l’édition » qui « ne lit jamais les livres qu’il achète, ne sachant lire que les chèques », ou encore Peter Piper, l’écrivain raté prisonnier des théories littéraires académiques. Cette galerie de portraits caustiques sert de prétexte à une succession de situations rocambolesques rythmées par les quiproquos.
Le roman se distingue par son ton irrévérencieux envers la société américaine, rappelant la tradition satirique de Dickens dans « Martin Chuzzlewit ». Les scènes se déroulant dans le Sud profond des États-Unis permettent à Sharpe de moquer avec férocité le fanatisme religieux et les préjugés locaux. Le personnage de Baby Hutchmeyer, épouse refaite de la tête aux pieds par la chirurgie esthétique, symbolise la superficialité et le matérialisme américains.
L’ironie du dénouement, où le médiocre Peter Piper devient un auteur à succès malgré lui tandis que Frensic se retrouve condamné à endosser la paternité d’œuvres qu’il méprise, illustre parfaitement l’absurdité du système éditorial dénoncé par Sharpe. Cette conclusion en forme de pied de nez renforce la dimension satirique de l’ensemble.
La BBC a adapté « La grande poursuite » en feuilleton radiophonique de 4 épisodes en 2005, avec une distribution incluant Sandra Dickinson, Mark Heap et Adam Godley.
Aux éditions FOLIO ; 382 pages.




