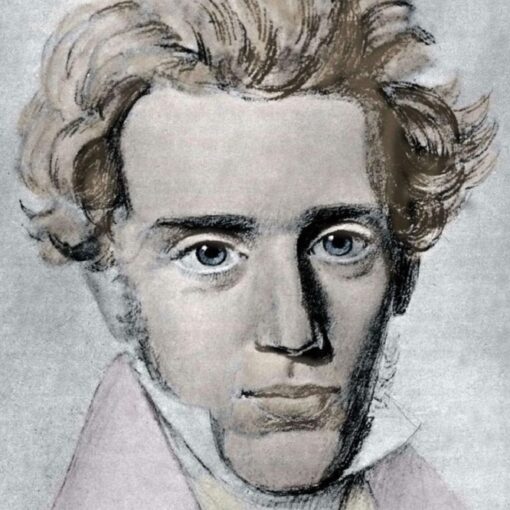Kamel Daoud est un écrivain et journaliste franco-algérien né le 17 juin 1970 à Mesra, dans la wilaya de Mostaganem. Fils d’un gendarme et d’une femme de la bourgeoisie terrienne, il est l’aîné d’une fratrie de six enfants et le seul à avoir fait des études supérieures.
Après des études de lettres françaises, il devient journaliste au Quotidien d’Oran en 1994, où il sera rédacteur en chef pendant huit ans. Il y publie notamment une chronique intitulée « Raina raikoum » (Notre opinion, votre opinion).
Son parcours littéraire est marqué par plusieurs succès majeurs. En 2014, son roman « Meursault contre-enquête », une réécriture de « L’Étranger » d’Albert Camus, lui vaut le Prix Goncourt du premier roman. En 2024, il devient le premier écrivain algérien à recevoir le Prix Goncourt pour son roman « Houris ».
Engagé dans le débat public, il n’hésite pas à prendre position sur des sujets sensibles, ce qui lui vaut parfois des controverses. En 2014, il est même la cible d’une fatwa d’un imam salafiste suite à ses propos sur l’islam. En 2020, il choisit de prendre la nationalité française, tout en conservant sa nationalité algérienne.
Kamel Daoud écrit en français, un choix qu’il justifie en expliquant que la langue arabe est selon lui « piégée par le sacré et les idéologies dominantes ». Il est aujourd’hui considéré comme l’une des voix majeures de la littérature francophone contemporaine.
Voici notre sélection de ses romans majeurs.
1. Houris (2024)
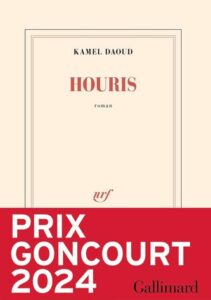
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
L’histoire commence à Oran en 2018. Aube, 26 ans, porte les stigmates de la guerre civile algérienne : une cicatrice de dix-sept centimètres qui lui barre le cou et des cordes vocales détruites. Le soir du 31 décembre 1999, elle avait cinq ans quand des islamistes ont égorgé sa famille et massacré tout son village. Sauvée in extremis, elle a grandi auprès de Khadija, son avocate et mère adoptive.
Aujourd’hui, Aube attend un enfant. Dans sa tête, elle parle à ce fœtus qu’elle imagine être une fille et qu’elle appelle Houri. Elle lui confie ses doutes, son histoire et surtout sa décision de ne pas la laisser naître dans une société qui opprime les femmes. Sa quête de vérité la pousse à retourner à Had Chekala, son village natal. En chemin, elle rencontre d’autres rescapés comme Aïssa, un libraire qui garde en mémoire chaque date, chaque lieu des tueries.
Autour du livre
« Houris » brise un tabou majeur en Algérie : une loi de 2005 interdit, sous peine de trois à cinq ans d’emprisonnement, toute évocation de la guerre civile des années 1990. Cette censure frappe d’ailleurs toujours l’œuvre de Kamel Daoud, contraint à l’exil pour l’écrire. La maison Gallimard se voit même exclue du Salon du livre d’Alger suite à cette publication.
Le texte entrelace habilement plusieurs voix qui se répondent. À celle d’Aube, quasi-muette mais dotée d’une « langue intérieure retentissante », fait écho celle d’Aïssa le libraire. Ce dernier incarne la mémoire vive des massacres : à chaque chiffre lancé, il associe une date précise, un lieu, parfois même les noms des victimes. Cette polyphonie crée un contrepoint saisissant à la loi du silence.
La dimension politique se mêle intimement aux questions de genre. Le titre fait référence aux « houris », ces vierges promises aux martyrs dans le paradis musulman. Cette symbolique souligne l’absurdité d’une société qui vénère des femmes imaginaires tout en opprimant les femmes réelles. Le corps mutilé d’Aube devient ainsi la métaphore d’une double violence : celle de la guerre civile et celle faite aux femmes dans l’Algérie contemporaine.
Le langage oscille entre brutalité et poésie. Les scènes de massacre côtoient des passages d’une grande sensualité, notamment dans l’évocation de la Méditerranée qui « impose son élégance » et « donne envie de se dévêtir ». Cette tension permanente entre horreur et beauté structure l’ensemble du récit.
Couronné par le Prix Goncourt 2024, « Houris » rejoint d’autres œuvres qui ont abordé cette période, comme « Bientôt les vivants » d’Amina Damerdji. Mais là où ses prédécesseurs adoptaient souvent une approche frontale, Daoud choisit la voie du monologue intérieur, donnant à son témoignage une puissance particulière : celle d’une parole qui persiste à s’élever malgré les cordes vocales tranchées.
Aux éditions GALLIMARD ; 411 pages.
2. Meursault, contre-enquête (2013)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Dans un bar d’Oran, un vieil homme, Haroun, livre son histoire à un universitaire. Il se présente comme le frère de « l’Arabe » tué par Meursault dans le célèbre roman de Camus, « L’Étranger ». Cet Arabe sans nom ni existence propre dans l’œuvre originale s’appelait Moussa, dit-il. Sa mort brutale sur une plage d’Alger en 1942 a bouleversé sa vie et celle de leur mère.
Le récit suit Haroun depuis son enfance, marquée par une mère obsédée par la vengeance et le deuil impossible de son fils aîné. Vingt ans plus tard, aux premiers jours de l’indépendance algérienne, Haroun commet à son tour un meurtre : celui d’un Français, sous un ciel lunaire qui fait écho au soleil aveuglant du crime de Meursault. Ce geste le libère autant qu’il l’enchaîne à jamais.
Autour du livre
Cette réinvention de « L’Étranger » donne enfin une voix à celui que Camus avait laissé dans l’anonymat : « l’Arabe » tué sur la plage. Sous la plume de Kamel Daoud, il devient Moussa, un homme doté d’une famille, d’une histoire et d’une identité propre. La démarche transcende le simple exercice littéraire pour interroger la colonisation française et ses conséquences sur la société algérienne contemporaine.
Dans ce texte qui fait écho à l’œuvre de Camus jusque dans sa construction même – il compte exactement le même nombre de signes que « L’Étranger » – les parallèles se multiplient : comme Meursault avec Marie, Haroun connaît une histoire d’amour avec Meriem ; comme le premier déteste les dimanches, le second exècre les vendredis ; comme l’un repousse le prêtre dans sa cellule, l’autre s’oppose violemment à l’imam de son quartier.
« Meursault, contre-enquête » ouvre un débat sur la place de la religion dans l’Algérie moderne et dénonce l’islamisation croissante de la société. Cette position courageuse vaut à Kamel Daoud une fatwa de la part d’un imam salafiste en 2014. Le livre reçoit néanmoins une reconnaissance internationale : Prix François-Mauriac, Prix des cinq continents de la Francophonie et Prix Goncourt du premier roman en 2015. Il manque de peu le Prix Goncourt en 2014, perdu à une voix près face à Lydie Salvayre.
La puissance du texte réside dans sa capacité à entremêler les destins individuels et collectifs. À travers le drame familial d’Haroun se dessine le portrait d’un pays marqué par la violence coloniale, les espoirs déçus de l’indépendance et les tensions contemporaines. L’utilisation maîtrisée du français – la langue du colonisateur – comme outil de réappropriation de l’histoire souligne la complexité des héritages culturels.
Aux éditions FOLIO ; 208 pages.
3. Zabor ou Les psaumes (2016)
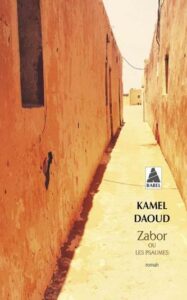
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Dans un village aux portes du désert algérien, Zabor vit en paria. Orphelin de mère, rejeté par son père qui s’est remarié, il habite avec sa tante célibataire Hadjer dans la maison du bas. À 28 ans, ce jeune homme à la voix chevrotante refuse de manger de la viande et n’est toujours pas circoncis. Mais il possède un don extraordinaire : par le pouvoir de ses mots, il peut repousser la mort. La nuit, il noircit des milliers de cahiers pour maintenir en vie les villageois qui implorent discrètement son aide.
Un soir, son demi-frère frappe à sa porte : leur père, le riche boucher Hadj Brahim, est mourant. Celui-là même qui l’a abandonné enfant se trouve maintenant entre ses mains. Face à ce père détesté, Zabor hésite. Utilisera-t-il son don pour sauver celui qui l’a renié ? Ou laissera-t-il la mort accomplir sa vengeance ?
Autour du livre
Deuxième roman de Kamel Daoud après « Meursault, contre-enquête » (Goncourt du premier roman 2015), « Zabor ou Les psaumes » paraît d’abord aux éditions Barzakh en Algérie en 2016, puis chez Actes Sud en France en 2017. Il obtient le Prix Méditerranée en 2018. Cette fable métaphysique tisse des liens étroits avec l’autobiographie : comme son personnage principal, Daoud grandit en Algérie dans les années post-indépendance et découvre la langue française à travers des livres abandonnés par les colons.
La présence des grands textes littéraires irrigue chaque page. Robinson Crusoé et son perroquet Poll deviennent les compagnons imaginaires du protagoniste. Les « Mille et Une Nuits » et Shéhérazade inspirent directement la trame narrative : comme l’héroïne qui raconte des histoires pour échapper à la mort, Zabor écrit pour sauver des vies. Le livre dialogue aussi avec « La chair de l’orchidée » de James Hadley Chase, roman qui éveille la sensualité du personnage principal.
Le rapport aux langues constitue l’un des enjeux majeurs. L’arabe se scinde entre la langue littéraire de l’école coranique, « présentée comme un bâton et pas comme un voyage », et le dialecte maternel. Le français ouvre une troisième voie : « Elle acquit la force d’une souveraineté car elle était royale […] Dernière vertu, elle était mienne dans le secret, intime, dérobée à la loi de mon père ». Cette langue devient un instrument de libération face à l’emprise religieuse et sociale. Chaque cahier de Zabor porte le titre d’un roman qui l’a marqué, comme autant d’hommages à la littérature qui l’a construit.
La critique se divise sur ce texte ambitieux. Si certains saluent sa dimension poétique et son style ciselé, d’autres pointent des longueurs et une écriture parfois hermétique. Mais tous s’accordent sur la puissance du propos : la littérature comme arme contre l’obscurantisme et rempart face aux horreurs du monde.
Aux éditions BABEL ; 336 pages.