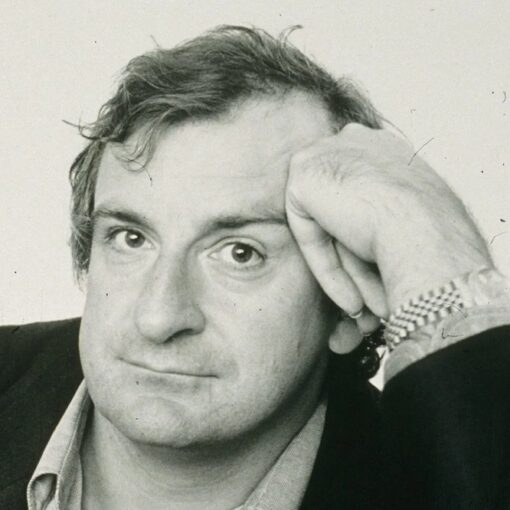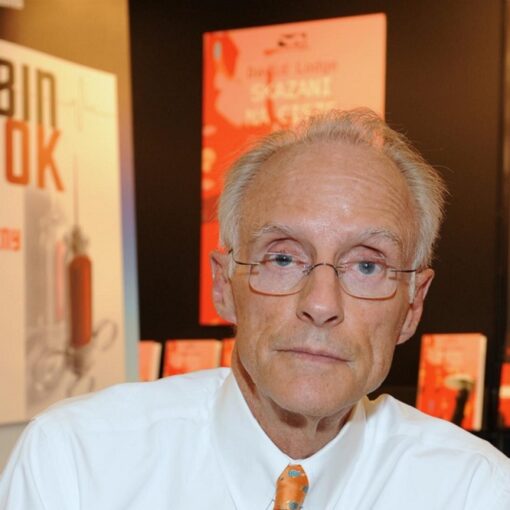Douglas Kennedy est un écrivain américain né le 1er janvier 1955 à Manhattan, New York. Il grandit dans l’Upper West Side, fils d’un courtier en bourse et d’une assistante de production à NBC. Après des études à la Collegiate School et au Bowdoin College, il passe une année au Trinity College de Dublin en 1974.
Sa carrière débute comme régisseur à Broadway avant de s’installer définitivement en Europe en 1977. À Dublin, il cofonde une compagnie de théâtre et travaille au National Theatre of Ireland (1978-1983). Il se lance ensuite dans le journalisme et l’écriture de pièces radiophoniques pour la BBC.
Son premier roman, « Cul-de-sac » (traduit ensuite sous le titre « Piège nuptial »), paraît en 1994. La consécration arrive avec « L’homme qui voulait vivre sa vie » (1997), best-seller international traduit en seize langues. Ses œuvres, souvent adaptées au cinéma, se distinguent par leur regard critique sur la société américaine et leurs questionnements sur les relations humaines.
Parfaitement francophone, Douglas Kennedy partage aujourd’hui sa vie entre Londres, Paris, Berlin et le Maine. Il a été marié à Grace Carley de 1985 à 2009, avec qui il a eu deux enfants. Il a reçu plusieurs distinctions, notamment le WH Smith Literary Award (1998) et a été fait Chevalier des Arts et des Lettres en 2006.
Voici notre sélection de ses romans majeurs.
1. Piège nuptial (1994)
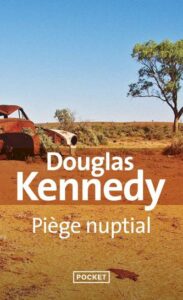
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
En 1994, dans le nord-est des États-Unis. Nick Hawthorne, pigiste trentenaire sans attaches, décide sur un coup de tête de partir en Australie après être tombé par hasard sur une carte routière. Une fois sur place, il achète un vieux combi Volkswagen et prend la route, bien décidé à traverser le continent. Sa rencontre avec Angie, une auto-stoppeuse au tempérament volcanique, va faire basculer son existence.
Ce qui devait être une simple aventure d’un soir se transforme en enfer : drogué, Nick se réveille dans un village perdu au cœur du bush australien, marié contre son gré à Angie. Wollanup, 54 âmes, est une communauté coupée du monde dirigée par quatre familles qui survivent en dépeçant des kangourous. Privé de ses papiers et de son argent, surveillé en permanence, Nick comprend qu’il est prisonnier d’un groupe d’illuminés. Le désert qui s’étend à perte de vue rend toute fuite impossible.
Autour du livre
Premier roman de Douglas Kennedy, « Piège nuptial » (initialement publié sous le titre « Cul-de-sac » en français et « The Dead Heart » en anglais) marque en 1994 les débuts fracassants de l’écrivain américain dans la fiction. Le titre original joue sur un double sens avec « red heart », terme qui désigne habituellement la partie centrale désertique de l’Australie.
Cette œuvre atypique, qui ne ressemble en rien aux romans ultérieurs de Kennedy, s’apparente à un thriller burlesque teinté d’humour noir. L’auteur s’inspire directement de son propre séjour en Australie en 1991, où il découvre avec stupeur l’immensité désolée de l’outback. Il puise également dans une réalité glaçante : environ 200 personnes disparaissent chaque année dans ces étendues désertiques sans laisser de trace.
En déconstruisant les clichés de carte postale, Kennedy dresse un portrait au vitriol de l’Australie profonde. L’atmosphère oppressante de Wollanup, cette cité fantôme officiellement rayée des cartes, fonctionne comme une métaphore cauchemardesque du mariage forcé. La communauté qui y survit, coupée du monde moderne, constitue une expérience sociale qui tourne au totalitarisme – une critique à peine voilée des dérives du collectivisme.
Le texte regorge de touches d’humour grinçant, notamment dans les dialogues savoureux entre le héros et les autochtones dépeints comme des êtres primitifs. L’écriture crue et sans concession sert parfaitement cette ambiance glauque où se mêlent violence verbale et physique.
Adapté au cinéma en 1997 sous le titre « Bienvenue à Woop Woop » par Stephan Elliott (le réalisateur de « Priscilla folle du désert »), puis en bande dessinée en 2012 par Christian de Metter, « Piège nuptial » demeure l’un des romans les plus populaires de Kennedy. Sa nouvelle traduction française en 2008 par Bernard Cohen, qui deviendra par la suite le traducteur attitré de l’auteur, témoigne de son statut particulier dans la bibliographie kennedienne.
De l’aveu même de l’écrivain, ce premier roman, le plus court mais aussi le plus difficile à écrire de sa carrière, recèle une dimension autobiographique voilée, notamment concernant « l’histoire de la première femme qui a blessé son cœur ». La structure narrative implacable et l’efficacité du suspense en font un page-turner par excellence, destiné à être lu d’une traite, idéalement au cours d’une nuit blanche selon les mots de Kennedy lui-même.
Aux éditions POCKET ; 256 pages.
2. L’homme qui voulait vivre sa vie (1997)
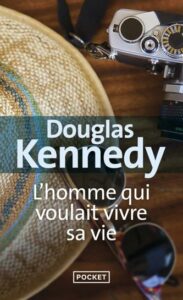
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Ben Bradford incarne la réussite à l’américaine des années 1990. Avocat prospère à Wall Street, il vit dans une luxueuse demeure du Connecticut avec sa femme Beth et leurs deux jeunes fils. Mais derrière cette façade, il suffoque : son métier l’ennuie profondément et son mariage s’étiole. Sa véritable passion, la photographie, reste confinée dans sa chambre noire au sous-sol, où il accumule un équipement sophistiqué sans jamais oser franchir le pas.
Un soir, il découvre que Beth le trompe avec leur voisin Gary Summers, un photographe bohème qui vit de son art. La confrontation tourne au drame : dans un accès de rage, Ben tue Gary. Au lieu de se rendre à la police, il élabore un plan ingénieux : faire croire à sa propre mort et endosser l’identité de sa victime. Il s’exile alors dans le Montana sous le nom de Gary, où il peut enfin se consacrer à la photographie. Mais son talent grandissant attire les projecteurs, menaçant de faire ressurgir son passé.
Autour du livre
L’Amérique des années 1990, avec ses banlieues cossues et son matérialisme triomphant, constitue la toile de fond de ce deuxième roman de Douglas Kennedy. « L’homme qui voulait vivre sa vie », publié en 1997, s’inscrit dans la lignée de son premier opus « Cul-de-sac » (rebaptisé plus tard « Piège nuptial ») en dépeignant le destin d’un homme dont la vie bascule brutalement.
La satire mordante du rêve américain transparaît à travers le portrait de cette société de nantis qui compensent leur vide existentiel par une frénésie consumériste. Les descriptions minutieuses des maisons néo-coloniales standardisées, des voitures familiales Volvo et des cartes Gold brandies comme des trophées dressent le tableau d’une Amérique superficielle où le bonheur se mesure en dollars. Le protagoniste lui-même souligne l’absurdité de ce mode de vie : « La crise conjugale majeure avait été évitée, du moins pour cette matinée-là. À nouveau nous étions une famille heureuse et unie, et cela moyennant seulement la somme totale de 623,99 dollars, taxes non comprises. »
Kennedy cisèle une solide réflexion sur la condition artistique, thématique qui sera reprise plus tard par Michel Houellebecq dans « La carte et le territoire ». Le dilemme entre sécurité financière et épanouissement créatif prend une dimension universelle à travers le parcours de Ben Bradford, qui a renoncé à sa passion pour la photographie sur injonction paternelle. L’ironie du sort veut que ce soit justement cette passion sacrifiée qui lui permettra de se reconstruire après sa fuite.
Le roman dévoile aussi une dimension psychologique qui évoque, sans l’égaler, « Crime et Châtiment » de Dostoïevski. La culpabilité et les remords du meurtrier sont disséqués avec acuité : « Soudain ce n’est pas que vous vous sentiez coupable : vous êtes coupable. Vous avez commis l’innommable, l’infaisable, et vous êtes toujours là. »
Cette quête effrénée de liberté se heurte finalement à un constat désabusé : même en changeant radicalement de vie, l’être humain ne peut échapper à sa nature profonde et finit par recréer les mêmes schémas, les mêmes chaînes qu’il cherchait initialement à fuir.
Si certains critiques déplorent des longueurs dans la première partie et un dénouement parfois jugé trop conventionnel, la majorité salue la construction rigoureuse du récit et sa dimension critique de la société américaine. Le succès commercial considérable du livre (400 000 exemplaires pour le premier tirage) a conduit à son adaptation cinématographique par Éric Lartigau en 2010, avec Romain Duris dans le rôle principal.
Aux éditions POCKET ; 512 pages.
3. Les hommes ont peur de la lumière (2021)
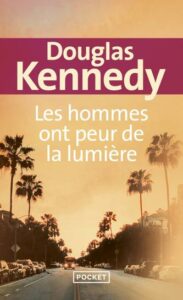
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Brendan, la cinquantaine désabusée, survit tant bien que mal comme chauffeur Uber à Los Angeles. Licencié après trente ans de bons et loyaux services dans la vente d’équipements électriques, il accumule les heures de conduite pour un salaire dérisoire. Sa vie privée n’est qu’un champ de ruines : depuis la mort de leur premier enfant, sa femme s’est enfermée dans un fanatisme religieux et milite activement contre l’avortement. Seule éclaircie dans ce tableau sombre : sa relation complice avec sa fille Klara.
Sa routine bascule le jour où il conduit Elise, une ancienne universitaire devenue bénévole dans une clinique pratiquant l’IVG. Sous ses yeux, un attentat frappe l’établissement. Cette rencontre le précipite dans une spirale infernale : entre sa femme convertie à l’intégrisme, un prêtre manipulateur et des groupuscules extrémistes, il se retrouve au centre d’une guerre idéologique qui pourrait bien lui coûter la vie.
Autour du livre
Au confluent de l’essai sociologique et du roman noir, « Les hommes ont peur de la lumière » de Douglas Kennedy résonne avec une acuité particulière dans l’Amérique contemporaine. Publié initialement en juillet 2021, ce quinzième opus de l’auteur s’avère prophétique puisqu’il anticipe la révocation de l’arrêt Roe v. Wade qui garantissait depuis 1973 le droit à l’avortement aux États-Unis.
À travers le prisme d’un chauffeur Uber, Kennedy dissèque les maux d’une société américaine fracturée, où l’ubérisation du travail côtoie le fondamentalisme religieux. Le système Uber, décrit avec une précision clinique, symbolise l’asservissement moderne : notation permanente, commentaires tyranniques des clients, précarité économique. Cette radiographie sans concession du capitalisme numérique s’inscrit dans une critique plus large de l’Amérique trumpiste, où les antagonismes sociaux et moraux atteignent leur paroxysme.
Le titre, inspiré de Platon – « On peut aisément pardonner à l’enfant qui a peur de l’obscurité ; la vraie tragédie de la vie, c’est lorsque les hommes ont peur de la lumière » – illustre parfaitement la thématique centrale du récit : l’obscurantisme qui menace les libertés individuelles, notamment celles des femmes. Kennedy ne se contente pas d’opposer pro-choice et pro-life, il met en lumière la violence systémique qui sous-tend ces affrontements idéologiques.
La structure narrative, bien que critiquée par certains pour son virage vers le thriller dans le dernier tiers, sert efficacement le propos social. Les personnages, notamment celui d’Elise, ancienne professeure devenue bénévole dans les cliniques d’avortement, incarnent les différentes facettes d’une Amérique en crise morale et identitaire.
« Les hommes ont peur de la lumière » s’inscrit dans la lignée des grands romans sociaux américains, tout en faisant écho à « Un livre de martyrs américains » de Joyce Carol Oates, qui traite également de la question de l’avortement. Toutefois, là où Oates privilégie une approche psychologique plus nuancée, Kennedy opte pour une immersion frontale dans les enjeux contemporains.
Certains critiques saluent sa pertinence sociale et sa dimension prémonitoire, d’autres regrettent un certain manichéisme dans le traitement des personnages. Néanmoins, tous s’accordent sur la puissance du témoignage qu’il constitue sur l’Amérique des années 2020.
Aux éditions POCKET ; 320 pages.
4. Les Désarrois de Ned Allen (1998)
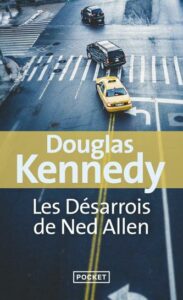
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Dans le New York des années 90, Ned Allen excelle comme vendeur d’espaces publicitaires pour un magazine d’informatique. Marié à Lizzie, une brillante attachée de communication, il mène une vie confortable à Manhattan. Le couple dépense sans compter, persuadé que leur ascension sociale ne connaîtra pas de limites. Mais un rachat hostile de son entreprise fait tout basculer : Ned perd son emploi et se retrouve sur la liste noire de toute la profession après une altercation violente.
La chute s’accélère. Lizzie le quitte, ses amis s’éloignent, les créanciers le harcèlent. Au bord du gouffre, il accepte la proposition d’un ancien camarade de lycée qui lui offre un poste dans une société de placement. Ce qui semble être une planche de salut s’avère être un redoutable piège. Ned se retrouve embarqué malgré lui dans une gigantesque arnaque orchestrée par des escrocs sans scrupules.
Autour du livre
Publié en 1998, ce troisième roman de Douglas Kennedy résulte d’une commande de son éditeur américain, désireux de capitaliser sur le succès de « L’homme qui voulait vivre sa vie ». Cette genèse particulière transparaît dans la construction narrative, qui épouse les codes du thriller d’entreprise à la manière de « La Firme » de John Grisham, tout en développant une critique musclée du monde des affaires new-yorkais des années 90.
La force du récit réside dans sa capacité à disséquer les mécanismes psychologiques et sociaux qui précipitent la chute d’un golden boy de la publicité. Kennedy dépeint cette époque où le culte de la réussite et de l’argent façonne les destins individuels. La première partie s’attache ainsi à déconstruire méthodiquement l’univers du protagoniste, créant une tension croissante qui culmine dans son licenciement brutal.
Le basculement vers le thriller financier dans le dernier tiers du livre marque une rupture de ton significative. Si certains lecteurs déplorent ce virage vers une intrigue plus conventionnelle, d’autres y voient une métaphore efficace de la frontière ténue entre success-story américaine et criminalité en col blanc. Les personnages secondaires, notamment Jerry et Jack Ballantine, incarnent les zones grises morales d’un système économique où la réussite justifie tous les moyens.
Les thèmes de la loyauté et de la trahison irriguent l’ensemble du récit. Le protagoniste lui-même oscille entre intégrité morale et compromissions, ses choix reflétant les dilemmes éthiques d’une génération prise au piège de ses propres ambitions. Sa relation avec Lizzie illustre notamment comment la quête effrénée du succès peut éroder les liens les plus solides.
La réception critique souligne la maîtrise technique du récit malgré quelques longueurs dans l’exposition initiale. Kennedy parvient à maintenir la tension narrative tout en développant une réflexion sociale sur les dérives du capitalisme financier. Cette dimension sociologique enrichit le simple schéma du thriller pour livrer un témoignage sur les excès et les contradictions de l’American Dream en fin de siècle.
Aux éditions POCKET ; 544 pages.
5. La Poursuite du bonheur (2001)
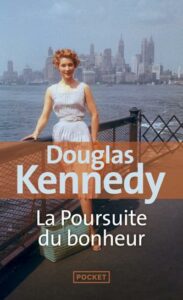
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Manhattan, 1945. Sara Smythe, récemment installée à New York, rencontre Jack Malone lors d’une soirée organisée par son frère Eric. Une passion fulgurante naît entre eux, mais Jack doit repartir le lendemain comme correspondant de guerre à Londres. Malgré ses promesses, il disparaît sans laisser de traces. Sara apprend plus tard qu’il a épousé Dorothy, déjà enceinte de lui. Jack meurt quand leur fille Kate n’a que dix-huit mois.
Un demi-siècle plus tard, Kate Malone enterre sa mère Dorothy. Dans l’assistance, elle remarque une femme élégante qui l’observe avec insistance. Cette inconnue, Sara Smythe, tente d’établir le contact par téléphone et par lettres. Elle finit par lui remettre un album photos et un manuscrit qui révèlent la vérité sur Jack Malone, ce père dont elle n’a aucun souvenir.
Autour du livre
En ancrant son récit dans le New York de l’après-guerre, Douglas Kennedy dépeint avec acuité une période sombre de l’histoire américaine : le maccarthysme. Cette chasse aux sorcières menée contre les communistes présumés sert de toile de fond à une histoire d’amour passionnée entre Sara Smythe et Jack Malone. Le contexte politique et social des années 1950 irrigue sensiblement l’intrigue, qui montre comment la paranoïa collective et la délation peuvent briser des vies.
La force de « La Poursuite du bonheur » réside dans sa narration alternant deux points de vue : celui de Kate dans le présent, et celui de Sara qui relate son histoire cinquante ans plus tôt. Cette architecture permet de mettre en perspective les choix et leurs conséquences sur plusieurs générations. Les personnages féminins occupent une place centrale et Kennedy excelle particulièrement dans leur portrait psychologique. Sara incarne une femme en quête d’indépendance dans une société encore profondément conservatrice, tandis que Kate représente une génération plus libre mais toujours aux prises avec ses démons intérieurs.
La relation fusionnelle entre Sara et son frère Eric constitue l’un des axes majeurs du récit. Leur complicité indéfectible transcende les épreuves, notamment lorsqu’Eric se retrouve sur la liste noire pendant la période maccarthyste. Kennedy aborde aussi sans détour l’homosexualité d’Eric, sujet tabou dans l’Amérique puritaine des années 1950.
À travers les destins croisés de ses personnages, Kennedy interroge la nature même du bonheur et sa quête perpétuelle. Les choix moraux difficiles, les trahisons et le poids du pardon constituent la substance émotionnelle d’un récit qui ne cède jamais au manichéisme. Les personnages restent profondément humains dans leurs faiblesses comme dans leur résilience.
Les critiques saluent particulièrement la capacité de Kennedy à adopter une voix narrative féminine crédible. « La Poursuite du bonheur » connaît un grand succès en France où il devient rapidement un best-seller. Sa traduction en serbe marque également les esprits, l’éditrice Tea Jovanović le considérant comme l’une de ses meilleures acquisitions.
Aux éditions POCKET ; 784 pages.
6. Les Charmes discrets de la vie conjugale (2005)
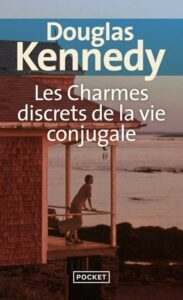
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
En 1970, Hannah surprend ses parents, universitaires militants de gauche, en épousant Dan, un étudiant en médecine conventionnel. Elle abandonne ses rêves de séjour à Paris pour le suivre dans une bourgade isolée du Maine où il débute sa carrière. Jeune mère accaparée par un bébé difficile, elle tue l’ennui en travaillant à la bibliothèque locale. Sa vie bascule quand elle accueille chez elle Tobias, un activiste politique poursuivi par le FBI. Après une brève idylle, il la contraint à l’aider à s’enfuir au Canada, la rendant complice d’un délit fédéral.
2003. Hannah a construit une vie confortable comme professeure. Son mari dirige le service d’orthopédie de l’hôpital, ses enfants ont quitté le nid. Mais ce fragile équilibre vole en éclats : sa fille Lizzie, instable émotionnellement, s’évapore dans la nature. Au même moment, Tobias, reconverti en prédicateur ultra-conservateur, sort un livre qui révèle et déforme leur liaison d’antan. Les médias s’emparent du scandale. Son fils, devenu évangélique radical, la renie. Dan s’enferme dans un silence glacial.
Autour du livre
Dans « Les Charmes discrets de la vie conjugale », Douglas Kennedy brosse un tableau saisissant de l’Amérique à travers deux époques : les années 1960-70 marquées par la contestation sociale et la guerre du Vietnam, puis les années 2000 sous l’ère Bush caractérisées par un retour au conservatisme. Cette dualité temporelle sert de toile de fond à une réflexion sur les choix de vie, les compromis et leurs conséquences à long terme.
Au cœur du récit se trouve Hannah, personnage complexe dont la trajectoire illustre les tensions entre conformisme et liberté, sécurité et authenticité. Son choix d’une vie conventionnelle, en contradiction avec son héritage familial progressiste, constitue un acte de rébellion paradoxal. Kennedy brille particulièrement dans sa capacité à incarner une voix féminine crédible, un talent souligné par de nombreux critiques qui notent la justesse psychologique du personnage principal.
L’œuvre s’articule autour d’une rupture temporelle de trente ans, créant ainsi deux mouvements distincts qui se répondent et s’enrichissent mutuellement. Cette structure narrative permet d’examiner comment les décisions prises dans la jeunesse peuvent resurgir des décennies plus tard, bouleversant une existence apparemment stable. La dimension politique s’avère omniprésente mais subtilement tissée dans la trame narrative, évitant l’écueil du pamphlet pour privilégier une réflexion nuancée sur l’évolution de la société américaine.
« Les Charmes discrets de la vie conjugale » se distingue aussi par son analyse fine des relations familiales, notamment à travers le prisme de la transmission intergénérationnelle. Les rapports entre Hannah et ses parents, puis entre Hannah et ses propres enfants, révèlent la complexité des liens familiaux et l’ironie des répétitions générationnelles. Son fils Jeffrey, devenu ultra-conservateur, incarne le paradoxe d’une génération qui rejette violemment les valeurs libérales de ses aînés.
La force du roman réside également dans sa représentation sans concession de l’hypocrisie sociale et du pouvoir destructeur des médias dans l’Amérique contemporaine. Kennedy décortique avec tact comment la société bien-pensante peut rapidement se retourner contre l’un des siens, transformant une erreur de jeunesse en scandale public déchaînant les passions.
L’accueil critique s’avère globalement positif, même si certains lecteurs pointent des longueurs dans la première partie. The Independent souligne notamment la capacité de Kennedy à transcender le genre du thriller domestique pour livrer une œuvre qui conjugue brillamment drame intime et commentaire social.
Aux éditions POCKET ; 608 pages.
7. La Symphonie du hasard (2017)
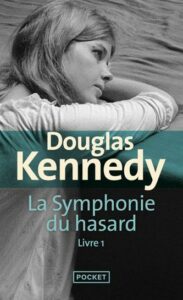
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Au début des années 1980, Alice Burns, éditrice new-yorkaise, apprend un terrible secret lors d’une visite à son frère Adam en prison. Cette révélation la plonge dans ses souvenirs du début des années 1970, quand sa famille vivait dans la banlieue cossue d’Old Greenwich, Connecticut.
Adolescente surdouée, mal dans sa peau, Alice suffoque entre un père catholique autoritaire qui passe plus de temps au Chili qu’à la maison, et une mère juive névrosée qui lit son journal intime. Ses deux frères, Peter et Adam, subissent comme elle le poids des disputes parentales et des secrets familiaux. Son admission à l’université de Bowdoin marque un tournant : elle y trouve un mentor en la personne du professeur Hancock, vit une histoire d’amour avec Bob, mais se heurte aussi aux préjugés et à la violence qui imprègnent le campus en ces temps de contestation contre Nixon et la guerre du Vietnam.
Autour du livre
Premier volet d’une trilogie, « La Symphonie du hasard » déploie sa trame dans l’Amérique des années 1970, à travers le parcours d’Alice Burns, jeune éditrice new-yorkaise. Douglas Kennedy y dépeint une famille de la classe moyenne supérieure américaine, miroir des bouleversements sociétaux de l’époque : le Watergate, la guerre du Vietnam, le coup d’État au Chili, les mouvements pour les droits civiques.
La narration s’articule autour d’un secret familial révélé par Adam, le frère d’Alice, depuis sa cellule de prison. Ce procédé narratif permet à Kennedy d’orchestrer un va-et-vient temporel entre le présent new-yorkais des années 1980 et le passé des années 1970. Cette construction en flash-back donne au récit sa profondeur, tout en maintenant une tension dramatique qui culmine dans les dernières pages.
Les Burns incarnent l’archétype de la famille américaine dysfonctionnelle : un père catholique irlandais aux activités douteuses au Chili, une mère juive de Brooklyn névrosée, et trois enfants qui tentent de se construire malgré ce climat délétère. Kennedy insuffle à chaque personnage une dimension complexe qui transcende les clichés. Comme le souligne l’auteur lui-même : « Aux États-Unis, on est obsédé par l’image de la perfection, du bonheur, de l’opulence […] Mais cette vie idéale est un grand mensonge. »
L’université de Bowdoin dans le Maine constitue le théâtre principal de ce premier tome. Kennedy y restitue l’atmosphère des campus américains, leurs codes sociaux, leurs fraternités étudiantes, sur fond de contestation politique. Cette immersion dans le monde universitaire fait écho à sa propre expérience, puisqu’Alice est née la même année que lui, ce qui lui fait dire « Alice, c’est moi ! », à la manière de Flaubert.
La force du livre réside dans sa capacité à entrelacer l’intime et le collectif. Les tourments personnels des Burns se mêlent aux grandes questions qui agitent la société américaine : l’homosexualité encore considérée comme une maladie mentale, le féminisme naissant, le racisme persistant. Kennedy livre ainsi une fresque ambitieuse de l’Amérique des seventies, sans jamais perdre de vue le fil conducteur des relations familiales.
Cette saga en trois volumes (environ 1300 pages au total) marque un virage dans l’œuvre de Kennedy, une ambition littéraire nouvelle par rapport à ses précédents romans. Certains critiques pointent néanmoins des longueurs, notamment dans les passages consacrés à la vie universitaire. Le New Statesman salue toutefois un livre « absolument excellent » doté d’un « effet étrangement hypnotique ».
Aux éditions POCKET ; 416 pages.
8. Cet instant-là (2011)
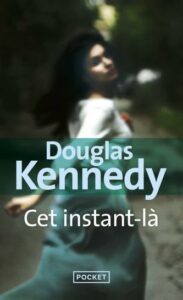
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Thomas Nesbitt, un écrivain américain divorcé d’une cinquantaine d’années, reçoit dans sa maison du Maine un mystérieux colis en provenance de Berlin. Cette livraison inattendue le propulse vingt-cinq ans en arrière, quand il était alors un jeune auteur parti écrire un livre sur Berlin-Ouest. À cette époque, la ville coupée en deux par le Mur cristallisait toutes les tensions de la Guerre froide.
1984. Dans les locaux de Radio Liberty où il travaille comme pigiste, Thomas rencontre Petra Dussmann, une jeune traductrice qui a fui l’Allemagne de l’Est. Entre eux, c’est le coup de foudre. Mais le passé de Petra recèle des zones d’ombre : son fils de trois ans est resté de l’autre côté du Mur et ses absences répétées éveillent les soupçons. Quand les services secrets américains s’en mêlent, Thomas doit faire un choix qui bouleversera leur existence.
Autour du livre
L’intrigue se déploie dans le Berlin des années 1980, ville déchirée par le mur et marquée par la guerre froide. Kennedy s’inspire de sa propre expérience dans la capitale allemande en 1983 pour construire sa trame narrative. Les rues de Kreuzberg, quartier alternatif situé à proximité du mur, constituent le théâtre principal de l’action et incarnent l’underground berlinois, ses artistes, ses marginaux.
Le roman se structure en cinq parties distinctes qui alternent entre le présent dans le Maine et le passé à Berlin. Cette construction permet de mettre en relief le poids des choix et leurs répercussions sur toute une vie. Le journal intime de Petra, dévoilé dans la quatrième partie, apporte un éclairage nouveau sur les événements.
La description minutieuse du régime totalitaire en RDA, avec son lot de délations et d’espionnage, s’appuie sur un important travail documentaire. Le roman fait écho au film « La vie des autres » de Florian Henckel von Donnersmarck, qui traite également du sort d’un auteur dramatique jugé subversif par le régime est-allemand. Kennedy parvient à restituer l’atmosphère oppressante de cette période, où chaque mot peut avoir des conséquences désastreuses.
Le personnage d’Alastair, colocataire britannique homosexuel et toxicomane de Thomas, insuffle une dimension marginale et artistique au récit. Certains lecteurs regrettent d’ailleurs que ce personnage haut en couleur ne soit pas davantage développé dans la suite de l’intrigue.
La réception critique s’avère contrastée : si certains saluent la capacité de Kennedy à entrelacer la grande Histoire et l’intime, d’autres pointent des longueurs dans la première moitié du roman et une certaine mièvrerie dans la description de la relation amoureuse. Le livre nécessite environ 200 pages pour véritablement démarrer, avant d’accélérer son rythme dans sa seconde partie.
Aux éditions POCKET ; 704 pages.
9. Quitter le monde (2009)
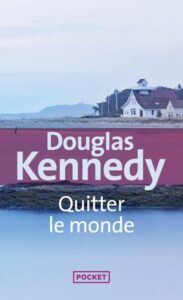
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Le soir de ses treize ans, Jane Howard lance une phrase qui bouleversera sa vie : « Je ne me marierai jamais et je n’aurai jamais d’enfants. » Le lendemain, son père quitte le foyer familial. Sa mère, incapable de surmonter cet abandon, fait porter à Jane le poids de cette rupture. Malgré cette enfance marquée par la culpabilité, la jeune femme brille dans ses études à Harvard avant de se lancer dans une carrière à Wall Street. Elle rencontre Theo, un homme passionné de cinéma avec qui elle aura une petite fille, Emily.
Mais le destin s’acharne. Une succession de trahisons et de drames pousse Jane à bout. Quand survient l’impensable – la mort d’Emily dans un accident de voiture – elle décide de disparaître. Elle s’exile au Canada, dans la ville de Calgary, où elle trouve un emploi de bibliothécaire. C’est là qu’elle croise la route d’une adolescente en danger. Cette rencontre la forcera à reprendre pied dans une existence qu’elle voulait fuir.
Autour du livre
Publié en 2009, « Quitter le monde » marque une nouvelle direction dans la bibliographie de Douglas Kennedy. Si ses premiers romans comme « Les Désarrois de Ned Allen » et « L’homme qui voulait vivre sa vie » s’inscrivaient dans la veine du thriller psychologique à la John Grisham, ce nouvel opus adopte une tonalité plus introspective et littéraire. Cette évolution n’est pas fortuite : entre-temps, Kennedy s’est forgé une solide réputation d’auteur capable de sonder avec finesse la psyché féminine, comme en témoignent les critiques qui saluent sa capacité à se glisser dans la peau de ses héroïnes.
La construction du roman en cinq parties distinctes tranche avec les codes habituels du genre. Chaque partie fonctionne presque comme un roman autonome, avec sa propre chute dramatique, sans que les fils narratifs ne soient systématiquement renoués par la suite. Cette structure fragmentée fait écho au parcours chaotique de Jane Howard, perpétuellement en fuite d’un univers à l’autre : du monde universitaire de Harvard aux salles de marché de Wall Street, des relations toxiques aux tentatives de reconstruction.
Les références culturelles émaillent le récit, parfois jusqu’à la saturation. Certains lecteurs déplorent d’ailleurs ces digressions sur la littérature américaine, le cinéma ou la musique classique, y voyant une forme d’étalage érudit qui ralentit la narration. D’autres y reconnaissent la marque d’un personnage façonné par ses études littéraires à Harvard. Cette ambivalence caractérise également la réception de la dernière partie du roman, où Jane se mue en détective amateur. Si ce virage vers l’enquête policière peut sembler artificiel, il s’inscrit dans une tradition littéraire américaine où la quête de rédemption passe souvent par la résolution d’une énigme criminelle.
L’accumulation des drames qui s’abattent sur Jane suscite des réactions contrastées. Pour certains critiques, cette succession de catastrophes confine à l’invraisemblance et trahit les limites du genre. D’autres y voient une réflexion sur la résilience et notre capacité à nous reconstruire après chaque épreuve. Le titre « Quitter le monde » prend alors tout son sens : il ne s’agit pas tant de fuir que de renaître sous une autre forme.
La trajectoire de Jane rappelle celle d’autres héroïnes de la littérature contemporaine, notamment Elena Greco dans « L’Amie prodigieuse » d’Elena Ferrante. Comme elle, Jane tente d’échapper à son milieu d’origine par les études et une discipline rigoureuse. Mais là où Elena parvient à s’émanciper, Jane reste prisonnière d’une culpabilité qui remonte à ses treize ans.
Aux éditions POCKET ; 704 pages.
10. Une relation dangereuse (2003)
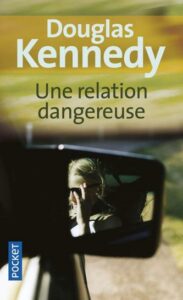
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Sally Goodchild, une reporter américaine de 37 ans pour le Boston Post, croise la route de Tony Thompson lors d’une mission au Moyen-Orient. Entre ces deux journalistes de guerre, le coup de foudre est immédiat. Bientôt, Sally tombe enceinte. Tony, rappelé à Londres pour un poste prestigieux, lui propose de se marier. Le couple s’installe dans la capitale britannique, où Sally peine à s’adapter aux codes de la société anglaise.
La grossesse se révèle difficile, l’accouchement traumatisant. Sally sombre dans une profonde dépression post-partum tandis que son mari se montre de plus en plus distant. À son retour d’un bref séjour aux États-Unis, elle découvre sa maison vide : Tony est parti avec leur bébé. Une bataille juridique s’engage alors, opposant une mère fragilisée à un mari manipulateur qui utilise la dépression de son épouse comme argument pour obtenir la garde exclusive de l’enfant.
Autour du livre
L’originalité d’ « Une relation dangereuse » réside dans le regard porté sur la dépression post-natale, un sujet rarement traité en littérature et d’autant plus remarquable que Douglas Kennedy parvient à incarner avec justesse la voix d’une femme. Cette prouesse s’explique notamment par l’important travail de documentation effectué par l’auteur, comme il le mentionne dans ses remerciements en fin d’ouvrage.
La structure narrative se divise en deux parties : les 300 premières pages posent les jalons psychologiques des personnages et de leur relation, avant que l’intrigue ne bascule dans une tension dramatique soutenue. Cette construction permet de mesurer toute l’ampleur de la chute de Sally, de son statut de reporter internationale intrépide à celui de mère fragilisée et isolée.
Le roman met particulièrement en relief les différences culturelles entre Britanniques et Américains. Kennedy dépeint les codes sociaux anglais qui déstabilisent Sally, illustrant comment l’expatriation peut devenir un facteur aggravant de vulnérabilité. Cette dimension sociologique s’incarne notamment dans des observations percutantes comme : « La grande différence entre Yankees et Rosbifs, c’est que les premiers considèrent la vie comme une affaire sérieuse mais non désespérée, tandis que les seconds pensent qu’elle est sans espoir mais pas sérieuse du tout. »
Le personnage de Tony évolue subtilement, passant du séduisant reporter au manipulateur machiavélique. Sa transformation progressive révèle les mécanismes pervers d’une emprise qui s’installe dans l’intimité du couple. La description minutieuse du système judiciaire britannique et de ses rouages ajoute une dimension supplémentaire au drame personnel qui se joue.
Le roman soulève également des questions sur la maternité contemporaine et ses difficultés, tout en évitant les clichés habituels sur le sujet. La description clinique de la dépression post-partum témoigne d’une volonté de briser les tabous autour de cette pathologie encore méconnue.
Publié en 2003, « Une relation dangereuse » s’inscrit dans la lignée des précédents ouvrages de Kennedy tout en marquant une évolution dans son écriture. Si certains critiques regrettent un rythme parfois inégal, la majorité salue la capacité de l’auteur à maintenir la tension narrative sur plus de 500 pages.
Aux éditions POCKET ; 544 pages.