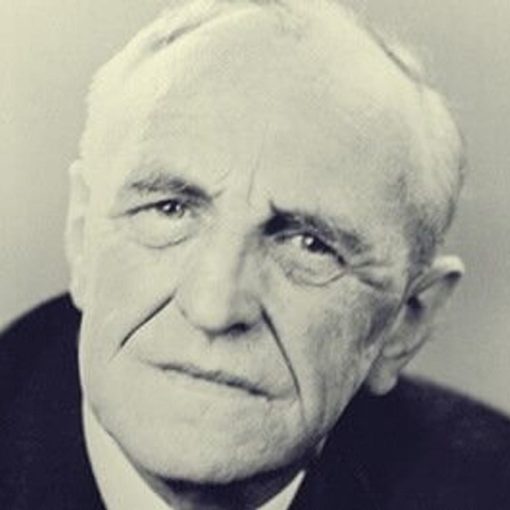Karine Tuil est une romancière française née le 3 mai 1972 à Paris, d’un père d’origine juive tunisienne. Après des études de droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas, où elle obtient un DEA en Droit de la communication, elle commence une carrière de juriste avant de se consacrer entièrement à l’écriture.
Son premier roman, « Pour le Pire », paraît en 2000 aux éditions Plon. Elle connaît son premier succès critique avec « Interdit » (2001), qui est sélectionné pour le prix Goncourt. Au fil des années, elle développe une œuvre qui analyse sans complaisance les contradictions des individus et les hypocrisies de la société contemporaine. Ses romans abordent des thèmes divers comme l’identité, le judaïsme, les rapports de domination et les enjeux sociaux.
Sa carrière littéraire connaît une consécration en 2019 avec « Les choses humaines », publié chez Gallimard, qui remporte le prix Interallié et le prix Goncourt des lycéens. Elle est nommée Chevalière de la Légion d’honneur en 2022, après avoir été faite Officière des Arts et des Lettres en 2017. Karine Tuil vit à Paris avec son compagnon et leurs trois enfants.
Voici notre sélection de ses romans majeurs.
1. La décision (2022)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Mai 2016. Alma Revel, 49 ans, juge d’instruction antiterroriste, doit se prononcer sur le sort d’Abdeljalil Kacem, un jeune homme de 23 ans suspecté d’avoir rejoint l’État islamique en Syrie. Cette décision déjà complexe se double d’un dilemme personnel : mariée depuis vingt-cinq ans à un écrivain juif en perte d’inspiration qui se réfugie dans la religion, Alma entretient une liaison avec Emmanuel, l’avocat qui représente justement Kacem.
Entre les interrogatoires du prévenu qui clame son innocence, les menaces de mort quotidiennes qui l’obligent à vivre sous protection policière, et sa vie familiale qui s’effrite, Alma perd pied. Comment trancher ? Maintenir en détention un homme peut-être innocent au risque qu’il se radicalise en prison ? Ou le libérer en espérant qu’il ne représente plus un danger pour la société ?
Autour du livre
« La décision » s’inscrit dans la continuité thématique des « Choses humaines », précédent livre de Karine Tuil récompensé par le Goncourt des lycéens. Cette fois, l’attention se porte sur l’univers des juges antiterroristes, dans un contexte post-attentats de 2015 qui imprègne chaque page. Les extraits d’interrogatoires, insérés entre les chapitres, donnent au texte une dimension quasi-documentaire, résultat d’un travail minutieux de documentation auprès des magistrats du pôle antiterroriste, des avocats et des enquêteurs de la DGSI.
La narration jongle avec deux fils conducteurs : d’un côté le quotidien harassant d’une juge confrontée à des choix cornéliens, de l’autre sa vie intime qui se désagrège. Cette construction en miroir permet d’interroger la notion même de décision, qu’elle soit professionnelle ou personnelle. La tension monte crescendo jusqu’au dernier tiers du livre où le récit devient presque irrespirable, rappelant la structure d’une tragédie grecque.
Si certains critiques y voient un ton parfois trop journalistique et une fin qui peut sembler improbable, la force du texte réside dans sa capacité à saisir les paradoxes de notre époque. Comment concilier présomption d’innocence et principe de précaution ?
Les personnages secondaires échappent aux clichés : un mari écrivain raté qui se réfugie dans le judaïsme orthodoxe, une fille brillante en couple avec un musulman modéré, un amant issu d’une lignée d’éminents juristes. Chacun incarne une facette des fractures qui traversent la société française contemporaine. Une citation résume particulièrement bien l’enjeu central du livre : « Le risque de prendre une mauvaise décision n’est rien comparé à la terreur de l’indécision. »
Aux éditions FOLIO ; 352 pages.
2. Les choses humaines (2019)
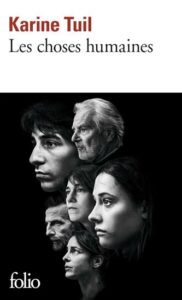
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Paris, 2016. Jean Farel s’apprête à recevoir la Légion d’honneur des mains du Président. À 70 ans, ce monstre sacré du PAF cumule émissions télé et chroniques radio. Sa femme Claire, 43 ans, s’est forgé une réputation d’intellectuelle féministe. Leur fils Alexandre brille à Polytechnique et s’apprête à rejoindre Stanford. Mais derrière cette façade étincelante se cache un édifice fragile : Jean entretient une liaison depuis des années avec une autre femme, tandis que Claire s’apprête à le quitter pour Adam, un professeur de français.
Le château de cartes s’effondre brutalement quand Alexandre est accusé de viol par Mila, la fille d’Adam. Une soirée arrosée, un pari stupide entre étudiants privilégiés, et voilà que deux vies basculent : celle de Mila, jeune fille timide issue d’un milieu juif traditionaliste, et celle d’Alexandre, héritier d’une dynastie médiatique. Pour lui, la relation était consentie. Pour elle, c’était un viol. Dans le sillage de l’affaire Weinstein et du mouvement #MeToo, l’accusation fait l’effet d’une bombe.
Le récit déroule alors l’inexorable descente aux enfers d’une famille privilégiée : perquisition, garde à vue, mise en examen. Claire doit concilier son engagement féministe avec la défense de son fils. Jean voit son empire médiatique vaciller. Les réseaux sociaux s’enflamment. Les médias dévoilent le moindre détail de leur vie privée.
Autour du livre
La genèse des « Choses humaines » prend racine dans un fait divers américain qui a secoué l’université de Stanford en 2016. Un étudiant nommé Brock Turner avait violé une femme inconsciente de 23 ans et n’avait écopé que de six mois de prison, le juge Aaron Persky estimant qu’une peine plus lourde aurait eu « un impact trop sévère » sur lui. Cette clémence controversée a déclenché un scandale aux États-Unis, alimenté par la lettre du père de l’accusé et le témoignage poignant de la victime.
Avant d’écrire, Karine Tuil s’est immergée pendant deux ans dans les tribunaux, assistant à de nombreux procès pour viol aux assises de Paris. Cette préparation méticuleuse transparaît dans la seconde partie du livre, consacrée au procès d’Alexandre. Les dialogues et confrontations sonnent juste, les plaidoiries atteignent une intensité rare, et la mécanique judiciaire se dévoile dans toute sa complexité.
La sortie du livre coïncide avec l’explosion du mouvement #MeToo et l’affaire Weinstein, donnant une résonance particulière aux questionnements sur le consentement, la culture du viol, les rapports de pouvoir entre hommes et femmes. Tuil refuse pourtant tout manichéisme facile : elle y met en scène les contradictions de Claire, féministe convaincue devenue mère d’un accusé de viol, et sonde la « zone grise » où les perceptions masculine et féminine d’un même événement divergent radicalement.
Couronné par le Prix Interallié et le Goncourt des lycéens 2019, « Les choses humaines » divise la critique. Olivia de Lamberterie et Jean-Claude Raspiengeas saluent dans « Le Masque et la Plume » son intelligence et sa pertinence sociale, quand Nelly Kapriélian y voit un opportunisme thématique et Frédéric Beigbeder des personnages caricaturaux. Le livre s’est néanmoins vendu à plus de 34 000 exemplaires avant même l’obtention de ses prix. Yvan Attal en a tiré une adaptation cinématographique en 2021, présentée hors compétition à la Mostra de Venise.
À travers cette affaire de viol qui fracasse une famille de l’élite parisienne, Tuil radiographie une société en mutation où les certitudes vacillent. Les réseaux sociaux y jugent avant les tribunaux, les médias dissèquent l’intime, les convictions les plus ancrées se heurtent à la complexité des choses humaines.
Aux éditions FOLIO ; 352 pages.
3. L’insouciance (2016)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
2009. Le lieutenant Romain Roller revient d’Afghanistan où une embuscade meurtrière a décimé son unité. Lors d’un séjour de décompression à Chypre organisé par l’armée, il tombe sous le charme de Marion Decker, une journaliste venue couvrir le retour des soldats. Leur liaison passionnée se poursuit en France, mais Marion est mariée à François Vély, un puissant entrepreneur franco-américain.
François Vély, fils d’un ancien ministre et résistant juif, dirige un empire des télécommunications. Sa vie bascule quand il pose pour un magazine, assis sur une œuvre d’art représentant une femme noire. La photographie déclenche un scandale médiatique qui menace sa réputation et compromet une importante fusion avec une société américaine.
En pleine tourmente, un ami d’enfance de Romain, Osman Diboula, prend publiquement sa défense. Fils d’immigrés ivoiriens devenu conseiller politique après les émeutes de 2005, Osman se retrouve malgré lui au cœur d’une spirale qui va tous les emporter.
Autour du livre
L’écriture de « L’insouciance » débute en 2013 et s’étale sur trois ans, une période marquée par les attentats de 2015 qui viennent teinter le texte d’une gravité particulière. Pour construire ce portrait sans concession de la France contemporaine, Karine Tuil mène un travail de documentation considérable, notamment auprès des services de l’armée sur le suivi des soldats blessés et le traitement du stress post-traumatique.
La construction du livre opère par tableaux successifs qui s’enchaînent en courts chapitres, chacun centré sur l’un des quatre protagonistes. Cette structure permet d’éclairer sous différents angles les fractures de la société française : la guerre et ses séquelles psychologiques, les arcanes du pouvoir politique, la montée des communautarismes, la puissance dévastatrice des réseaux sociaux. Les personnages incarnent ces tensions : un militaire hanté par la mort de ses hommes, un homme d’affaires rattrapé par ses origines juives, un fils d’immigrés propulsé dans les sphères du pouvoir.
« Il y a quelque chose de très malsain qui est en train de se produire dans notre société, tout est vu à travers le prisme identitaire. On est assigné à ses origines quoi qu’on fasse. Essaye de sortir de ce schéma-là et on dira de toi que tu renies ce que tu es ; assume-le et on te reprochera ta grégarité. » Cette réflexion d’un des personnages résume l’une des questions centrales du livre : peut-on échapper à ses origines dans une société où l’identité devient une assignation ?
La réception critique souligne la pertinence de cette fresque sociale qui saisit les bouleversements des années post-11 septembre. Si certains lecteurs pointent le caractère parfois stéréotypé des personnages, la majorité salue la puissance du propos et l’habileté avec laquelle Karine Tuil tisse les fils de son intrigue. Le livre marque la rentrée littéraire 2016 et confirme la place de son autrice parmi les voix majeures de la littérature française contemporaine.
Les similitudes entre certains personnages et des figures politiques réelles ont nourri les discussions, particulièrement autour du personnage d’Osman Diboula et de la représentation des cercles du pouvoir. Cette dimension documentaire renforce l’ancrage du livre dans son époque, tout en soulevant des questions sur les rapports entre fiction et réalité.
Aux éditions FOLIO ; 544 pages.
4. L’Invention de nos vies (2013)
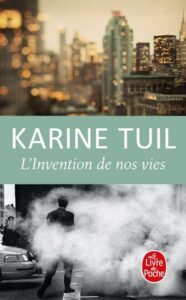
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
À New York, Sam Tahar incarne la réussite absolue. Avocat de renom, marié à la fille d’une des plus grandes fortunes juives américaines, père de deux enfants, il mène une vie luxueuse entre procès médiatiques et aventures extraconjugales. Mais derrière cette façade étincelante se cache une imposture : Sam s’appelle en réalité Samir, il est musulman et a construit son succès en usurpant l’identité de Samuel, son ami de jeunesse.
Vingt ans plus tôt, tous deux étudiaient le droit à Paris avec Nina, une beauté envoûtante qui oscillait entre leurs deux personnalités opposées. Après une liaison passionnée avec Samir, Nina avait choisi de rester auprès de Samuel par pitié, suite à sa tentative de suicide. Blessé, Samir s’était exilé aux États-Unis en s’inventant une nouvelle vie. Tandis qu’il gravissait les échelons du barreau new-yorkais, Samuel végétait dans une banlieue française, enchaînant les manuscrits refusés.
Vingt ans plus tard, le hasard d’une émission de télévision permet à Nina et Samuel de retrouver la trace de leur ancien ami. Les retrouvailles font ressurgir les passions, mais aussi les vérités inavouables. Dans une Amérique traumatisée par le 11 septembre, la supercherie de Sam pourrait déclencher un séisme. La menace se précise quand son demi-frère, radicalisé dans les quartiers sensibles, menace de tout révéler.
Autour du livre
Entre satire sociale et thriller psychologique, « L’Invention de nos vies » interroge les mécanismes de l’identité et les compromissions nécessaires à l’ascension sociale. Karine Tuil y déploie un effet miroir saisissant entre les destins opposés de Samir et Samuel : l’un s’élève en reniant ses origines quand l’autre s’enfonce dans une médiocrité qui finira par le sauver. Nina, objet du désir des deux hommes, incarne une féminité réduite au rôle de faire-valoir jusqu’à sa révolte finale.
Les thématiques abordées résonnent avec l’actualité brûlante des années 2010 : la discrimination à l’embauche, le terrorisme islamiste, le communautarisme, l’antisémitisme. Le meurtre d’Ilan Halimi et les attentats du 11 septembre constituent la toile de fond d’une Amérique paranoïaque où la moindre suspicion peut détruire une réputation. Cette dimension sociologique se double d’une réflexion sur l’écriture elle-même, à travers le personnage de Samuel qui trouve enfin sa voie littéraire dans le récit de sa propre déchéance.
La singularité formelle du texte tient à l’utilisation systématique de barres obliques qui scandent les phrases, donnant un rythme haletant au récit. Des notes de bas de page esquissent la biographie des personnages secondaires, toujours à l’imparfait comme pour souligner le caractère improbable de leurs ambitions. Cette technique narrative renforce le thème central de l’invention de soi et des vies rêvées.
Sélectionné dans la première liste du prix Goncourt 2013, ce sixième roman de Karine Tuil s’inscrit dans la lignée de Philip Roth et Tom Wolfe par sa façon d’ausculter la société contemporaine. La comparaison avec « Le Bûcher des vanités » s’impose notamment dans la mécanique implacable de l’ascension et de la chute. Certains critiques ont néanmoins reproché au livre ses rebondissements parfois invraisemblables et ses personnages féminins cantonnés à des rôles stéréotypés.
Face aux éloges qui saluent la puissance du style et la pertinence de l’analyse sociale, quelques voix s’élèvent aussi pour dénoncer une vision caricaturale des relations entre communautés. Le livre divise également par son traitement des questions d’identité religieuse, certains y voyant une simplification des enjeux. Ces controverses n’empêchent pas « L’Invention de nos vies » de s’imposer comme une œuvre marquante sur les illusions et les compromissions de notre époque.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 504 pages.
5. Six mois, six jours (2010)
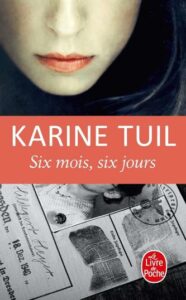
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Dans un hôtel de luxe, Juliana Kant succombe au charme d’un inconnu, Herb Braun. À 45 ans, cette héritière de l’une des plus grandes fortunes d’Allemagne, mariée et mère de famille, se lance dans une liaison qui va précipiter sa chute. En exactement six mois et six jours, le séduisant photographe de guerre va détruire sa réputation.
Cette histoire nous est racontée par Karl Fritz, 78 ans, qui fut pendant un demi-siècle l’homme de confiance de la famille Kant avant d’être brutalement congédié. Face à une journaliste venue recueillir ses mémoires, ce vieillard amer dévoile les coulisses du scandale : les rendez-vous clandestins, les vidéos compromettantes, le chantage. Mais ce qui semblait n’être qu’une sordide affaire d’extorsion cache peut-être une vengeance liée à un passé plus sombre. Car il semblerait que l’empire industriel des Kant ait connu son essor sous le Troisième Reich.
Autour du livre
« Six mois, six jours » s’inspire d’un fait divers qui a secoué l’Allemagne en 2007 : l’héritière de BMW, Susanne Klatten Quandt, victime d’un maître chanteur suisse nommé Helg Sgarbi. Cette affaire a éclaté en même temps que la sortie du documentaire « Le silence des Quandt », qui révélait l’exploitation de milliers de prisonniers dans les usines d’accumulateurs Quandt à Hanovre-Stöcken, une annexe du camp de concentration de Neuengamme.
En transposant cette histoire dans la fiction, Karine Tuil choisit comme narrateur Karl Fritz, ancien homme de confiance de la famille Kant pendant cinquante ans. Ce vieillard de 78 ans, brutalement congédié, livre ses confidences à une journaliste dans un monologue acerbe et cynique. Son témoignage dévoile non seulement le scandale contemporain mais aussi les secrets bien gardés de trois générations d’industriels allemands.
Le récit entremêle trois trames : la liaison fatale de Juliana, l’histoire trouble de la fortune familiale sous le IIIe Reich, et le destin tragique de Magda Goebbels. Le titre lui-même revêt une double signification : les six mois et six jours de la liaison destructrice de Juliana font écho à l’espérance de vie des prisonniers juifs dans les usines Kant. « Au camp de Stöcken, on meurt en six mois », plaisantaient les SS.
Le dernier chapitre, qui rompt avec le reste du texte, donne la parole à Richard Friedländer, père adoptif juif de Magda Goebbels. Cette figure historique, déportée à Buchenwald sur ordre de sa fille adoptive devenue l’épouse du ministre de la propagande nazie, incarne la question centrale du livre : la responsabilité des enfants face aux crimes de leurs parents.
Sélectionné pour le prix Goncourt 2010 et lauréat du prix du Roman-News, qui récompense la transposition d’un fait d’actualité en fiction, « Six mois, six jours » s’inscrit dans la lignée du « Liseur » de Bernhard Schlink par sa façon d’interroger la transmission de la culpabilité dans l’Allemagne contemporaine.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 256 pages.
6. Douce France (2007)
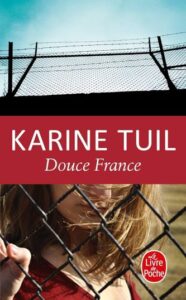
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Années 2000. Claire Funaro, une Française de trente ans se fait arrêter par erreur lors d’un contrôle d’identité visant des immigrants clandestins. Au lieu de prouver sa nationalité française, elle décide de se faire passer pour une Roumaine sans papiers. Cette décision impulsive la précipite dans l’univers des centres de rétention administrative, où sont détenus les étrangers en situation irrégulière.
Dans cet espace clos régi par l’attente et l’incertitude, la narratrice découvre un microcosme où se côtoient diverses nationalités. Sa rencontre avec Yuri, un Biélorusse énigmatique aux histoires changeantes, la trouble profondément. Cette expérience ravive en elle le sentiment d’illégitimité hérité de ses parents, juifs d’Afrique du Nord naturalisés français dans les années 1960.
Autour du livre
Publié en 2007, ce livre nait dans un contexte de durcissement des politiques migratoires en France. Karine Tuil a obtenu une autorisation exceptionnelle pour visiter le centre de rétention du Mesnil-Amelot. Cette immersion clandestine s’inscrit dans la lignée d’autres infiltrations célèbres, comme « Dans la peau d’un Noir » de John Howard Griffin (1960), « Tête de Turc » de Günter Wallraff (1986), ou la série « Stateless », basée sur le cas réel d’une Australienne enfermée par erreur dans un centre de détention.
« Douce France » résonne aussi avec d’autres créations sur le même thème : le film « Samba » d’Eric Toledano et Olivier Nakache (2014), le roman « Police » d’Hugo Boris. Le titre fait écho à la chanson de Charles Trenet, revisitée en 1987 par Rachid Taha et son groupe « Carte de séjour » dans une version qui sort de l’oubli l’originale jugée trop « franchouillarde ».
La narration entremêle plusieurs fils : la question de l’immigration clandestine, l’héritage familial juif, et une relation amoureuse ambiguë. Cette multiplicité thématique divise les critiques : certains y voient une force qui enrichit la réflexion sur l’identité, d’autres regrettent une dispersion qui empêche d’approfondir chaque sujet. Le parallèle entre la situation des migrants et les origines juives de la narratrice suscite des réactions contrastées, parfois jugé artificiel ou trop appuyé.
Dans ce texte à mi-chemin entre le pamphlet et la lettre d’amour aux siens, l’écriture se fait incisive, courte, agressive. Les novations formelles surviennent principalement dans les moments d’intensité émotionnelle, notamment après la rencontre avec le père. Le style épuré sert un propos qui interroge la légitimité à vivre dans un pays, le prix à payer pour avoir la certitude d’être français, et la possibilité même de l’assimilation.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 160 pages.