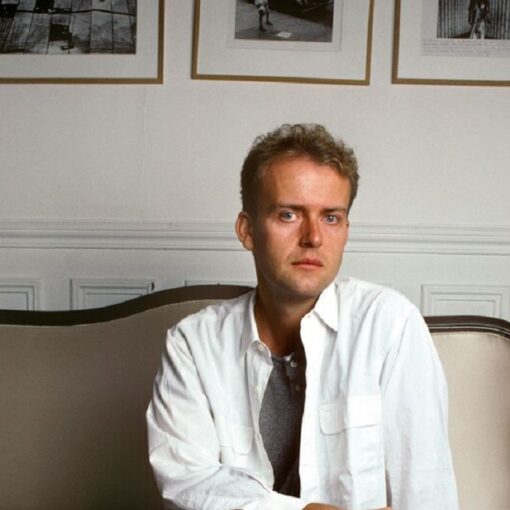Né à Dublin en 1971, John Boyne se forme à la littérature anglaise au Trinity College de Dublin puis à l’écriture créative à l’université d’East Anglia. Sa carrière d’écrivain décolle véritablement avec la publication en 2006 du « Garçon en pyjama rayé », un roman qui devient un best-seller mondial avec plus de 11 millions d’exemplaires vendus et fait l’objet d’adaptations au cinéma, au théâtre, en opéra et en ballet.
Auteur prolifique, il publie des romans tant pour adultes que pour la jeunesse. Son œuvre comprend aujourd’hui 16 romans pour adultes, 6 romans jeunesse, un recueil de nouvelles et un album illustré. Ses livres sont traduits dans 60 langues, ce qui fait de lui l’écrivain irlandais le plus traduit de tous les temps. Critique littéraire régulier pour The Irish Times, il reçoit de nombreuses distinctions, dont quatre Irish Book Awards et le Prix Gustav-Heinemann pour son travail sur l’éducation à l’Holocaust.
En 2019, son roman « My Brother’s Name is Jessica », qui aborde le thème de la transidentité, suscite une vive controverse sur les réseaux sociaux. Ouvertement gay, il évoque régulièrement les difficultés rencontrées durant sa jeunesse dans l’Irlande catholique. En 2023, il se lance dans un ambitieux projet avec « The Elements », une série de quatre nouvelles dont la dernière, « Air », est prévue pour mai 2025. John Boyne vit toujours à Dublin.
Voici notre sélection de ses romans majeurs.
1. Les fureurs invisibles du cœur (2017)
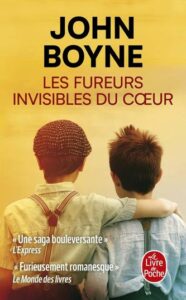
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Dans l’Irlande catholique conservatrice de 1945, Catherine Goggin, seize ans, est chassée de son village pour être tombée enceinte hors mariage. Réfugiée à Dublin, elle confie son nouveau-né à l’adoption. L’enfant, prénommé Cyril, grandit dans une famille dublinoise aisée et excentrique, qui ne cesse de lui rappeler qu’il n’est pas « un vrai Avery ». À sept ans, il rencontre Julian Woodbead, le fils de l’avocat de son père adoptif, et découvre peu à peu son attirance pour les garçons.
Dans une Irlande où l’homosexualité est un crime passible de prison, Cyril mène une double vie faite de rencontres furtives et de mensonges. Son parcours le conduit d’Amsterdam à New York, où il affronte l’épidémie de sida, avant de revenir dans son pays natal. Pendant soixante-dix ans, il cherche sa place, son identité et l’acceptation de qui il est vraiment.
Autour du livre
Inspiré par le référendum irlandais sur le mariage homosexuel de 2015, « Les fureurs invisibles du cœur » de John Boyne brosse un portrait sans concession de l’évolution sociale de l’Irlande sur sept décennies, à travers le destin de Cyril Avery. Le découpage temporel, qui fait progresser le récit par bonds de sept ans, structure habilement cette fresque monumentale qui débute en 1945 et s’achève en 2015.
La narration alterne entre le tragique et le comique, dans un équilibre savamment dosé. L’humour, souvent grinçant, imprègne particulièrement les dialogues, notamment ceux mettant en scène les parents adoptifs excentriques de Cyril. Cette tonalité apporte une respiration salutaire face à la violence des situations décrites et à la dureté du propos sur l’homophobie institutionnalisée.
L’ouvrage est dédié à John Irving, dont l’influence se fait sentir dans le mélange des registres et le traitement des « inadaptés sexuels », pour reprendre l’expression d’Irving lui-même. Boyne fait d’ailleurs plusieurs références directes au « Monde selon Garp ».
L’hypocrisie de la société irlandaise d’après-guerre constitue une cible privilégiée de la narration. Le clergé catholique, dépeint comme moralisateur mais corrompu, incarne cette duplicité : le prêtre qui bannit la mère de Cyril s’avère lui-même père de deux enfants illégitimes. Cette dénonciation s’étend à l’ensemble des institutions, judiciaires comme politiques.
Les personnages secondaires, loin d’être de simples faire-valoir, possèdent une réelle épaisseur psychologique. Catherine Goggin, la mère biologique de Cyril, incarne une force tranquille face à l’adversité. Le couple Avery forme un duo délicieusement atypique, avec Charles le fraudeur fiscal invétéré et Maude l’écrivaine qui considère le succès comme une vulgarité.
La réception critique s’est montrée largement favorable, saluant l’ambition et la maîtrise de cette saga familiale et sociétale. Le roman figure parmi les finalistes du Goodreads Choice Award 2017 dans la catégorie Fiction historique, confirmant son impact auprès du public international. Les critiques s’accordent toutefois sur certaines invraisemblances, notamment dans les multiples coïncidences qui émaillent le parcours de Cyril. Ces artifices narratifs, s’ils servent la dimension romanesque de l’œuvre, peuvent parfois nuire à sa crédibilité.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 864 pages.
2. Le garçon en pyjama rayé (roman jeunesse, 2006)
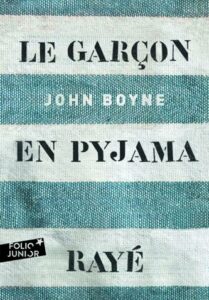
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Berlin, 1942. Bruno, neuf ans, mène une vie paisible dans la grande maison familiale avec ses parents et sa sœur Gretel. Son père, officier nazi, reçoit une promotion qui force toute la famille à déménager près d’un mystérieux camp entouré de barbelés. Le jeune garçon s’ennuie dans ce lieu isolé qu’il nomme « Hoche-Vite », loin de ses amis et de l’animation de la capitale.
De la fenêtre de sa chambre, Bruno observe des silhouettes en pyjama rayé qui se déplacent derrière une haute clôture. Personne ne veut lui expliquer qui sont ces gens ni pourquoi ils vivent là. Un jour, lors d’une escapade interdite le long des barbelés, il rencontre Shmuel, un garçon de son âge qui vit de l’autre côté. Une amitié clandestine naît entre les deux enfants, unis par leur innocence face à l’horreur qui les entoure.
Autour du livre
La genèse du « Garçon en pyjama rayé » présente une particularité remarquable : contrairement à ses autres œuvres qui nécessitent des mois de préparation, John Boyne rédige la première version en deux jours et demi, dans un état quasi fiévreux, sans presque dormir. L’idée initiale surgit sous la forme d’une image mentale : « deux garçons, le miroir l’un de l’autre, assis de part et d’autre d’une clôture ». Cette inspiration fulgurante s’appuie néanmoins sur une solide documentation préalable, Boyne ayant étudié la littérature sur l’Holocauste pendant plusieurs années.
Le choix narratif adopté par Boyne suscite des débats passionnés dans la communauté académique et mémorielle. En présentant les événements à travers le regard naïf d’un enfant de neuf ans, fils d’un officier nazi, Boyne déploie une perspective inédite sur l’horreur des camps de concentration. Cette approche, que l’auteur qualifie lui-même de « fable », privilégie une vérité morale plutôt qu’une exactitude historique stricte.
Cette orientation narrative divise profondément la critique. D’un côté, certains saluent la puissance du message moral et sa capacité à sensibiliser un jeune public. The Guardian évoque ainsi « une petite merveille » qui parvient à évoquer l’horreur d’Auschwitz sans briser l’innocence enfantine du protagoniste. De l’autre, des historiens et des organisations mémorielles pointent des inexactitudes historiques majeures. Le rabbin Benjamin Blech va jusqu’à qualifier le roman de « profanation », arguant qu’il minimise la réalité des camps où les enfants de l’âge de Shmuel étaient immédiatement gazés.
L’impact pédagogique du livre soulève également des interrogations. Une étude du London Jewish Cultural Centre révèle que 70 % des personnes interrogées pensent que l’histoire est basée sur des faits réels. Cette confusion entre fiction et réalité historique inquiète les spécialistes de l’éducation sur l’Holocauste. Le musée d’État d’Auschwitz-Birkenau déconseille d’ailleurs formellement son utilisation dans l’enseignement de la Shoah.
Malgré ces controverses, ou peut-être grâce à elles, le succès commercial est considérable : plus de 11 millions d’exemplaires vendus dans le monde, des traductions en 57 langues. Ce trriomphe engendre plusieurs adaptations : un film en 2008, un ballet par le Northern Ballet en 2017 et un opéra intitulé « A Child in Striped Pyjamas » en 2023.
En 2022, Boyne publie une suite, « La vie en fuite », qui suit le parcours de Gretel, la sœur de Bruno, devenue nonagénaire. Elle permet d’évoquer les répercussions transgénérationnelles du traumatisme de la Shoah.
Aux éditions FOLIO JUNIOR ; 208 pages ; Dès 12 ans.
3. La vie en fuite (2022)
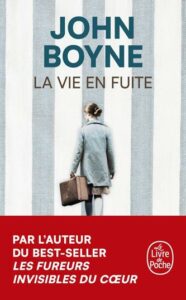
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Londres, 2022. À plus de quatre-vingt-dix ans, Gretel Fernsby coule des jours tranquilles dans son appartement cossu de Mayfair. Son quotidien bien réglé bascule avec l’installation de nouveaux voisins : un producteur de cinéma, sa femme et leur fils Henry, neuf ans. La présence de ce garçon solitaire fait ressurgir des souvenirs qu’elle croyait avoir enterrés.
L’histoire nous ramène en 1946, quand Gretel et sa mère ont quitté précipitamment la Pologne pour Paris. Dans leurs bagages, un lourd secret : elles sont la fille et l’épouse d’un officier nazi, commandant d’un des plus terribles camps de concentration. Pendant des décennies, Gretel va fuir ce passé à travers trois continents, rongée par une culpabilité qui ne la quittera jamais.
Autour du livre
Publié en septembre 2022, « La vie en fuite » naît pendant le confinement de 2020, alors que John Boyne avait initialement prévu d’écrire cette suite du « Garçon en pyjama rayé » dans ses 80 ou 90 ans. Le succès phénoménal de son prédécesseur – 11 millions d’exemplaires vendus, adapté au cinéma, au théâtre, en ballet et en opéra – engendre des attentes considérables pour cette continuation qui transpose l’histoire dans un registre adulte.
La profondeur psychologique de Gretel constitue l’une des grandes réussites du texte. Cette femme de 91 ans porte en elle une dualité saisissante : capable de générosité mais aussi de réactions brutales, bienveillante tout en restant distante, elle incarne la complexité d’une existence façonnée par la culpabilité. Sa voix narrative, décrite comme « intelligente, engageante et sans compromis », rappelle celle de la narratrice dans « Chronique d’un scandale » de Zoë Heller.
Le choix d’une structure alternant présent et passé génère une tension narrative constante. Les chapitres courts entrelacent habilement deux fils temporels : la vie actuelle de Gretel à Londres et ses errances d’après-guerre entre Paris, Sydney et Londres. Cette construction permet d’explorer les répercussions à long terme du traumatisme et de la honte.
Le roman soulève des questions morales fondamentales sur la responsabilité individuelle face aux crimes collectifs. Peut-on tenir une enfant de 12 ans pour responsable des actes de son père ? La culpabilité se transmet-elle par hérédité ? Ces interrogations trouvent un écho dans les dilemmes contemporains auxquels Gretel fait face.
La réception critique se révèle contrastée. Si The Guardian salue la caractérisation de Gretel et le Star Tribune qualifie l’histoire « d’essentielle », d’autres voix s’élèvent contre le traitement de l’Holocauste. Le Daily Telegraph reproche au livre de n’être habile que si « on ne sait rien de l’Holocauste et qu’on souhaite n’en rien savoir », tandis que le New Statesman va jusqu’à le qualifier de « fadaises infantiles ». Le musée d’Auschwitz lui-même prend position sur Twitter pour mettre en garde contre certaines inexactitudes historiques. Cette controverse reflète la difficulté persistante à fictionnaliser les événements de la Shoah, même plusieurs décennies après les faits.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 456 pages.
4. Il n’est pire aveugle (2014)
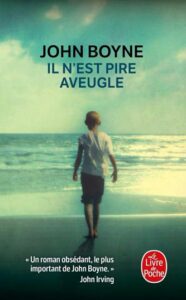
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Dans l’Irlande des années 1970, Odran Yates entre au séminaire sous l’impulsion de sa mère, marquée par un drame familial. À cette époque, les prêtres incarnent l’autorité morale du pays et jouissent d’un respect absolu. Après ses études, Odran mène une existence paisible comme bibliothécaire au collège Terenure, aux côtés de son ami Tom Cardle, rencontré lors de sa formation.
Quarante ans plus tard, l’Église irlandaise chancelle sous le poids des scandales de pédophilie. Les révélations s’enchaînent, les procès se multiplient. La population, autrefois si déférente, manifeste désormais sa colère et son mépris envers le clergé. Odran doit alors affronter une terrible vérité : n’a-t-il pas délibérément fermé les yeux sur les agissements de certains de ses pairs, notamment ceux de son ami Tom ?
Autour du livre
Premier roman de John Boyne situé dans son Irlande natale, « Il n’est pire aveugle » puise ses racines dans sa propre expérience. Comme il le confie au Irish Times, lui-même a subi des violences de la part de prêtres sadiques durant sa scolarité, dont l’un maniait une canne lestée de métal. Ces traumatismes expliquent pourquoi il a longtemps différé l’écriture d’un livre se déroulant dans son pays.
Le choix d’un narrateur prêtre, plutôt que celui d’une victime ou d’un romancier homosexuel comme dans ses autres œuvres, témoigne d’une volonté d’équilibre. Boyne souhaite que son texte ne soit pas qu’un simple réquisitoire contre l’Église, mais permette aussi à ses défenseurs les plus ardents de prendre conscience de leur responsabilité. Il entend également rendre justice aux religieux intègres dont la vocation a été ternie par les actes de leurs pairs.
La construction non chronologique, avec des chapitres correspondant à différentes années entre 1964 et 2013, sert habilement le propos. Cette structure exige une attention soutenue du lecteur, tant pour le cadre historique que pour l’évolution psychologique du protagoniste. Elle évite l’écueil du sensationnalisme en distillant progressivement les révélations. Le procédé du narrateur non fiable renforce cette subtilité : Odran omet sciemment certains faits qu’il ne dévoile que bien plus tard, comme l’épisode de la voiture vandalisée.
L’accueil critique s’avère globalement favorable, particulièrement dans le monde anglo-saxon. Helen Dunmore, dans The Guardian, salue la dénonciation des effets corrupteurs du pouvoir dans une Irlande quasi théocratique. Seules quelques voix discordantes, comme celle de Patrick T. Reardon – lui-même ancien séminariste – reprochent à Boyne son manque de nuance envers le clergé.
« Il n’est pire aveugle » s’inscrit dans une veine similaire à d’autres productions culturelles traitant des scandales de pédophilie dans l’Église catholique, comme le film « Spotlight » consacré aux révélations du Boston Globe. Elle se distingue toutefois par son point de vue original : celui d’un témoin passif dont la complicité silencieuse interroge la responsabilité collective face aux crimes institutionnels.
La publication intervient dans un contexte particulièrement sensible, alors que les révélations d’abus sexuels continuent d’ébranler l’Église catholique à travers le monde. En Irlande même, plus de 9000 plaintes ont été déposées, impliquant 1300 prêtres, pour un coût d’indemnisation se chiffrant en milliards d’euros.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 528 pages.
5. L’audacieux Monsieur Swift (2018)
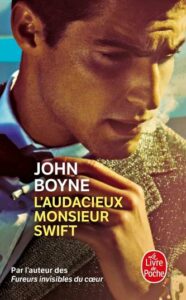
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
En 1988, dans le Berlin d’avant la chute du Mur, Maurice Swift officie comme serveur au Savoy Hotel. Ce jeune homme d’une beauté remarquable cache une ambition dévorante : devenir un écrivain reconnu. Son talent ne fait aucun doute, mais il achoppe sur un problème de taille : l’absence totale d’imagination.
Sa rencontre avec Erich Ackermann, un auteur allemand respecté de 66 ans, va lui ouvrir les portes du monde littéraire. Profitant du désir qu’il suscite chez le vieil homme, Maurice obtient ses confidences sur un lourd secret datant de la Seconde Guerre mondiale, matière première de son premier roman qui connaîtra un succès retentissant.
Mais ce succès initial ne suffit pas à Maurice Swift. Dépourvu de créativité propre, il développe une technique redoutable : séduire puis voler les histoires des autres. De victime en victime, il gravit les échelons du milieu littéraire avec un cynisme glaçant. Ni sa femme Edith, elle-même écrivaine, ni son fils Daniel ne seront épargnés par sa soif de reconnaissance.
Autour du livre
Dans le sillage du « Monsieur Ripley » de Patricia Highsmith, John Boyne livre avec « L’audacieux Monsieur Swift » un portrait glaçant d’un sociopathe du milieu littéraire. Maurice Swift incarne la figure du prédateur absolu : magnétique, implacable, dépourvu de toute empathie, il vampirise méthodiquement ses victimes pour assouvir son ambition dévorante de devenir un écrivain célèbre.
La structure du roman, articulée autour de différents narrateurs qui croisent la route de Swift, permet de disséquer la psychologie tortueuse du personnage sous des angles multiples. Tour à tour séducteur manipulateur avec Erich Ackermann, époux toxique avec Edith, père défaillant avec Daniel, Swift se révèle dans toute sa noirceur à travers le regard de ceux qu’il broie sur son passage. Seul Gore Vidal, dans un savoureux interlude en Italie, parvient à déjouer ses manœuvres et à percer à jour sa véritable nature.
Le roman pose avec acuité la question de l’origine de l’inspiration et de la propriété intellectuelle. Swift, écrivain talentueux mais dépourvu d’imagination, illustre de manière paroxystique la tentation du plagiat et du vol d’idées. Sa quête obsessionnelle de reconnaissance littéraire le pousse à franchir toutes les limites morales, dans une spirale de plus en plus destructrice.
En filigrane se dessine une satire mordante du milieu éditorial, de ses codes et de ses travers. Les enjeux de pouvoir, la course aux prix littéraires, les rivalités entre auteurs sont disséqués avec un humour corrosif. Boyne interroge également la notion de paternité, tant littéraire que biologique, à travers le désir paradoxal de Swift de devenir père.
Shortlisté pour le prix du roman de l’année aux Irish Book Awards 2018, « L’audacieux Monsieur Swift » confirme le talent de John Boyne pour créer des personnages complexes et mémorables. L’ouvrage s’inscrit dans une veine plus sombre que ses précédents romans comme « Les fureurs invisibles du cœur », tout en conservant sa virtuosité narrative. L’auteur s’est inspiré d’une expérience personnelle avec un aspirant écrivain qui s’était attaché à lui, qu’il transpose dans une fiction aux accents de thriller psychologique.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 512 pages.
6. Le syndrome du canal carpien (2021)
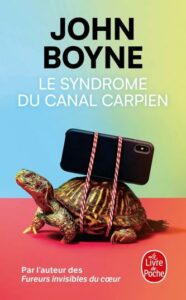
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Dans le Londres contemporain, la famille Cleverley règne sur les ondes et la littérature populaire. George, présentateur vedette de la BBC depuis trente ans, se considère comme un « trésor national ». Son épouse Beverley écrit des best-sellers à l’eau de rose – ou plutôt les fait écrire par des prête-plumes qu’elle maltraite. Leurs trois enfants vivent encore à la maison : Nelson, un professeur qui cache sa timidité maladive sous des déguisements, Elizabeth, une accro aux réseaux sociaux, et Achille, un séduisant lycéen qui extorque de l’argent à des hommes plus âgés.
Tout bascule quand George publie un tweet maladroit à propos d’une personne transgenre. En quelques heures, la meute des réseaux sociaux se déchaîne contre lui. Sa carrière s’effondre tandis que les secrets et mensonges de chaque membre de la famille remontent à la surface : l’amant ukrainien de Beverley, les trolls anonymes d’Elizabeth, les arnaques d’Achille. En cinq jours, l’empire Cleverley vacille.
Autour du livre
Satire de notre époque hyperconnectée, « Le syndrome du canal carpien » de John Boyne puise sa genèse dans une controverse. En 2019, l’auteur irlandais subit les foudres des réseaux sociaux suite à la publication de son roman « My Brother’s Name Is Jessica », accusé de « décentrer » et de « mal genrer » son personnage transgenre. Cette expérience traumatisante le pousse à abandonner sa plume habituellement sensible pour embrasser l’esprit caustique de Tom Sharpe.
Le roman s’ouvre sur une citation percutante d’Umberto Eco : « Les réseaux sociaux ont donné le droit de parole à des légions d’imbéciles qui, avant, ne parlaient qu’au bar, après un verre de vin et ne causaient aucun tort à la collectivité. » Cette épigraphe donne immédiatement le ton d’une comédie grinçante qui n’épargne personne. La structure narrative s’articule astucieusement autour de cinq journées décisives, ponctuées par des prologues qui coïncident avec la création des principaux réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et TikTok.
Le portrait au vitriol des Cleverley s’inscrit dans une tradition britannique de satire sociale, rappelant les œuvres de Saki, Evelyn Waugh ou Joseph Connolly. Les personnages, poussés jusqu’à la caricature, incarnent les travers d’une société obsédée par son image numérique. George, le patriarche, représente cette génération dépassée par les codes du « wokisme », tandis que sa fille Elizabeth personnifie la schizophrénie des réseaux sociaux à travers ses deux comptes Twitter antagonistes.
Cette famille dysfonctionnelle sert de prisme pour décortiquer les phénomènes contemporains : cancel culture, influenceurs, addiction aux likes, validation par les followers. Le titre original anglais « The Echo Chamber » s’avère d’ailleurs plus pertinent que sa traduction française, évoquant parfaitement cette chambre d’écho médiatique où les opinions se radicalisent.
L’humour, résolument british, oscille entre situations loufoques – comme cette tortue centenaire nourrie aux After Eight – et dialogues cinglants qui dénoncent l’hypocrisie d’une société où « les intentions ne comptent plus ». Les scènes s’enchaînent dans un rythme effréné, transformant progressivement la comédie de mœurs en farce sociale.
La parenté thématique avec « Le Voyant d’Étampes » d’Abel Quentin est frappante : tous deux mettent en scène un homme blanc vieillissant, traditionnellement de gauche, submergé par les nouvelles normes sociales véhiculées par les réseaux. Mais là où Quentin opte pour une approche plus nuancée, Boyne choisit délibérément l’excès et la provocation.
Par son ton irrévérencieux et sa critique acerbe du politiquement correct, « Le syndrome du canal carpien » marque une rupture significative dans la bibliographie de Boyne, plus connu pour des romans comme « Les fureurs invisibles du cœur » ou « Le garçon en pyjama rayé ». Cette métamorphose stylistique témoigne de la versatilité d’un romancier qui n’hésite pas à bousculer les attentes de son lectorat.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 640 pages.
7. Le garçon au sommet de la montagne (roman jeunesse, 2015)
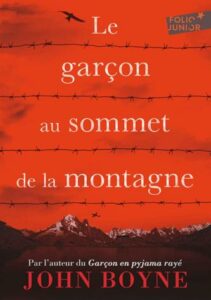
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Paris, 1936. Pierrot Fisher vit une enfance simple avec ses parents, sa mère française et son père allemand, ancien combattant traumatisé par la Grande Guerre. Son meilleur ami est Anshel, un petit garçon juif muet avec qui il communique en langue des signes. Mais sa vie bascule : son père se suicide, puis sa mère meurt de tuberculose. À sept ans, Pierrot devient orphelin.
Sa tante Beatrix, qu’il n’a jamais rencontrée, le recueille en Allemagne où elle travaille comme gouvernante au Berghof, la résidence secondaire d’Adolf Hitler dans les Alpes bavaroises. Pour s’intégrer, Pierrot doit changer son prénom en Pieter et oublier ses origines françaises. Au contact du Führer qui le prend sous son aile, le garçon timide et innocent se métamorphose peu à peu en un jeune nazi convaincu, prêt à trahir ses proches au nom de l’idéologie du Reich.
Autour du livre
Cette nouvelle incursion de John Boyne dans la période du nazisme adopte un angle singulier : plutôt que de dépeindre les victimes comme dans « Le garçon en pyjama rayé », il choisit de suivre la transformation d’un innocent en bourreau. Cette démarche audacieuse soulève des questions fondamentales sur la malléabilité de l’esprit humain et les mécanismes de l’endoctrinement.
L’originalité du texte réside dans sa capacité à montrer comment un enfant franco-allemand, initialement lié d’amitié avec un jeune juif sourd, peut basculer dans l’idéologie nazie. La métamorphose de Pierrot en Pieter se déroule dans un lieu hautement symbolique : le Berghof, résidence secondaire d’Hitler dans les Alpes bavaroises. Cette localisation isolée renforce l’aspect inquiétant de l’emprise exercée sur le protagoniste.
John Boyne excelle particulièrement dans la représentation des figures historiques qui gravitent autour du récit. Hitler apparaît sous un jour complexe : à la fois mentor attentionné envers Pierrot et tyran lunatique capable de basculer dans la violence. Des personnages comme le duc de Windsor, Wallis Simpson, Leni Riefenstahl ou encore Goebbels traversent les pages, ancrant solidement la fiction dans son contexte historique.
La particularité du « Garçon au sommet de la montagne » tient aussi à sa structure en trois parties distinctes, qui suivent l’évolution psychologique du personnage principal. Le contraste entre le Pierrot initial, empathique et sensible, et le Pieter final, imbu de lui-même et cruel, illustre avec force le pouvoir destructeur de l’idéologie totalitaire sur une personnalité en construction.
Si certains critiques soulignent que la fin du roman paraît précipitée, la plupart s’accordent sur la puissance du message véhiculé. La phrase clé « Ne fais jamais semblant de ne pas savoir ce qui se passait. Ce serait le pire des crimes » résonne comme un avertissement sur la responsabilité individuelle face aux atrocités collectives.
Recommandée aux lecteurs à partir de 12 ans, « Le garçon au sommet de la montagne » se distingue des autres romans jeunesse sur la Seconde Guerre mondiale par son refus du manichéisme. Il constitue un précieux outil pédagogique pour aborder en classe les mécanismes de l’embrigadement idéologique, tout en restant accessible aux adolescents sans sacrifier la complexité historique du sujet.
Aux éditions FOLIO JUNIOR ; 272 pages ; Dès 12 ans.
8. Mon père est parti à la guerre (roman jeunesse, 2014)
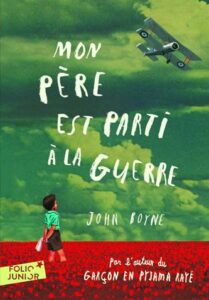
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Le 28 juillet 1914, Alfie Summerfield fête ses cinq ans le jour même où éclate la Première Guerre mondiale. Dans les rues de Londres, l’atmosphère change brutalement. Son père Georgie, malgré sa promesse de ne pas partir au front, s’engage dès le lendemain comme volontaire, persuadé que tout sera fini pour Noël.
Quatre ans plus tard, Alfie n’a plus de nouvelles. Sa mère prétend que Georgie est en mission secrète pour le gouvernement, mais le garçon de neuf ans n’est pas dupe. Pour aider sa famille, il devient cireur de chaussures à la gare de King’s Cross. C’est là qu’il découvre par hasard que son père n’est pas mort : il se trouve dans un hôpital psychiatrique, traumatisé par l’horreur des tranchées. Déterminé à le ramener à la maison, Alfie se lance dans une périlleuse mission de sauvetage.
Autour du livre
Publié en 2014 dans un contexte de commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale, ce récit de John Boyne s’éloigne des représentations traditionnelles du conflit pour en dévoiler des aspects moins connus. À travers le regard d’Alfie, jeune Londonien de 9 ans, se dessine une fresque sociale qui met en lumière les bouleversements provoqués par la guerre sur ceux qui restent.
« Mon père est parti à la guerre » aborde notamment le sort des objecteurs de conscience, ces hommes qui refusent de prendre les armes et subissent l’ostracisme de la société. Joe Patience, personnage emblématique du récit, incarne cette résistance pacifiste : « Je n’ai pas été mis au monde pour tuer mon prochain », déclare-t-il, tout en faisant face aux persécutions et à l’emprisonnement. Les femmes participent activement à cette stigmatisation en épinglant des plumes blanches sur les vêtements de ces hommes pour signifier leur prétendue lâcheté.
Le traumatisme psychologique des soldats constitue un autre thème central. À une époque où le stress post-traumatique n’est pas reconnu, les hommes qui en souffrent sont considérés comme des simulateurs ou des « fous ». Le père d’Alfie illustre tragiquement cette réalité méconnue de la Grande Guerre.
La xénophobie d’État trouve également sa place dans le récit à travers le sort réservé aux résidents d’origine étrangère. L’arrestation et la déportation sur l’île de Man de M. Janáček et sa fille Kalena, pourtant née en Angleterre, témoignent des dérives nationalistes du temps de guerre.
Les chapitres portent chacun le titre d’une chanson populaire de l’époque, une bande-son historique qui ancre le récit dans son contexte. Cette attention aux détails historiques n’empêche pas quelques anachronismes relevés par la critique, comme la mention d’émissions radio en 1914, alors que la BBC ne commence à émettre qu’en 1922.
Nominé pour le prix du meilleur livre jeunesse 2013 en Irlande (Irish Book Award Children’s Book of the Year), cet ouvrage s’inscrit dans la lignée du « Garçon en pyjama rayé » du même auteur, confirmation de son talent pour aborder les conflits historiques à hauteur d’enfant.
Aux éditions FOLIO JUNIOR ; 256 pages ; Dès 10 ans.