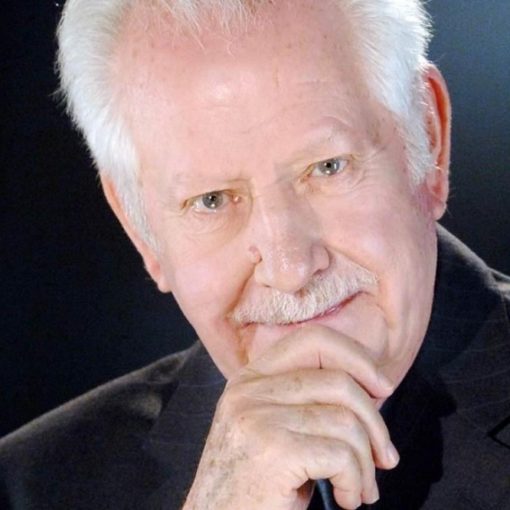Emmanuelle Pirotte, née le 1er novembre 1968, est une romancière, scénariste et historienne belge. Après avoir soutenu une thèse de doctorat à l’Université libre de Bruxelles en 1999 et travaillé dans la recherche au FNRS jusqu’en 2004, elle se tourne vers l’écriture de scénarios de documentaires et de fictions.
En 2015, elle fait une entrée remarquée sur la scène littéraire avec « Today we live », son premier roman traduit en quinze langues et récompensé par plusieurs prix dont le Prix Historia et le Prix Edmée-de-La-Rochefoucauld. Elle est depuis l’autrice de plusieurs romans dont « De Profundis » (2016), « Loup et les hommes » (2018) ou encore « Les Reines » (2022).
Voici notre sélection de ses romans majeurs.
1. Loup et les hommes (2018)
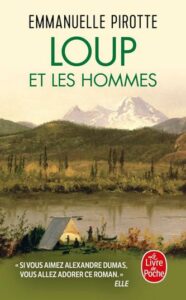
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Paris, hiver 1663. Le marquis de Canilhac mène une existence médiocre jusqu’au soir où il aperçoit, dans un salon, une jeune Amérindienne qui porte au cou un bijou qui lui est familier. Ce saphir appartenait à Loup, son frère adoptif qu’il a trahi vingt ans plus tôt et fait condamner aux galères. Sans nouvelles depuis, Armand le croit mort. Cette découverte bouleversante le pousse à embarquer pour la Nouvelle-France avec son valet Valère à la recherche de son frère.
Les longues journées en mer ravivent les souvenirs du Gévaudan natal. Armand se revoit enfant aux côtés de ce frère magnétique qui éclipsait tout le monde, même lui, l’héritier légitime. Loup incarnait les contradictions : protecteur et cruel, séduisant et brutal. Cette dualité avait nourri chez Armand un mélange toxique d’amour et de haine, puis une terrible trahison.
Sur les terres sauvages d’Iroquoisie, entre les conflits qui opposent Français, Anglais et tribus amérindiennes, Armand poursuit sa quête de rédemption. Il découvre un monde où s’entremêlent cruauté et spiritualité, où les « Robes noires » tentent d’évangéliser des peuples aux traditions millénaires.
Autour du livre
Dans son troisième opus publié en 2018, Emmanuelle Pirotte délaisse la Seconde Guerre mondiale de « Today we live » et la dystopie de « De Profundis » pour s’aventurer sur les traces d’Alexandre Dumas et Jack London. Ce changement radical de registre confirme sa capacité à se renouveler, tout en conservant la puissance narrative qui a fait le succès de ses précédents romans.
L’originalité de « Loup et les hommes » réside dans son traitement nuancé des relations fraternelles, loin des dichotomies simplistes. Le couple Armand-Loup incarne une complexité psychologique où l’admiration et la haine s’entremêlent jusqu’à la trahison. Cette ambivalence se retrouve dans leur statut respectif : Loup, l’enfant adopté rayonnant qui vole la vedette à Armand, l’héritier légitime condamné à vivre dans son ombre. La quête d’Armand prend alors les contours d’une double rédemption, personnelle et familiale.
Le choix du XVIIe siècle comme toile de fond permet à Emmanuelle Pirotte de tisser des parallèles saisissants entre le destin individuel des personnages et les bouleversements historiques. La colonisation de la Nouvelle-France devient le théâtre d’une confrontation entre deux visions du monde : celle des Européens, avides de conquêtes territoriales, et celle des peuples autochtones, en harmonie avec leur environnement. Cette opposition se matérialise notamment à travers le personnage de « Vieille Épée », un Blanc devenu Indien, qui symbolise la possibilité d’une autre voie.
Les personnages secondaires acquièrent une profondeur remarquable. Valère, le valet d’Armand surnommé par les Indiens « Celui-qui-n’aime-pas-les-Robes-Noires », transcende son statut social pour devenir une figure centrale. Sa découverte de lui-même au contact des Amérindiens illustre la dimension initiatique du récit. De même, Antoinette, l’une des « Filles du Roi » envoyées pour peupler la colonie, incarne la condition féminine de l’époque avec une force singulière : « Nous autres, Filles du roi, ne sommes ici qu’en tant que ventres sur pattes, destinés à porter de quoi peupler ce continent. »
La construction du récit alterne habilement entre le présent de la quête et les souvenirs d’enfance, créant un effet de miroir entre les deux époques. Cette structure permet de dévoiler progressivement les motivations profondes des personnages tout en maintenant le suspense sur le sort de Loup. L’immersion dans l’univers des tribus amérindiennes s’appuie sur une documentation historique méticuleuse, fruit du travail d’historienne de l’autrice.
« Loup et les hommes » s’inscrit dans la lignée du « Comte de Monte-Cristo » pour sa réflexion sur la jalousie et la vengeance, tout en développant sa propre vision des thèmes universels de la culpabilité et du pardon. La violence omniprésente – qu’elle soit physique ou psychologique – sert de révélateur aux personnages plutôt que de simple ressort dramatique. Son succès critique témoigne de la capacité d’Emmanuelle Pirotte à renouveler le genre du roman historique en y insufflant des préoccupations contemporaines, sans pour autant tomber dans l’anachronisme. Cette fresque de 600 pages a notamment séduit par son équilibre entre l’ampleur de la narration et la finesse de l’analyse psychologique.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 600 pages.
2. Today we live (2015)
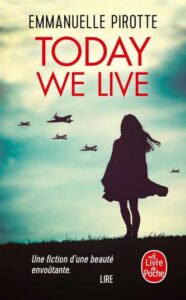
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Dans les Ardennes belges de l’hiver 1944, la contre-offensive allemande fait rage. Renée, une petite fille juive de sept ans, est confiée par un prêtre à deux soldats en uniforme américain. Mais ces hommes sont des agents nazis infiltrés dans les lignes ennemies. L’un d’eux, Mathias, est chargé d’abattre l’enfant. Au moment de commettre la funeste besogne, le regard de la fillette le fait cependant vaciller : il tue son complice, puis décide de la protéger.
Leur cavale les mène dans une ferme isolée où ils se cachent avec d’autres réfugiés. Mathias se fait passer pour un soldat canadien. Entre cet homme endurci par la guerre et la petite fille au courage stupéfiant naît un lien inexplicable. Mais le danger rôde : la ferme accueille successivement des troupes américaines puis allemandes, qui menacent de révéler leur secret à chaque instant.
Autour du livre
Premier roman d’Emmanuelle Pirotte, « Today we live » naît d’un scénario de film qui n’a jamais vu le jour. Cette genèse cinématographique imprègne la narration, avec des scènes qui se succèdent dans une tension palpable et une écriture très visuelle. L’action se déroule durant un épisode méconnu de la Seconde Guerre mondiale : l’opération Greif, menée par Otto Skorzeny, qui consistait à infiltrer des soldats allemands dans les rangs américains pour désorganiser les troupes alliées.
Le choix des Ardennes belges comme décor ne relève pas du hasard : cette région frontalière connaît en décembre 1944 une situation chaotique où les lignes entre amis et ennemis se brouillent. Les fermiers ne savent plus s’ils doivent craindre les Allemands en déroute ou les Américains nerveux qui pillent leurs réserves. De ce contexte trouble émerge le duo improbable de Mathias et Renée.
La construction des personnages principaux brille par sa complexité psychologique. Mathias incarne la dualité : ancien trappeur du Grand Nord canadien devenu machine à tuer de la SS, il porte en lui la sauvagerie des grands espaces et la brutalité militaire. Son geste salvateur envers Renée ne découle pas de la pitié mais d’une reconnaissance instinctive, presque animale. Sa nature même se fissure sous l’influence de cette enfant qui réveille son humanité enfouie.
Renée, elle, transcende le stéréotype de l’enfant juive persécutée. Sa maturité exceptionnelle pour ses sept ans ne verse jamais dans l’invraisemblance : elle découle de sa trajectoire de survie, ballottée de famille en famille. Sa force réside dans sa capacité à lire les âmes, à percevoir par-delà les apparences. Le doudou de chiffon qu’elle serre contre elle, seul vestige de sa mère, rappelle sa vulnérabilité d’enfant malgré sa lucidité précoce.
Dans la cave de la ferme des Paquet où se réfugient Mathias et Renée, le huis clos fait ressortir la véritable nature de chacun. Les personnages secondaires incarnent différentes facettes de l’humanité en temps de guerre : la lâcheté des délateurs, le courage tranquille des justes, l’opportunisme des survivants. Certains soldats américains se révèlent brutaux tandis que des Allemands manifestent une humanité inattendue.
La particularité de « Today we live » réside ainsi dans son refus du manichéisme. Les relations entre les personnages se tissent dans les zones grises de la guerre, là où les étiquettes de « bons » et « méchants » perdent leur sens. Le texte s’enrichit de touches de wallon dans les dialogues, ancrant l’histoire dans son terroir tout en lui conférant une authenticité supplémentaire.
Cette fable sur l’humanité en temps de guerre a reçu le Prix Edmée de la Rochefoucauld et le Prix Historia. Elle a également connu une diffusion internationale avec des traductions dans quinze langues. Une adaptation cinématographique pourrait voir le jour prochainement.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 224 pages.
3. Flamboyant crépuscule d’une vieille conformiste (2024)
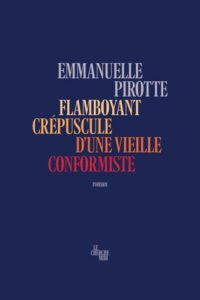
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Dans ce roman d’Emmanuelle Pirotte, nous suivons les trois derniers jours d’une octogénaire belge, Dominique Biron. Cette bourgeoise « bien comme il faut » vient d’apprendre qu’elle souffre de la maladie d’Alzheimer. Elle refuse catégoriquement cette « mort à petit feu » et planifie son suicide pour le mercredi suivant, à 20 heuses précises.
L’annonce de la maladie agit comme un détonateur. Durant ce court délai, cette « vieille conformiste » autoproclamée laisse libre cours à ses pensées les plus acerbes. Sans filtre, elle dresse le bilan de son existence étriquée aux côtés d’un mari insipide. Elle dit enfin ses quatre vérités à ses enfants, à son entourage. Seules sa fille Dorothée, morte d’un cancer, et sa petite-fille Victoire trouvent grâce à ses yeux.
Autour du livre
Emmanuelle Pirotte inscrit son septième roman dans une actualité brûlante, celle de la crise du Covid, pour aborder des sujets sociétaux forts : la place des personnes âgées dans nos sociétés, la fin de vie choisie, la maladie d’Alzheimer. À travers le monologue sans concession de Dominique Biron, octogénaire bourgeoise qui décide de mettre fin à ses jours, se dessine une critique acerbe de la bourgeoisie belge et de ses codes étriqués.
Cette confession d’une femme qui n’a pas su ou pas osé vivre pleinement prend la forme d’une tragi-comédie où l’humour noir le dispute à l’émotion. Le choix d’un format en trois parties – « Lundi », « Mardi », « Mercredi » – structure ce compte à rebours macabre mais libérateur. La chronologie, bousculée par les souvenirs désordonnés de Dominique, traduit les premiers effets d’Alzheimer tout en conservant une cohérence narrative portée par le présent des trois derniers jours.
La dimension théâtrale du texte, qui pourrait aisément devenir un one-woman-show, s’incarne dans les interpellations directes au lecteur et les dialogues que Dominique entretient avec elle-même. Cette mise en scène de l’intime permet d’éviter l’écueil du pathos malgré la gravité du sujet. La protagoniste tranche avec les figures convenues de vieilles dames : ni totalement Tatie Danielle, ni complètement « vieille dame indigne », elle compose un personnage complexe qui reconnaît ses torts et ses faiblesses.
Emmanuelle Pirotte interroge la transmission entre générations, incarnée par le trio Dominique-Dorothée-Victoire. La fille décédée et la petite-fille représentent ce que Dominique aurait pu être : libres, cultivées, authentiques. Cette relation privilégiée avec Victoire, seul personnage à trouver grâce aux yeux de la narratrice avec le chat errant qu’elle recueille, offre les passages les plus émouvants du livre.
La musique occupe une place centrale dans ce récit qui convoque aussi bien Jimmy Fontana que Kurt Cobain. Ces références musicales éclectiques révèlent une sensibilité artistique insoupçonnée chez cette « bourgeoise conformiste ». De même, sa lecture passionnée des « Cendres d’Angela » de Frank McCourt suggère une soif de culture réprimée par son milieu social.
« Flamboyant crépuscule d’une vieille conformiste » s’inscrit dans une réflexion plus large sur l’euthanasie et le droit de mourir dans la dignité. Même en Belgique où la législation paraît plus avancée qu’en France sur ce sujet, la question reste complexe comme en témoigne le choix de Dominique d’agir seule et en secret. Son refus de la déchéance fait écho aux débats actuels sur la fin de vie.
La force du roman réside dans sa capacité à traiter de sujets graves – la vieillesse, la solitude, la mort – avec une légèreté qui n’enlève rien à leur profondeur. L’humour corrosif de Dominique n’épargne personne, pas même elle-même : « Je suis désolée. Entre votre père et moi, c’était aussi rasoir qu’un spectacle d’école quand vos enfants ne sont pas dedans. » Cette autodérision constante permet d’aborder frontalement la question du conformisme social et de ses conséquences sur une vie.
« Flamboyant crépuscule d’une vieille conformiste » confirme la singularité d’Emmanuelle Pirotte dans le paysage littéraire contemporain. Historienne et scénariste, elle continue d’explorer des territoires différents à chaque livre, refusant de se cantonner à un genre ou une époque. Après le roman historique « Today we live », la dystopie « De Profundis », ou encore « Les Reines », elle livre ici un texte d’une actualité saisissante qui questionne notre rapport à la vieillesse et à la mort.
Aux éditions CHERCHE MIDI ; 160 pages.
4. Rompre les digues (2021)
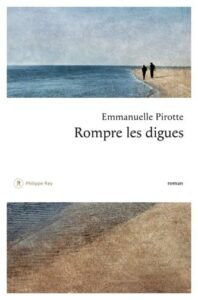
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Sur la côte belge d’Ostende, Renaud traîne sa mélancolie dans une immense demeure bourgeoise. Ce quinquagénaire fortuné cherche l’oubli dans la cocaïne et les visites régulières d’une prostituée moldave. Son existence se partage entre ses amis écorchés – François, un chômeur inconsolable depuis la mort de sa femme, et Brigitte, une militante humanitaire qui trouve refuge dans l’aide aux migrants – les virées chez sa tante excentrique en Angleterre, et les rendez-vous périlleux avec Tarik, son dealer.
La mort de sa vieille gouvernante bouleverse ce quotidien morose. Renaud engage alors Teodora, une jeune Salvadorienne au passé trouble qui a fui son pays. Dans cette demeure peuplée d’œuvres d’art et de silences, une relation ambiguë se tisse peu à peu entre ces deux êtres blessés.
Autour du livre
Dans ce cinquième opus, Emmanuelle Pirotte délaisse les territoires historiques qui ont fait sa renommée pour s’ancrer dans le présent, sous les ciels bas d’Ostende. L’écrivaine belge, qui s’était jusqu’alors attachée à dépeindre la Seconde Guerre mondiale (« Today we live »), une pandémie (« De Profundis »), la colonisation des Indiens au XVIe siècle (« Loup et les hommes ») ou encore l’épidémie de peste à Londres (« D’innombrables soleils »), sonde maintenant les fractures de notre monde contemporain.
La force de « Rompre les digues » réside dans sa capacité à transcender les barrières sociales pour tisser des liens improbables entre des êtres que tout semble opposer. Le texte pulse au rythme des contradictions de ses personnages : Renaud, héritier fortuné consumé par l’ennui, trouve son salut auprès d’une prostituée slave tandis que François, son ami d’enfance désargenté, cherche l’oubli dans des cours de tango. Cette galerie de portraits s’enrichit de Brigitte, militante humanitaire qui délaisse sa propre fille pour s’occuper des migrants, et de Teodora, Salvadorienne au passé trouble venue s’échouer sur les rivages belges.
La mélancolie qui baigne le récit se teinte d’une causticité mordante quand il s’agit de dépeindre l’insolence des nantis ou la vanité de leurs occupations. Les dialogues alternent entre crudité et poésie, tandis que l’humour vient régulièrement percer la grisaille ostendaise. Cette atmosphère si particulière rappelle les chansons de Jacques Brel, qui hantent d’ailleurs les pages du livre, donnant à l’ensemble une bande-son aussi nostalgique qu’ironique.
Plus qu’une simple critique sociale, le texte interroge la possibilité de trouver sa place dans un monde en déséquilibre. La solitude – morale et physique – traverse les pages comme un fil rouge, reliant ces êtres cabossés par l’existence. Pourtant, au cœur de ce tableau sombre, des éclats de lumière surgissent, portés par l’excentrique tante Clarisse qui tisse patiemment des liens entre ces âmes égarées.
Sans jamais tomber dans le pathos, Emmanuelle Pirotte manie l’art du contraste avec une habileté remarquable. Sa plume acérée dissèque les rapports humains sans concession, tout en préservant une forme de tendresse pour ses personnages les plus antipathiques. Même Renaud, dans son cynisme et son autodérision, conserve une part d’humanité qui le rend étrangement attachant.
Les thématiques contemporaines – migration, inégalités sociales, quête de sens – s’entrelacent naturellement dans la trame narrative sans jamais alourdir le propos. Emmanuelle Pirotte évite les écueils du roman à thèse pour privilégier la complexité des relations humaines et leurs paradoxes. La structure même du récit, avec ses allers-retours entre différents points de vue, reflète la fragmentation d’une société où les repères traditionnels s’effritent.
Ce changement radical de registre par rapport à ses œuvres précédentes confirme la polyvalence d’Emmanuelle Pirotte. L’écrivaine démontre sa capacité à saisir les nuances de notre époque avec la même acuité qu’elle appliquait aux périodes historiques. Son regard sur la société contemporaine s’avère aussi incisif que sa lecture du passé, créant des résonances troublantes avec l’actualité, notamment dans le traitement des questions migratoires et des fractures sociales exacerbées par les crises récentes.
Aux éditions PHILIPPE REY ; 267 pages.
5. Les Reines (2022)
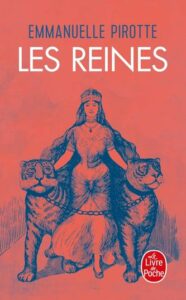
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Cinq siècles après l’effondrement de notre civilisation, les femmes ont pris le pouvoir. Dans ce monde revenu à un mode de vie rustique, elles règnent désormais en souveraines absolues sur des territoires morcelés, tandis que les hommes sont relégués au rang d’esclaves ou de reproducteurs. Seuls les Gypsies, peuples nomades, maintiennent encore une forme d’égalité entre les sexes.
Parmi eux, Milo et Faith s’aiment depuis l’enfance. Mais leur passion est interdite par les lois de leur clan, les Britannia. Après une trahison de Faith, Milo est banni et commence une longue errance à travers les terres glacées du Nord. Son périple le mène jusqu’au royaume d’Edda, une reine cruelle des Amazones, et sur l’île où vit Alba, une mystérieuse prophétesse qui détient peut-être la clé de ses origines.
Autour du livre
Publié dans la collection Cobra du Cherche Midi, « Les Reines » marque une rupture dans la bibliographie d’Emmanuelle Pirotte. L’historienne belge, connue pour son best-seller « Today we live » couronné par le Prix Historia et traduit en quinze langues, s’aventure pour la première fois dans les territoires de l’anticipation et du mythe. Cette incursion dans un autre genre littéraire ne sacrifie rien à la puissance narrative qui caractérise ses précédents romans.
Dans ce monde post-effondrement, cinq cents ans après la Chute, la société s’est reconstruite sur des bases radicalement différentes. Les survivants, réduits à une poignée d’âmes, ont renoncé aux progrès technologiques jugés responsables de leur quasi-extinction. Cette régression volontaire s’accompagne d’un renversement complet de l’ordre social : le matriarcat succède au patriarcat. Les reines gouvernent désormais les royaumes, tandis que les hommes se trouvent relégués au rang d’esclaves ou de reproducteurs.
La singularité de cette dystopie réside dans son refus de l’utopie féministe. Le pouvoir corrompt indifféremment hommes et femmes. Les reines reproduisent les mêmes schémas de domination qu’elles dénonçaient autrefois. Le titre prend alors une résonance ironique : ces souveraines ne valent pas mieux que leurs prédécesseurs masculins. À travers ce miroir inversé, Emmanuelle Pirotte soulève des questions fondamentales sur la nature même du pouvoir et ses effets délétères.
La structure narrative alterne entre deux fils conducteurs principaux. D’un côté, le périple de Milo et Faith, couple maudit issu de la tribu nomade des Britannia. De l’autre, les confessions d’Alba, ancienne reine devenue oracle, qui livre ses réflexions sur la nature humaine depuis son île battue par les vents. Cette construction en miroir permet d’articuler l’intime et le politique, le destin individuel et les bouleversements collectifs.
Le théâtre occupe une place centrale dans cette fresque. Les personnages jouent Shakespeare, notamment « Othello », relu comme un « plaidoyer contre la tyrannie des hommes ». Ces représentations théâtrales font écho aux passions qui agitent les protagonistes. La dramaturgie imprègne l’ensemble des pages, qui emprunte aux codes de la tragédie antique : prophéties, filiations cachées, vengeances, destins contrariés.
L’influence des grands récits fondateurs transparaît également dans le traitement des figures féminines. Edda, reine des Amazones, rappelle les mythes grecs. Alba évoque les prophétesses antiques. Faith, par son tempérament impétueux et ses actions aux conséquences funestes, s’inscrit dans la lignée des héroïnes tragiques. Les personnages masculins ne sont pas en reste. Milo incarne la figure du héros errant, banni de sa communauté. Son parcours initiatique croise celui de Novak, personnage transgenre qui transcende les catégories de genre imposées par ce nouvel ordre social.
Premier titre d’Emmanuelle Pirotte dans la collection Cobra, « Les Reines » répond parfaitement à l’ambition éditoriale affichée : renouer avec le « merveilleux » et la « démesure » du roman. Cette épopée de plus de cinq cents pages mêle avec audace les genres littéraires, de la dystopie au mythe en passant par la tragédie.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 528 pages.
6. D’innombrables soleils (2019)
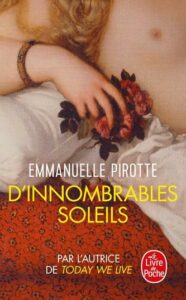
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Angleterre, mai 1593. Le dramaturge Christopher Marlowe, figure majeure du théâtre élisabéthain, est laissé pour mort après une rixe dans une taverne de Deptford. Son ami Walter le recueille dans son manoir isolé où il vit avec sa femme Jane. Entre Marlowe et Jane naît aussitôt une attirance irrépressible, qui se mue en passion dévorante.
Sous la plume d’Emmanuelle Pirotte, cette liaison impossible prend une tournure singulière : Christopher Marlowe, homosexuel notoire qui méprisait jusque-là les femmes, est chamboulé par des sentiments qu’il n’aurait jamais cru éprouver. Dans l’intimité du manoir, les deux amants se rapprochent dans une ardeur à la fois charnelle et intellectuelle, sous le regard impuissant de Walter.
Autour du livre
Dans son quatrième livre, Emmanuelle Pirotte s’empare d’une énigme historique qui entoure la mort du dramaturge Christopher Marlowe pour tisser une fresque où s’entremêlent création artistique et passion charnelle. Cette incursion dans l’Angleterre élisabéthaine se distingue radicalement de ses œuvres précédentes comme « Today we live », « De Profundis » ou « Loup et les hommes », témoignant d’une volonté constante de renouvellement.
L’intrigue prend racine dans les zones d’ombre qui persistent autour de la mort supposée de Marlowe le 30 mai 1593. Si les archives officielles attestent de son décès lors d’une rixe dans une taverne de Deptford, certains historiens remettent en question cette version des faits. Cette incertitude historique devient le terreau fertile d’une fiction qui métamorphose un fait divers en une réflexion sur l’art, le désir et la transgression des normes sociales.
La singularité de cette œuvre tient notamment dans le renversement inattendu qu’elle opère : Marlowe, figure notoirement homosexuelle de son vivant – celui qui aurait déclaré que « celui qui n’aime ni le tabac ni les garçons rate quelque chose » – se trouve submergé par une attirance irrépressible pour une femme. Cette subversion des codes permet d’interroger la nature même du désir, tout en brossant le portrait d’une époque où l’homosexualité constituait un motif de pendaison.
Le personnage de Jane émerge comme une figure d’émancipation féminine avant-gardiste. Loin des représentations conventionnelles de la femme élisabéthaine, elle s’affirme comme une créatrice à part entière, transcendant sa condition par l’écriture. Sa relation avec Marlowe catalyse son éveil artistique, faisant d’elle non pas une simple muse mais une véritable partenaire intellectuelle.
Le contexte historique imprègne chaque page sans jamais verser dans la reconstitution pesante. L’Angleterre de 1593 y palpite avec ses contradictions : la peste qui ravage Londres, le puritanisme ambiant, les intrigues de cour, les soupçons d’espionnage qui planent sur Marlowe. Cette toile de fond sert de caisse de résonance aux thématiques universelles que sont la création artistique, la liberté individuelle, la quête d’authenticité.
L’érotisme qui parcourt le texte ne verse jamais dans la gratuité : il participe d’une réflexion plus large sur la création artistique et la transgression des normes sociales. Les scènes charnelles s’entrelacent avec les moments d’écriture, suggérant une symbiose entre le corps et l’esprit créateur. Cette dimension érotique divise d’ailleurs la réception critique : certains lecteurs y voient une célébration nécessaire de la sensualité quand d’autres y perçoivent une accumulation excessive.
« D’innombrables soleils » constitue ainsi une méditation sur la fugacité du temps et l’urgence de créer. Le titre lui-même, tiré d’une réplique du livre, évoque la multiplicité des mondes possibles et l’infinité des destins qui s’offrent à chacun. Cette œuvre s’inscrit dans la lignée des grands romans historiques qui utilisent le passé comme un miroir tendu au présent.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 240 pages.
7. De Profundis (2016)
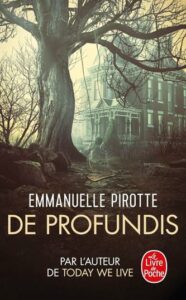
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Dans un futur proche, Bruxelles suffoque sous l’épidémie d’Ebola III. La ville sombre dans le chaos : hôpitaux débordés, électricité rationnée, pillages quotidiens. Roxanne y survit grâce au trafic de médicaments frelatés. Cette trentenaire au passé trouble n’attend plus rien de la vie.
Un jour, son ex-mari succombe au virus. Il lui confie leur fille Stella, une enfant de huit ans qu’elle avait abandonnée à la naissance. La petite, presque mutique, semble imperméable aux émotions. Quand des pillards assassinent leur voisine, Roxanne décide de fuir la capitale avec sa fille vers une maison familiale isolée dans la campagne namuroise.
Mais l’exil rural n’apporte pas la paix espérée. Entre une communauté villageoise méfiante et la présence d’une entité surnaturelle dans la demeure, mère et fille devront apprendre à coexister dans ce monde dévasté.
Autour du livre
Publié en 2016 aux éditions Le Cherche Midi, « De Profundis » dépeint une Belgique ravagée par une mutation du virus Ebola. Le choix de situer l’action à Bruxelles plutôt que dans les métropoles habituelles du genre post-apocalyptique (Paris, New York, Londres) insuffle une originalité certaine au récit. Cette singularité géographique s’accompagne d’un ancrage culturel fort avec l’utilisation du wallon et des références locales qui renforcent l’authenticité du propos.
La construction narrative en deux temps marque une rupture nette dans le ton et l’ambiance. D’abord immergé dans une dystopie urbaine où règnent violence et chaos, le lecteur bascule sans transition vers un récit aux accents fantastiques dans une campagne namuroise isolée. Cette dichotomie ville/campagne ne se résume pas à une simple opposition entre deux univers : elle révèle la complexité d’une société en déliquescence où la barbarie prend des visages multiples, des gangs urbains aux communautés rurales repliées sur elles-mêmes.
L’écriture, influencée par le métier de scénariste d’Emmanuelle Pirotte, découpe l’action en séquences nettes qui s’enchaînent avec la précision d’un montage cinématographique. Cette construction par tableaux successifs renforce l’intensité dramatique tout en évitant l’écueil d’une narration trop didactique.
Au cœur de cette structure se trouve la relation complexe entre Roxanne et sa fille Stella. Le personnage de Roxanne bouscule les archétypes de l’héroïne post-apocalyptique et de la figure maternelle. Dealeuse de médicaments frelatés dénuée d’instinct maternel, elle incarne une anti-héroïne qui refuse les compromis moraux faciles. Sa fille Stella, enfant mutique aux comportements énigmatiques, crée un contrepoint silencieux mais puissant à la violence environnante.
L’irruption du surnaturel dans la seconde partie, à travers la présence d’un esprit médiéval hantant la demeure familiale, établit un parallèle saisissant entre deux époques marquées par les épidémies et la violence. Cette mise en perspective historique suggère une réflexion sur la cyclicité des catastrophes humaines et naturelles.
La dimension prophétique du texte n’échappe pas aux lecteurs contemporains : écrit en 2015, « De Profundis » préfigure avec une acuité troublante certains aspects de la pandémie de Covid-19, notamment dans sa description des funérailles contraintes et des comportements sociaux en temps de crise sanitaire.
Le mélange des genres – dystopie, conte fantastique, thriller – qui déroute certains lecteurs, participe d’une volonté de décloisonnement littéraire. Cette hybridation générique reflète la confusion d’un monde où les repères traditionnels s’effondrent. L’alternance entre violence crue et moments de grâce poétique compose une partition dissonante qui fait écho au chaos décrit.
Emmanuelle Pirotte s’inscrit dans une tradition littéraire qui utilise l’anticipation comme miroir critique de la société contemporaine, tout en renouvelant les codes du genre par un traitement original. Son approche évite les écueils du catastrophisme simpliste pour proposer une réflexion nuancée sur la nature humaine face à l’effondrement des structures sociales.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 312 pages.