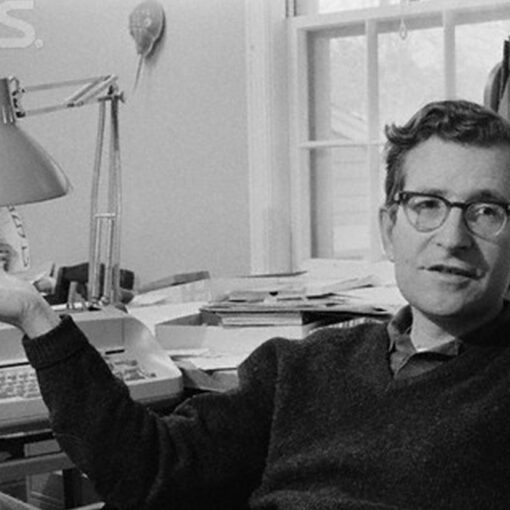David Vann est un écrivain américain né le 19 octobre 1966 sur l’île Adak en Alaska. Aventurier dans l’âme, il a parcouru plus de 40 000 milles en mer et tenté un tour du monde en solitaire.
Son parcours littéraire débute véritablement avec « Sukkwan Island » (2009), écrit en 17 jours lors d’un voyage en mer mais qui mettra 12 ans à trouver un éditeur. Le livre connaît finalement un immense succès en France, où il reçoit le prix Médicis étranger en 2010.
Auteur de plusieurs romans dont « Désolations » (2011) et « Un poisson sur la Lune » (2019), il partage aujourd’hui son temps entre la Nouvelle-Zélande où il vit et l’Angleterre où il enseigne la littérature.
Voici notre sélection de ses romans majeurs.
1. Sukkwan Island (2009)
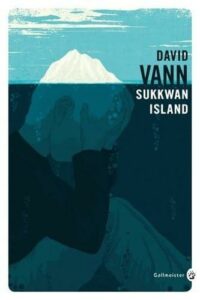
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Dans le sud-est de l’Alaska se trouve Sukkwan Island, une île sauvage uniquement accessible par hydravion. C’est là que Jim, un dentiste qui vient de divorcer pour la deuxième fois, décide d’emmener son fils Roy, treize ans, pour y vivre une année entière. Il a acheté une cabane isolée et rêve de prendre un nouveau départ tout en renouant avec ce garçon qu’il connaît à peine. Mais dès leur arrivée, rien ne se passe comme prévu : la cabane est vétuste, les provisions insuffisantes et Jim s’avère totalement inadapté à la vie en autarcie.
Les jours passent et la situation empire. Roy observe avec inquiétude son père pleurer chaque nuit, submergé par ses échecs personnels. Les rôles s’inversent : l’adolescent devient celui qui organise la survie quotidienne pendant que son père sombre dans la dépression. Face à cette nature hostile et à l’hiver qui approche, leur séjour se transforme peu à peu en cauchemar, jusqu’à un événement brutal qui va tout faire basculer.
Autour du livre
Premier roman de David Vann publié aux États-Unis en 2009, « Sukkwan Island » puise sa source dans un drame familial : lorsque l’auteur avait 13 ans, son père l’invita à passer une année avec lui en Alaska. Suite à son refus, son père se donna la mort quinze jours plus tard. Il faudra dix ans à David Vann pour mettre en mots cette blessure intime, imaginant le scénario inverse où l’adolescent aurait accepté la proposition paternelle.
Couronné par le prix Médicis étranger en 2010, ce texte initialement paru dans le recueil « Legend of a Suicide » se démarque par sa construction en diptyque, avec un basculement brutal au milieu du récit. La première partie suit le point de vue de Roy, le fils de 13 ans qui observe les défaillances de son père Jim avec une maturité précoce. La seconde partie adopte la perspective de Jim après un événement traumatique, dans une spirale d’isolement et de folie.
L’environnement hostile de l’Alaska, avec ses forêts denses et ses montagnes escarpées, ne constitue pas qu’un simple décor mais devient un personnage à part entière qui révèle la fragilité des protagonistes. Le huis clos entre père et fils dans cette nature sauvage met en lumière l’inversion des rôles : l’adolescent endosse une responsabilité d’adulte face à un père instable qui passe ses nuits à sangloter.
« Sukkwan Island » transpose aussi la culpabilité de l’auteur en la transférant symboliquement sur le père. Cette catharsis littéraire a permis à David Vann de se libérer de ses démons, comme il le confie dans la postface. En 2014, le roman a été adapté en bande dessinée par Ugo Bienvenu aux éditions Denoël Graphic, sélectionnée au Festival d’Angoulême 2015.
Delphine de Vigan salue dans sa préface à la réédition de 2020 le « phénoménal changement de point de vue » qui donne toute sa force au récit. Les éditions Gallmeister ont également publié conjointement un recueil de nouvelles intitulé « Le bleu au-delà », dont les textes gravitent autour de l’univers de « Sukkwan Island », élargissant ainsi la portée de cette oeuvre fondatrice qui a révélé David Vann comme l’une des voix majeures de la littérature américaine contemporaine.
Aux éditions GALLMEISTER ; 208 pages.
2. Désolations (2011)
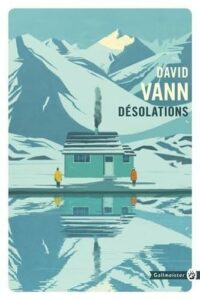
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Sur les rives d’un lac glaciaire en Alaska, Gary et Irene ont vécu trente ans d’une existence sans éclat. À l’heure de la retraite, Gary décide de concrétiser son rêve : construire une cabane en rondins sur Caribou Island, un îlot au milieu du lac. Malgré les migraines qui l’assaillent et son peu d’enthousiasme pour ce projet, Irene suit son mari. Elle craint qu’il ne l’abandonne si elle refuse.
Tandis que l’hiver s’installe, le couple s’enlise dans la construction hasardeuse de cette cabane. Les reproches et les rancœurs accumulés depuis des décennies remontent à la surface. Leur fille Rhoda, qui vit en ville avec un dentiste plus âgé qu’elle, observe avec inquiétude la dégradation de la relation entre ses parents. Son frère Mark, lui, préfère rester à l’écart.
Autour du livre
La genèse de « Désolations » puise dans la propre histoire de David Vann, né dans une île au large de l’Alaska. Il a rédigé ce texte en à peine cinq mois et demi, après l’avoir débuté quatorze ans plus tôt sans parvenir à le terminer. Cette genèse chaotique fait écho aux tourments des protagonistes, notamment Gary qui accumule les projets inaboutis.
La force du texte réside dans sa capacité à tisser une toile étouffante entre plusieurs couples qui se font écho : Gary et Irene, leur fille Rhoda et Jim, Mark et Karen, Carl et Monique. Leurs trajectoires s’entrecroisent et se répondent, dessinant une cartographie des solitudes modernes. La construction de la cabane sur Caribou Island devient ainsi une métaphore de l’échec programmé de ces relations bancales.
La critique littéraire a salué ce roman comme l’égal, voire le dépassement, de « Freedom » de Jonathan Franzen. The Irish Independent n’hésite pas à qualifier David Vann de « grand romancier américain ». Le Washington Post souligne la maîtrise avec laquelle l’auteur manie les codes de la tragédie grecque, créant une tension insoutenable jusqu’au dénouement final.
Une particularité formelle notable : l’absence de guillemets dans les dialogues, qui contribue à créer une impression de flou entre la réalité et les perceptions déformées des personnages. Cette technique narrative renforce l’atmosphère claustrophobe du récit.
« Désolations » s’inscrit dans la tradition du « nature writing » américain, mais en subvertit les codes. Là où cette littérature célèbre habituellement la communion avec la nature, Vann montre au contraire comment le paysage grandiose de l’Alaska peut devenir le théâtre d’une aliénation profonde. « L’Alaska ressemblait à la fin du monde, un lieu d’exil. Ceux qui ne trouvaient pas leur place ailleurs venaient ici, et s’ils ne s’ancraient nulle part, ils tombaient simplement dans le vide ».
« Désolations » a consolidé la réputation de Vann comme l’une des voix majeures de la littérature américaine contemporaine. Le Paris Review l’a désigné comme son roman préféré des dernières années, tandis que le San Francisco Chronicle y voit « une déflagration d’une rare puissance émotionnelle ».
Aux éditions GALLMEISTER ; 304 pages.
3. Un poisson sur la Lune (2019)
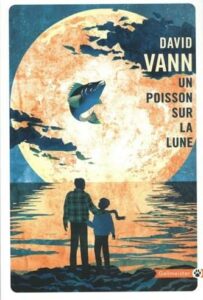
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
À la fin des années 1970, Jim Vann, un dentiste de 39 ans installé en Alaska, retourne en Californie pour quelques jours. Divorcé deux fois, criblé de dettes, il souffre d’une profonde dépression. Son frère Doug l’accueille à l’aéroport avec une mission : ne jamais le laisser seul, car Jim ne pense qu’à mourir. Dans sa valise, un Magnum attend son heure.
Pendant ces quelques jours, Jim rend visite à ses enfants David et Cheryl, à ses parents, à son ex-femme. Il consulte aussi un psychiatre. Mais rien ne semble pouvoir le retenir à la vie. Entre accès d’euphorie et phases sombres, Jim oscille dangereusement. Son obsession pour Jeannette, sa dernière compagne qui l’a quitté, le ronge. Les nuits sans sommeil s’enchaînent. Sa famille tente tout pour le sauver, en vain.
Autour du livre
Un authentique exercice de reconstruction s’opère dans ce texte où David Vann ose affronter le traumatisme fondateur de son existence : le suicide de son père survenu alors qu’il n’avait que treize ans. La narration se déploie dans une tension constante entre fiction et réalité – les personnages portent leurs véritables noms, les lieux sont authentiques, seuls les dialogues relèvent de l’imagination.
Cette immersion dans l’esprit tourmenté de Jim Vann pendant ses derniers jours révèle une maîtrise narrative impressionnante. La conscience du père se manifeste dans toute sa complexité : phases d’euphorie maniaque alternant avec des périodes d’abattement profond, obsessions sexuelles compulsives, ruminations incessantes sur l’échec de ses mariages. Le texte ne tombe jamais dans le pathos malgré la gravité du sujet – des touches d’humour noir ponctuent même le récit.
La dimension autobiographique confère une puissance particulière à ce « Poisson sur la Lune ». Le jeune David, alter ego de l’auteur, apparaît comme témoin impuissant du naufrage paternel. Cette présence discrète mais cruciale rappelle constamment le prix émotionnel qu’a dû coûter l’écriture de ce livre. La scène poignante où Jim raconte à ses enfants l’histoire du flétan envoyé sur la Lune illustre de manière métaphorique sa propre tragédie – celle d’un homme qui ne trouve plus sa place nulle part.
David Vann pose aussi un regard acéré sur l’Amérique profonde, ses tabous et ses démons. La présence constante des armes à feu, acceptée comme normale, devient le symbole d’une violence latente. La religion luthérienne et le conformisme social étouffant sont également questionnés à travers le prisme de la dérive mentale du protagoniste.
L’impuissance des proches face à la maladie mentale constitue un autre axe majeur du récit. Le frère Doug, en particulier, incarne cette volonté désespérée de sauver quelqu’un qui ne veut plus être sauvé. Ses efforts touchants mais vains soulignent la solitude fondamentale du dépressif.
La dimension cathartique de l’œuvre transparaît dans sa construction même. En redonnant vie à son père à travers l’écriture, David Vann accomplit un travail de deuil et de compréhension. Cette quête de sens face à l’incompréhensible donne au texte sa force universelle, dépassant le cadre strict de l’autobiographie.
Les critiques saluent unanimement la puissance émotionnelle du livre, qui s’inscrit dans la lignée des précédents romans de Vann comme « Sukkwan Island » ou « Désolations », également centrés sur des drames familiaux. « Un poisson sur la Lune » marque cependant une étape nouvelle dans son œuvre par son caractère plus directement personnel.
Aux éditions GALLMEISTER ; 320 pages.
4. Aquarium (2016)
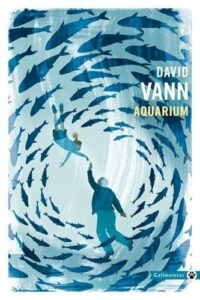
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Dans la grisaille de Seattle, Caitlin, une adolescente de douze ans, passe ses après-midi à l’aquarium municipal. C’est son refuge, loin de l’appartement exigu qu’elle partage avec sa mère célibataire Sheri, qui s’épuise dans un travail physique sur les docks pour leur assurer un avenir meilleur. Un jour, elle y rencontre un vieil homme qui semble partager sa passion pour le monde sous-marin. Une complicité naît entre eux, jusqu’à ce qu’il exprime le désir de rencontrer sa mère.
Cette simple requête fait voler en éclats l’équilibre précaire de leur existence. Car cet inconnu n’en est pas un : c’est le père de Sheri, qui l’a abandonnée enfant au moment où elle avait le plus besoin de lui. La rage refoulée de Sheri explose alors avec une force destructrice. Elle soumet Caitlin à un véritable calvaire psychologique pour la punir d’avoir renoué avec ce grand-père dont elle ne peut tolérer le retour.
Autour du livre
Cinquième roman de David Vann, « Aquarium » marque une évolution dans son écriture. Le romancier s’éloigne des espaces sauvages d’Alaska qui caractérisaient ses œuvres précédentes pour s’ancrer dans l’urbanité de Seattle. Pour la première fois, Vann adopte un point de vue féminin et propose une narration à travers les yeux d’une enfant de douze ans, Caitlin, qui se remémore les événements vingt ans plus tard.
L’inspiration du livre provient d’une visite de l’auteur à l’aquarium de Seattle, où les descriptions poétiques accompagnant chaque bassin lui sont apparues comme des métaphores du comportement humain racontées à travers l’étrangeté des poissons. Cette dimension symbolique irrigue l’ensemble du récit : les créatures aquatiques, leurs stratégies de survie et leurs territoires délimités par des parois de verre font écho aux destins des personnages, à leurs traumatismes et à leurs tentatives d’échapper à leur condition.
L’objet-livre lui-même témoigne d’un soin particulier apporté à sa conception : papier épais, utilisation du bleu pour les initiales de chapitres et la pagination, reproduction en couleur de seize illustrations de poissons. Cette dimension esthétique prolonge la dimension contemplative du récit tout en créant un contraste saisissant avec la violence psychologique qui s’y déploie.
Contrairement aux précédents romans de Vann où la violence masculine dominait, ce sont ici les personnages féminins qui portent le récit. La rage destructrice de Sheri envers son père abandonnique prend des proportions dramatiques, tandis que sa fille Caitlin incarne une forme de résilience. Le pardon impossible entre en résonance avec l’expérience personnelle de l’auteur, qui avoue avoir écrit ce livre en partie pour sonder ses propres relations difficiles avec sa mère.
« Aquarium » constitue également une rupture dans l’œuvre de Vann par sa structure : là où ses précédents romans (« Sukkwan Island », « Désolations », « Impurs », « Goat Mountain ») s’achevaient dans le tragique absolu, celui-ci laisse entrevoir une possibilité de rédemption. Cette évolution reflète peut-être l’apaisement progressif de l’auteur avec son histoire familiale, marquée par cinq suicides et un meurtre.
Sélectionné parmi les meilleurs livres du mois de mars 2015 par Amazon, le roman a reçu un accueil critique très favorable et les droits d’adaptation cinématographique ont été acquis par Rhodri Thomas, producteur du film d’Ang Lee « Un jour dans la vie de Billy Lynn ».
Aux éditions GALLMEISTER ; 240 pages.
5. L’obscure clarté de l’air (2017)
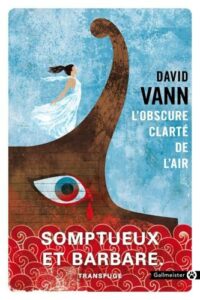
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
L’histoire commence sur l’Argo, navire des Argonautes où Médée fuit la Colchide avec Jason après avoir volé la Toison d’or à son père. Petite-fille du Soleil mais vouée à la sombre Hécate, cette princesse barbare n’hésite pas à assassiner son frère et à disperser ses membres dans la mer pour ralentir leurs poursuivants. Assoiffée de pouvoir, elle rêve de renverser l’ordre établi et de régner comme Hatchepsout, la femme-pharaon d’Égypte.
Mais le destin en décide autrement. À Iolcos puis à Corinthe, Médée et Jason sont soumis à l’esclavage par des rois tyranniques. Elle qui a tout abandonné par amour pour Jason – son pays, sa famille, ses dieux – ne supporte pas de le voir s’incliner devant leurs maîtres. Quand il finit par la trahir pour épouser une princesse plus docile, sa vengeance sera impitoyable et culminera dans le meurtre de leurs enfants.
Autour du livre
À partir de l’expérience maritime de David Vann sur la reconstitution d’un navire égyptien antique naît « L’obscure clarté de l’air », une réécriture du mythe de Médée. Cette genèse singulière ancre le récit dans une temporalité précise : le XIIIe siècle avant notre ère, à la fin de l’âge du bronze.
L’originalité de cette version réside dans le choix de dépouiller le mythe de tout élément merveilleux. Plus de dragon gardant la Toison d’or, plus de char tiré par des serpents volants, mais une femme qui use d’artifices et de stratagèmes bien réels : champignons hallucinogènes pour terroriser l’équipage, tours de passe-passe dans la pénombre pour tromper les filles de Pélias, poison à base de colchique pour éliminer ses ennemis. Cette approche réaliste s’étend jusqu’au navire Argo lui-même, réduit à une embarcation mal agencée et peu performante, bien loin du vaisseau légendaire construit avec l’aide d’Athéna.
Le texte se construit sur une écriture fragmentée, hachée, où les phrases nominales s’enchaînent dans un rythme haletant qui épouse les pensées de Médée. Cette structure narrative inhabituelle, sans chapitres mais divisée en deux parties, crée une immersion totale dans la psyché du personnage. Le style poétique et viscéral de Vann transforme même les scènes les plus brutales en tableaux d’une beauté glaçante.
La force du roman tient aussi dans sa dimension politique et féministe. Médée incarne la révolte contre un monde qui marginalise les femmes et les étrangers. Son rêve de devenir « une reine sans roi, une Hatshepsout » résonne comme un cri de rage contre la domination masculine. Sa cosmologie personnelle, où la déesse égyptienne Nout remplace le dieu grec Ouranos, reflète cette volonté de renverser l’ordre patriarcal établi.
Le roman de Vann dialogue avec d’autres réécritures contemporaines, comme celle de Rachel Cusk qui transpose l’histoire dans le Londres moderne, ou celle de Christa Wolf. Mais là où ces versions cherchent à moderniser le mythe, Vann choisit de revenir aux sources tout en offrant une lecture résolument contemporaine des enjeux.
« L’obscure clarté de l’air » reçoit un accueil critique élogieux dès sa sortie en 2017. Le Library Journal salue « une écriture magnifiquement implacable », tandis que le Financial Times souligne « un roman ambitieux, éblouissant, dérangeant et mémorable ». Le livre s’inscrit dans la lignée des grands romans de David Vann tout en marquant un tournant dans son œuvre : c’est sa première incursion dans la mythologie grecque, lui qui situe habituellement ses récits en Alaska ou en Californie.
Aux éditions GALLMEISTER ; 240 pages.
6. Komodo (2021)
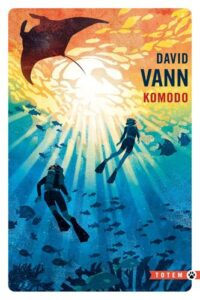
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Tracy, 45 ans, quitte la Californie pour rejoindre son frère Roy sur l’île de Komodo en Indonésie. Cette mère de jumeaux de cinq ans, épuisée par un quotidien qui l’étouffe et un mari distant, espère trouver dans ce séjour paradisiaque une pause salvatrice. Une semaine sous le soleil indonésien, à observer les requins et les raies manta aux côtés de Roy, qui termine sa formation d’instructeur, et de leur mère qui les accompagne.
Mais les retrouvailles familiales tournent vite au vinaigre. Tracy ne supporte plus rien : ni son frère qui a divorcé d’une femme qu’elle adorait, ni sa mère qui prend toujours sa défense, ni son propre corps qu’elle trouve disgracieux. Sa colère, contenue depuis des années, explose au grand jour. Entre les sorties en mer et les repas qui s’éternisent, la tension monte jusqu’à un point de rupture.
Autour du livre
Dans la lignée de « Sukkwan Island » (Prix Médicis étranger 2010), David Vann poursuit son examen des relations familiales toxiques. « Komodo » s’inscrit dans une œuvre largement autobiographique, où l’auteur revient sans cesse sur son histoire familiale marquée par le suicide de son père.
Ce nouveau roman opère un changement de perspective notable : pour la première fois, Vann adopte un point de vue féminin et délaisse les paysages familiers de l’Alaska pour les eaux indonésiennes. À travers le personnage de Tracy, il dresse un portrait sans concession du burn-out maternel. La protagoniste incarne une femme prisonnière de ses choix, étouffée par une maternité qui l’a dépossédée de son identité. « Personne ne vous prévient de ce que cela signifie, de devenir mère », observe-t-elle avec amertume.
Les relations fraternelles constituent le cœur névralgique du récit. La tension entre Tracy et Roy monte crescendo, alimentée par des années de ressentiment et de non-dits. Les dialogues cinglent comme des coups de fouet, dans « un festival de vacheries » qui ne laisse aucun répit. La construction en deux parties accentue cette progression vers l’irrémédiable : d’abord les retrouvailles explosives à Komodo, puis le retour de Tracy dans son quotidien californien étouffant.
La métaphore marine irrigue l’ensemble du texte. Les eaux troubles de l’océan Indien font écho aux profondeurs psychologiques des personnages. Les descriptions des fonds marins contrastent avec la violence des rapports humains, créant un effet de miroir saisissant entre la beauté naturelle et la laideur des relations familiales.
« Komodo » brille particulièrement dans son traitement de la charge mentale féminine. Tracy devient le porte-voix d’une génération de femmes sacrifiées sur l’autel de la maternité : « Et personne ne prend soin de moi, jamais, personne ne remarque tous les sacrifices que j’ai faits ». L’audace du roman réside dans ce portrait d’une mère qui ose exprimer sa haine et ses pulsions destructrices.
La critique salue unanimement cette nouvelle œuvre. Télérama souligne « un climat d’angoisse et de malaise palpable », tandis que L’Express loue « un festival de vacheries et des réflexions sur le couple, la famille, la société, à graver dans le marbre ». Le Journal du Dimanche relève la « justesse remarquable » avec laquelle le romancier se glisse dans la peau d’une femme épuisée.
Aux éditions GALLMEISTER ; 304 pages.
7. Impurs (2013)
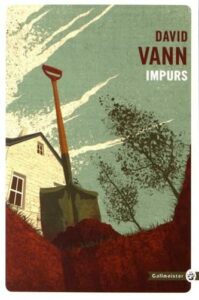
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
En 1985, dans une ferme isolée de la vallée centrale de Californie, Galen vit seul avec sa mère Suzie-Q. À 22 ans, ce jeune homme instable partage son temps entre méditations mystiques et visites obligées à sa grand-mère atteinte de la maladie d’Alzheimer. Sa mère, sous prétexte de difficultés financières, refuse de l’envoyer à l’université et maintient sur lui une emprise étouffante. Les visites fréquentes et impromptues de sa tante Helen et de sa cousine Jennifer, viennent perturber leur routine.
Le climat familial se dégrade rapidement. Helen jalouse sa sœur qui gère l’argent de leur mère, tandis que Jennifer, 17 ans, s’amuse à torturer psychologiquement son cousin par des jeux de séduction pervers. Prisonnier de cet univers exclusivement féminin où chacun dissimule ses rancœurs, Galen tente de trouver refuge dans des pratiques spirituelles New Age. Mais sous le soleil brûlant de Californie, les tensions atteignent leur point de rupture et la folie s’immisce peu à peu dans son esprit.
Autour du livre
La violence familiale atteint son paroxysme dans cette chronique torride et dérangeante qui se déroule sous le soleil implacable de la Californie des années 1980. Troisième roman de David Vann après « Sukkwan Island » et « Désolations », « Impurs » marque une rupture géographique avec les précédents ouvrages situés en Alaska, tout en conservant la thématique centrale des relations familiales destructrices.
La force du livre réside dans son atmosphère suffocante, où la chaleur écrasante de la vallée californienne devient un personnage à part entière qui contribue à l’escalade de la tension. L’écriture se caractérise par une certaine économie de moyens, avec des phrases parfois fragmentées qui renforcent l’impression d’étouffement. Cette sobriété stylistique contraste avec la démesure des situations décrites.
« Impurs » a reçu un accueil critique contrasté lors de sa sortie. Si certains y voient un chef-d’œuvre de noirceur dans la lignée de Tennessee Williams, d’autres regrettent des longueurs dans la seconde partie. Le Washington Post souligne « la sensibilité littéraire extravagante » de l’auteur, tandis que The Economist salue « un récit brillant […] plein de violence, de destruction et d’infamie. »
L’ombre du Sud gothique plane sur ces pages qui évoquent aussi bien Tchekhov que Thomas Bernhard dans leur traitement de la violence familiale. Plusieurs critiques établissent également des parallèles avec l’œuvre de Stephen King pour le traitement psychologique des personnages.
L’ouvrage figure dans plusieurs listes des meilleurs livres de l’année 2012, notamment celles du New Statesman et de l’Observer. Le Times Literary Supplement en fait « l’expérience de lecture la plus intense de l’année. »
Aux éditions GALLMEISTER ; 256 pages.
8. Goat Mountain (2014)
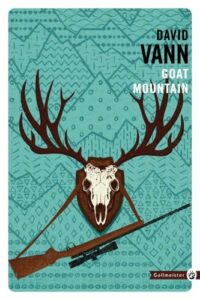
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Automne 1978, dans les terres arides du nord de la Californie. Un garçon de onze ans part chasser sur les terres familiales de Goat Mountain avec son père, son grand-père et Tom, un ami de la famille. Cette année marque un tournant : le jeune garçon pourra enfin tuer son premier cerf, rite de passage censé faire de lui un homme. Mais à leur arrivée sur le domaine, ils découvrent un braconnier.
Le drame survient en quelques secondes. Alors que son père lui tend son fusil pour observer l’inconnu dans la lunette, l’enfant tire. L’homme s’effondre, mort sur le coup. Plus troublant encore : le jeune garçon ne manifeste aucun remords. S’ensuit une confrontation brutale entre les trois adultes : le père cherche à étouffer l’affaire, Tom insiste pour alerter les autorités, le grand-père prône une justice archaïque.
Autour du livre
Quatrième roman de David Vann, « Goat Mountain » clôture un cycle romanesque inspiré de son histoire familiale. Après dix ans d’écriture d’un premier roman et un succès initialement limité aux États-Unis, l’auteur trouve finalement la consécration en France avec « Sukkwan Island », couronné du prix Médicis étranger en 2010.
La trame narrative s’ancre dans les souvenirs de chasse de l’auteur, lui-même initié aux armes à feu dès l’âge de sept ans par son père. Cette expérience personnelle imprègne chaque page du récit, notamment dans la description minutieuse du dépeçage d’un cerf, scène centrale dont l’intensité bouleverse. La narration mêle habilement le point de vue de l’enfant et celui de l’adulte qu’il est devenu, créant une tension permanente entre l’innocence perdue et la conscience tourmentée.
L’œuvre s’inscrit dans la lignée des grands textes américains sur la violence primitive, rappelant « Méridien de sang » de Cormac McCarthy. Les références bibliques parsèment le texte, particulièrement l’histoire de Caïn et Abel, citée neuf fois. Cette dimension théologique n’est pas fortuite : ancien étudiant en études religieuses, Vann interroge la nature même du mal et son rapport à la foi.
Le récit se déroule dans un espace clos malgré l’immensité du décor – 250 hectares de terres familiales en Californie du Nord. Cette contradiction apparente renforce le caractère tragique de l’histoire, transformant le territoire de chasse en théâtre antique où se joue un drame inexorable.
Les personnages masculins, à l’exception de Tom, restent sans nom, acquérant ainsi une dimension archétypale. L’absence totale de présence féminine accentue la brutalité des rapports entre ces hommes confrontés à leurs instincts primitifs.
Originellement conçu comme une nouvelle il y a plus de vingt-cinq ans, le texte a mûri pour devenir un roman dense où la nature devient un personnage à part entière. La chaleur californienne, succédant aux paysages glacés de l’Alaska des précédents romans, étouffe les protagonistes dans une atmosphère infernale.
« Goat Mountain » devrait connaître une adaptation cinématographique, tandis que « Sukkwan Island » est en cours d’adaptation par les producteurs de « Coco avant Chanel ». Ces projets témoignent de la puissance visuelle du texte, qui ne laisse aucun lecteur indemne.
Aux éditions GALLMEISTER ; 224 pages.