Christian Bobin (1951-2022) est un écrivain et poète français né au Creusot. Fils d’employés de l’usine Schneider, il passe une enfance solitaire, plongé dans les livres. Après des études de philosophie, il occupe divers emplois : bibliothécaire, guide de musée, infirmier psychiatrique, rédacteur.
Sa carrière littéraire débute en 1977 avec « Lettre pourpre ». Son style singulier, entre essai et poésie, se caractérise par des textes brefs et contemplatifs. Le succès vient en 1991 avec « Une petite robe de fête », suivi en 1992 par « Le Très-Bas », consacré à saint François d’Assise, qui lui vaut le Prix des Deux Magots et le Grand Prix catholique de littérature.
Auteur prolifique avec une soixantaine d’ouvrages, Bobin aborde des thèmes universels comme le vide, la nature, l’enfance et les petites choses du quotidien. Sa prose poétique et aérienne invite à la contemplation, teintée d’une spiritualité éloignée des dogmes traditionnels.
Malgré son succès, il reste toujours discret, vivant à l’écart du monde littéraire. Il partage la fin de sa vie avec la poétesse Lydie Dattas. Christian Bobin s’éteint le 23 novembre 2022 à Chalon-sur-Saône, des suites d’un cancer. En 2023, il reçoit à titre posthume le prix Goncourt de la poésie pour l’ensemble de son œuvre.
Voici notre sélection de ses livres majeurs.
1. La plus que vive (1996)
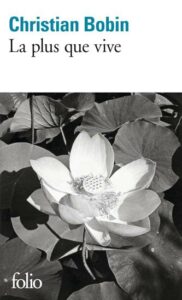
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Dans une petite ville de Bourgogne, la mort frappe sans prévenir un jour d’août 1995. Ghislaine, 44 ans, s’effondre, victime d’une rupture d’anévrisme. Pour Christian Bobin, qui partageait sa vie, le monde s’arrête. Cette femme solaire, mère de trois enfants, enseignante passionnée, disparaît en laissant derrière elle un vide immense.
L’écrivain refuse d’abord d’écrire, comme pour se punir de cette injustice. Puis les mots reviennent, presque malgré lui. Durant l’automne et l’hiver qui suivent, il compose ce texte comme une longue lettre à celle qui n’est plus là. Page après page, il fait revivre Ghislaine à travers leurs souvenirs communs : ses éclats de rire, sa liberté farouche, sa manière si particulière de parler « en dansant des mains ».
Autour du livre
L’écriture de « La plus que vive » naît dans des circonstances particulières. Dans les jours qui suivent la mort de Ghislaine, Christian Bobin pense d’abord qu’il n’écrira plus jamais, comme un enfant qui boude parce qu’on lui a enlevé ce qu’il aime. Puis les mots reviennent, presque naturellement. Il comprend qu’il lui reste au moins un livre à écrire : celui-là.
Ce texte de cent pages se distingue par son caractère épuré et sa structure fragmentaire. Les chapitres courts s’enchaînent sans ordre chronologique apparent, guidés par le flux des souvenirs et des émotions. Les phrases brèves alternent avec des passages plus longs, un rythme qui épouse les mouvements de la pensée. La parole s’adresse directement à Ghislaine, entre le présent et l’imparfait, comme si l’auteur refusait de la cantonner au passé.
Ce texte intime, qui n’était pas initialement destiné à être édité, trouve un écho inattendu auprès du public. Les lecteurs y reconnaissent une vérité universelle sur l’amour et le deuil, sans pathos ni complaisance. Les critiques saluent cette capacité à transformer la perte en une célébration de la vie, à faire surgir la lumière du plus profond de l’absence.
L’originalité du livre réside dans son refus des conventions du genre. Ce n’est ni une biographie, ni un éloge funèbre traditionnel, mais plutôt une conversation qui se poursuit par-delà la mort. Les anecdotes du quotidien se mêlent aux réflexions sur l’éternité, le rire côtoie les larmes. Christian Bobin réussit ce paradoxe : parler de la mort en rendant la vie plus intense encore.
Christian Bobin construit ainsi un monument de mots à celle qui n’est plus, tout en évitant les pièges de l’idéalisation. Ghislaine apparaît dans sa vérité, avec ses contradictions et sa liberté. Sa présence irradie chaque page, non comme un fantôme mais comme une force vitale qui continue d’agir sur le monde des vivants.
Aux éditions FOLIO ; 110 pages.
2. La folle allure (1995)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Dans un cirque ambulant, une petite fille de deux ans se réfugie dans la cage d’un loup aux yeux couleur mimosa. Cette première passion inaugure une existence hors des sentiers battus, rythmée par les fugues et les métamorphoses. Entre un père perfectionniste et une mère solaire qui rit à gorge déployée, elle grandit en cultivant un goût immodéré pour la liberté.
L’héroïne traverse les années et les expériences avec la même devise : « on verra bien ». Elle se marie très jeune à un fils de notaire, devient actrice, prend des amants – dont un érable majestueux. Sa vie ressemble à une succession de bonds en avant, portée par trois guides : un loup aux dents jaunies, un ange aux cheveux rouges et Bach, qu’elle surnomme affectueusement « le gros ». À vingt-sept ans, elle s’isole dans un hôtel jurassien pour mettre des mots sur son parcours atypique.
Autour du livre
« La folle allure » s’inscrit parmi les textes majeurs de Christian Bobin. Cette chronique d’une liberté absolue prend la forme d’un récit à la première personne où la musique occupe une place centrale, notamment à travers la figure tutélaire de Bach, surnommé affectueusement « le gros » par la narratrice. La structure non linéaire du texte fait écho aux fugues musicales qu’affectionne l’héroïne : les séquences temporelles s’entremêlent avec fluidité, tissant une trame qui épouse le caractère insaisissable du personnage principal.
Les multiples identités endossées par la protagoniste – Lucie, Prune, Irène, Marilyn – reflètent sa quête perpétuelle d’émancipation. Sa philosophie du « on verra bien » se décline tout au long des pages comme un manifeste existentiel. Le texte pulse entre moments d’introspection et scènes d’action, silences et éclats, à l’image de cette vie qui refuse les conventions.
La dimension poétique du texte ne verse jamais dans la mièvrerie grâce à des ruptures de ton maîtrisées et des formules qui frappent juste : « Je ne sais pas ce qui est le pire – de ne s’adapter en rien au monde, ou de s’y adapter en tout, des fous ou des gens dits convenables, convenus. Je sais que j’ai moins peur des fous, je crois qu’ils sont bien moins dangereux. » La force du livre réside dans cette capacité à transformer des situations quotidiennes en moments de grâce, sans jamais tomber dans le pathos.
Les critiques soulignent unanimement la singularité de ce texte dans l’œuvre de Bobin. Jacques Folch-Ribas, dans La Presse, note comment ce livre a créé une communauté de lecteurs qui « se reconnaissent à leur sourire enchanté d’innocence, à un regard droit, net, franc ». Cette observation témoigne de l’impact particulier de « La folle allure » sur son lectorat, qui dépasse le simple cadre littéraire pour toucher à une forme d’expérience partagée.
Aux éditions FOLIO ; 170 pages.
3. Geai (1998)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Dans un village d’Isère, Albain, huit ans, fait une découverte surnaturelle : sous la glace du lac de Saint-Sixte gît le corps d’une femme en robe rouge, morte depuis des années. Cette femme, qui se fait appeler Geai, lui sourit à travers la surface gelée. Commence alors une relation singulière entre l’enfant solitaire et cette présence invisible aux yeux des autres.
L’histoire suit la trajectoire singulière d’Albain jusqu’à l’âge adulte. Considéré comme un « idiot » par les villageois, ce contemplatif qui préfère l’observation du monde au travail finit pourtant par trouver sa voie comme vendeur ambulant. Sa sensibilité particulière, loin d’être un handicap, devient alors un atout : il sait écouter les gens et créer avec eux des moments de grâce au milieu du quotidien.
Autour du livre
« Geai » dessine le portrait d’un être différent, Albain, qui refuse de se plier aux conventions sociales. À travers cette figure d’enfant rêveur devenu adulte marginal, Christian Bobin interroge notre rapport au temps et à la productivité. Le personnage principal incarne une forme de résistance paisible face aux pressions de la société moderne : il préfère contempler le monde plutôt que d’y participer activement.
La présence surnaturelle de Geai sert de fil conducteur à une réflexion plus large sur la sensibilité et l’imaginaire. Cette femme mystérieuse, visible uniquement par Albain, symbolise la part de magie qui survit dans un monde désenchanté. Le lac de Saint-Sixte en Isère, où se déroule une partie de l’histoire, existe réellement. Cette ancrage géographique confère au texte une dimension supplémentaire : plusieurs lecteurs témoignent avoir visité ce lieu après leur lecture, touchés par sa description dans le livre.
La construction fragmentée du récit, faite de petits tableaux successifs, permet de suivre l’évolution d’Albain tout en préservant une part de mystère. Le personnage trouve finalement sa place dans la société sans renoncer à sa nature profonde : sa sensibilité particulière, d’abord perçue comme un handicap, devient un atout dans son métier de vendeur. Cette trajectoire inattendue souligne l’un des messages centraux du livre : la différence, loin d’être un obstacle, peut devenir une force quand on reste fidèle à soi-même.
« Geai » oscille ainsi entre conte et méditation philosophique, rappelant par moments « Le Petit Prince » dans sa capacité à parler aux enfants comme aux adultes.
Aux éditions FOLIO ; 120 pages.
4. Ressusciter (2001)
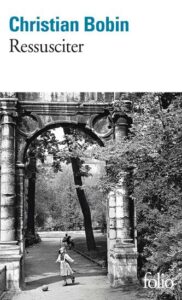
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
« Ressusciter » est un recueil de réflexions et de méditations sur la vie, la mort et le divin. Christian Bobin y compose une mosaïque de pensées où s’entremêlent des observations sur le quotidien – un rouge-gorge qui saute dans un rayon de soleil, une tourterelle sur la branche d’un bouleau – et des considérations plus profondes sur l’existence.
La mort du père de l’auteur, emporté par la maladie d’Alzheimer, constitue la trame souterraine de l’ouvrage. Cette tragédie personnelle devient le point de départ d’une réflexion plus large sur notre rapport à l’absence et à la mémoire. Les visites au cimetière, les souvenirs qui affleurent, la persistance des liens malgré la disparition physique : tout contribue à tisser une méditation sur ce qui survit à la mort.
Autour du livre
La mort du père de Christian Bobin, emporté par la maladie d’Alzheimer, imprègne profondément les pages de « Ressusciter ». Sa perte donne naissance à une réflexion plus vaste sur le deuil, la mémoire et la permanence des liens, comme en témoigne cette observation poignante : « Il y a parfois entre deux personnes un lien si profond qu’il continue à vivre même quand l’un des deux ne sait plus le voir. »
La spiritualité qui traverse « Ressusciter » se démarque des approches conventionnelles. Bobin trouve le divin dans les manifestations les plus modestes du quotidien : les flaques d’eau, le parfum du chèvrefeuille, la pureté de certains livres, et même chez des athées. Cette vision contraste avec celle des « religieux professionnels », qu’il critique ouvertement.
Les lecteurs témoignent d’une relation particulière avec ce texte publié en 2001. Beaucoup y reviennent régulièrement, comme à une source apaisante. Certains le lisent par fragments, savourant des passages comme « des petits chocolats soigneusement choisis ». D’autres notent comment le livre les « désencombre », selon l’expression même de l’auteur, faisant glisser les peines « comme la neige, par plaques ».
La dimension contemplative n’exclut pas une certaine critique sociale. Des observations acérées sur notre époque s’intercalent entre les moments de grâce. Cette tension entre beauté et lucidité caractérise l’ensemble de l’œuvre, où la critique la plus sévère côtoie l’émerveillement le plus pur.
Les dernières pages bouclent la boucle en revenant aux yeux d’Agnès, une « sainte milliardaire » emportée par la maladie, dont le regard immortalisé par un dessinateur guide le lecteur vers ces sources de lumière que Bobin n’a cessé de traquer tout au long de ces pages.
Aux éditions FOLIO ; 176 pages.
5. L’inespérée (1994)
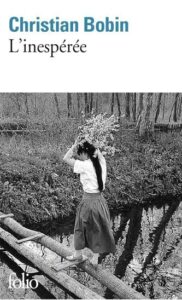
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
« L’inespérée », publié en 1994, se compose de onze textes courts qui s’ouvrent sur une lettre adressée à « la lumière qui traînait dans les rues du Creusot ». À travers ces fragments, Christian Bobin trace le portrait d’une femme disparue, celle qu’il nomme « l’inespérée », dont la présence lumineuse irradie l’ensemble du recueil. Entre ces deux lettres qui encadrent l’ouvrage, le narrateur médite sur la solitude, la mort, la pureté, l’amour.
Les textes évoquent tour à tour une grand-mère célébrée par ses petits-enfants, un arbre solitaire à Saint-Ondras en Isère, une peinture de Bonnard, ou encore une jeune fille enceinte du Christ. Certains passages plus critiques s’attaquent aux travers de la société moderne : la télévision y est décrite comme une « brute geignarde », les colloques universitaires comme des cérémonies vides de sens.
Autour du livre
À travers les onze textes de « L’inespérée », Christian Bobin déploie une méditation sur la pureté, qu’il définit non comme une morale mais comme « le fait simple et pauvre d’être pour chacun au bord des eaux de sa mort noire ». Cette quête spirituelle s’incarne dans des scènes du quotidien transfigurées : une dinette sans thé avec des enfants, un arbre solitaire à Saint-Ondras, la célébration d’une grand-mère disparue.
Entre contemplation et critique sociale, Bobin brode une réflexion sur les travers de notre époque. La télévision y est dépeinte comme une « brute geignarde et avinée », symbole d’une société de consommation qui noie l’essentiel sous un flot d’images. De cette agitation, Bobin oppose la vertu du vide et du silence : « Ne rien faire, rien dire, presque rien être. Vous y découvrez le cœur subtil du temps. »
La force de ces textes réside dans leur capacité à révéler l’extraordinaire dans l’ordinaire. Chaque rencontre, chaque instant banal recèle une grâce possible. L’écriture opère comme un geste de résistance : « L’écriture c’est une façon d’échapper à cette misère, une variation de la solitude au même titre que l’amour ou le jeu – un principe d’insoumission, une vertu d’enfance. »
« L’inespérée » se distingue aussi par sa structure en miroir, encadrée par deux lettres d’amour – l’une à la lumière du Creusot, l’autre à une femme disparue. Cette architecture reflète la quête centrale du livre : comment préserver la pureté et l’amour dans un monde qui tend à les dissoudre ? La réponse se trouve peut-être dans cette phrase lapidaire : « Nous sommes faits de cela, nous ne sommes faits que de ceux que nous aimons et de rien d’autre. »
Aux éditions FOLIO ; 120 pages.
6. Le Très-Bas (1992)
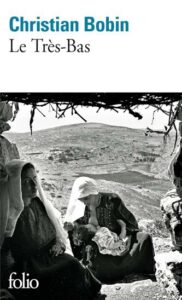
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Dans l’Italie médiévale du XIIIe siècle, François d’Assise naît dans une famille de riches marchands. Sa mère le couve d’un amour absolu tandis que son père, négociant prospère, projette de faire de lui son héritier. Mais le jeune homme, d’abord mondain et insouciant, connaît une transformation radicale après une expérience mystique. Il abandonne ses privilèges et choisit une vie de pauvreté absolue, au grand désespoir de sa famille.
Le conflit avec son père culmine lors d’un procès où François, accusé d’avoir dilapidé les biens familiaux, se dévêt entièrement devant la cour pour signifier son renoncement total au monde matériel. Il part sur les routes, prêche aux plus démunis, parle aux animaux et fonde une communauté religieuse vouée à la pauvreté. Sa quête spirituelle s’oriente vers ce qu’il appelle le « Très-Bas » : une conception de Dieu qui se manifeste dans l’humilité et la simplicité.
Autour du livre
Publié en 1992, « Le Très-Bas » transcende la simple biographie de saint François d’Assise pour se lire comme un texte méditatif sur la spiritualité et l’amour. Cette œuvre majeure de Christian Bobin reçoit en 1993 le Prix des Deux Magots ainsi que le Grand prix catholique de littérature, une double distinction qui souligne sa capacité à toucher un large public, croyant comme non-croyant.
La force du texte réside dans sa manière de nouer ensemble plusieurs niveaux de lecture. La trame biographique s’entremêle avec des réflexions sur l’amour maternel, la nature de la foi, et une critique musclée du matérialisme contemporain. Bobin oppose ainsi le « Très-Haut » de la religion institutionnelle au « Très-Bas », ce Dieu humble qui se manifeste dans la simplicité et parle « dans l’intime et chuchote dans la brise ». Le treizième siècle dépeint dans le livre « parlait au cœur », tandis que le vingtième « parle pour vendre » – un contraste qui structure la réflexion sur notre époque.
Gabriel Ringlet, écrivain et théologien, qualifie Bobin de « grand poète » lors de la diffusion télévisée de l’intronisation du Pape François sur la RTBF, soulignant la portée spirituelle du « Très-Bas ». Le texte frappe par sa capacité à aborder la religion sans prosélytisme, à parler de Dieu sans dogmatisme. Les phrases ciselées s’enchaînent comme autant de méditations : « Très peu de vraies paroles s’échangent chaque jour, vraiment très peu. Peut-être ne tombe-t-on amoureux que pour enfin commencer à parler. »
Si certains critiques évoquent une résistance initiale face à ce texte qui demande « du temps, beaucoup de temps », la majorité souligne sa puissance méditative. Bobin ne cherche pas à reconstituer exhaustivement la vie du saint d’Assise – « on sait de lui peu de choses et c’est tant mieux » écrit-il dès les premières pages. Il préfère distiller une réflexion sur la quête spirituelle, le dépouillement et la joie, thèmes qui résonnent particulièrement dans notre société de consommation.
Aux éditions FOLIO ; 129 pages.
7. L’homme-joie (2012)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
« L’homme-joie » déroule quinze instants de vie desquels Christian Bobin fait surgir la poésie du quotidien. Un mimosa qui s’épanouit, une conversation avec un voisin, la visite d’une exposition deviennent autant d’occasions de célébrer la beauté du monde. Entre les textes, des pensées manuscrites créent des respirations, tandis qu’au cœur du livre, des pages bleues accueillent une lettre à l’amour perdu.
Le fil conducteur de ces récits est la quête d’une joie essentielle, qui persiste malgré la maladie, la mort, la perte. Bobin observe son père qui s’enfonce dans la maladie d’Alzheimer, médite devant les toiles de Soulages, écoute Glenn Gould interpréter Bach. Ces rencontres dessinent peu à peu le portrait d’un homme qui refuse de céder au désespoir et cherche obstinément la lumière.
Autour du livre
Publié aux éditions Gallimard/L’Iconoclaste en 2012, « L’homme-joie » se distingue dans la bibliographie de Christian Bobin par sa construction singulière. Les quinze récits s’entrecoupent de pages manuscrites, créant une cadence particulière dans la lecture. Au centre, sur papier bleu, une lettre à la femme aimée et perdue – « la plus que vive » – constitue le cœur névralgique de l’ensemble. Cette architecture inhabituelle transforme le livre en objet littéraire précieux qui établit une proximité inédite avec le lecteur.
François Busnel, dans sa chronique, n’hésite pas à considérer « L’homme-joie » comme l’un des meilleurs livres qu’il ait jamais lus. Cette reconnaissance médiatique souligne la force d’un texte qui réussit à métamorphoser les sujets les plus graves – la maladie d’Alzheimer, le deuil, la solitude – en méditation lumineuse sur l’existence.
La présence de l’art irrigue ces pages : les tableaux noirs de Soulages deviennent « de grandes bêtes vivantes, allongées, un peu engourdies d’être là », Glenn Gould se mue en « renard des neiges, une marmotte des sons ». Ces références culturelles s’entremêlent aux observations du quotidien : un bouquet de fleurs, un chat qui meurt, une gitane enceinte dans Paris. Chaque scène se métamorphose en instant d’épiphanie.
Dans « L’homme-joie », la spiritualité n’exclut pas le concret, ni la mélancolie, l’espérance. « Il n’y a dans la nature les fragments d’un alphabet ancien », écrit Bobin, « des morceaux de lettres capitales, des ruisselets d’italiques, de grands espacements bleus de silence. » Cette attention aux signes les plus ténus de la beauté du monde constitue la signature de ce texte qui refuse de céder au désespoir.
Aux éditions FOLIO ; 176 pages.
8. La part manquante (1989)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
« La part manquante » se compose de onze textes courts qui s’entrecroisent autour des thèmes de l’amour, de la solitude et du divin. Le premier récit dépeint une mère esseulée dans un hall de gare avec son enfant, après une rupture. D’autres fragments évoquent une baleine blanche inspirée de Melville, un homme d’affaires qui ne dort jamais, ou encore la première neige de l’année.
Ces tranches de vie, à la fois quotidiennes et mystiques, tissent un fil rouge autour de ce qui nous échappe : l’enfant qui grandit et s’éloigne, l’amour qui se dérobe, le temps qui file. Les personnages apparaissent furtivement, comme des silhouettes entrevues dans la brume, unis par leur quête d’absolu et leur conscience aiguë du manque.
Autour du livre
Ce recueil suscite des réactions diamétralement opposées chez la critique : soit il séduit immédiatement par sa musicalité et sa profondeur, soit il rebute par son apparente opacité. Cette polarisation s’explique par l’approche singulière de Bobin qui cisèle chaque phrase comme un orfèvre, dans une prose poétique où les mots s’enchaînent selon une cadence particulière. « C’est par incapacité de vivre que l’on écrit. C’est par nostalgie d’un Dieu que l’on aime », affirme-t-il dès les premières pages, posant ainsi les fondements de sa réflexion sur l’écriture et la spiritualité.
La dimension mystique imprègne l’ensemble des textes sans jamais verser dans le prosélytisme. Les thèmes s’entrelacent – maternité, enfance, lecture, amour – pour former une méditation sur l’absence et le manque. Cette quête spirituelle se manifeste notamment dans « Les preuves en miettes de l’existence de Dieu », l’un des textes les plus marquants du recueil selon plusieurs critiques.
La concision caractéristique de Bobin prend ici toute son ampleur : les phrases courtes s’enchaînent comme autant de notes dans une partition musicale. Cette économie de mots, loin d’appauvrir le texte, en accentue la force évocatrice. Certains y voient une influence du haïku japonais, d’autres y décèlent une parenté avec la tradition mystique chrétienne. Plusieurs critiques soulignent la ressemblance avec Philippe Delerm dans cette attention portée aux instants fugaces du quotidien, mais notent une mélancolie plus prononcée chez Bobin.
Les onze textes qui composent « La part manquante » fonctionnent comme des variations sur un même thème, celui du vide qui habite toute existence humaine. Cette structure fragmentaire, qui pourrait dérouter, permet au contraire une lecture progressive, où chaque texte peut être savouré individuellement avant d’être replacé dans l’ensemble de l’œuvre.
Aux éditions FOLIO ; 108 pages.
9. Le Murmure (2024)
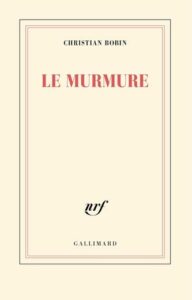
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
L’écriture du « Murmure » s’inscrit dans des circonstances exceptionnelles : commencé au Creusot en juillet 2022, le texte se poursuit sur un lit d’hôpital à Chalon-sur-Saône durant les deux derniers mois de la vie de Christian Bobin, qui s’éteint le 23 novembre 2022. Cette genèse particulière imprègne les pages d’une intensité rare : le texte se construit dans l’urgence d’un temps qui s’échappe, comme en témoigne cette phrase saisissante : « Puisque je n’ai plus le temps, eh bien je vais le prendre ».
La musique classique traverse ces pages tel un fil conducteur, notamment à travers la figure tutélaire du pianiste russe Sokolov, dont les interprétations de Chopin agissent comme un baume sur l’âme du poète. « Le docteur Sokolov m’a fait une transfusion de Chopin. Pendant quelques jours j’ai été protégé de tout et ouvert à tout », confie Bobin. Cette présence musicale s’entrelace avec des déclarations d’amour bouleversantes adressées à la poétesse Lydie Dattas, sa compagne. Entre réalité et hallucinations causées par les opiacés, les sens s’éveillent et les mots ricochent, dans une succession de tableaux où se côtoient les « petites infirmières jaunes » aux « regards si purs » et l’abbatiale de Conques.
Autour du livre
La critique littéraire s’accorde à voir dans ce testament poétique l’aboutissement d’une œuvre majeure. Les textes de « La nuit du cœur », « La folle allure » ou « La part manquante » trouvent ici leur point d’orgue, dans cette méditation finale où la mort n’apparaît jamais comme une fin mais comme un « merveilleux achèvement ». Sans apitoiement ni grandiloquence, ces pages murmurent une dernière leçon de vie, portée par cette conviction inébranlable : « La grande énigme n’est grande que d’être petite ».
Aux éditions GALLIMARD ; 144 pages.




