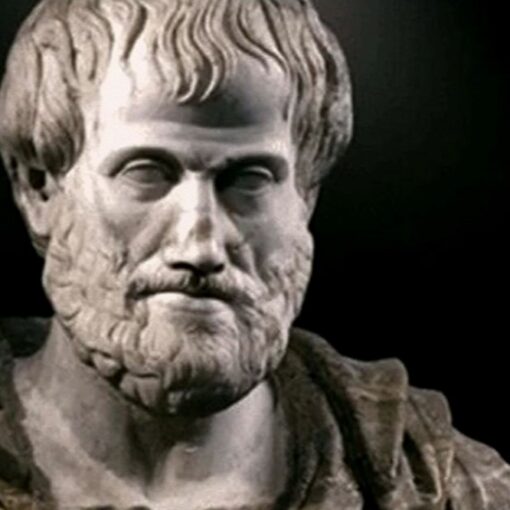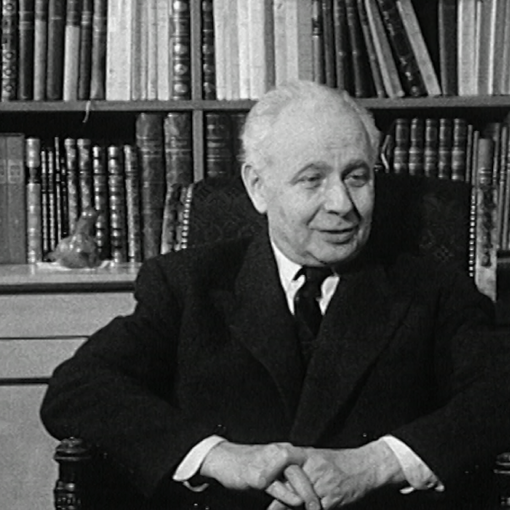Barbara Constantine est une romancière française née à Nice en 1955. Fille de l’acteur américain Eddie Constantine et d’une danseuse des ballets de Monte-Carlo, elle s’oriente d’abord vers le cinéma, mais derrière la caméra. Elle travaille comme scripte pour le cinéma et la télévision, collaborant notamment avec des réalisateurs comme Cédric Klapisch, Robert Altman et Andrzej Zulawski.
C’est lors d’une période de chômage qu’elle se lance dans l’écriture. Elle publie son premier roman « Allumer le chat » en 2007 aux éditions Calmann-Lévy. Le succès est au rendez-vous et se poursuit avec plusieurs autres ouvrages, dont « Et puis, Paulette… » (2012) qui sera traduit en 22 langues. Son travail est récompensé par plusieurs prix, notamment le Prix Charles Exbrayat 2010 pour « Tom, petit Tom, tout petit homme, Tom » et le Prix Marguerite Audoux 2013 pour « Et puis, Paulette… ».
Partageant sa vie entre Paris et le Berry, Barbara Constantine est aussi céramiste et passionnée de nature. Elle consacre son temps à planter des arbres fruitiers, jardiner et observer ses chats. Son écriture, à la fois drôle et touchante, se caractérise par son accessibilité et sa capacité à toucher des lecteurs de tous âges, avec une attention particulière pour la vie rurale et ses habitants.
Voici notre sélection de ses romans majeurs.
1. Tom, petit Tom, tout petit homme, Tom (2010)
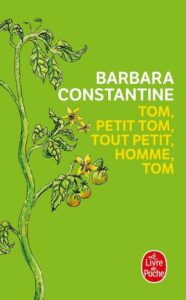
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Tom a onze ans et vit dans un mobile-home délabré avec Joss, sa mère qui l’a eu à treize ans et demi. Pour survivre, il chaparde des légumes dans les potagers du voisinage, notamment chez Archibald et Odette, un couple d’Anglais récemment installés qui ferment les yeux sur ses larcins. Sa mère, qui préfère faire la fête et partir en week-end avec ses copains, le laisse souvent seul.
Un soir, alors qu’il s’aventure dans un nouveau jardin, Tom tombe sur Madeleine, une vieille dame de quatre-vingt-treize ans, étendue au milieu de ses choux. Il la sauve et une amitié improbable naît entre eux. Pendant la convalescence de Madeleine à l’hôpital, Tom s’occupe de sa maison et de ses animaux. C’est alors que surgit Samy, un ancien compagnon de Joss tout juste sorti de prison, qui va bouleverser leur équilibre précaire.
Autour du livre
« Tom, petit Tom, tout petit homme, Tom » se démarque par une approche singulière de thèmes sociaux complexes : la précarité, la maternité précoce, la solitude des personnes âgées. La fraîcheur du regard de Tom transforme ces sujets graves en une chronique où l’espoir surgit des situations les plus précaires.
Le personnage de Tom incarne cette dualité : enfant par son âge mais adulte par ses responsabilités, il jongle entre ces deux mondes avec une débrouillardise qui force l’admiration. Sa relation avec les voisins anglais Archibald et Odette illustre cette ambivalence – ils observent ses larcins avec une bienveillance amusée, créant des scènes où l’humour allège la gravité de la situation.
Les jardins potagers occupent une place centrale dans la narration. Plus qu’un simple décor, ils deviennent des espaces de transformation où les personnages évoluent et se reconstruisent. Le jardinage, d’abord moyen de survie pour Tom, se mue en vecteur de liens sociaux et d’apprentissage.
Couronné par le prix Charles Exbrayat en 2010, « Tom, petit Tom, tout petit homme, Tom » a conquis le public par sa capacité à traiter de sujets difficiles sans tomber dans le misérabilisme. Constantine y réussit notamment un tour de force en donnant la parole à chaque personnage à la première personne, permettant une immersion totale dans leurs pensées et leurs émotions.
L’histoire s’inscrit dans une continuité avec les autres œuvres de Constantine – les lecteurs attentifs noteront d’ailleurs un clin d’œil à « À Mélie, sans mélo » à travers l’apparition furtive du personnage de Clara. Sa force réside dans sa capacité à montrer comment la solidarité peut naître dans les situations les plus improbables. Les personnages, malgré leurs failles et leurs blessures, construisent peu à peu une famille de cœur qui transcende les liens du sang.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 224 pages.
2. Et puis, Paulette… (2012)
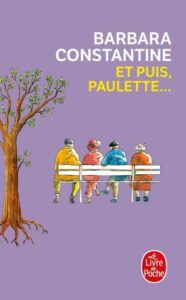
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Ferdinand vit seul dans sa grande ferme depuis que son fils a déménagé avec femme et enfants. Sa vie bascule le jour où il propose d’héberger sa voisine Marceline, dont la maison menace de s’effondrer après une tempête. Ce geste de solidarité, suggéré par ses petits-enfants, les « Lulus », marque le début d’une grande aventure collective.
La ferme devient rapidement un refuge pour d’autres âmes esseulées : Guy, un ami d’enfance qui peine à surmonter son veuvage, puis les sœurs Lumière, deux octogénaires que leur neveu cherche à expulser. Cette communauté atypique s’enrichit encore avec l’arrivée de deux étudiants : Muriel, future infirmière, et Kim, apprenti horticulteur. Chacun apporte ses compétences et trouve peu à peu sa place dans ce microcosme.
Autour du livre
« Et puis, Paulette… » de Barbara Constantine s’inscrit dans le sillage d’ « Ensemble, c’est tout » d’Anna Gavalda et entre en résonance avec « Les enfants du marais » de Georges Montforez, adapté au cinéma par Jean Becker. Le titre lui-même fait écho à la célèbre chanson « La bicyclette » d’Yves Montand, créant d’emblée une atmosphère nostalgique.
Couronné par le Prix des Libraires du Livre de Poche, ce quatrième opus de Constantine aborde les thèmes de la vieillesse et de la solitude sans jamais sombrer dans le pathos. Les chapitres courts s’enchaînent avec fluidité, portés par un langage familier parsemé d’expressions désuètes qui rappellent le parler des grands-parents. Le texte se nourrit d’anecdotes amusantes et de situations cocasses qui contrebalancent la gravité des sujets traités : le deuil, la précarité, l’abandon parental ou encore le déni de grossesse.
L’initiative fictive de la ferme partagée a trouvé un écho dans la réalité avec la création du site internet solidarvioc.com. Cette expérience de cohabitation intergénérationnelle fait aussi écho à des initiatives contemporaines, comme l’installation d’écoles maternelles en maison de retraite ou la colocation entre étudiants et personnes âgées. « Et puis, Paulette… » s’inscrit ainsi dans une réflexion plus large sur les alternatives aux modes de vie traditionnels des seniors.
Si certains critiques pointent le caractère utopique de cette communauté où tout finit par s’arranger, d’autres y voient justement une force : celle de proposer un modèle différent de société, à l’heure où l’individualisme prévaut. Le mystère qui entoure l’identité de Paulette, révélée seulement dans les dernières pages, ajoute une dimension supplémentaire à cette chronique du quotidien qui redonne ses lettres de noblesse aux valeurs de partage et d’entraide.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 288 pages.
3. À Mélie, sans mélo (2008)
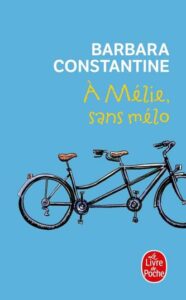
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Dans sa maison de campagne, Mélie, 72 ans, attend avec impatience l’arrivée de sa petite-fille Clara pour les grandes vacances. Quand son médecin l’appelle pour évoquer des résultats d’analyses inquiétants, elle refuse de l’écouter : ces deux mois avec Clara sont trop précieux pour les gâcher avec des soucis de santé.
L’été s’annonce radieux pour la grand-mère et sa petite-fille de 10 ans, rapidement rejointes par une joyeuse bande : Marcel, le vieux voisin bougon au grand cœur, Fanette, la mère de Clara, Gérard, le médecin de famille, et Antoine, le premier amour de Clara. Entre parties de pêche improvisées, construction de cabanes dans les arbres et contemplation des étoiles, ces vacances marquent un tournant dans leurs vies.
Autour du livre
Publié en 2008, « À Mélie, sans mélo » compte parmi les premières œuvres de Barbara Constantine. Sa signature s’y dessine déjà : une attention particulière aux liens entre générations, une préférence pour les personnages âgés aux caractères bien trempés, un goût pour les amitiés improbables. Dans la même veine que « Tom, petit Tom, tout petit homme, Tom » et « Et puis, Paulette… », Constantine traite avec tact des sujets graves comme la maladie ou la vieillesse, sans jamais les mettre au premier plan.
La force du texte réside dans sa capacité à sublimer le quotidien. Les moments anodins prennent une dimension extraordinaire : observer une araignée tisser sa toile devient une aventure, une balade à vélo se transforme en épopée. Cette alchimie opère grâce à des dialogues vivants qui reproduisent fidèlement le parler populaire, au risque parfois de dérouter certains lecteurs par leur oralité assumée.
Les personnages secondaires constituent l’autre point fort du récit. Marcel notamment, ancien résistant au caractère bourru, cache derrière ses râleries un lourd secret qu’il finira par révéler. Le dictaphone qu’il utilise pour raconter ses souvenirs de guerre ajoute une épaisseur historique à l’intrigue principale.
Constantine évite l’écueil du mélo, comme le promet le titre. La maladie de Mélie reste en arrière-plan, jamais nommée explicitement. Cette retenue permet de maintenir un équilibre entre légèreté et gravité, entre rires et larmes contenues. « À Mélie, sans mélo » préfigure ainsi les thèmes qui feront le succès des romans suivants de l’autrice : la solidarité intergénérationnelle, l’importance des petits bonheurs quotidiens, la force des liens qui se tissent par-delà ceux du sang.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 256 pages.
4. Allumer le chat (2007)
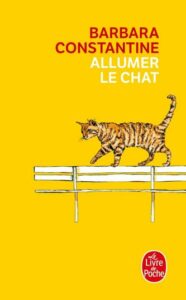
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Dans un village français, Raymond et Mine forment un vieux couple uni qui vit avec leur chat Bastos. Raymond, bourru mais attachant, tente régulièrement de « dégommer » le félin à coups de fusil, persuadé que celui-ci se moque de lui. Leur quotidien bascule quand leur fille Josette, avec qui ils sont brouillés depuis sept ans, les recontacte : son fils Rémi, 5 ans, souffre d’un eczéma que seuls les dons de guérisseur de Raymond pourraient soigner.
L’histoire prend un virage inattendu lorsque Martial, le mari de Josette, se tue en percutant un cerf sur la route. Sa veuve trouve alors du réconfort dans les bras d’Edith – qui n’est autre que l’ancienne maîtresse du défunt. Autour de cette famille gravitent des personnages excentriques : un croque-mort qui photographie ses « clients », une cuisinière spécialisée dans le pâté de rat, un enfant de dix ans alcoolique, et bien sûr Bastos, le chat philosophe qui observe tout ce petit monde avec ironie.
Autour du livre
Publié en 2007, « Allumer le chat » marque les débuts littéraires de Barbara Constantine, jusqu’alors céramiste et scripte pour le cinéma – elle a notamment collaboré au film « Les Poupées russes » de Cédric Klapisch. Cette première œuvre pose déjà les fondements de son univers singulier qu’elle développera ensuite dans « Tom, petit Tom, tout petit homme, Tom » et « Et puis, Paulette… ».
Les soixante-dix chapitres très courts insufflent un rythme effréné à ce qui pourrait n’être qu’une simple chronique villageoise. Chaque scène, titrée avec humour, agit comme une photographie instantanée de la vie des personnages. Cette construction fragmentée permet de passer d’un protagoniste à l’autre sans transition, créant un effet kaléidoscopique qui renforce l’aspect déjanté du récit. Cette structure narrative évoque l’influence du cinéma sur l’écriture de Constantine, avec des séquences qui s’enchaînent comme autant de plans successifs.
La force de la romancière réside dans sa capacité à aborder des sujets graves – l’inceste, l’abandon, la maltraitance, l’alcoolisme – tout en maintenant une légèreté de ton. Le langage cru et populaire des personnages contraste avec la tendresse qui émane de leurs relations. Les dialogues percutants rappellent parfois l’humour d’Audiard, comme le note un critique qui compare l’ambiance du livre à « Garfield semant la zizanie chez les Bidochon ».
Cette comédie sociale, saluée par la critique pour son originalité, s’inscrit dans la tradition du roman populaire français. Le critique littéraire Daniel Picouly y voit « les Deschiens qui auraient fait un enfant à Queneau », soulignant ainsi le mélange réussi entre l’absurde et l’observation sociale. La dimension chorale du récit, où même les animaux prennent la parole, crée une microsociété à la fois loufoque et profondément humaine.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 240 pages.