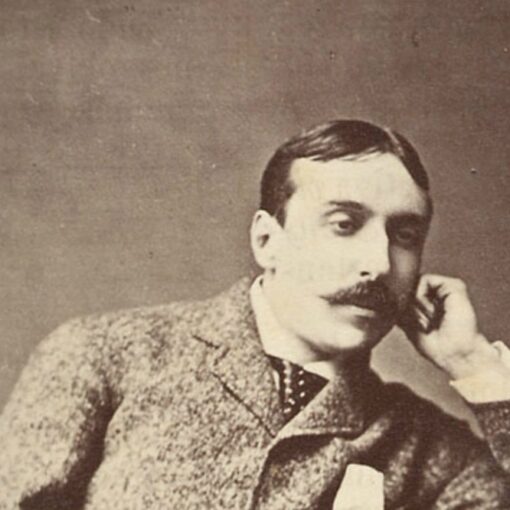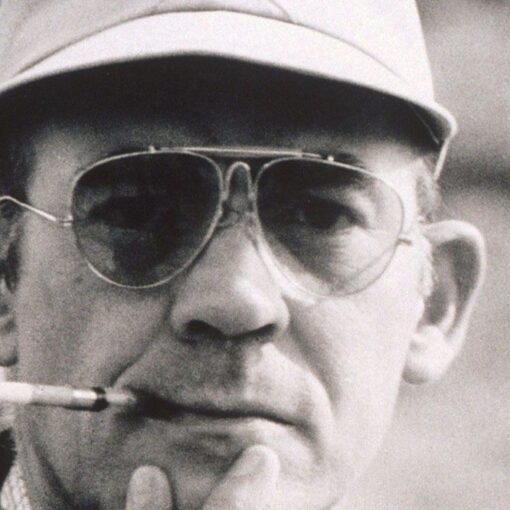Anna Gavalda est une écrivaine française née le 9 décembre 1970 à Boulogne-Billancourt. Son père travaille dans l’informatique bancaire tandis que sa mère fabrique des foulards pour de grandes marques. Elle suit des études littéraires avant d’enseigner le français au collège Nazareth à Voisenon.
Sa carrière littéraire décolle en 1999 avec son premier recueil de nouvelles « Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part », qui remporte le grand prix RTL-Lire et devient un succès international, traduit en vingt-sept langues. Ses romans suivants connaissent également un grand succès, notamment « Je l’aimais » (2002) et « Ensemble, c’est tout » (2004).
Anna Gavalda écrit aussi bien pour les adultes que pour les enfants, comme en témoigne son roman jeunesse « 35 kilos d’espoir » (2002). Plusieurs de ses œuvres ont été adaptées au cinéma, notamment « Ensemble, c’est tout » par Claude Berri en 2007 et « Je l’aimais » par Zabou Breitman en 2009. Elle collabore également au magazine Elle où elle tient une chronique sur la littérature jeunesse.
Mère de deux enfants, elle vit à Paris et continue d’écrire.
Voici notre sélection de ses livres majeurs.
1. Ensemble, c’est tout (roman, 2004)
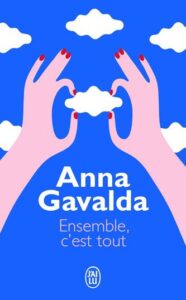
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Paris, années 2000. Quatre êtres écorchés par la vie se rencontrent par hasard. Camille, une jeune femme anorexique solitaire, survit en faisant des ménages la nuit tout en refoulant sa passion pour le dessin. Philibert, un aristocrate bègue féru d’histoire, occupe un immense appartement familial où il héberge Franck, un cuisinier au caractère bourru qui cache sa sensibilité derrière une façade de dur à cuire.
Leurs chemins croisent celui de Paulette, la grand-mère de Franck, une octogénaire qui dépérit dans sa maison de retraite. Réunis sous le même toit dans l’appartement bourgeois de Philibert, ces quatre personnages que tout oppose vont peu à peu s’apprivoiser et panser leurs blessures respectives. Entre les horaires décalés de Franck, les TOC de Philibert et les démons de Camille, une famille de cœur va peu à peu prendre forme.
Autour du livre
À travers l’histoire de quatre personnages que rien ne prédestinait à se rencontrer, « Ensemble, c’est tout » brosse un tableau sensible de la solidarité et de l’entraide face aux difficultés de la vie. L’écriture d’Anna Gavalda, parsemée de dialogues percutants et d’expressions familières, s’éloigne délibérément des conventions littéraires pour mieux saisir la réalité brute des relations humaines. Cette approche ne fait pas l’unanimité : certains critiques y voient une force qui donne vie aux personnages, d’autres déplorent un style trop oral qui multiplie les sauts de ligne et rend parfois difficile l’identification des interlocuteurs.
La force du livre réside dans sa capacité à transformer des situations quotidiennes en moments d’émotion pure. Des scènes comme le pique-nique improvisé sous les combles ou la soirée du 31 décembre dans les cuisines du restaurant illustrent comment les liens se tissent entre ces êtres cabossés. La présence récurrente de références culturelles – de Haendel à Van Gogh en passant par Marvin Gaye – enrichit le récit sans jamais l’alourdir.
Le succès du livre a conduit à son adaptation cinématographique en 2007 par Claude Berri, avec Audrey Tautou et Guillaume Canet dans les rôles principaux. Le casting, salué par la critique comme « parfait », a contribué à ancrer ces personnages dans l’imaginaire collectif. La romancière Agnès Ledig considère « Ensemble, c’est tout » comme « la plus belle histoire d’amitié dans un livre » et affirme même que sa lecture a déclenché sa propre vocation d’écrivaine.
Cette histoire de reconstruction collective résonne particulièrement avec les préoccupations sociales actuelles, notamment la crise du logement en région parisienne. Le thème des jeunes contraints de vivre dans des conditions précaires, abordé en 2004, garde toute sa pertinence plus de vingt ans plus tard. Le livre illustre comment la mise en commun des ressources et des talents peut créer des solutions inattendues aux difficultés sociales.
Aux éditions J’AI LU ; 576 pages.
2. Je l’aimais (roman, 2002)
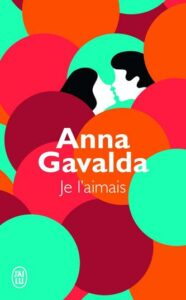
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Pierre, un homme de 65 ans à l’apparence froide et autoritaire, emmène sa belle-fille Chloé et ses deux petites-filles dans leur maison de campagne. Chloé vient d’être quittée par Adrien, le fils de Pierre, parti avec une autre femme. Effondrée, elle ne comprend pas ce départ brutal qui laisse sa famille en morceaux.
Au fil des heures passées ensemble dans cette demeure isolée, le masque du « vieux con » que Chloé attribuait à son beau-père commence à se fissurer. Pierre se confie alors sur sa propre histoire : il y a des années, il a vécu une passion dévorante avec Mathilde, une traductrice qui parcourait le monde. Mais par lâcheté ou par devoir, il a choisi de rester auprès de sa femme Suzanne et de leurs enfants, renonçant à celle qu’il aimait vraiment.
Autour du livre
Derrière une apparente simplicité, « Je l’aimais » soulève des questions profondes sur le courage et la lâcheté face aux choix amoureux. L’opposition entre le fils qui ose partir et le père qui n’a pas su le faire crée une tension dramatique qui traverse tout le texte. La confession nocturne de Pierre révèle peu à peu les conséquences d’un choix qui a marqué toute une vie : « On biaise, on s’arrange, on a notre petite lâcheté dans les pattes comme un animal familier. On la caresse, on la dresse, on s’y attache. »
Le texte prend la forme d’un dialogue intime où les silences comptent autant que les mots. Les personnages se dévoilent par petites touches, dans une progression subtile qui mène de l’incompréhension à une forme de réconciliation. Le père comme la belle-fille portent leurs blessures : lui avec son amour perdu pour Mathilde, elle avec sa rupture brutale. Cette symétrie des souffrances permet d’aborder la question de l’abandon sous ses deux faces : celui qui part et celui qui reste.
Zabou Breitman a adapté « Je l’aimais » au cinéma en 2009 avec Daniel Auteuil et Marie-Josée Croze dans les rôles principaux. En 2010, Patrice Leconte en propose une version théâtrale, soulignant ainsi la dimension scénique déjà présente dans le texte original à travers sa construction en huis clos. Ces multiples adaptations témoignent de la force dramatique du récit, qui tient moins à son intrigue qu’à la vérité des émotions qui s’y expriment.
La réussite de « Je l’aimais » réside dans sa capacité à transformer une situation banale – une rupture amoureuse – en un moment de vérité où deux êtres que tout sépare finissent par se reconnaître. Anna Gavalda évite les jugements moraux faciles pour interroger ce qui constitue le vrai courage en amour : partir ou rester, bouleverser ou préserver, assumer ses désirs ou protéger les autres.
Aux éditions J’AI LU ; 157 pages.
3. L’échappée belle (roman, 2001)
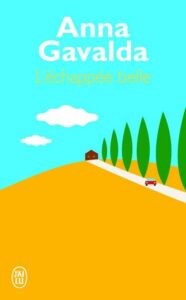
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Trois frères et sœurs – Garance, Simon, Lola – se rendent au mariage d’une cousine dans la campagne française. Simon, l’aîné, conduit, accompagné de son épouse Carine dont la maniaquerie exaspère sa sœur Garance. Lola, artiste divorcée, les rejoint en cours de route. Seul manque à l’appel Vincent, le benjamin, guide saisonnier dans un château.
L’ennui qui plane sur la cérémonie pousse la fratrie à faire faux bond aux convives. Sur un coup de tête, ils prennent la route pour retrouver leur petit frère Vincent. Cette escapade improvisée devient l’occasion de renouer avec leur complicité d’antan, de partager leurs doutes et leurs espoirs. Le temps d’une journée, ils retrouvent l’insouciance de leur jeunesse, loin des obligations et des conventions sociales.
Autour du livre
« L’échappée belle » paraît d’abord comme une exclusivité France Loisirs en 2001, avant d’être réédité et légèrement modifié pour une diffusion plus large. Cette histoire de fratrie saisit la quintessence des relations familiales dans toute leur complexité : les quatre protagonistes incarnent des personnalités contrastées qui s’entrechoquent et se complètent. Simon, le sage, porte le rôle de pilier familial malgré ses failles dissimulées. Lola, l’artiste divorcée, compose avec les blessures de sa séparation. Vincent, le musicien bohème, aborde la vie avec insouciance tandis que Garance navigue entre provocation et quête identitaire.
Les liens qui unissent ces quatre personnages transcendent leurs différences et leurs conflits. À travers leur complicité se dessine une réflexion sur le passage à l’âge adulte et la préservation des souvenirs d’enfance. Cette tension entre responsabilités et nostalgie constitue la colonne vertébrale du récit, portée par des dialogues qui oscillent entre humour cinglant et tendresse pudique. Les échanges entre Garance et sa belle-sœur Carine illustrent particulièrement cette dynamique : leurs joutes verbales, teintées d’ironie, révèlent les fractures et les non-dits familiaux.
La force de cette « Échappée belle » réside dans sa capacité à saisir l’essence des relations fraternelles sans tomber dans le sentimentalisme. Les situations cocasses s’enchaînent naturellement, servant de catalyseur aux émotions plutôt que de simples ressorts comiques. La dimension symbolique du chien qui suit Garance traduit subtilement son évolution personnelle : cette rencontre fortuite la pousse à reconsidérer ses choix de vie et à assumer enfin ses responsabilités d’adulte.
Ce texte concis – à peine 130 pages – fonctionne comme une parenthèse dans le temps, où chaque scène compte. La structure même du récit mime le caractère éphémère de cette réunion familiale : une échappée brève mais intense qui marque un tournant dans la vie des personnages.
Aux éditions J’AI LU ; 128 pages.
4. La consolante (roman, 2008)
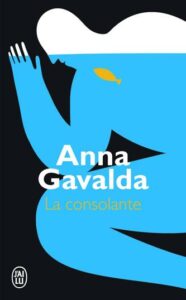
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
À 47 ans, Charles Balanda a tout pour être heureux : une carrière d’architecte florissante à Paris, une relation stable avec Laurence et une complicité touchante avec Mathilde, la fille de cette dernière. Un jour, il reçoit une lettre lui annonçant le décès d’Anouk, la mère de son ami d’enfance Alexis. Cette nouvelle le bouleverse inexplicablement et fait basculer son quotidien.
Charles perd le sommeil et l’appétit. Il se détourne peu à peu de son travail, commence à prendre ses distances avec son entourage, se met à questionner ses choix de vie. Son passé ressurgit par bribes, notamment ses souvenirs avec Anouk, cette femme anticonformiste qui avait tant marqué son adolescence. Sa fuite en avant le mène jusqu’à Kate, une jeune Anglaise qui vit retirée à la campagne avec plusieurs enfants et de nombreux animaux.
Autour du livre
« La consolante » marque une rupture dans la bibliographie d’Anna Gavalda lors de sa sortie en 2008. Ce cinquième opus se démarque d’abord par son format imposant de 640 pages et son tirage initial conséquent de 300 000 exemplaires, suivi d’un second tirage de 30 000 exemplaires en avril 2008.
La structure narrative innove par sa construction en quatre parties distinctes qui suivent l’évolution psychologique du protagoniste. Les premières pages déstabilisent volontairement le lecteur par leur style haché et leurs phrases sans sujet – un choix d’écriture qui reflète l’état mental chaotique de Charles. Cette fragmentation s’atténue progressivement à mesure que le personnage retrouve son équilibre intérieur.
Les personnages secondaires, particulièrement Kate et sa tribu atypique, insufflent une énergie vitale dans la seconde partie du livre. Leur mode de vie anticonformiste fait écho à celui d’Anouk et pose la question des choix de vie alternatifs dans une société normée.
Le titre fait référence au monde du billard : la consolante désigne cette dernière partie qu’on joue pour le plaisir après avoir perdu, comme une chance de tout recommencer. Cette métaphore résonne avec le parcours de Charles qui, à travers sa reconstruction personnelle, accède à une forme de rédemption.
Les avis des critiques se divisent nettement sur cette œuvre plus ambitieuse. Certains saluent l’audace stylistique et la profondeur psychologique, quand d’autres regrettent de ne pas retrouver la légèreté des précédents livres de Gavalda comme « Ensemble, c’est tout ». Cette polarisation des critiques témoigne d’un tournant artistique assumé, même si le succès commercial initial suggère que ce pari littéraire n’a pas rebuté le lectorat fidèle de l’autrice.
Aux éditions J’AI LU ; 640 pages.
5. Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part (recueil de nouvelles, 1999)
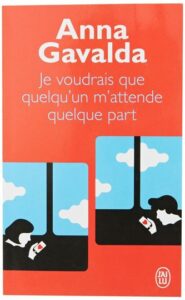
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
« Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part » rassemble douze nouvelles qui dressent le portrait d’hommes et de femmes ordinaires, saisis dans leur quotidien. Les récits s’enchaînent comme autant de fragments de vie, où l’attente – d’un signe, d’une réponse, d’un être cher – tient souvent le premier rôle.
La première nouvelle nous plonge sur le boulevard Saint-Germain, où une rencontre furtive entre deux inconnus pourrait tout changer. S’ensuivent des histoires de couples qui s’effritent, comme dans « Petites pratiques germanopratines », où une femme observe son mari s’éloigner inexorablement. « I.I.G. » aborde avec une délicatesse bouleversante le drame d’une grossesse interrompue, tandis que « Junior » dépeint avec humour les mésaventures d’un fils de bonne famille qui emprunte la Jaguar paternelle.
Dans « Permission », un jeune militaire en permission se confronte à l’ombre écrasante de son frère aîné. « Catgut » nous emmène dans le cabinet d’une vétérinaire de campagne, dont la vie bascule brutalement. « Clic-clac » évoque les souvenirs tenaces d’un premier amour, alors que « Le fait du jour » suit un employé de bureau secrètement épris d’une collègue. Le recueil se clôt sur un « Épilogue » où une aspirante écrivaine attend fébrilement des nouvelles de son éditeur.
Autour du livre
Premier recueil de nouvelles d’Anna Gavalda publié en 1999, « Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part » marque une entrée remarquée dans le milieu littéraire. Les douze nouvelles qui le composent lui valent le Grand Prix RTL-Lire 2000, consécration qui lance sa carrière d’écrivaine.
Les personnages qui peuplent ces pages ne cherchent pas à changer le monde ni à accomplir des actes héroïques. Ce sont des êtres ordinaires, croisés quotidiennement sans qu’on leur prête attention, mais dont la plume de Gavalda révèle soudain la charge émotionnelle. L’attente constitue le fil rouge qui relie ces douze récits : attente d’un signe, d’une invitation, d’un signal du destin ou simplement de quelqu’un sur un quai de gare.
Certaines nouvelles se distinguent particulièrement, comme « Catgut » qui saisit par son côté glaçant, « Junior » qui fait rire avec son histoire de sanglier dans une Jaguar, ou encore « I.I.G » (Interruption Involontaire de Grossesse) qui frappe par sa charge émotionnelle malgré un sujet difficile. L’épilogue, où l’autrice se met elle-même en scène avec autodérision dans le rôle d’une aspirante écrivaine, clôt le recueil sur une note d’humour.
Un détail qui date le livre : les prix sont encore mentionnés en francs, créant aujourd’hui un effet vintage involontaire qui témoigne de cette fin des années 1990. Plus récemment, le cinéaste Arnaud Viard a adapté ces nouvelles au cinéma, avec Jean-Paul Rouve et Alice Taglioni. Le film prend le parti de relier tous les personnages par un lien fraternel, alors qu’ils étaient indépendants dans le livre.
Cette première œuvre dévoile déjà les thèmes qui caractériseront les futurs romans de Gavalda comme « Ensemble c’est tout » : une attention particulière aux petits moments de la vie, un mélange d’humour et de mélancolie, une capacité à saisir les émotions dans leur complexité. Le succès de ce recueil ouvre la voie à une série d’autres ouvrages qui confirmeront la popularité de l’autrice auprès du public.
Aux éditions J’AI LU ; 156 pages.
6. Fendre l’armure (recueil de nouvelles, 2017)
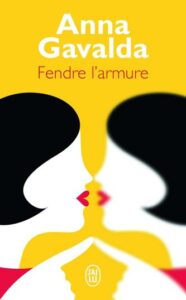
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
« Fendre l’armure » rassemble sept nouvelles qui dévoilent des moments décisifs dans la vie de personnages ordinaires. À travers ces récits, Anna Gavalda saisit l’instant où une rencontre fait tomber les défenses et révèle la vulnérabilité de chacun.
« L’amour courtois » narre l’histoire de Ludmila, vendeuse dans une animalerie, qui rencontre un jeune poète lors d’une soirée mondaine. Le choc de leurs univers sociaux donne naissance à une romance improbable où se mêlent désir et appréhension. Dans « La maquisarde », une jeune veuve alcoolique partage une nuit de confidences avec une inconnue croisée dans un bar, confrontant leurs solitudes et leurs chagrins respectifs.
« Mon chien va mourir » brosse le portrait poignant d’un routier qui accompagne son vieux compagnon à quatre pattes chez le vétérinaire pour un dernier voyage, lequel ravive la douleur de la mort de son fils. « Happy Meal » raconte un déjeuner au fast-food entre un homme et une jeune fille, une histoire à la chute surprenante qui force à relire le texte sous un autre angle.
« Mes points de vie » met en scène un père confronté à la bêtise de son fils de six ans qui a crevé les pneus du fauteuil roulant d’un camarade handicapé. « Le fantassin » dépeint une amitié singulière entre deux voisins de palier que relie une passion commune pour les chaussures, jusqu’au suicide de l’un d’eux. Le recueil se clôt sur « Un garçon », l’histoire d’un trentenaire revenant du mariage de son ex-fiancée, qui fait une rencontre nocturne qui bouleverse ses certitudes.
Autour du livre
À travers sept nouvelles à la première personne, « Fendre l’armure » dévoile des personnages dans leurs moments de vulnérabilité. Anna Gavalda s’attache à représenter ce qu’elle nomme elle-même « la vraie vie des vraies gens », refusant catégoriquement de les considérer comme de simples personnages de fiction. Cette posture transparaît dès la note d’intention qui ouvre le recueil, où elle confie sa difficulté à présenter son livre aux libraires et aux critiques.
Le recueil se distingue par sa capacité à faire cohabiter des registres de langue radicalement différents. La première nouvelle bouscule d’emblée les conventions avec un langage très oral et familier, qui désarçonne certains lecteurs – notamment belges qui avouent leur incompréhension totale. Ce choix stylistique audacieux s’avère pourtant parfaitement adapté pour incarner une jeune vendeuse d’animalerie.
Les critiques soulignent la grande diversité des portraits brossés : du routier au chef d’entreprise, de la veuve alcoolique au père de famille, chaque voix sonne juste dans sa singularité. Plusieurs textes ressortent particulièrement aux yeux des lecteurs : « Mon chien va mourir », qui parvient à émouvoir même les plus réticents aux histoires d’animaux, ou encore « Happy Meal » dont la chute inattendue pousse à relire immédiatement la nouvelle sous un autre angle.
Le recueil marque pour beaucoup un retour réussi d’Anna Gavalda à la forme courte qui l’avait révélée avec « Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part ». L’accueil critique s’avère globalement très positif, notamment lors de son passage dans l’émission « Le Masque et la Plume » sur France Inter. Seule la nouvelle « Le Fantassin » divise davantage, certains la trouvant trop longue ou obscure, d’autres y voyant des échos de « La Chute » de Camus.
Le fil conducteur du recueil – ces moments où les personnages « fendent l’armure » – permet d’aborder avec tact des thèmes comme la solitude, le deuil ou le handicap. La force du livre réside dans sa capacité à traiter ces sujets graves sans pathos excessif, en privilégiant toujours l’authenticité des émotions et des situations.
Aux éditions J’AI LU ; 275 pages.
7. Des vies en mieux (recueil de nouvelles, 2014)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
« Des vies en mieux » réunit trois récits d’Anna Gavalda qui décrivent ce moment où tout bascule dans la vie de jeunes gens. Ces nouvelles, initialement publiées séparément dans « Billie » et « La vie en mieux », forment un triptyque sur le désir de changement et la recherche d’authenticité.
La première nouvelle suit Billie, une adolescente issue d’un milieu précaire, qui raconte sa vie depuis le fond d’une crevasse des Cévennes où elle est bloquée avec son ami Franck. C’est grâce à une pièce de Musset, « On ne badine pas avec l’amour », et à cette amitié improbable avec ce garçon fragile que sa vie prend un nouveau tournant.
Dans la deuxième histoire, Mathilde, 24 ans, oublie son sac contenant une importante somme d’argent dans un café. Un inconnu le lui rapporte intact une semaine plus tard, déclenchant chez elle une profonde remise en question.
Le dernier récit met en scène Yann, 26 ans, qui réalise lors d’une soirée improvisée chez ses voisins que sa vie bien rangée avec Mélanie n’est qu’une façade derrière laquelle il étouffe.
Les trois protagonistes se ressemblent dans leur fragilité et leur désir de s’échapper d’une existence qui ne leur correspond pas. Chacun trouve, à travers une rencontre décisive, le courage de bousculer son quotidien pour tenter de vivre authentiquement. Ces trois chemins d’émancipation résonnent avec « Ensemble c’est tout », le roman qui avait fait connaître Gavalda au grand public.
Autour du livre
Ce recueil réunit deux précédents ouvrages d’Anna Gavalda, « Billie » et « La vie en mieux », tous deux parus initialement en 2013 aux éditions Le Dilettante. La publication sous cette nouvelle forme rassemble trois récits indépendants qui gravitent autour d’un même thème : la métamorphose de jeunes gens malmenés par l’existence qui choisissent de prendre leur destin en main.
La particularité de ces trois nouvelles réside dans leur traitement linguistique distinct, adapté à chaque protagoniste. Pour Billie, le texte adopte une langue crue, brutale, parfois vulgaire, qui retranscrit la violence du milieu social dont elle provient. Cette écriture saccadée et familière, qui peut dérouter certains lecteurs, traduit la rage et la souffrance du personnage. Dans la deuxième nouvelle, le parlé « branché » de Mathilde fait écho à son statut d’étudiante en Histoire de l’Art, tandis que la dernière partie consacrée à Yann retrouve une certaine fluidité narrative.
Les références culturelles parsèment subtilement le texte, créant une connivence avec le lecteur attentif : Victor Hugo, Rimbaud, Musset notamment avec « On ne badine pas avec l’amour » qui joue un rôle central dans l’histoire de Billie. Cette intertextualité nourrit la dimension sociale du recueil, qui met en scène des personnages issus de milieux défavorisés ou en rupture avec leur environnement.
Le livre a connu un important succès commercial lors de sa sortie en format poche, sa couverture acidulée et estivale ayant sans doute contribué à séduire un large public. Cependant, les critiques demeurent partagées : si certains lecteurs retrouvent l’émotion qui avait fait le succès d’ « Ensemble c’est tout », d’autres regrettent un manque d’approfondissement des personnages et des situations.
La structure en trois récits indépendants suscite également des réactions contrastées. L’absence de liens entre les protagonistes frustre les attentes de certains lecteurs qui espéraient voir les destins se croiser. Néanmoins, l’unité thématique autour de la résilience et du courage de changer sa vie confère sa cohérence à l’ensemble.
Aux éditions J’AI LU ; 442 pages.