Alexandre Soljenitsyne voit le jour le 11 décembre 1918 à Kislovodsk, dans le nord du Caucase. Son père, Issaaki, officier de l’armée russe et étudiant en philologie, meurt avant sa naissance. Sa mère, Taïssia, d’origine ukrainienne, élève seule ce fils qui grandit dans la foi orthodoxe avant d’être happé par l’idéologie communiste.
Brillant étudiant, il mène de front des études de mathématiques et de littérature. La guerre éclate alors qu’il vient d’épouser Natalia Rechetovskaïa. Mobilisé, il devient capitaine d’artillerie et se distingue sur le front. Mais en 1945, le SMERSH l’arrête : dans sa correspondance privée, il a osé critiquer Staline. Cette audace lui vaut huit ans de détention dans les camps du Goulag.
La mort de Staline en 1953 ne lui apporte qu’une liberté relative : il est envoyé en relégation au Kazakhstan. Ce n’est qu’en 1956 qu’il peut rentrer en Russie. La période du dégel khrouchtchévien lui permet de publier en 1962 « Une journée d’Ivan Denissovitch », première œuvre dévoilant l’univers concentrationnaire soviétique. Le succès est immédiat, mais l’arrivée de Brejnev au pouvoir marque le retour de la censure.
Soljenitsyne entre alors dans la clandestinité pour poursuivre son œuvre. Le Prix Nobel de littérature en 1970 accroît sa notoriété internationale. En 1973, la publication à Paris de « L’Archipel du Goulag », témoignage monumental sur le système répressif soviétique, provoque un séisme politique. Le pouvoir réagit : en 1974, l’écrivain est arrêté, déchu de sa citoyenneté et expulsé vers l’Allemagne.
S’installe alors une longue période d’exil, principalement aux États-Unis, où il s’établit dans le Vermont. Là, il se consacre à son œuvre monumentale, « La Roue rouge », fresque historique sur l’effondrement de la Russie impériale. La perestroïka lui permet enfin de retrouver sa citoyenneté. En 1994, il rentre triomphalement en Russie, traversant le pays d’est en ouest en train.
Dans ses dernières années, il maintient une position critique face au pouvoir tout en recevant les honneurs officiels. Figure complexe, à la fois dissident et patriote russe, chrétien orthodoxe et critique acerbe de la société de consommation occidentale, il s’éteint à Moscou le 3 août 2008, laissant derrière lui une œuvre monumentale qui témoigne des tragédies du XXe siècle.
Voici notre sélection de ses livres majeurs.
1. L’Archipel du Goulag (essai d’investigation, 1973)
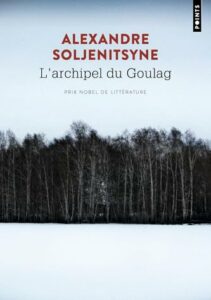
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
« L’Archipel du Goulag », structuré en trois tomes et sept parties, retrace l’histoire du système concentrationnaire soviétique de 1918 à 1956. La première partie, « L’industrie pénitentiaire », décrit la mise en place systématique de l’appareil répressif dès la révolution bolchévique. Soljenitsyne y expose les mécanismes de l’arrestation, les techniques d’interrogatoire et le système judiciaire expéditif.
La deuxième partie, « Mouvement perpétuel », suit le parcours des détenus à travers le réseau des camps. Les vagues d’arrestations successives alimentent ce système : d’abord les cadets en 1917, puis les socialistes-révolutionnaires et les sociaux-démocrates, suivis des paysans opposés à la collectivisation, des officiers, des membres du clergé, et plus tard des « ennemis du peuple » sous Staline.
Les troisième et quatrième parties nous plongent dans la réalité quotidienne des camps. On y découvre les conditions de détention, le travail forcé, la hiérarchie entre détenus où les criminels de droit commun bénéficient d’un traitement privilégié par rapport aux prisonniers politiques. Soljenitsyne souligne comment l’administration organise délibérément la compétition entre détenus pour leur survie, instaurant un système où « un ou deux morts reviennent à un survivant ».
La cinquième partie traite de la « katorga » (travaux forcés), tandis que la sixième aborde la question de l’exil intérieur, où les anciens détenus, même libérés, restent assignés à résidence dans des régions reculées. La septième partie se penche sur l’évolution du système après la mort de Staline.
Au fil des pages, l’auteur mêle témoignages personnels et récits collectés auprès de 227 anciens détenus. Il démontre comment le système concentrationnaire servait non seulement d’instrument de répression politique mais aussi de source de main-d’œuvre gratuite pour les grands projets soviétiques, comme la construction du canal de la mer Blanche ou le développement de la Sibérie.
Soljenitsyne révèle également comment la terreur s’étendait au-delà des camps, imprégnant toute la société soviétique d’une atmosphère de peur et de méfiance, où la délation devenait un moyen de survie. Il souligne particulièrement que le système des camps ne constituait pas une déviation du projet soviétique mais en était une composante intrinsèque, présente dès ses débuts sous Lénine.
Autour du livre
« L’Archipel du Goulag » se distingue par sa nature hybride, entre chronique historique et témoignage littéraire. Cette « investigation littéraire », selon les mots mêmes de Soljenitsyne, puise sa matière dans les récits de 227 anciens détenus et dans l’expérience personnelle de l’auteur. La métaphore de l’archipel, qui donne son titre à l’œuvre, évoque la multiplication des camps à travers l’URSS, telles des îles isolées sur l’ensemble du territoire.
La genèse de l’ouvrage s’étend sur une décennie, de 1958 à 1968, dans des conditions de clandestinité extrême. Pour déjouer la surveillance du KGB, Soljenitsyne ne travaille jamais sur le manuscrit complet, mais disperse les différentes parties chez des amis de confiance à Moscou et ses environs. Parmi ses collaborateurs secrets, surnommés les « invisibles », Nadejda Levitskaïa et Natalia Anitchkova, elles-mêmes anciennes détenues, l’assistent dans cette entreprise périlleuse.
Le destin tragique d’Elizaveta Voronyanskaya, une des dactylos de confiance de l’auteur, précipite la publication de l’œuvre. Après avoir révélé sous la torture l’emplacement d’une copie du manuscrit au KGB, elle est retrouvée pendue dans son appartement en août 1973. Cet événement pousse Soljenitsyne à autoriser la publication immédiate du texte à Paris, aux éditions YMCA-Press.
L’impact de l’ouvrage se révèle considérable. George F. Kennan le qualifie de « plus puissante dénonciation d’un régime politique jamais formulée à l’époque moderne ». Les droits d’auteur sont versés à un fonds d’aide aux prisonniers politiques soviétiques et à leurs familles, opérant clandestinement. « L’Archipel du Goulag » contribue significativement à l’affaiblissement des partis communistes en Europe occidentale, particulièrement en France, en Italie et en Espagne.
La réception de l’ouvrage en France provoque un séisme intellectuel majeur. Le Parti communiste français tente de neutraliser sa portée en stigmatisant l’auteur, l’accusant notamment de sympathies pro-nazies. Jean Daniel note que Soljenitsyne subit une campagne de calomnies « avec une force, une orchestration, une insistance qui ont égaré jusqu’à nos amis socialistes ».
En 2009, « L’Archipel du Goulag » intègre le programme scolaire russe, marquant une reconnaissance officielle de sa valeur historique et littéraire. Un documentaire français, « L’Histoire secrète de l’Archipel du Goulag », réalisé en 2008 par Nicolas Milétitch et Jean Crépü, retrace l’histoire de sa création et le destin des personnes impliquées dans sa réalisation.
Aux éditions POINTS ; 924 pages.
2. Le pavillon des cancéreux (roman, 1966)
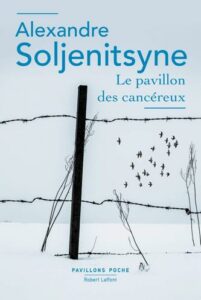
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
En 1955, dans un hôpital de Tachkent en Ouzbékistan soviétique, le pavillon 13 accueille les malades du cancer. Dans ce lieu austère se croisent des destins que tout oppose. Deux hommes en particulier incarnent les antagonismes de la société post-stalinienne : Paul Roussanov, un haut fonctionnaire zélé, et Oleg Kostoglotov, un ancien prisonnier du goulag. L’un a prospéré en dénonçant ses compatriotes, l’autre a payé de sa liberté ses critiques du régime.
Autour d’eux gravitent d’autres figures : le jeune Vadim qui rêve de grandes découvertes scientifiques, Ephrem qui s’éveille à la littérature, le docteur Dontsova confrontée elle aussi à la maladie. Une équipe médicale presque exclusivement féminine s’affaire entre les lits, avec des moyens limités. Dans ce microcosme, la hiérarchie sociale s’efface devant l’égalité face à la maladie. En toile de fond, l’URSS post-stalinienne commence sa mutation.
Autour du livre
« Le pavillon des cancéreux » est un roman semi-autobiographique qui puise dans l’expérience de Soljenitsyne. Déporté puis relégué au Kazakhstan, l’auteur subit deux attaques cancéreuses en 1952 et 1954, dont il sort guéri. Cette expérience directe de la maladie nourrit la création du personnage d’Oleg Kostoglotov, lui-même ancien déporté et relégué.
La genèse du roman s’inscrit dans un contexte politique complexe. Sa rédaction débute en 1963, pendant le « dégel » khrouchtchévien, mais la chute de Khrouchtchev en 1964 et l’arrivée de Brejnev au pouvoir compliquent la situation des écrivains non conformistes. La première partie, achevée entre 1963 et 1966, est proposée à la revue Novy Mir qui refuse sa publication, tout comme d’autres maisons d’édition soviétiques. Le roman circule alors en samizdat (auto-édition clandestine) et fait l’objet en novembre 1966 d’une séance de l’Union des écrivains soviétiques qui soutient l’auteur. La seconde partie est terminée en 1967, alors que l’existence du roman est déjà connue en Occident.
« Le pavillon des cancéreux » dépeint la société soviétique à travers le microcosme d’un service de cancérologie provincial, en février et mars 1955, au moment où émergent les premiers signes de la déstalinisation. Le choix du cancer comme métaphore politique s’avère particulièrement puissant : « Une personne meurt d’une tumeur, comment un pays peut-il survivre avec des tumeurs comme les camps de travail et les exils ? » Cette analogie entre la maladie individuelle et le système totalitaire soviétique traverse l’ensemble du roman.
Les personnages incarnent différentes positions face au régime stalinien : du bureaucrate opportuniste Rusanov au prisonnier politique Kostoglotov, en passant par ceux qui se sont tus ou ont collaboré. Soljenitsyne interroge la responsabilité morale de chacun, notamment à travers les réflexions du bibliothécaire Chouloubine qui regrette son silence face aux crimes du régime.
La dimension médicale occupe également une place centrale. Le professeur Lev Durnov, médecin oncologue, souligne la précision remarquable des descriptions médicales : « On croirait que l’ouvrage a été écrit par un médecin diplômé ». Soljenitsyne met en lumière les relations complexes entre médecins et patients, notamment la pratique du mensonge médical, les médecins dissimulant aux malades la gravité de leur état.
L’interdiction de publication en URSS conduit à des éditions non autorisées en Occident. Une version russe paraît en Italie en 1968, suivie de traductions, notamment en Grande-Bretagne. Cette circulation clandestine entraîne l’exclusion de Soljenitsyne de l’Union des écrivains soviétiques en 1969. Le roman ne sera publié officiellement en URSS qu’en 1990.
« Le pavillon des cancéreux » connaît plusieurs adaptations, notamment une version télévisée allemande de 150 minutes en 1970, réalisée par Heinz Schirk avec Martin Benrath, Siegfried Lowitz et Vera Tschechowa dans les rôles principaux. Plus récemment, en 2012, une adaptation théâtrale de John von Düffel est créée au Hans-Otto-Theater.
Aux éditions ROBERT LAFFONT ; 784 pages.
3. Une journée d’Ivan Denissovitch (roman, 1962)
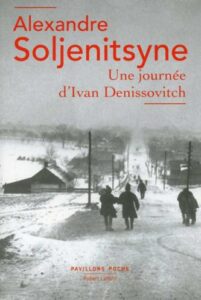
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
En 1962, Alexandre Soljenitsyne publie « Une journée d’Ivan Denissovitch », premier récit à lever le voile sur l’univers concentrationnaire soviétique. Le roman raconte une journée dans la vie d’Ivan Denissovitch Choukhov, prisonnier d’un camp de travail en Sibérie au début des années 1950.
Ancien soldat fait prisonnier par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, Choukhov a été condamné à dix ans de bagne pour « espionnage ». Dans un froid mordant qui peut atteindre les -40 °C, il lutte chaque jour pour survivre avec sa brigade de forçats. Le récit dépeint ses stratégies quotidiennes : économiser son pain, négocier une soupe supplémentaire, voler des outils, éviter les punitions qui pourraient l’envoyer au cachot. Malgré huit années déjà passées au camp, il conserve sa dignité et son humanité.
Autour du livre
Fruit de sa propre expérience dans les camps du Goulag, « Une journée d’Ivan Denissovitch » naît d’abord dans l’esprit de Soljenitsyne pendant l’hiver 1950-1951, alors qu’il purge sa peine au camp d’Ekibastuz dans le nord du Kazakhstan. L’idée lui vient en portant des briques avec un compagnon : plutôt que de décrire l’intégralité du système concentrationnaire soviétique, il choisit de se concentrer sur une seule journée ordinaire d’un prisonnier ordinaire, estimant que cette approche suffira à tout dire de l’horreur du Goulag.
La rédaction s’effectue en à peine quarante jours en 1959, une fois Soljenitsyne libéré et installé à Riazan. Le manuscrit, initialement intitulé « Chtch-854 » d’après le matricule du personnage principal, parvient en 1961 à Alexandre Tvardovski, rédacteur en chef de la revue Novy Mir. Celui-ci, bouleversé par sa lecture, mobilise toutes ses forces pour obtenir sa publication. Le texte circule alors parmi les grandes figures littéraires soviétiques : Tchoukovski qualifie l’œuvre de « miracle littéraire », comparant Ivan Denissovitch au Vassili Tiorkine de Tvardovski pour sa résilience et son incarnation de l’âme russe.
La publication en novembre 1962 dans Novy Mir constitue un séisme dans l’histoire littéraire soviétique : pour la première fois, un témoignage sur le Goulag paraît officiellement en URSS. Cette parution n’est rendue possible que par le contexte de la déstalinisation et l’approbation personnelle de Khrouchtchev, qui y voit un outil pour sa politique. Le tirage initial de 96 900 exemplaires s’épuise en quelques heures. Deux rééditions suivent début 1963, portant le total à près d’un million d’exemplaires.
La singularité de l’œuvre réside dans son choix narratif : plutôt que de dépeindre une journée exceptionnellement terrible, Soljenitsyne décrit une journée « presque heureuse » où le protagoniste obtient une ration supplémentaire. Ce parti pris renforce paradoxalement la puissance du témoignage en révélant ce qui constitue le bonheur dans l’univers concentrationnaire. L’humour noir perce notamment dans la conclusion, où Ivan compte les trois jours supplémentaires que les années bissextiles ajoutent à sa peine.
L’impact est immédiat : les lettres affluent vers l’auteur, principalement d’anciens détenus qui témoignent à leur tour. Ces correspondances fourniront plus tard la matière de « L’Archipel du Goulag ». La poétesse Anna Akhmatova déclare que chaque citoyen soviétique devrait apprendre le texte par cœur. À l’inverse, certains critiques reprochent à Soljenitsyne d’avoir choisi un simple paysan comme protagoniste plutôt qu’un intellectuel ou un membre du Parti.
« Une journée d’Ivan Denissovitch » connaît une diffusion internationale rapide avec des traductions dans de nombreuses langues dès 1963. Toutefois, après la chute de Khrouchtchev en 1964, elle est progressivement retirée des bibliothèques soviétiques. En 1974, lorsque Soljenitsyne est expulsé d’URSS, tous ses livres sont officiellement bannis. Le roman ne reparaîtra en URSS qu’en 1990.
Selon Vitali Korotitch, rédacteur en chef du magazine Ogoniok pendant la perestroïka, « l’Union soviétique a été détruite par l’information – et cette vague a commencé avec Une journée d’Ivan Denissovitch ». Le roman inspire plusieurs adaptations, notamment un téléfilm américain avec Jason Robards Jr. (1963) et un long-métrage britannico-norvégien (1970). Une version russe voit le jour en 2021 sous la direction de Gleb Panfilov, tandis qu’une adaptation en opéra par Alexandre Tchaikovski est créée en 2009.
Aux éditions ROBERT LAFFONT ; 240 pages.
4. Le Premier Cercle (roman, 1968)
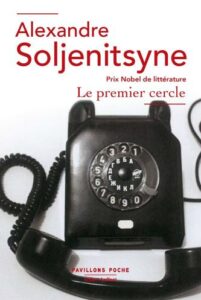
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Dans la Moscou glaciale de décembre 1949, un jeune diplomate soviétique, Innokenty Volodine, apprend qu’un complot se trame contre un médecin ami de sa famille. Malgré la terreur qui règne sous Staline, il décide de le prévenir en téléphonant d’une cabine publique. Son appel est intercepté.
Or, non loin de la capitale, dans la prison-laboratoire de Mavrino – surnommée « charachka » -, des détenus travaillent sur un système de reconnaissance vocale. Ces hommes, ingénieurs et techniciens de haut niveau tombés en disgrâce, constituent une élite carcérale privilégiée : ils mangent à leur faim et sont dispensés de corvées, loin des conditions effroyables du goulag. Mais leur sort reste précaire. Un faux pas, et c’est la déportation vers les camps de travail. Parmi eux se trouve Gleb Nerjine, la figure centrale du récit, qui est chargé d’analyser l’enregistrement avec ses codétenus pour identifier la voix du « traître ».
Autour du livre
Le titre du « Premier Cercle » fait référence aux Limbes, premier cercle de l’Enfer dans « La Divine Comédie » de Dante, où les philosophes grecs et autres païens vertueux demeurent dans un jardin verdoyant ceint de murs. Cette analogie avec l’œuvre de Dante se révèle particulièrement pertinente : tout comme ces philosophes qui, nés avant le Christ, ne peuvent accéder au paradis mais bénéficient d’une relative liberté au cœur des enfers, les prisonniers de la charachka jouissent de conditions de détention moins rigoureuses que dans les autres camps du Goulag, tout en restant privés de leur liberté.
La genèse du roman s’étend sur plus d’une décennie, avec de multiples versions et remaniements. Une première mouture de 96 chapitres voit le jour entre 1955 et 1958, basée sur l’expérience de Soljenitsyne dans la charachka de Marfino. En 1964, l’écrivain produit une version édulcorée de 87 chapitres dans l’espoir d’une publication en URSS. Cette autocensure le conduit notamment à modifier un élément crucial de l’intrigue : l’appel téléphonique du diplomate Volodine ne concerne plus la bombe atomique mais un secret médical. Malgré ces concessions, le manuscrit est saisi par le KGB en 1965.
La dimension autobiographique imprègne profondément l’œuvre. Le personnage de Gleb Nerjine incarne l’auteur lui-même, tandis que d’autres protagonistes s’inspirent de compagnons de détention : Lev Roubine trouve son modèle en Lev Kopelev, philologue et dissident, et Dmitri Sologdine en Dmitri Panin, ingénieur-constructeur et philosophe. Cette transposition du vécu confère au roman une authenticité poignante dans sa description du quotidien des détenus et des dilemmes moraux auxquels ils font face.
« Le Premier Cercle » soulève une question éthique fondamentale à travers le choix cornélien qui se pose aux prisonniers : collaborer avec un système oppressif pour préserver des conditions de vie relativement confortables, ou refuser cette compromission au prix d’un transfert vers les camps les plus durs du Goulag. Cette problématique se cristallise particulièrement dans l’opposition entre Lev Roubine, qui demeure un communiste convaincu malgré son emprisonnement, et Gleb Nerjine, qui préfère renoncer aux privilèges de la charachka plutôt que de mettre son intelligence au service du régime.
Le succès du roman a donné lieu à plusieurs adaptations : une version cinématographique par Aleksander Ford en 1973, une mini-série télévisée en 1992 avec Christopher Plummer et F. Murray Abraham, et même un opéra composé par Gilbert Amy en 1999. En 2006, une nouvelle adaptation télévisée russe voit le jour, pour laquelle Soljenitsyne lui-même participe à l’adaptation et assure la narration.
La publication de la version intégrale de 96 chapitres doit attendre 1978 (en russe) et 2009 (en anglais), permettant enfin aux lecteurs de découvrir l’œuvre dans sa forme originelle, non censurée, telle que l’auteur l’avait initialement conçue.
Aux éditions ROBERT LAFFONT ; 1008 pages.
5. La maison de Matriona (roman, 1963)
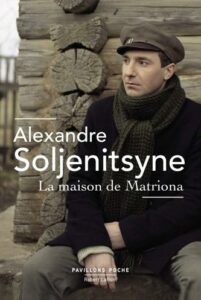
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
À l’été 1956, après dix années d’internement dans un camp soviétique, Ignatitch regagne la Russie centrale. Il accepte un poste de professeur de mathématiques dans le village reculé de Talnavo. Une vieille femme, Matriona Vassilievna, lui offre le gîte dans son isba délabrée où cohabitent souris et cafards. Entre ces murs branlants naît une relation singulière entre le narrateur et son hôtesse.
Le quotidien est rude dans cette campagne soviétique des années 1950. Ancienne kolkhozienne privée de retraite par la bureaucratie soviétique, Matriona mène une existence précaire. Elle cultive des pommes de terre, chaparde de la tourbe pour se chauffer. Elle garde néanmoins une générosité sans bornes, toujours prête à aider ses voisins qui abusent de sa bonté sans jamais la rémunérer. Au fil des soirées, elle confie son histoire à Ignatitch : ses six enfants morts en bas âge, son mariage avec Efime alors qu’elle était promise à son frère Faddeï.
Autour du livre
Considérée par Andreï Siniavski comme la pierre angulaire de toute la « littérature rurale russe », la genèse de « La maison de Matriona » remonte à l’été 1959, quand Soljenitsyne commence sa rédaction dans la ville de Tchernomorski en Crimée occidentale, où il séjourne chez des amis rencontrés pendant son exil au Kazakhstan. Le texte est achevé en décembre de la même année. Le 26 décembre 1961, l’auteur soumet son manuscrit à Alexandre Tvardovski, rédacteur en chef de Novy Mir. Si ce dernier juge d’abord la publication impossible, le succès d’ « Une journée d’Ivan Denissovitch » le pousse à reconsidérer sa position. Dans son journal, Tvardovski note alors avec admiration : « Mon Dieu, quel écrivain […] Pas l’ombre d’une tentative de ‘faire mouche’, de flatter, de faciliter la tâche du rédacteur ou du critique ».
Le roman paraît finalement dans le numéro de janvier 1963 de Novy Mir, aux côtés d’ « Incident à la gare de Kotchetovka ». Contrairement à « Une journée d’Ivan Denissovitch », globalement bien accueilli par la critique, « La maison de Matriona » déclenche des débats houleux dans la presse soviétique, notamment dans Literatournaïa Rossia à l’hiver 1964.
L’œuvre s’inspire de faits réels : le personnage de Matriona est basé sur Matriona Vassilievna Zakharova (1896-1957), qui vivait dans le village de Miltsevo (rebaptisé Talnovo dans le récit). En 2012, sa maison, destinée à devenir un musée, est détruite par un incendie, possiblement criminel. Un musée ouvre finalement ses portes le 26 octobre 2013 dans une reconstruction de la maison, installée près de l’école de Mezinovo où Soljenitsyne enseignait.
Une analyse psychanalytique proposée par Gisela Pankow en 1972 met en lumière le thème central de la « maison désarticulée ». Selon elle, le destin tragique de Matriona découle d’une rupture identitaire survenue dans sa jeunesse, quand elle épouse le frère de son fiancé présumé mort, créant ainsi une identification secrète entre elle-même et sa maison, qui la conduira ultimement à sa perte.
« La maison de Matriona » connaît de nombreuses adaptations théâtrales, notamment au Théâtre Vakhtangov (2008), au BBC Radio (2008-2009), au Théâtre dramatique de Krasnoïarsk (2018) et au Théâtre de marionnettes de Vladimir (2018), preuves de sa résonance durable dans la culture russe.
Aux éditions ROBERT LAFFONT ; 304 pages.




