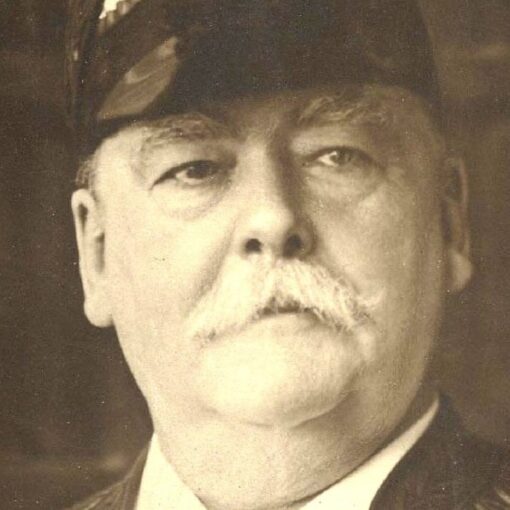Robert Seethaler est un écrivain, scénariste et acteur autrichien né le 7 août 1966 à Vienne. Issu d’une famille ouvrière (son père était serrurier et sculpteur sur bois, sa mère secrétaire), il grandit dans le dixième arrondissement de Vienne. En raison d’un problème de vue congénital sévère (-18 à -19 dioptries), il fréquente d’abord une école pour malvoyants avant de poursuivre sa scolarité dans un lycée qu’il quitte à quinze ans.
Avant de se consacrer à l’écriture, il exerce divers métiers : vendeur, coursier pour le journal Kurier, ouvrier dans un élevage de dindes en Israël, physiothérapeute, vendeur de disques. Il suit ensuite une formation d’acteur à l’école du Wiener Volkstheater et participe à de nombreuses productions cinématographiques, télévisuelles et théâtrales à Vienne, Berlin, Stuttgart et Hamburg. Il est notamment connu pour son rôle du Dr Kneissler dans la série « Ein starkes Team » et pour son apparition aux côtés de Rachel Weisz dans « Youth » de Paolo Sorrentino (2015).
Sa carrière d’écrivain débute en 2006 avec « Die Biene und der Kurt ». Il connaît un succès international avec « Le tabac Tresniek » (2012), « Une vie entière » (2014) et « Le Champ » (2018). Ses œuvres, traduites dans plus de 40 langues, lui ont valu plusieurs distinctions, dont une nomination pour le prix international Man Booker en 2016 et le prix littéraire Anton-Wildgans en 2017. En 2022, il reçoit la médaille d’or du Mérite de la République d’Autriche.
Robert Seethaler partage aujourd’hui sa vie entre Berlin et Vienne. Il est père d’un fils né en 2009.
Voici notre sélection de ses romans majeurs.
1. Le tabac Tresniek (2012)
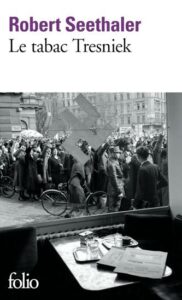
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
En août 1937, Franz Huchel, dix-sept ans, quitte sa paisible région du Salzkammergut pour Vienne. Sa mère, privée des subsides d’un riche protecteur foudroyé lors d’une baignade, l’envoie travailler chez Otto Tresniek, un buraliste unijambiste. Dans la capitale autrichienne, le jeune provincial découvre un monde en pleine mutation : la montée du nazisme commence à gangrener la société, tandis que les tensions s’exacerbent entre communautés.
Au tabac Tresniek défile une clientèle éclectique, dont le célèbre Sigmund Freud. Une relation singulière se noue entre le « docteur des fous » et Franz, qui sollicite ses conseils quand il tombe éperdument amoureux d’Anezka, une artiste de cabaret. Mais l’Anschluss approche : Freud prépare son exil vers Londres, Otto subit des pressions pour interdire sa boutique aux Juifs, les croix gammées fleurissent sur les murs, la violence s’installe dans les rues de Vienne.
Autour du livre
L’approche la plus originale du « Tabac Tresniek » réside dans sa manière de traiter la montée du nazisme à travers le regard candide de Franz, sans jamais verser dans le pathos. Cette légèreté apparente, qui contraste avec la gravité des événements, renforce paradoxalement l’intensité dramatique du récit. La relation improbable entre Franz et Freud offre certains des moments les plus savoureux, notamment lorsque le célèbre psychanalyste dispense ses conseils amoureux avec une ironie mordante.
Dans ce microcosme du bureau de tabac se joue en miniature le drame de l’Autriche toute entière. Les personnages incarnent différentes attitudes face à la montée du nazisme : la résistance têtue d’Otto qui refuse d’interdire sa boutique aux Juifs, la lâcheté du boucher délateur, la fuite de Freud vers Londres. La transformation d’un jeune provincial naïf en résistant solitaire s’opère sans emphase, à travers de petits gestes symboliques comme l’affichage quotidien de ses rêves en vitrine.
« Le tabac Tresniek » connaît un retentissant succès dans les pays germanophones dès sa parution en 2012. S’ensuivent deux adaptations : une version scénique et un film réalisé en 2017 par Nikolaus Leytner, avec Bruno Ganz dans le rôle de Freud. Le comédien y incarne magistralement ce vieil homme malade et désabusé qui trouve dans ses conversations avec Franz une dernière bouffée d’air frais avant l’exil.
Le geste final de Franz – remplacer un drapeau nazi par le pantalon d’unijambiste d’Otto – concentre toute la force du livre : un acte de résistance à la fois dérisoire et héroïque, qui dit la victoire morale des vaincus sur leurs bourreaux. Cette image puissante clôt ce récit où l’humour viennois se fait « la politesse du désespoir dans une société déboussolée ».
Aux éditions FOLIO ; 272 pages.
2. Une vie entière (2014)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Années 1900. Dans les Alpes autrichiennes, le destin d’Andreas Egger commence sous de sombres auspices. Orphelin dès l’âge de quatre ans, il est recueilli par un oncle brutal qui le bat jusqu’à le rendre boiteux. Sa force physique et son caractère tenace lui permettent pourtant de s’émanciper. Il participe notamment à l’aventure des premiers téléphériques, symboles d’une modernité qui commence à transformer la vallée.
À trente-cinq ans, sa rencontre avec Marie, serveuse dans une auberge du village, illumine enfin son existence. Mais leur bonheur est fugace : une avalanche emporte son épouse. La Seconde Guerre mondiale l’arrache ensuite à ses montagnes pour l’envoyer sur le front russe, où il passera huit ans en captivité. À son retour en 1951, le village s’est métamorphosé : les étables se sont vidées au profit des skieurs, les croix gammées ont cédé la place aux géraniums.
Autour du livre
L’histoire d’Andreas Egger résonne comme celle d’un « cœur simple » flaubertien, avec la même humilité et la même force tranquille face aux bouleversements qui transforment son village des Alpes autrichiennes. La sobriété de « Une vie entière » met en relief la grandeur discrète de cet homme qui traverse le XXe siècle sans jamais perdre sa dignité, malgré les coups du sort et les mutations profondes de son environnement.
La puissance du texte tient dans sa capacité à transcender l’ordinaire : les moments les plus intenses surgissent dans les petits riens du quotidien, comme cette demande en mariage d’une poésie surprenante où Andreas illumine la montagne « comme par magie ». À travers son regard, nous suivons la métamorphose inexorable d’une vallée traditionnelle qui s’ouvre au tourisme de masse. Les étables se vident de leurs bêtes pour accueillir les skis des vacanciers, tandis que les géraniums remplacent les croix gammées aux fenêtres du village.
La beauté rare de ces 150 pages a valu à Robert Seethaler d’être sacré meilleur auteur de l’année par les libraires allemands. La traduction anglaise de Charlotte Collins, « A Whole Life », s’est hissée jusqu’à la finale de l’International Booker Prize. Le succès critique et public ne s’est pas démenti depuis la parution en 2014, conduisant à une adaptation cinématographique en 2022 par Hans Steinbichler, sur un scénario d’Ulrich Limmer.
Cette méditation sur le temps qui passe évoque irrésistiblement « Derborence » de Charles Ferdinand Ramuz par sa beauté dépouillée. Sans pathos ni artifice, la prose épurée sculpte un portrait saisissant d’une existence modeste mais digne, où la nature – tour à tour nourricière et dévastatrice – joue un rôle central. L’histoire d’Andreas Egger nous rappelle que la grandeur peut naître de la simplicité la plus absolue.
Aux éditions FOLIO ; 144 pages.
3. Le café sans nom (2023)
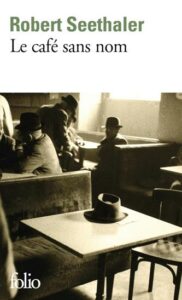
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
En 1966, dans un quartier populaire de Vienne encore marqué par la guerre, Robert Simon quitte son travail de journalier pour réaliser son rêve : ouvrir un café. Orphelin discret et travailleur, il rénove un local abandonné près du marché des Carmélites. Le succès arrive dès les premiers jours, si bien qu’il recrute Mila comme serveuse, une jeune femme courageuse que son usine textile vient de licencier.
Le café devient vite un refuge pour tout le voisinage. Johannes Berg, le boucher d’en face, y décompresse de sa famille nombreuse. René, un catcheur sur le déclin, y noie ses défaites. Des commerçants, des ouvriers et même quelques artistes s’y croisent autour d’un verre de punch ou d’une tartine de saindoux. Robert observe leurs joies et leurs peines, leurs amours et leurs disputes, tandis que sa logeuse Martha, une veuve de guerre, veille sur lui.
Pendant dix ans, le café résiste aux bouleversements qui transforment Vienne : la modernisation effrénée, l’arrivée des supermarchés, la construction du métro. Mais en 1976, le propriétaire endetté doit vendre l’immeuble. Robert organise une dernière fête avant de fermer définitivement son établissement.
Autour du livre
À travers ce microcosme d’un café viennois, Seethaler dépeint les transformations sociales et économiques de l’Autriche des années 1960-70. Le quartier des Carmélites, jadis le plus grand quartier juif de Vienne où 60 000 personnes vivaient avant l’Holocauste, porte encore les stigmates de la guerre : maisons en ruines, gare rasée, cratères de bombes où les voisins cultivent désormais des jardins. Cette période charnière voit l’émergence d’une nouvelle société de consommation : les supermarchés remplacent peu à peu les commerces traditionnels, les usines textiles ferment face à la concurrence chinoise, les travailleurs immigrés turcs et yougoslaves arrivent.
Le café incarne cette tension entre tradition et modernité. Les tartines de saindoux aux cornichons et le punch maison côtoient les aspirations à « la vie à l’américaine ». La construction du métro et de la Cité de l’ONU, décrite comme « une nouvelle Babylone, une ville dans la ville », symbolise cette métamorphose urbaine qui inquiète certains habitants : « Creuser sous la ville comme des taupes. Imagine un peu ce que l’on va trouver là-dessous. À Vienne, on compte autant de têtes de morts que de pavés. »
Les patronymes des personnages – Blaha, Pospisil, Bednarik – rappellent l’héritage multiculturel de l’Empire austro-hongrois. Sans jamais évoquer directement les traumatismes de la guerre, Seethaler laisse transparaître leur persistance à travers des figures comme Martha, la veuve de guerre, ou ces habitants « chassés de leur quartier par des élus ou des spéculateurs alors qu’ils ont déjà été chassés de leurs vies par la guerre. »
Finaliste des prix Femina et Médicis étrangers 2023, « Le café sans nom » marque pour Seethaler un retour aux sources après « Le tabac Tresniek » (2012), « Une vie entière » (2014), « Le Champ » (2018) et « Le dernier mouvement » (2020). L’action débute précisément l’année de sa naissance dans ce même quartier des Carmélites, comme si la chronique de ce café sans nom permettait aussi de retracer l’histoire de sa ville natale à travers une époque charnière de son histoire.
Aux éditions FOLIO ; 272 pages.
4. Le Champ (2018)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Un cimetière autrichien baptisé « le Champ », dans la petite ville imaginaire de Paulstadt. C’est là qu’un vieil homme vient s’asseoir chaque jour, persuadé d’entendre les voix des morts s’élever de terre. Ces murmures, d’abord indistincts comme un gazouillis d’oiseaux, prennent peu à peu forme et substance.
Une trentaine de défunts se succèdent alors pour raconter leur histoire. Certains évoquent un instant décisif, d’autres déroulent toute une vie. Un prêtre parle de sa folie incendiaire, une femme de son mari qu’elle n’a jamais vraiment connu, un enfant de ses souvenirs fugaces. Les récits se répondent et se contredisent. Chacun livre un fragment de son existence – parfois en quelques mots, parfois en plusieurs pages.
De ces voix émerge le portrait d’une bourgade ordinaire traversée par l’Histoire, des années d’après-guerre jusqu’à aujourd’hui. Les morts évoquent les bombardements, l’exode, mais aussi les petits arrangements du maire, le tragique accident au centre commercial, les préjugés face aux étrangers. Sans pathos ni sensiblerie, ils livrent l’essence de ce qui fit leur existence.
Autour du livre
Troisième livre de Robert Seethaler traduit en français, « Le Champ » s’inscrit dans la lignée du « Tabac Tresniek » et « Une vie entière », qui ont établi sa réputation d’écrivain poétique et mélancolique. La conception originale de cette œuvre polyphonique marque toutefois un tournant significatif : les voix des défunts s’élèvent du cimetière pour raconter non pas leur mort, mais leur vie.
La structure narrative, composée d’une trentaine de chapitres indépendants mais interconnectés, crée un effet de kaléidoscope où chaque témoignage éclaire différemment la petite ville de Paulstadt. Ces récits varient en longueur – de deux mots à une vingtaine de pages – et en intensité. Les morts ne philosophent pas sur leur condition : ils parlent comme des vivants, avec leurs regrets, leurs joies, leurs colères. Quand deux personnages évoquent un même événement, leurs versions se complètent ou se contredisent, comme dans le cas saisissant des époux qui décrivent leur mariage sous des angles radicalement opposés.
Le contexte historique de l’après-guerre imprègne les témoignages, à travers des références aux bombardements, à l’exode, aux familles déplacées. Ces traces du passé se mêlent aux enjeux contemporains, notamment à travers le personnage de l’épicier musulman confronté au racisme. Sans jamais verser dans le pathos, ces confidences posthumes tissent la chronique d’une communauté où le tragique côtoie le quotidien.
Bien que certains critiques regrettent le manque de liens explicites entre les récits, cette fragmentation délibérée sert le propos : montrer comment une communauté se construit à partir d’expériences individuelles qui ne font sens que dans leur accumulation. Cette mosaïque évoque l’anthologie « Spoon River » d’Edgar Lee Masters, citée en exergue, tout en proposant une variation originale sur le thème des voix d’outre-tombe.
Le succès rencontré en Allemagne et en Autriche témoigne de la force de cette œuvre qui, paradoxalement, parle davantage de la vie que de la mort. C’est d’ailleurs un livre qui a marqué de nombreux lecteurs pendant le confinement du printemps 2020, sa traduction française coïncidant avec cette période particulière qui a modifié notre rapport collectif à la mort.
Aux éditions FOLIO ; 256 pages.
5. Le dernier mouvement (2020)
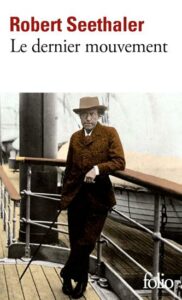
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
1911. Gustav Mahler quitte New York après sa dernière saison à la tête de l’orchestre philharmonique. Sur le pont du paquebot qui le ramène en Europe, le compositeur autrichien, affaibli par la maladie, sait que la mort approche. Fiévreux, emmitouflé dans une couverture, il n’échange que quelques mots avec le jeune domestique chargé de veiller sur lui, pendant qu’Alma, son épouse, et leur fille Anna restent dans leur cabine.
Dans ce moment de solitude face à l’immensité des flots, les souvenirs affluent. Sa jeunesse dans une famille juive de quatorze enfants, ses années à diriger l’Opéra de Vienne de 1897 à 1907, sa rencontre avec Alma Schindler – considérée comme la plus belle femme de Vienne. L’année 1907 marque un tournant tragique : la mort de sa fille aînée Maria, emportée par la diphtérie à cinq ans, la perte de son poste à l’Opéra de Vienne, le diagnostic d’une maladie cardiaque incurable. Plus tard surgira la trahison d’Alma, éprise d’un jeune architecte.
Autour du livre
« Le dernier mouvement » s’inscrit dans une longue tradition littéraire qui prend Mahler comme source d’inspiration. Thomas Mann avait déjà modelé son personnage de Gustav von Aschenbach dans « La mort à Venise » sur le compositeur, lui donnant son prénom et une partie de son apparence physique. Cette filiation s’est prolongée au cinéma quand Visconti a choisi d’utiliser la musique de Mahler pour son adaptation du roman de Mann.
Seethaler reprend ces codes tout en s’en démarquant : là où Mann créait un personnage de fiction, « Le dernier mouvement » reste fidèle à la réalité historique sans tomber dans les écueils d’une biographie conventionnelle. Le choix du lieu – le pont d’un paquebot – permet une mise en scène épurée qui rappelle celle d’Aschenbach sur la plage du Lido. Cette similitude n’est pas fortuite : Mann a écrit « La mort à Venise » quelques mois après le décès de Mahler, s’inspirant à la fois du compositeur et de ses propres expériences vénitiennes.
Les rencontres avec des figures majeures de l’époque ponctuent le récit et offrent des scènes mémorables : une séance de pose avec Rodin qui vire à l’affrontement entre deux caractères irascibles, et une consultation-promenade avec Freud qui débouche sur une conclusion laconique – Mahler cherchait sa mère, Alma son père. La dimension autobiographique se double d’une réflexion sur l’art : « On ne peut pas raconter la musique, il n’y a pas de mots pour ça. Dès qu’on peut décrire la musique, c’est qu’elle est mauvaise. »
Traduit dans plusieurs langues, dont le bulgare, le français, l’italien, le croate, le néerlandais, le suédois et le turc, « Le dernier mouvement » a été sélectionné pour le Prix du livre allemand, une reconnaissance significative dans le paysage littéraire germanophone. Plus qu’une simple évocation biographique, cette œuvre constitue une méditation sur la création artistique, la maladie et la mort imminente, portée par une tension permanente entre la puissance créatrice et la fragilité du corps.
Aux éditions FOLIO ; 144 pages.