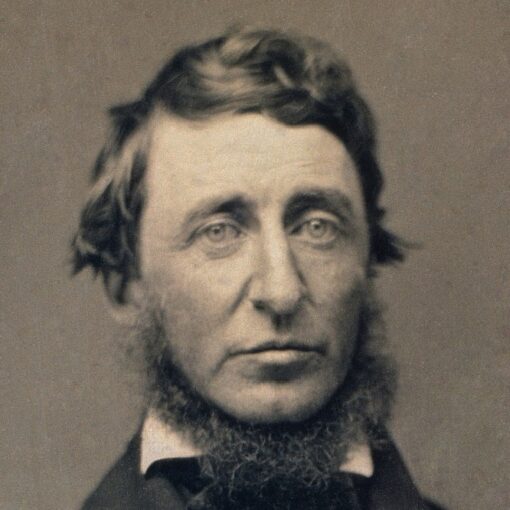Marcel Pagnol est un écrivain, dramaturge et cinéaste français né le 28 février 1895 à Aubagne et mort le 18 avril 1974 à Paris. Fils d’instituteur, il passe une enfance heureuse en Provence, notamment près du massif du Garlaban, qui marquera profondément son œuvre.
Après des études brillantes et une brève carrière d’enseignant, il connaît son premier grand succès en 1928 avec la pièce « Topaze ». Sa célèbre trilogie marseillaise (« Marius », « Fanny », « César ») le consacre définitivement comme dramaturge majeur.
Pionnier du cinéma parlant français, il fonde ses propres studios à Marseille en 1934 et réalise de nombreux films dont « La Femme du boulanger » (1938) et « La Fille du puisatier » (1940). Il travaille avec les plus grands acteurs de l’époque comme Raimu et Fernandel.
Élu à l’Académie française en 1946, il se consacre dans les années 1950-1960 à l’écriture de ses célèbres « Souvenirs d’enfance » (« La Gloire de mon père », « Le Château de ma mère », « Le Temps des secrets »), qui connaissent un immense succès. Il publie également « L’Eau des collines » (1962), composé de « Jean de Florette » et « Manon des sources ».
Son œuvre, profondément ancrée dans la Provence, mêle avec talent humour et émotion, tout en dressant des portraits inoubliables de personnages populaires. Pagnol a marqué durablement la culture française du XXe siècle, tant par ses écrits que par ses films.
Voici notre sélection de ses romans majeurs.
1. La Gloire de mon père (Souvenirs d’enfance #1, 1957)
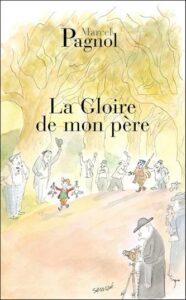
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Dans la France du début du XXe siècle, le petit Marcel grandit à Aubagne puis à Marseille, fils d’un instituteur républicain et d’une mère couturière. Sa tante Rose l’emmène régulièrement au parc Borély où elle rencontre en secret son futur mari, l’oncle Jules, qui deviendra plus tard un personnage haut en couleur de la famille.
L’été de ses huit ans, en 1904, Marcel découvre pour la première fois les collines provençales lorsque ses parents louent avec l’oncle Jules et la tante Rose une maison de campagne, la Bastide Neuve. Pour le jeune garçon et son petit frère Paul, c’est le début d’une suite d’aventures dans la garrigue, entre observation des insectes et jeux d’Indiens. Mais le moment crucial arrive lors de l’ouverture de la chasse : Marcel suit en cachette son père et son oncle, se perd dans les collines, et assiste finalement à un exploit qui fera la fierté de toute la famille.
Autour du livre
Premier volet d’une tétralogie autobiographique publiée en 1957, « La Gloire de mon père » marque un tournant dans la carrière de Marcel Pagnol. Dramaturge et cinéaste reconnu, notamment pour sa « Trilogie marseillaise » (« Marius », « Fanny », « César »), il se lance dans l’écriture de ses souvenirs d’enfance après avoir délaissé le cinéma et le théâtre. Dans la préface, il précise qu’il ne s’agit pas d’un livre sur lui-même mais sur « l’enfant qu’il n’est plus », un « petit personnage qui s’est fondu dans l’air du temps ».
La candeur du regard enfantin s’entremêle à la maturité de l’adulte qui raconte. Cette dualité transparaît notamment dans les passages où le jeune Marcel découvre les premières désillusions de l’enfance, comme lorsqu’il réalise que son père n’est pas infaillible. La scène où Joseph écoute, tel un élève attentif, les conseils de chasse de l’oncle Jules illustre ce moment charnière : « J’en étais honteux et humilié […] S’il ne tue rien, eh bien moi, ça me dégoûtera. Oui ça me dégoutera. Et moi je ne l’aimerai plus. »
Au cœur du récit se dessine la figure emblématique du père, Joseph Pagnol, instituteur anticlérical qui incarne les valeurs de la IIIème République. Face à lui, l’oncle Jules, catholique pratiquant, apporte un contrepoint idéologique qui nourrit de savoureuses joutes verbales. Augustine, la mère discrète mais aimante, occupe une place particulière dans l’univers affectif du narrateur : « Ma mère, c’était moi, et je pensais, dans mon enfance, que nous étions nés le même jour. »
Une grande attention est portée aux mots provençaux qui émaillent le texte, comme « galéjade » (plaisanterie), « pitchounet » (petit enfant) ou « parpeléger » (battre des paupières). Ces termes contribuent à ancrer le récit dans son terroir, au même titre que les descriptions sensorielles des collines, du thym et de la garrigue.
La renommée immédiate du livre se mesure à ses ventes : plus de cinquante mille exemplaires s’écoulent en un mois. Le deuxième tome, « Le Château de ma mère », connaît un succès similaire en se classant en tête des meilleures ventes de l’année 1958. René Frégni note une différence fondamentale entre l’écriture de Pagnol et celle de son contemporain Jean Giono : là où ce dernier décrit des terres plus hostiles vers Manosque, Pagnol dépeint un Sud baigné de soleil autour d’Aubagne et Marseille.
En 1990, Yves Robert adapte le roman au cinéma avec Philippe Caubère et Nathalie Roussel dans les rôles des parents. Le film, tourné à Grambois pour les scènes du village de la Treille et dans le domaine de Pichauris à Allauch pour la « Bastide Neuve », s’inscrit dans un diptyque avec « Le Château de ma mère ». En 2015, une adaptation en bande dessinée voit le jour chez Bamboo Édition/Grand Angle, suivie en 2018 par une version en langue provençale intitulée « La Glori de moun paire ». Une version audio, enregistrée par Marcel Pagnol lui-même dans les années 1960, a été retrouvée et publiée en 2006 chez Frémeaux & Associés.
Aux éditions GRASSET ; 240 pages.
2. Le Château de ma mère (Souvenirs d’enfance #2, 1957)
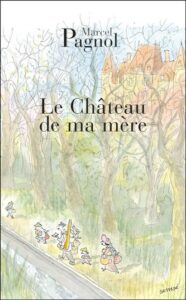
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Dans ce deuxième volet des « Souvenirs d’enfance », le petit Marcel savoure ses vacances d’été dans les collines provençales. Admis comme rabatteur de chasse aux côtés de son père Joseph et de l’oncle Jules, il fait la connaissance de Lili des Bellons, un garçon de son âge qui maîtrise tous les secrets de la garrigue. Entre parties de chasse et pose de pièges, une amitié profonde se noue entre les deux enfants.
La perspective de la rentrée scolaire pousse Marcel à une tentative de fugue qui tourne court. Pour atténuer le chagrin du retour à Marseille, la famille entreprend de revenir chaque week-end à la Bastide Neuve. Le trajet, long de quatre heures, est considérablement raccourci grâce à Bouzigue, ancien élève de Joseph, qui leur remet la clé des propriétés longeant le canal. Ces passages clandestins deviennent source d’angoisse pour Augustine, la mère de Marcel, particulièrement effrayée par un château et son terrible gardien.
Autour du livre
Paru en 1957, « Le Château de ma mère » constitue le deuxième tome des « Souvenirs d’enfance » de Marcel Pagnol. Cette œuvre autobiographique s’inscrit dans la continuité immédiate de « La Gloire de mon père », sans ellipse temporelle ni transition artificielle. Le récit conserve la même atmosphère méridionale mais prend progressivement un tournant plus mélancolique, glissant de l’insouciance de l’enfance vers une prise de conscience plus grave de la réalité.
L’apparition de Lili des Bellons marque un virage décisif dans la narration. Ce jeune paysan « brun avec un fin visage provençal, des yeux noirs et de longs cils de fille » devient pour Marcel bien plus qu’un simple compagnon de jeu – il incarne l’ami idéal, celui qui connaît tous les secrets des collines. Leur relation transcende les différences sociales : tandis que Lili initie Marcel aux mystères de la nature, ce dernier lui fait découvrir la ville et l’école. Cette amitié pure et sincère, dénuée d’arrière-pensées, insuffle une dimension universelle au récit.
La structure narrative se distingue par sa dualité temporelle. Si la majeure partie du texte se déroule sur une année, l’épilogue opère un saut dans le temps saisonnier mais aussi émotionnel. Cette rupture chronologique permet à Pagnol d’évoquer avec une sobriété poignante la disparition prématurée de trois êtres chers : sa mère Augustine, son frère Paul devenu chevrier, et son ami Lili, tombé au front durant la Première Guerre mondiale « sur des touffes de plantes froides dont il ne savait pas les noms ». Cette conclusion bouleversante sublime la dimension autobiographique en lui conférant une portée universelle sur la fragilité du bonheur.
L’histoire du château éponyme recèle une ironie du sort remarquable. En 1941, Pagnol, devenu cinéaste reconnu, acquiert sans le savoir le château de la Buzine – celui-là même qui terrorisait tant sa mère lors de leurs passages clandestins le long du canal. Cette coïncidence, presque trop parfaite pour être véridique selon certains critiques, offre néanmoins une conclusion symbolique puissante au récit. Un doute historique persiste d’ailleurs sur la véracité de certains éléments : le canal de Marseille ne traverse pas réellement le domaine de la Buzine, et le château appartenait à l’époque à un officier de marine nommé Félix Pallez, non au prétendu baron des Accates.
Les critiques s’accordent à reconnaître dans ce second tome une profondeur émotionnelle supérieure à celle de « La Gloire de mon père ». La sensibilité à fleur de peau du récit, sa capacité à transmettre l’atmosphère provençale et sa justesse dans l’évocation des relations humaines en font, selon plusieurs commentateurs, un chef-d’œuvre de la littérature française.
« Le Château de ma mère » a connu plusieurs adaptations notables. En 1990, Yves Robert réalise une version cinématographique avec Philippe Caubère et Nathalie Roussel dans les rôles des parents, tandis que Jean-Pierre Darras assure la narration. Le film utilise comme décor le village de Grambois pour représenter l’ancien village de La Treille, et situe la « Bastide Neuve » dans le domaine de Pichauris à Allauch. En 2015, le roman est adapté en bande dessinée par Éric Stoffel, Serge Scotto et Nicolas Pagnol, petit-fils de l’auteur. Une version audio existe également, enregistrée par Pagnol lui-même vers le milieu des années 1960 et retrouvée une trentaine d’années après sa mort.
Aux éditions GRASSET ; 240 pages.
3. Le Temps des secrets (Souvenirs d’enfance #3, 1960)
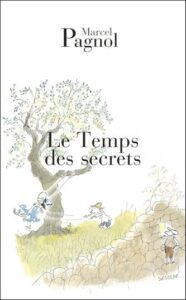
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Dans ce troisième volet des « Souvenirs d’enfance », le jeune Marcel Pagnol vit ses dernières vacances d’été à La Treille, dans l’arrière-pays marseillais du début du XXe siècle. Son ami Lili, désormais occupé aux travaux des champs, n’a plus autant de temps à lui consacrer. C’est alors que Marcel fait la rencontre d’Isabelle, fille d’un prétendu poète, qui va bouleverser sa vie de préadolescent. Subjugué par cette demoiselle aux manières sophistiquées, il délaisse ses anciennes activités pour jouer les chevaliers servants, jusqu’à ce que la réalité le rattrape brutalement.
La deuxième partie du livre marque un tournant : Marcel entre en sixième au lycée Thiers de Marseille. Fini le temps des courses dans la garrigue, place à la discipline et aux nouveaux codes sociaux. Entre professeurs excentriques et camarades hauts en couleur comme l’inénarrable Lagneau, le garçon découvre un monde où il n’est plus le fils du maître d’école mais un élève parmi d’autres.
Autour du livre
Publié en 1960, « Le Temps des secrets » constitue le troisième volet des « Souvenirs d’enfance » de Marcel Pagnol. À l’origine, ce tome devait clore la série sous le titre « Les Grands Amours », comme l’indique la mention à la fin de l’édition originale du « Château de ma mère ». Cependant, la matière narrative s’avère si abondante que Pagnol remanie plusieurs fois son projet. La trilogie devient une tétralogie, bien que l’auteur ne finalisera que ce troisième tome de son vivant.
Dans cette nouvelle étape des souvenirs, l’enfance cède progressivement la place à la pré-adolescence. La naïveté des premiers tomes s’estompe au profit d’une conscience plus aiguë du monde adulte et de ses secrets. Les rapports entre hommes et femmes intriguent particulièrement le jeune Marcel, pour qui l’univers féminin demeure un territoire mystérieux. Son expérience se limite à sa mère, sa tante Rose, sa petite sœur et Clémentine, la fille du concierge de l’école qui louche « de manière fort fascinante ».
La rupture avec l’innocence se matérialise notamment dans l’évolution de l’amitié entre Marcel et Lili. Les jeux dans la garrigue et la chasse aux bartavelles perdent de leur attrait. L’arrivée d’Isabelle bouleverse cet équilibre, confrontant pour la première fois le jeune garçon aux illusions et désillusions amoureuses. Cette transformation s’accompagne aussi d’un changement dans le rapport à la famille : Marcel commence à garder ses secrets, à dissimuler une partie de sa vie au lycée, marquant ainsi les prémices de son émancipation.
L’entrée au lycée Thiers de Marseille est une étape importante. La description minutieuse de ce nouvel univers, avec ses codes et ses rituels, témoigne d’une époque où l’accès à l’enseignement secondaire ne va pas de soi. Les élèves font face à des journées de onze heures, des retenues les jours de congé, et une discipline stricte. Cette partie du récit acquiert une dimension universelle en évoquant les défis, les amitiés et les petites victoires qui jalonnent le parcours de tout écolier.
Les critiques saluent unanimement ce nouvel opus des souvenirs d’enfance. Certains estiment même que « Le Temps des secrets » gagne en profondeur par rapport aux tomes précédents. Si quelques lecteurs regrettent la perte de la fraîcheur enfantine des premiers volumes, la majorité apprécie la finesse avec laquelle Pagnol dépeint cette période charnière entre l’enfance et l’adolescence. Le passage sur la rencontre et l’histoire d’amour avec Isabelle est notamment considéré par certains comme « un chef-d’œuvre de la littérature amoureuse pré-adolescente ».
Le livre connaît plusieurs adaptations. En 2006, Thierry Chabert réalise une version télévisée sur un scénario de Louis Gardel et Ariane Gardel Beaulande, avec Pierre-François Martin-Laval et Armelle Deutsch dans les rôles des parents. Certains éléments du livre sont également intégrés au film « Le Château de ma mère » d’Yves Robert en 1990. Plus récemment, en 2020, Christophe Barratier propose sa propre adaptation cinématographique avec Guillaume de Tonquédec, Mélanie Doutey et François-Xavier Demaison, sortie en 2022. Par ailleurs, Marcel Pagnol lui-même enregistre une version audio du livre vers le milieu des années 1960, redécouverte trente ans après sa mort et publiée en 2008 chez Frémeaux & Associés.
Aux éditions GRASSET ; 264 pages.
4. Le Temps des amours (Souvenirs d’enfance #4, 1977)
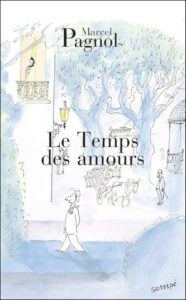
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Dans ce quatrième et dernier tome des « Souvenirs d’enfance » publié à titre posthume en 1977, Marcel Pagnol nous ramène dans le Marseille du début du XXe siècle. L’histoire suit le jeune Marcel au lycée Thiers où il entre comme demi-pensionnaire en 1905. Loin de sa famille et des collines de son enfance, l’adolescent découvre un nouveau monde : celui des amourettes lycéennes, des punitions scolaires et des premières farces potaches entre camarades.
Les personnages emblématiques des premiers tomes – Paul le petit frère, Joseph le père instituteur, Lili des Bellons – cèdent la place à une nouvelle galerie de figures marquantes : Lagneau, cancre attachant dont les amours maladroites occupent le dernier chapitre, et Yves, qui partage avec Marcel tant la passion des études que celle des collines provençales. Une longue digression sur l’épidémie de peste qui ravagea Marseille en 1720 vient surprendre le lecteur au milieu de ces souvenirs lycéens.
Autour du livre
Publié trois ans après la disparition de Marcel Pagnol en 1977, « Le Temps des amours » vient clore la tétralogie des « Souvenirs d’enfance ». Ce quatrième tome se distingue nettement des précédents par sa construction particulière, fruit d’une genèse complexe. L’éditeur Bernard de Fallois a reconstitué l’ouvrage à partir de différents textes retrouvés dans les dossiers de l’auteur après son décès. Cette publication posthume explique en grande partie la structure fragmentée du livre, qui s’articule autour de dix chapitres distincts.
Contrairement à ce que son titre pourrait laisser croire, les amours n’occupent qu’une place marginale dans le récit. Seul le dernier chapitre, consacré aux émois de Lagneau, aborde véritablement cette thématique. Le livre se concentre essentiellement sur les années de lycée de Marcel au lycée Thiers de Marseille, où il entre en 1905. Les souvenirs scolaires se mêlent aux aventures dans les collines provençales, créant une alternance rythmique entre l’univers citadin et rural qui caractérisait déjà les tomes précédents.
La société secrète du Trèfle Rouge, les boules puantes lancées en classe, les caricatures de professeurs suspendues au plafond – autant d’épisodes qui témoignent d’une adolescence marquée par l’espièglerie et la camaraderie. La figure de Lagneau, ami fidèle mais élève dissipé, occupe une place prépondérante dans ces souvenirs lycéens. À travers lui se dessine le portrait d’une jeunesse insouciante du début du XXe siècle, entre farces potaches et premières amours platoniques.
Un long chapitre inattendu sur la peste de Marseille en 1720 vient rompre la chronologie des souvenirs. Cette digression historique, qui occupe une soixantaine de pages, révèle une autre facette de Pagnol : celle de l’historien passionné qui, à l’instar de son essai sur le Masque de fer, s’attache à reconstituer des épisodes marquants de l’histoire provençale.
La famille Pagnol, si présente dans les tomes précédents, s’efface progressivement pour laisser place à de nouveaux personnages comme Yves, qui incarne une synthèse entre le monde érudit du lycée et celui plus sauvage des collines. Une magnifique partie de boules où Joseph, le père de Marcel, tient le premier rôle, constitue l’une des rares mais mémorables réapparitions du cercle familial.
Le livre retrace également la naissance de la vocation littéraire de Marcel. Son premier poème, « Le Grillon », et sa passion croissante pour les mots annoncent déjà l’écrivain qu’il deviendra. Un ami prédit même, non sans une certaine prescience, son entrée future à l’Académie française.
La critique s’accorde généralement sur le caractère moins abouti de ce dernier tome. Certains regrettent l’absence de la magie qui imprégnait « La Gloire de mon père » ou « Le Château de ma mère », d’autres pointent un manque de cohérence dans la structure narrative. Néanmoins, la plupart reconnaissent que ces textes, malgré leur caractère inachevé, conservent la verve et la sensibilité caractéristiques de Pagnol.
« Le Temps des amours » a fait l’objet d’une adaptation télévisuelle en 2006 par Thierry Chabert. Ce téléfilm de 90 minutes fait suite à l’adaptation du « Temps des secrets » par le même réalisateur.
Aux éditions GRASSET ; 260 pages.
5. Jean de Florette (L’eau des collines #1, 1962)
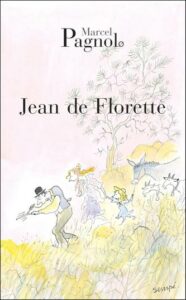
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Au début du XXe siècle, dans un hameau perché des collines provençales, deux paysans rusés, César Soubeyran et son neveu Ugolin, rêvent de faire fortune en cultivant des œillets. Pour cela, il leur faut une terre irriguée. La mort du vieux Pique-Bouffigue, propriétaire d’un domaine pourvu d’une source, semble leur offrir cette chance.
Mais c’est Jean Cadoret, un bossu venu de la ville, qui hérite du domaine. Cet ancien percepteur s’installe avec femme et enfant, la tête pleine de projets agricoles inspirés par les livres. Les deux comploteurs décident alors de boucher la source en secret. Jean ignore son existence et s’échine à transporter l’eau de très loin. Malgré sa détermination et son optimisme, ses efforts sont voués à l’échec. Un jour, Jean tente d’accéder à un point d’eau avec des explosifs. L’opération lui est fatale.
Autour du livre
À treize ans, Marcel Pagnol entend un paysan narrer une histoire qui ne le quittera plus : celle de Manon des sources. Cette histoire germe dans son esprit pendant des décennies avant de prendre forme en 1952 sous la forme d’un film. Dix ans plus tard, en 1962, il transforme ce matériau cinématographique en un diptyque romanesque intitulé « L’eau des collines », dont « Jean de Florette » constitue le premier volet.
Dans les collines provençales près d’Aubagne se joue une implacable tragédie autour de l’eau, cette ressource plus précieuse que l’or. Les habitants des Bastides Blanches perpétuent leurs traditions ancestrales, régies par des codes tacites : le braconnage se tolère tant qu’il respecte certaines règles, quitter son village équivaut à une haute trahison, et surtout – règle cardinale – on ne s’immisce pas dans les affaires d’autrui. Cette dernière loi du silence scelle le destin tragique de Jean Cadoret.
Dans ce microcosme rural où chaque goutte d’eau compte, Pagnol décortique les mécanismes de l’exclusion et de la xénophobie ordinaire. Jean, le citadin bossu venu de Crespin – village ennemi juré des Bastides – cristallise toutes les méfiances. Son instruction et ses méthodes agricoles modernes heurtent les traditions locales, comme le souligne cette réplique mordante : « La routine, ça veut dire ce que les vieux nous ont appris, et d’après eux, il faut tout foutre en l’air, parce que c’est pas moderne, et que maintenant on a inventé les miracles… »
Les personnages échappent au manichéisme simpliste. Ugolin, tiraillé entre sa cupidité et une réelle affection pour Jean, incarne cette ambivalence. Même le Papet, malgré sa cruauté calculatrice, ne suscite pas une haine absolue – sa punition à venir dans le second tome garantira une justice poétique dévastatrice.
À travers ce drame rural, Pagnol livre une réflexion sur la condition humaine, où la soif de possession mène au crime, où l’ignorance s’allie à la méchanceté pour broyer les rêves d’un idéaliste. L’opposition entre savoir livresque et connaissance empirique traverse l’œuvre, questionnant la légitimité de chaque approche.
Les critiques littéraires saluent unanimement la puissance tragique de l’œuvre. Certains y voient un « Madame Bovary de la Provence », où l’idéalisme rousseauiste de Jean se brise contre la vision cynique d’un monde paysan âpre et calculateur. D’autres soulignent la dimension quasi-grecque de cette tragédie provinciale, où le destin implacable s’accomplit à travers les petitesses humaines.
En 1986, Claude Berri adapte « Jean de Florette » pour le cinéma avec un trio d’acteurs mémorables : Yves Montand incarne le Papet, Gérard Depardieu prête ses traits à Jean de Florette, tandis que Daniel Auteuil compose un Ugolin saisissant de vérité. Cette adaptation, saluée pour sa fidélité au texte original, contribue à populariser l’œuvre auprès d’un large public.
Aux éditions GRASSET ; 288 pages.
6. Manon des sources (L’eau des collines #2, 1962)
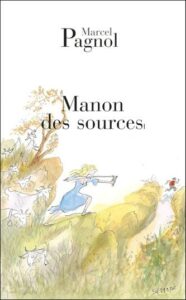
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Deuxième volet du diptyque « L’eau des collines », « Manon des sources » se déroule dans les années 1920, dans l’arrière-pays d’Aubagne. Quelques années après la mort tragique de Jean de Florette, sa fille Manon est devenue une jeune bergère solitaire qui parcourt les collines avec ses chèvres. Pendant ce temps, Ugolin Soubeyran prospère grâce à ses cultures d’œillets sur les terres qu’il a acquises par des manœuvres malhonnêtes.
Le destin bascule quand Ugolin tombe éperdument amoureux de Manon. Mais la jeune fille, qui découvre que les villageois connaissaient l’existence d’une source sur les terres de son père sans jamais l’en avoir informé, ne songe plus qu’à la vengeance. Elle trouve le moyen de priver d’eau tout le village, provoquant une série d’événements qui vont révéler les secrets enfouis et bouleverser la vie de chacun.
Autour du livre
Second volet du diptyque « L’eau des collines », « Manon des sources » est la suite de « Jean de Florette ». Publié en 1962, ce récit puise ses origines dans le scénario du film éponyme tourné par Marcel Pagnol lui-même en 1952, avec son épouse Jacqueline dans le rôle-titre. Cette genèse cinématographique imprègne la structure du texte en lui conférant une théâtralité saisissante qui culmine dans la scène de la révélation finale à l’école.
La construction narrative emprunte aux codes de la tragédie antique : la vengeance comme moteur de l’action, l’ironie du destin qui frappe les Soubeyran, et surtout ce secret de famille dévastateur qui n’éclate qu’au dénouement. Le village des Bastides Blanches devient une scène où se joue un drame aux résonances universelles, avec ses personnages emblématiques : Manon incarnant la Némésis vengeresse, Ugolin consumé par un amour impossible, et le Papet, figure œdipienne accablée par ses actes passés.
L’eau, élément central du récit, transcende sa fonction première pour devenir un personnage à part entière. Source de vie et de mort, elle porte en elle toute l’ambivalence morale de cette histoire où les notions de bien et de mal s’entremêlent. Les personnages eux-mêmes échappent aux clichés du méchant et du gentil : Ugolin, d’abord présenté comme un être cupide, se révèle touchant dans sa passion dévorante pour Manon, tandis que cette dernière, malgré sa position de victime, n’hésite pas à user des mêmes armes que ses bourreaux en privant le village d’eau.
Le microcosme villageois dépeint par Pagnol dépasse le simple folklore provençal pour interroger la nature humaine dans ce qu’elle a de plus complexe : la loi du silence qui régit la communauté, la peur de l’étranger, la force des préjugés, mais aussi la possibilité de rédemption. L’arrivée de personnages extérieurs – l’instituteur et le curé – agit comme un révélateur des consciences, permettant peu à peu l’émergence de la vérité.
La dernière partie du livre atteint une intensité dramatique rare quand le Papet découvre que Jean de Florette était son fils. Cette révélation transforme rétrospectivement toute la lecture : chaque action passée prend un sens nouveau, chaque dialogue résonne différemment. La lettre finale du Papet à Manon, écrite dans un provençal maladroit, constitue l’un des moments les plus bouleversants du texte, mêlant remords, tendresse et désespoir.
Les critiques littéraires s’accordent à voir dans ce diptyque l’une des plus belles réussites romanesques de Pagnol. Certains le considèrent comme l’égal des « Misérables » ou du « Comte de Monte-Cristo » dans le panthéon de la littérature française. Si quelques voix dissidentes pointent des longueurs dans les descriptions des collines ou une certaine tendance au mélodrame, la grande majorité salue la maestria avec laquelle le romancier orchestre cette tragédie rurale.
L’adaptation cinématographique de Claude Berri en 1986, avec Yves Montand dans le rôle du Papet et Daniel Auteuil dans celui d’Ugolin, contribue significativement au rayonnement de « Manon des sources ». La performance d’Auteuil, notamment, est unanimement saluée comme « magistrale », donnant à Ugolin toute sa dimension pathétique. Cette version, jugée supérieure à l’originale de Pagnol lui-même, reste aujourd’hui une référence du cinéma français.
Aux éditions GRASSET ; 288 pages.