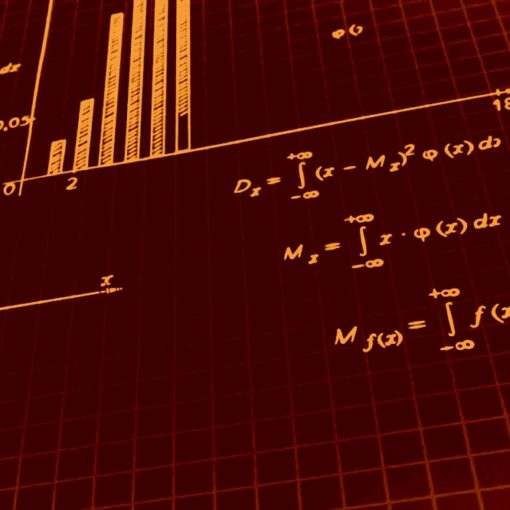Entrer en licence d’histoire, c’est apprendre un métier intellectuel autant qu’une discipline. On y découvre des outils (dissertation, commentaire, travail d’archives), des façons de raisonner (problématiser, contextualiser, critiquer les sources) et des horizons historiographiques divers.
La sélection ci-dessous rassemble des incontournables éprouvés — méthodes, épistémologie, sources et cartographie — classés dans un ordre logique : des fondations du métier vers les usages concrets, puis les appuis visuels. L’objectif : vous suggérer des ouvrages que l’on lit vraiment en L1–L3, qui structurent la progression et font gagner du temps, des points, de l’assurance.
1. Apologie pour l’histoire ou Métier d’historien (Dunod, 2024)
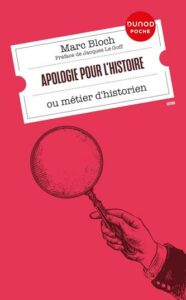
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Texte bref, limpide et toujours actuel, l’ouvrage de Marc Bloch répond à la question d’un fils : « À quoi sert l’histoire ? ». C’est à la fois une éthique du métier et un manifeste contre les paresses intellectuelles : refus de juger trop vite, vigilance critique, goût du comparatif, attention à la temporalité. Bloch rappelle que l’objet de l’histoire est « les hommes dans le temps », que les documents mentent parfois, et que l’historien doit croiser les indices comme un enquêteur.
Pour un étudiant, ce livre installe les bons réflexes : formuler un problème, articuler faits et hypothèses, écrire sans dogmatisme. L’édition de poche récente remet le texte à disposition avec un appareil critique concis ; elle s’accorde parfaitement aux exercices de la licence (commentaire de document, dissertation, exposé). On y trouve enfin une invitation à la curiosité : le meilleur antidote au bachotage.
Comment l’utiliser ?
- Lisez-le d’une traite, puis relisez en notant les passages sur source/preuve/comparaison.
- Constituez une fiche « méthode » à partir des exemples (juger/comprendre, causalité).
- Citez-le pour problématiser vos introductions.
- Reliez ses principes à vos TD : quels « indices » exploitez-vous réellement ?
2. Douze leçons sur l’histoire (Points, 2014)
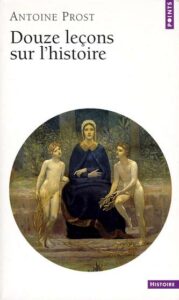
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Issu d’un cours à la Sorbonne, ce classique d’Antoine Prost est le meilleur mode d’emploi du raisonnement historique à l’université. Chapitre après chapitre, il démonte les étapes d’une recherche : question, corpus, critique interne/externe, mise en série, interprétation, écriture. Prost montre comment articuler cadres conceptuels et sources, et comment « faire parler » des documents de nature différente.
L’ouvrage vaut aussi pour ses mises en garde : illusions de neutralité, pièges des chiffres, anachronismes. Sa force tient à un style clair, sans jargon, et à une articulation constante entre théorie et ateliers de pratique – exactement ce qu’on attend en licence. Pour vos dissertations comme pour vos commentaires, Douze leçons fournit une boîte à outils transversale, de l’histoire politique à l’histoire sociale et culturelle.
Comment l’utiliser ?
- Faites une fiche synthèse par « leçon » (définition, méthode, pièges).
- Transformez les check-lists implicites en grilles d’autoévaluation avant rendu.
- Testez un même chapitre sur deux corpus (texte/statistique, image/texte).
- Reprenez l’index pour bâtir votre propre glossaire méthodologique.
3. Méthode pour le commentaire et la dissertation historiques (Armand Colin, 5ᵉ éd., 2025)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Vincent Milliot et Olivier Wieviorka proposent l’ouvrage méthodologique le plus directement opérationnel pour vos examens. Un premier bloc clarifie attentes et critères d’évaluation ; un second détaille les étapes : analyse du sujet, problématisation, architecture du plan, transitions, gestion du temps.
Le cœur du livre, c’est l’atelier : sujets intégralement traités, copies annotées, exemples de plans, bibliographies types. Les auteurs insistent sur la lecture des consignes, la pertinence des exemples, le traitement de séries chiffrées et d’images, la construction d’une démonstration probante plutôt que seulement descriptive.
L’édition la plus récente actualise les conseils (usage raisonné des outils numériques, références, normalisation des citations) : pratique pour standardiser vos méthodes de la L1 à la L3.
Comment l’utiliser ?
- Refaites « à blanc » au moins deux sujets corrigés du livre, en condition temps.
- Élaborez des modèles de plans types (chronologique, thématique, dialectique).
- Constituez une « banque » de transitions et d’amorces d’introduction.
- Comparez vos copies aux critères de correction pour cibler vos axes de progrès.
4. Comment on écrit l’histoire (Seuil, 2015)
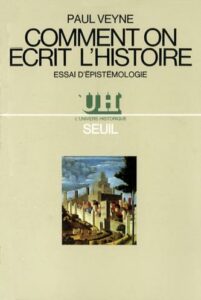
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Provocant à sa parution (1971), l’essai de Paul Veyne demeure une initiation brillante à l’épistémologie de la discipline. Veyne s’attaque aux dogmes : non, l’histoire n’est pas une science cumulative ; oui, elle construit des intrigues explicatives en sélectionnant des faits pertinents et des concepts opératoires.
Il rappelle ce que l’historien fait vraiment « après les archives » : ordonner des singularités et forger une démonstration. L’étudiant y gagne un sens aigu de la problématique : toute copie doit rendre explicite ce qu’elle fait d’un sujet (choix et hiérarchies), non se contenter de résumer. À lire en parallèle de Prost : l’un fournit l’atelier, l’autre la hauteur de vue.
Comment l’utiliser ?
- Fichez les notions « intrigue », « explication », « singularité », « comparaison ».
- Entraînez-vous à reformuler un sujet en « proposition de recherche ».
- Vérifiez, dans vos plans, la cohérence entre hypothèse et exemples.
- Mobilisez deux citations de Veyne pour cadrer vos introductions difficiles.
5. De la connaissance historique (Points, 2016)
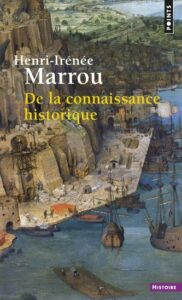
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Henri-Irénée Marrou explore les conditions de possibilité d’un savoir historique : rapport au vrai, au temps, au langage. Loin d’un positivisme naïf, il montre que l’histoire n’existe pas « toute faite » dans les archives ; elle se construit, sans sombrer pour autant dans le relativisme.
Pour l’étudiant, cette « métaphysique minimale » du métier est précieuse : elle clarifie la place des valeurs, de l’imagination contrôlée, du style. Marrou insiste sur la critique des témoignages et l’importance de la question initiale : « De quoi ce document est-il la réponse ? ». Quelques pages suffisent souvent à débloquer un plan ou à muscler une conclusion.
Comment l’utiliser ?
- Dressez une table de « tests de crédibilité » des sources pour vos commentaires.
- Quand un plan vous résiste, relisez le chapitre sur l’explication historique.
- Tenez un carnet d’exemples où une idée de Marrou éclaire un cas précis.
- Appuyez-vous sur Marrou pour justifier vos choix d’échelle (micro/macro).
6. L’écriture de l’histoire (Folio, 2002)
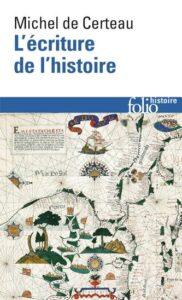
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Michel de Certeau déplace le regard vers l’opération historiographique : lieu social de production, méthodes et discours. Écrire l’histoire, c’est fabriquer un objet, découper des durées, ordonner des matériaux hétérogènes et produire un récit adressé – avec des effets.
Exigeant mais stimulant, le livre éclaire la dimension rhétorique de toute démonstration : prologues, transitions, choix narratifs. En licence, Certeau apprend à assumer l’angle choisi et à contrôler l’écriture (souvent la différence entre une copie correcte et une copie convaincante).
Comment l’utiliser ?
- Repérez dans vos copies : où « fabriquez-vous » l’objet ? où l’explicitez-vous ?
- Travaillez trois transitions « Certeau-compatibles » (annonce, pont, relance).
- Réécrivez un développement en modifiant délibérément l’angle narratif.
- Lisez un chapitre après avoir rédigé un devoir : que changeriez-vous ?
7. Les courants historiques en France – 19ᵉ–20ᵉ siècle (Armand Colin, 2005)
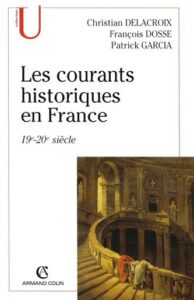
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Delacroix, Dosse et Garcia livrent une cartographie précise de l’historiographie française moderne : néo-érudition, Annales, histoire sociale, histoire politique renouvelée, tournant culturel, etc. Chaque courant est replacé dans ses enjeux théoriques et institutionnels, ses revues, ses controverses.
C’est l’outil idéal pour relier méthodes et contexte : comprendre pourquoi l’on passe d’une histoire événementielle aux séries, puis aux sensibilités, et comment ces mutations façonnent vos sujets de partiels. En L2-L3, l’ouvrage est précieux pour situer un sujet dans un débat et construire des bibliographies commentées.
Comment l’utiliser ?
- Faites une frise « courants → concepts → auteurs → méthodes → exemples ».
- Entraînez-vous à situer tout article/livre lu dans ce panorama.
- Servez-vous des notices pour rédiger des paragraphes d’historiographie.
- Repérez le vocabulaire-clé (sérialité, mentalités, représentation, etc.).
8. Qu’est-ce que l’histoire culturelle ? (Folio, 2024)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Peter Burke offre la meilleure porte d’entrée à un domaine désormais omniprésent dans les cours : l’histoire culturelle. L’ouvrage (traduit et actualisé) retrace la tradition – de Burckhardt aux Subaltern Studies – et fait le point sur les notions (représentations, pratiques, corps, émotions), les croisements disciplinaires (anthropologie, sociologie, gender, postcolonial) et les méthodes (micro-histoire, étude des performances).
Pour un étudiant, c’est un guide d’orientation : il résume ce qu’il faut savoir pour maîtriser un commentaire iconographique, un sujet sur les sensibilités, ou bâtir une problématique originale en L3. L’édition Folio rend le texte plus accessible ; la version Belles Lettres propose un avant-propos substantiel et une bibliographie sélective très utile.
Comment l’utiliser ?
- Fichez 10 notions « culturelles » avec exemples historiques précis.
- Pour tout document figuré, vérifiez : pratique, représentation, réception.
- Puisez dans les biblios pour créer des « mini-panoramas » thématiques.
- Révisez avec la table des matières : elle sert de checklist de cours.
9. Réussir sa licence d’histoire (Studyrama, 2025)
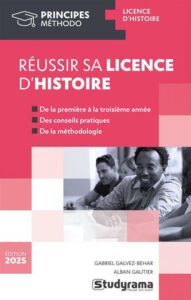
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Moins « théorique », ce guide de Gabriel Galvez-Behar et Alban Gautier répond aux questions qui font souvent la différence : organisation du semestre, méthodo des exercices, attendus implicites des évaluations, usage des bibliothèques et ressources numériques, orientation (mineures, stages, concours), exemples corrigés.
La nouvelle édition actualise les conseils (travail en groupe, prise de notes, bibliographie, gestion du temps). C’est le compagnon de route pragmatique : il évite de réinventer la roue et structure vos efforts semaine après semaine. Utile aussi pour préparer des oraux (exposés, khôlles) et professionnaliser votre posture d’étudiant.
Comment l’utiliser ?
- Construisez, à partir du livre, un planning « semaine type » réaliste.
- Reprenez les sujets corrigés et comparez-les aux attentes de vos UE.
- Mettez en place une veille (Cairn, e-revues) selon leurs conseils.
- Utilisez les check-lists en amont des partiels (matériel, timing, relectures).
Conseils de lecture et de travail
- Alternez méthode et pratique : un chapitre de Prost/Veyne → un exercice (dissert/commentaire).
- Constituez un répertoire de citations courtes (5–6 lignes max.) mobilisables sans alourdir vos copies.
- Entraînez-vous à “légender” une carte ou un graphique en 5 phrases : source, échelle, message, limites, lien avec la problématique.
- Faites vivre vos livres : marges, post-its, fiches synthèse, mini-glossaire maison.
- Pour aller plus loin (L3 et M1) : Historiographies. Concepts et débats, t. I & II (Gallimard, Folio Histoire, 2010) et Histoire mondiale de la France (Seuil/Points, dir. P. Boucheron) — utiles pour élargir les perspectives et nourrir introductions et ouvertures.
Références
- Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne — Licence Histoire : objectifs, parcours et maquette
- Université Lumière Lyon 2 — Licence 1 Histoire : programme et contenus du semestre
- Université Bordeaux Montaigne — Licence Histoire : organisation des études et UE
- Sorbonne Université — Guide pratique « Réussir sa licence d’histoire » (PDF)
- Onisep — La licence Histoire : contenus, compétences et débouchés
- FUN-MOOC — Cours d’histoire et de géographie (sélection de MOOC utiles)
- EHESS — Méthodologie de la recherche en histoire (UE : techniques et ressources)