Julian Patrick Barnes est un écrivain britannique né le 19 janvier 1946 à Leicester. Issu d’une famille d’enseignants de français, il grandit à Londres puis dans sa périphérie. Après des études de langues modernes à l’université d’Oxford (1968), il débute sa carrière comme lexicographe pour l’Oxford English Dictionary, avant de devenir critique littéraire et journaliste.
Sa carrière littéraire commence en 1980 avec la publication de son premier roman « Metroland » et d’un polar sous le pseudonyme de Dan Kavanagh. Auteur prolifique, il écrit de nombreux romans, nouvelles, essais et mémoires, devenant l’une des figures majeures de la littérature postmoderne britannique. Ses œuvres, traduites dans plus de 40 langues, lui valent de prestigieuses récompenses dont le Prix Booker (2011), le Prix Médicis essai et le Prix Femina.
Francophile reconnu, Barnes est particulièrement apprécié en France où il est fait Commandeur des Arts et des Lettres (2004) puis Officier de la Légion d’honneur (2017). Son œuvre se caractérise par une grande diversité thématique et stylistique, abordant aussi bien l’histoire, l’art, la mémoire que les relations humaines. Veuf depuis 2008 de Pat Kavanagh, son épouse et agente littéraire, il continue d’être un observateur engagé de la société britannique, s’opposant notamment au Brexit et aux politiques culturelles conservatrices.
Voici notre sélection de ses romans majeurs.
1. Le perroquet de Flaubert (1984)
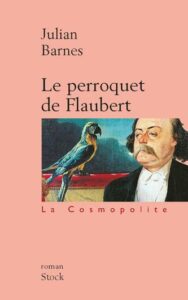
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Dans les années 1980, un médecin anglais à la retraite sillonne la Normandie sur les traces de Gustave Flaubert. Geoffrey Braithwaite, veuf, passionné par l’auteur de « Madame Bovary », se lance dans une drôle d’investigation : retrouver parmi deux spécimens empaillés le véritable perroquet qui aurait servi de modèle à Flaubert pour sa nouvelle « Un cœur simple ».
Le narrateur accumule les découvertes inattendues sur son écrivain fétiche : ses amours contrariées, ses opinions tranchées sur la littérature, ses habitudes excentriques. Mais à mesure que progresse son enquête, c’est sa propre histoire qui affleure en filigrane, notamment le mystère entourant la disparition de son épouse.
Autour du livre
La genèse du « Perroquet de Flaubert » prend racine dans un voyage que Julian Barnes effectue en Normandie en 1981. Lors d’une visite au musée Flaubert de l’Hôtel-Dieu à Rouen, il découvre l’existence de deux perroquets empaillés – l’un à Rouen, l’autre à Croisset – revendiquant chacun le titre de modèle authentique ayant inspiré Loulou dans « Un cœur simple ». Cette simple anecdote consignée dans ses carnets de voyage devient l’étincelle créatrice d’un livre qui bouscule les conventions de la biographie littéraire.
Barnes conçoit son ouvrage comme une mosaïque de quinze chapitres aux formes variées : chronologies multiples, bestiaire, guide ferroviaire, dictionnaire pastiche, sujets d’examens… Cette structure kaléidoscopique permet d’aborder Flaubert sous des angles inédits, loin des approches universitaires traditionnelles. Les trois chronologies du deuxième chapitre en offrent un parfait exemple : la première met en valeur les succès de l’écrivain, la seconde ses échecs, tandis que la troisième se compose uniquement de métaphores extraites de sa correspondance.
Le choix d’un narrateur fictif, Geoffrey Braithwaite, médecin anglais veuf obsédé par Flaubert, constitue une autre originalité majeure. Ce subterfuge narratif autorise Barnes à prendre des libertés impossibles dans une biographie classique. Braithwaite peut ainsi se permettre des hypothèses audacieuses et laisser coexister des versions contradictoires, tout en parsemant le texte d’humour britannique. Sa quête du véritable perroquet devient métaphore d’une interrogation plus vaste sur la possibilité même de saisir la vérité d’un écrivain.
Barnes multiplie les perspectives : il donne la parole à Louise Colet pour livrer sa version de sa relation avec Flaubert, compose un bestiaire des animaux qui peuplent son œuvre et sa correspondance, analyse les références aux trains dans ses écrits. Il va jusqu’à imaginer les livres que Flaubert n’a pas écrits et les vies qu’il n’a pas vécues. Cette approche kaléidoscopique trouve son point culminant dans la révélation finale : les deux perroquets initiaux se transforment en une cinquantaine de spécimens possibles, démultipliant vertigineusement les interprétations potentielles.
Cette construction sophistiquée vaut au « Perroquet de Flaubert » une réception paradoxale : publié comme roman en Angleterre, il reçoit le Prix Médicis essai en France. Le succès est immédiat des deux côtés de la Manche. Barnes, qui confie avoir eu peu d’attentes concernant la réception de son livre – imaginant au mieux intéresser quelques flaubertiens et psittacophiles – voit son ouvrage rapidement traduit en plusieurs langues.
L’ambition originelle de Barnes n’était pas d’ajouter une nouvelle couche au « tumulus biographique et critique » existant sur Flaubert. Son projet consistait plutôt à créer un objet littéraire inclassable, mêlant avec virtuosité le factuel et le fictionnel, le XIXe siècle et l’époque contemporaine. Le résultat transcende les genres pour devenir ce que Michel Murat qualifie d’hapax – une œuvre sans antécédents ni postérité générique, comparable à un coup de dés impossible à rejouer.
Les archives de Barnes révèlent un travail préparatoire minutieux : listes d’histoires potentielles, compilation méticuleuse des citations de Flaubert, traductions personnelles de la correspondance… Cette méthode de composition programmée contraste avec le caractère apparemment libre et fragmenté du résultat final. Le livre devient ainsi un magnifique oxymore : une construction rigoureusement chaotique qui reflète la complexité même de son sujet.
En définitive, « Le perroquet de Flaubert » ne cherche pas à enfermer son sujet dans une vérité définitive mais propose au contraire une multiplication vertigineuse des possibles. Barnes y réussit le tour de force de questionner la biographie littéraire tout en créant une forme nouvelle qui dynamite le genre. Son livre se mue en méditation sur l’impossibilité de saisir la vérité d’un être, fût-il un des écrivains les plus documentés de la littérature française.
Aux éditions STOCK ; 342 pages.
2. Love, etc. (1991)
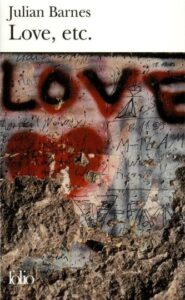
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Dans ce roman publié en 1991, Julian Barnes met en scène un trio amoureux peu conventionnel. Stuart et Oliver, amis depuis le lycée malgré leurs personnalités opposées, se disputent l’amour de Gillian. L’un est banquier, méthodique et réservé, l’autre professeur d’anglais, extraverti et fantasque.
Tout bascule le jour du mariage de Stuart avec Gillian, restauratrice de tableaux. Oliver réalise soudain qu’il est éperdument amoureux de la jeune femme et décide de la séduire, sans égard pour son meilleur ami. S’ensuit une série d’événements qui conduiront Gillian à quitter Stuart pour Oliver, bouleversant irrémédiablement l’équilibre de leur trio.
Le récit adopte une structure chorale originale où chaque personnage s’adresse directement au lecteur, livrant sa version des faits. Ces confessions croisées révèlent peu à peu la complexité des relations, entre manipulation, culpabilité et désir. Le portrait sans concession de ces trois êtres ordinaires confrontés à leurs contradictions fait émerger une réflexion acérée sur l’amour et l’amitié.
Autour du livre
Publié en 1991 sous le titre original « Talking It Over », ce sixième roman de Julian Barnes renouvelle brillamment le thème éternel du triangle amoureux grâce à un dispositif narratif singulier : les trois protagonistes s’adressent directement au lecteur, transformé en confident et quasi-juge de leurs confessions croisées. Cette construction polyphonique permet à Barnes de déconstruire les mécanismes des relations humaines, tout en maintenant une tension narrative soutenue.
La force du récit réside dans le contraste saisissant entre ses trois voix principales. Stuart incarne la rationalité poussée jusqu’à l’obtusion, tandis qu’Oliver déploie une verve flamboyante qui masque mal ses failles. Entre eux, Gillian apparaît plus discrète mais non moins complexe. Leurs témoignages contradictoires sur les mêmes événements créent un effet kaléidoscopique qui questionne la nature même de la vérité en matière de sentiments.
Barnes conjugue avec maestria l’humour britannique le plus mordant – notamment dans les interventions d’Oliver, véritable feu d’artifice verbal – et une réflexion aigüe sur l’amour, le mariage et l’amitié. La dimension comique n’occulte jamais la cruauté sous-jacente des situations ni la finesse de l’analyse psychologique. Le texte fourmille d’aphorismes cinglants sur la nature des relations conjugales, comme lorsqu’un personnage affirme que « l’amour est juste un système pour se faire appeler ‘chéri’ après l’acte sexuel. »
La construction du roman en trois parties – chiffre récurrent dans l’œuvre de Barnes – trouve un écho dans sa structure narrative à trois voix. Cette architecture complexe permet d’explorer les zones d’ombre entre les versions contradictoires des personnages, laissant au lecteur la liberté d’établir sa propre vérité. Le final, d’une violence psychologique remarquable, couronne cette mécanique narrative implacable en soulevant plus de questions qu’il n’apporte de réponses.
Barnes excelle particulièrement dans sa capacité à faire surgir l’universel du particulier : à travers ce trio spécifique se dessine une réflexion plus large sur la nature cyclique des relations amoureuses et la difficulté à établir des vérités définitives en matière de sentiments. Les personnages secondaires, notamment la mère française de Gillian, apportent un contrepoint cynique qui enrichit encore la palette émotionnelle du roman.
Couronné par le Prix Femina étranger en 1992, « Love, etc. » connaît une suite intitulée « Dix ans après », qui retrouve les mêmes personnages une décennie plus tard. Marion Vernoux en propose également une adaptation cinématographique en 1996, transposant l’intrigue dans un contexte français avec Charlotte Gainsbourg, Yvan Attal et Charles Berling.
Aux éditions FOLIO ; 377 pages.
3. Arthur & George (2005)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
L’histoire commence en 1903 dans un petit village anglais. George Edalji, avoué méticuleux, fils d’un pasteur d’origine indienne, se retrouve au cœur d’une sombre affaire : on l’accuse d’avoir éventré des chevaux dans la campagne environnante. Malgré l’absence de preuves tangibles, la justice le condamne à sept ans de travaux forcés.
Après trois ans derrière les barreaux, George est libéré sans explication ni réhabilitation. En désespoir de cause, il écrit à Arthur Conan Doyle, alors au sommet de sa gloire. L’écrivain, qui vit une période trouble entre la maladie de sa première épouse et son amour platonique pour Jean Leckie, décide de reprendre du service comme détective, non plus dans la fiction mais dans la réalité.
Autour du livre
Dans « Arthur & George », Julian Barnes entremêle les destins de deux hommes que tout sépare dans l’Angleterre victorienne : Arthur Conan Doyle, médecin et écrivain à succès, et George Edalji, modeste avoué d’origine parsie. Cette narration en miroir permet à Barnes d’orchestrer une réflexion sur l’identité britannique et ses paradoxes à travers le prisme d’une erreur judiciaire historique.
Le roman s’inscrit dans la lignée des grandes affaires qui ont secoué l’Europe à la fin du XIXe siècle, comme l’affaire Dreyfus en France. Barnes puise dans une documentation méticuleuse – lettres authentiques, articles de journaux, rapports gouvernementaux, débats parlementaires – pour reconstituer cette page méconnue de l’histoire anglaise. Cette trame historique sert de socle à une méditation sur les thèmes de l’honneur, de la justice et des préjugés raciaux.
La force du texte réside dans sa capacité à saisir la complexité psychologique des personnages. George apparaît comme un homme méthodique et réservé, prisonnier d’un certain aveuglement face aux préjugés raciaux qui l’entourent. Arthur, lui, est dépeint dans toute sa contradiction : noble défenseur de la justice mais aussi fervent adepte du spiritisme, homme d’honneur torturé par son amour pour Jean Leckie du vivant de sa première épouse.
Barnes excelle particulièrement dans sa peinture des tensions qui traversent la société britannique. Le traitement réservé à la famille Edalji met en lumière le racisme latent de l’époque, tandis que le comportement d’Arthur révèle les codes moraux rigides de la période victorienne. Le roman questionne ainsi la notion même d’anglicité : ni Arthur l’Écossais ni George le Parsi ne sont « des Anglais de pure souche », comme le souligne Barnes avec ironie.
Il est significatif que Barnes, qui avait auparavant écrit des romans policiers sous le pseudonyme de Dan Kavanagh, choisisse de transformer cette erreur judiciaire en une méditation sur la vérité et ses manifestations. La structure même du roman, avec ses chapitres alternés entre Arthur et George, crée un effet de parallélisme qui souligne les contrastes entre les deux hommes tout en révélant leurs points communs inattendus.
Le texte interroge aussi la nature même de la connaissance et de la certitude. Les méthodes déductives chères à Sherlock Holmes se heurtent ici à la réalité plus complexe du monde judiciaire, où les préjugés et les apparences l’emportent souvent sur la logique pure. Cette tension entre vérité et apparence trouve un écho particulier dans l’intérêt d’Arthur pour le spiritisme, qui constitue une autre forme de quête de la vérité. Le personnage de George, fils de pasteur, incarne une forme de martyre séculier, tandis qu’Arthur représente une figure quasi-christique de rédempteur.
« Arthur & George » a reçu un accueil critique enthousiaste lors de sa parution en 2005, notamment sélectionné pour le prestigieux Man Booker Prize. Les critiques ont particulièrement salué la manière dont Barnes parvient à insuffler vie à cette histoire vraie sans jamais tomber dans le piège de la reconstitution historique artificielle. Le roman a fait l’objet d’une adaptation télévisée en 2015 par ITV, sous forme d’une mini-série en trois épisodes, avec Martin Clunes dans le rôle d’Arthur Conan Doyle et Arsher Ali dans celui de George Edalji. Une version théâtrale a également vu le jour en 2010, dramatisée par David Edgar pour le Birmingham Repertory Theatre et le Nottingham Playhouse.
Aux éditions FOLIO ; 608 pages.
4. Une fille, qui danse (2011)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Angleterre, années 1960. Tony Webster partage ses années de lycée avec trois amis inséparables. Le plus brillant d’entre eux, Adrian, impressionne le groupe par son intelligence et sa maturité. À l’université, Tony vit une histoire d’amour avec Veronica, une jeune femme énigmatique qui le quittera pour se mettre en couple avec Adrian. Quelques mois plus tard, ce dernier met fin à ses jours.
Quarante ans ont passé. Tony, désormais retraité et divorcé, reçoit un héritage inattendu : la mère de Veronica lui lègue 500 livres et le journal intime d’Adrian. Cette nouvelle ravive des souvenirs qu’il croyait enfouis et le pousse à recontacter Veronica pour obtenir le mystérieux journal.
Au fil de sa quête, Tony découvre que la réalité de son passé diffère radicalement de ce qu’il s’était persuadé avoir vécu. Une lettre haineuse écrite dans sa jeunesse refait surface, ainsi qu’une série de révélations qui l’obligent à reconsidérer le rôle qu’il a joué dans le destin d’Adrian.
Autour du livre
Avec « Une fille, qui danse », Julian Barnes livre une méditation vertigineuse sur la malléabilité de la mémoire et les illusions que nous entretenons sur notre propre passé. Les souvenirs, loin d’être des archives fidèles, se révèlent des constructions mouvantes sans cesse réinventées par notre esprit. Cette thématique centrale se déploie à travers le personnage de Tony Webster, un sexagénaire qui doit affronter une vérité longtemps occultée lorsque le testament d’une femme à peine connue le confronte brutalement à son passé.
La structure du livre en deux parties distinctes met habilement en scène ce questionnement sur la fiabilité des souvenirs. La première moitié présente une version lisse et contrôlée du passé de Tony, tandis que la seconde fait voler en éclats cette reconstruction confortable. Barnes manie avec brio le principe du narrateur peu fiable, non par malice mais par auto-aveuglement. Tony incarne cette tendance universelle à remodeler nos souvenirs pour préserver une image acceptable de nous-mêmes.
En écho au titre original « The Sense of an Ending », emprunté à un essai de Frank Kermode sur la théorie littéraire, le roman interroge notre besoin de donner sens et cohérence à nos vies. Cette quête de sens se heurte pourtant à l’impossibilité d’établir une vérité définitive sur le passé. Comme le note Barnes à travers son personnage : « L’histoire n’est pas seulement les mensonges des vainqueurs […] mais aussi les autoréalisations des survivants ».
La construction du récit mime le fonctionnement de la mémoire elle-même : fragmentaire, subjective, traversée de zones d’ombre et de certitudes trompeuses. Barnes distille subtilement les indices qui permettront au lecteur, comme à Tony, de remettre en question la version initiale des événements. Cette technique narrative sophistiquée transforme progressivement ce qui semblait être une histoire de retrouvailles tardives en une enquête vertigineuse sur soi-même.
Si le livre s’inscrit dans la lignée des grands romans britanniques sur la mémoire et le remords, comme « Les Vestiges du jour » de Kazuo Ishiguro, il se démarque par son traitement particulièrement acéré de l’auto-illusion. La prose de Barnes, précise et incisive, décortique les mécanismes par lesquels nous réécrivons constamment notre propre histoire. Le titre français, avec sa virgule énigmatique, fait écho à un bref moment du récit où Veronica danse pour Tony. Cette scène apparemment anodine cristallise toute l’ambiguïté des relations entre les personnages et la façon dont un instant peut acquérir, avec le recul, une signification insoupçonnée.
Récompensé par le prestigieux Man Booker Prize en 2011, « Une fille, qui danse » séduit par sa construction mathématique et son dénouement percutant. La présidente du jury Stella Rimington salue d’ailleurs « un livre qui parle à l’humanité du XXIe siècle » tout en soulignant qu’il « révèle de nouvelles profondeurs à chaque lecture ». La critique britannique, notamment à travers le London Review of Books, souligne la manière dont Barnes parvient à transformer une histoire en apparence banale en une réflexion profonde sur la responsabilité morale et le poids des actes passés.
L’adaptation cinématographique réalisée par Ritesh Batra en 2017, avec Jim Broadbent et Charlotte Rampling dans les rôles principaux, transpose efficacement à l’écran cette réflexion sur le temps et la mémoire. Le film conserve l’essence du roman tout en donnant corps aux séquences du passé qui hantent le protagoniste.
Aux éditions FOLIO ; 224 pages.
5. La seule histoire (2018)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Dans une petite ville du Surrey, au début des années 1960, Paul Casey passe un été morne entre deux années universitaires. Pour l’occuper, ses parents l’inscrivent au club de tennis où il rencontre Susan MacLeod, une femme de 48 ans, mariée et mère de deux filles plus âgées que lui. De leur complicité sur le court naît une relation qui défie les conventions de l’époque.
Leur amour grandit dans l’ombre des regards désapprobateurs, jusqu’à ce que le scandale les pousse à quitter la ville. Ils s’installent à Londres, où Paul poursuit ses études de droit grâce à l’argent de Susan. Les premières années sont heureuses, mais peu à peu, une sombre réalité émerge : l’alcoolisme de Susan, qui n’avait jamais bu une goutte avant leur rencontre.
Paul consacre sa vingtaine à tenter de sauver celle qu’il aime, oscillant entre espoir et désespoir face à une maladie qui transforme Susan en étrangère. Cette lutte épuisante le force à questionner la nature même de son engagement : est-ce encore l’amour qui le retient ou simplement le devoir ?
Autour du livre
Treizième roman de Julian Barnes, « La seule histoire » marque un virage dans son œuvre – c’est le premier livre qu’il n’a pas dédié à son épouse Pat Kavanaugh, décédée en 2008. Cette absence de dédicace résonne d’autant plus fortement avec le thème central du livre : l’empreinte indélébile que laisse un premier amour sur une vie entière.
En exergue figure une définition du roman par Samuel Johnson datant de 1755 : « une petite histoire, généralement d’amour ». Cette apparente simplicité cache une construction narrative ambitieuse en trois mouvements, chacun correspondant à une voix différente. La première partie emploie le « je », donnant accès à l’immédiateté des sensations du jeune Paul. La deuxième bascule vers le « vous », créant une distance réflexive. La troisième adopte le « il », parachevant ce mouvement de détachement progressif. Cette évolution des pronoms personnels traduit la transformation intérieure du protagoniste, son passage de l’innocence à l’expérience, mais aussi sa tentative de mettre à distance une souffrance qui ne s’est jamais vraiment estompée.
Le roman s’ouvre sur une question philosophique vertigineuse : « Préféreriez-vous aimer davantage, et souffrir davantage ; ou aimer moins, et moins souffrir ? » Cette interrogation traverse l’ensemble du récit comme un fil rouge, trouvant son écho dans une citation de Chamfort que le narrateur conserve précieusement : « En amour, tout est vrai, tout est faux ; c’est la seule chose sur laquelle on ne puisse pas dire une absurdité. »
L’action se situe dans une banlieue résidentielle au sud de Londres dans les années 1960-1970, période charnière marquée par l’émergence de nouvelles libertés sexuelles. Le contexte social est finement dessiné à travers les réactions feutrées mais réprobatrice de cette société anglaise où « la respectabilité n’était pas plus abandonnée en public que les vêtements ». Barnes excelle dans la peinture de ce milieu bourgeois avec ses codes et ses non-dits, ses parties de tennis et ses verres de gin.
Le personnage de Joan, l’amie de Susan, incarne particulièrement bien cette Angleterre post-guerre. Figure solitaire entourée de chiens, elle porte un regard lucide teinté de cynisme sur les relations humaines. À travers elle, Barnes dessine en creux le portrait d’une génération marquée par les privations et les traumatismes de la guerre.
La structure du roman fait écho à son propos : comme la mémoire qui trie et réorganise les souvenirs selon les besoins du présent, le récit progresse par touches successives, alternant moments de grâce et signes avant-coureurs du désastre à venir. Le narrateur lui-même met en garde contre la fiabilité de ses souvenirs : « Je me remémore le passé, je ne le reconstruis pas. »
La critique britannique a salué ce retour de Barnes à la forme qui lui avait valu le Man Booker Prize pour « Une fille, qui danse ». Selon The Guardian, « La seule histoire » brille par son « ton mélancolique et intime » et sa façon d’interroger la nature même de l’amour. Le Times Literary Supplement souligne quant à lui la maîtrise avec laquelle Barnes parvient à transmuer une histoire d’amour apparemment banale en une méditation profonde sur la mémoire et le temps.
Ce qui frappe particulièrement dans ce roman, c’est la manière dont Barnes parvient à tenir ensemble les contraires : la légèreté et la gravité, l’humour et la tragédie, la passion et sa dissolution. L’alcoolisme de Susan n’est jamais traité de façon spectaculaire mais s’insinue progressivement dans le récit, comme les bouteilles qu’elle dissimule « sous l’évier, sous le lit, derrière les étagères, dans son estomac, dans sa tête, dans son cœur. »
Cette histoire d’amour entre un jeune homme de dix-neuf ans et une femme de quarante-huit ans transcende le simple scandale pour devenir une réflexion sur ce qui reste quand l’amour s’en va. Paul finit par comprendre que « lorsqu’on est jeune, on ne se sent pas de devoir envers l’avenir ; mais quand on est vieux, on a un devoir envers le passé. » Ce passé dont il ne peut se défaire devient paradoxalement ce qui le constitue comme sujet.
Aux éditions FOLIO ; 352 pages.
6. England, England (1998)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Dans un futur proche, le richissime Jack Pitman conçoit un projet mégalomane : rassembler sur l’île de Wight les attractions emblématiques de l’Angleterre. Pour mener à bien cette entreprise, il recrute Martha Cochrane, une quadragénaire brillante marquée par l’abandon paternel de son enfance. Ensemble, ils créent « England, England », un parc où les touristes peuvent visiter Big Ben, admirer une reproduction miniature de Buckingham Palace, croiser Robin des Bois dans la forêt de Sherwood reconstituée, rencontrer la famille royale et découvrir les légendes britanniques, le tout concentré sur quelques kilomètres carrés.
Le succès est tel que le parc obtient son indépendance et intègre l’Union européenne, pendant que la « vraie » Angleterre sombre dans un inexorable déclin. Martha, promue à la tête du projet après avoir découvert les penchants inavouables de Pitman, règne sur ce simulacre de nation. Mais son triomphe est de courte durée : un scandale la contraint à l’exil, de retour dans une Angleterre désormais archaïque.
Autour du livre
Nommé pour le Booker Prize en 1998, « England, England » se lit comme une satire mordante qui interroge l’identité nationale britannique à travers le prisme d’un projet pharaonique : la création d’un parc d’attractions regroupant tous les stéréotypes de l’anglicité sur l’île de Wight. Cette prémisse singulière permet à Julian Barnes de disséquer avec causticité les mécanismes de la mémoire collective et individuelle, tout en questionnant la frontière entre authenticité et simulacre dans notre société contemporaine.
La construction tripartite du récit reflète une progression temporelle et thématique savamment orchestrée. Le premier volet, centré sur l’enfance de Martha Cochrane, pose les jalons d’une réflexion sur la mémoire et ses déformations. Le puzzle des comtés d’Angleterre devient une métaphore filée de l’incomplétude, symbolisée par la pièce manquante du Nottinghamshire que le père emporte dans sa fuite. Cette partie initiale se distingue par sa sensibilité et sa justesse psychologique dans l’évocation des souvenirs d’enfance.
Le deuxième mouvement, qui constitue le cœur du roman, déploie une verve satirique cinglante à travers la description du projet « England, England ». Le personnage de Sir Jack Pitman incarne avec outrance les travers du capitalisme triomphant : mégalomanie, cynisme et perversion sexuelle se conjuguent dans cette figure grotesque de tycoon. Les cinquante « quintessences » de l’anglicité, établies par sondage auprès des touristes potentiels, dressent un inventaire aussi hilarant qu’accablant des clichés sur l’Angleterre.
La dernière partie, « Anglia », projette le lecteur dans un futur post-apocalyptique où la véritable Angleterre, vidée de sa substance, régresse vers un état préindustriel. Cette vision prophétique prend une résonance particulière à la lumière du Brexit : Barnes anticipe dès 1998 l’isolement britannique et les tensions avec l’Union européenne.
Les personnages secondaires, notamment les acteurs du parc d’attractions qui finissent par s’identifier totalement à leurs rôles historiques, participent à la réflexion sur l’authenticité et l’illusion. Robin des Bois et sa bande se mettent réellement à braconner, tandis que le Dr Johnson devient véritablement désagréable avec les clients – une manière pour Barnes d’illustrer le brouillage croissant entre réalité et simulation.
Le roman puise sa force théorique dans les réflexions de Jean Baudrillard sur le simulacre et la société du spectacle. L’idée que la copie puisse supplanter l’original trouve son expression la plus aboutie dans le succès d’England, England au détriment de la véritable Angleterre. Cette thématique fait écho aux préoccupations contemporaines sur la marchandisation de la culture et l’industrie du tourisme de masse.
La critique est partagée sur la cohérence de l’ensemble : si les première et dernière parties recueillent l’unanimité pour leur finesse d’analyse, la partie centrale divise davantage. Certains y voient une farce appuyée qui peine à s’intégrer au ton plus subtil du reste de l’œuvre. Néanmoins, cette disparité de registres peut se lire comme un choix délibéré, reflétant la tension entre authentique et artificiel qui traverse le roman.
L’intelligence conceptuelle de Barnes se manifeste dans sa capacité à entrelacer les destins individuels et collectifs. Le parcours de Martha, de l’enfance traumatisée à la maturité désabusée, fait écho à l’évolution de l’Angleterre elle-même. La question de l’identité – personnelle ou nationale – traverse « England, England » comme un fil rouge, interrogeant la possibilité même d’une authenticité dans un monde dominé par les simulacres.
Aux éditions FOLIO ; 441 pages.
7. Le fracas du temps (2016)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
En 1936, le compositeur Dmitri Chostakovitch attend chaque nuit sur le palier de son appartement, une valise à la main. Son opéra « Lady Macbeth de Mzensk » a déplu à Staline et la Pravda l’a condamné comme « anti-soviétique ». Dans la terreur des grandes purges, il préfère se tenir prêt pour éviter que sa famille n’assiste à son arrestation.
« Le fracas du temps » suit ce géant de la musique russe à travers trois moments décisifs : ces nuits d’angoisse de 1936, un voyage à New York en 1949 où il doit servir la propagande soviétique, et enfin les années Khrouchtchev où, devenu figure officielle du régime, il doit composer avec sa conscience et ses compromissions. Entre survie et création artistique, résistance et soumission, Chostakovitch tente de préserver son art tout en protégeant les siens.
Autour du livre
Premier roman publié par Julian Barnes après son Booker Prize pour « Une fille, qui danse » en 2011, « Le fracas du temps » délaisse la fiction pure pour s’attaquer à la figure complexe du compositeur russe Dmitri Chostakovitch. Ce choix n’est pas anodin – Barnes emprunte son titre aux mémoires du poète Ossip Mandelstam, victime des purges staliniennes, créant d’emblée une résonance entre deux destins d’artistes confrontés au totalitarisme.
La narration s’articule autour de trois moments charnières espacés de douze ans – 1936, 1948 et 1960 – qui correspondent aux « conversations avec le Pouvoir » imposées à Chostakovitch. Cette structure ternaire, semblable aux mouvements d’une symphonie, permet à Barnes d’orchestrer une méditation sur la survie de l’art sous la dictature. La répétition lancinante de la phrase « Tout ce qu’il savait c’est que ceci était le pire moment » ouvre chaque partie, tel un motif musical qui souligne l’enfermement psychologique du compositeur.
L’originalité de Barnes tient dans son refus de livrer une biographie conventionnelle ou un réquisitoire moral. À travers une narration à la troisième personne qui épouse les circonvolutions mentales de Chostakovitch, il sonde les compromissions graduelles d’un artiste pris entre son intégrité et sa survie. Cette approche distingue « Le fracas du temps » des récits habituels sur la période stalinienne – pas de scènes spectaculaires de répression, mais une dissection minutieuse de la terreur quotidienne et de ses effets sur la conscience.
Barnes s’attache particulièrement à déconstruire les notions simplistes de courage et de lâcheté. Pour Chostakovitch, « être un héros était bien plus facile qu’être un lâche » car l’héroïsme ne demande qu’un instant de bravoure, tandis que la lâcheté exige « une carrière qui durait toute une vie ». Cette réflexion sur la nature du courage moral transcende le cadre historique pour interroger la responsabilité de l’artiste face au pouvoir.
La question centrale qui traverse le livre – « À qui appartient l’art ? » – trouve sa réponse dans une formule saisissante : « L’art est le murmure de l’Histoire, perçu par-dessus le fracas du temps. » Barnes suggère ainsi que la véritable victoire de Chostakovitch réside peut-être dans la survie de sa musique, qui continue à parler par-delà les circonstances politiques qui l’ont vue naître.
Une certaine critique reproche à Barnes de ne pas assez s’attarder sur la musique elle-même. Mais ce parti pris correspond à sa volonté de saisir avant tout un état d’esprit, une conscience tourmentée par les exigences contradictoires de l’art et du pouvoir. Les compositions de Chostakovitch apparaissent moins comme des œuvres à analyser que comme des actes de résistance cryptée, des messages codés adressés à la postérité.
En faisant le choix d’une narration elliptique qui privilégie les moments de crise sur la continuité biographique, Barnes crée un texte qui mime les silences forcés et les non-dits caractéristiques de la période stalinienne. Cette économie narrative s’accorde avec la vision de Chostakovitch lui-même, qui considérait que la musique devait être « assez forte et vraie et pure pour recouvrir le fracas du temps. »
Aux éditions FOLIO ; 256 pages.




