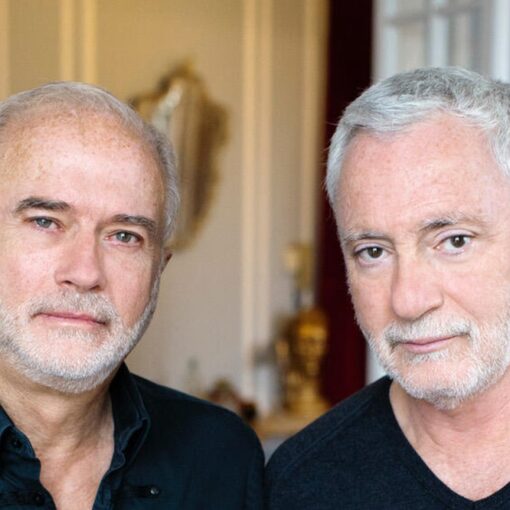Herta Müller, née le 17 août 1953 à Nițchidorf en Roumanie, est une romancière germano-roumaine qui a reçu le prix Nobel de littérature en 2009. Issue de la minorité allemande des Souabes du Banat, elle grandit dans un contexte familial marqué par l’histoire : sa mère fut déportée cinq ans dans un camp du Goulag soviétique et son père était un ancien soldat de la Waffen-SS.
Après des études de lettres allemandes et roumaines à l’université de Timișoara, elle devient traductrice dans une usine. Son refus de collaborer avec la Securitate (police secrète roumaine) lui vaut d’être licenciée en 1979. Ses premiers livres publiés en Roumanie, dont « Dépressions » (1982), sont censurés par le régime communiste.
Sous la pression internationale, elle obtient l’autorisation d’émigrer en Allemagne de l’Ouest en 1987. Son œuvre, composée d’une vingtaine de romans et récits, dépeint avec une extraordinaire force poétique la vie sous la dictature de Ceaușescu, abordant les thèmes de la surveillance, de la peur et de l’oppression. Son style singulier mêle réalisme et éléments fantastiques, dans une langue percutante.
Intellectuelle engagée, elle prend régulièrement position sur des sujets politiques, notamment pour dénoncer la persistance des méthodes de la Securitate dans la Roumanie post-communiste. Elle vit aujourd’hui à Berlin et continue d’être une voix importante de la littérature contemporaine.
Voici notre sélection de ses romans majeurs.
1. La bascule du souffle (2009)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
En janvier 1945, Léopold Auberg, jeune Roumain germanophone de 17 ans, est arraché à sa Transylvanie natale. Accusé comme des milliers d’autres d’avoir soutenu l’Allemagne nazie pendant la guerre, il est déporté dans un camp de travail en URSS sur ordre des autorités soviétiques. Sa grand-mère lui murmure alors une phrase qui le hantera : « Je sais que tu reviendras. »
Cinq années durant, Léopold survit dans le camp de Novo-Gorlovka en Ukraine. Les journées s’enchaînent entre l’usine de charbon, la cimenterie et la tuilerie. Deux rations de soupe aux choux, un bout de pain, le froid mordant, les poux, la dysenterie : telle est sa nouvelle réalité. Pour ne pas sombrer, il métamorphose son univers, prête vie aux objets, dialogue avec « l’ange de la faim » qui le tourmente sans répit.
Autour du livre
Dans « La bascule du souffle », Herta Müller dépeint l’expérience d’un jeune homme de 17 ans déporté dans un camp de travail soviétique en 1945. La genèse du livre découle d’une collaboration avortée avec le poète Oskar Pastior, lui-même ancien déporté qui devait co-écrire l’ouvrage avant son décès en 2006. En s’appuyant sur les témoignages recueillis auprès de Pastior et d’autres survivants, notamment sa propre mère qui passa cinq années dans les camps, Müller restitue cette page sombre de l’histoire roumaine longtemps passée sous silence.
Le récit se structure en soixante-quatre chapitres courts qui abolissent la chronologie traditionnelle. Cette architecture fragmentée reflète la désagrégation mentale et physique subie par les détenus. La narration oscille entre l’évocation crue du quotidien – le froid, les poux, le travail épuisant dans les mines de charbon et les cimenteries – et des passages où la réalité se métamorphose sous l’effet de l’imagination du narrateur. Les objets s’animent, se personnifient : la pelle devient un cœur, le ciment boit, le mouchoir offert par une vieille femme russe se transforme en « seul être à se soucier » du narrateur.
La faim, omniprésente, prend les traits d’un « ange » qui hante les détenus. Cette figure paradoxale incarne à la fois le tourment de la famine et une forme de salut : « Le Hungerengel (l’ange de la faim) doit être imaginé comme un esprit que l’affamé se crée pour pouvoir lutter contre lui ». Cette métaphore traverse tout le texte et lui confère sa dimension allégorique.
Les mots de la grand-mère du narrateur – « Je sais que tu reviendras » – agissent comme un talisman protecteur durant les cinq années de détention. Pourtant, le retour s’avère aussi problématique que la survie : le protagoniste ne parvient pas à se réinsérer dans une vie normale, hanté par son expérience. L’homosexualité du personnage principal, à peine esquissée, ajoute une couche supplémentaire d’aliénation.
La critique allemande s’est divisée sur ce livre finaliste du Deutscher Buchpreis 2009. Iris Radisch dans Die Zeit pointe une « virtuosité insincère et désengagée » tandis que Michael Naumann y voit un chef-d’œuvre sur « la peur quotidienne sous une dictature ». Le débat porte notamment sur la pertinence d’une approche poétique pour traiter d’une telle expérience traumatique.
Une adaptation théâtrale a vu le jour en octobre 2021 au Schauspiel de Cologne, dans une mise en scène de Bastian Kraft. Le texte a par ailleurs reçu plusieurs distinctions dont le Prix Oxford-Weidenfeld pour sa traduction anglaise en 2013.
Aux éditions FOLIO ; 368 pages.
2. Animal du cœur (1994)
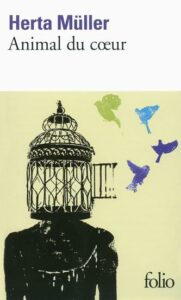
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Roumanie, années 1980. Sous la dictature de Ceaușescu, une jeune étudiante germanophone partage sa chambre universitaire avec cinq autres filles, dont Lola. Cette dernière, issue d’une province pauvre du sud, tente d’échapper à sa condition en multipliant les relations avec des ouvriers et son professeur de gymnastique. Un jour, on la retrouve pendue dans son placard avec la ceinture de la narratrice.
La mort de Lola marque le début d’une amitié profonde entre la narratrice et trois étudiants : Edgar, Kurt et Georg. Unis par la lecture du journal intime de leur amie disparue, ils développent une résistance silencieuse au régime. Mais leurs activités attirent l’attention de la Securitate, la police politique. Commence alors une longue série d’interrogatoires et de persécutions. Quand la répression s’intensifie, certains choisissent l’exil en Allemagne tandis que d’autres restent, au péril de leur vie.
Autour du livre
Dans « Animal du cœur », Herta Müller recrée l’atmosphère étouffante de la Roumanie sous Ceaușescu à travers une narration fragmentée et elliptique qui mime la désagrégation psychologique provoquée par la dictature. Cette écriture déstructurée, qui désarçonne d’abord le lecteur, traduit avec une grande justesse l’expérience traumatique de la surveillance permanente et de la peur omniprésente.
La métaphore centrale du titre – le « Herztier » en allemand, littéralement « animal du cœur » – évoque cette part indomptable qui survit en chacun malgré l’oppression. Ce néologisme poétique incarne la résistance intime face à la déshumanisation orchestrée par le régime. Les personnages portent en eux cet « animal du cœur » qui détermine leur caractère et leurs réactions face à l’adversité.
Le récit s’ancre dans la propre expérience de l’autrice, issue comme sa narratrice de la minorité allemande de Roumanie, les Souabes du Banat. Cette dimension autobiographique se double d’une portée universelle sur les mécanismes de la terreur politique. À travers le destin de quatre jeunes gens, Müller dissèque les effets corrosifs de la dictature sur les rapports humains : l’amitié devient suspecte, l’intimité impossible, la confiance un luxe dangereux.
Les images récurrentes des prunes vertes dévorées par les policiers ou du carnet de Lola fonctionnent comme des leitmotivs obsédants qui structurent ce récit éclaté. La narration procède par touches impressionnistes, par fragments qui s’assemblent peu à peu comme les pièces d’un puzzle cauchemardesque. Cette construction reflète la difficulté à saisir et à dire une réalité rendue opaque par la propagande et la censure.
Le texte tisse également un réseau complexe de références à la Seconde Guerre mondiale, notamment à travers la figure du père ancien SS qui hante la narratrice. Cette superposition des traumatismes historiques montre comment les régimes totalitaires se nourrissent des blessures du passé pour perpétuer la violence et la peur.
La critique internationale salue unanimement la puissance d’évocation de ce roman qui renouvelle la littérature du témoignage. Le jury du Prix IMPAC Dublin souligne « la beauté âpre » du texte et sa capacité à « évoquer brillamment un monde de cruauté et d’oppression ». « Animal du cœur » reçoit également le prestigieux Prix Kleist en 1994. Plusieurs adaptations théâtrales ont vu le jour, notamment au Maxim Gorki Theater de Berlin en 2009 et au Theater Konstanz en 2013.
Aux éditions FOLIO ; 288 pages.
3. La convocation (1997)
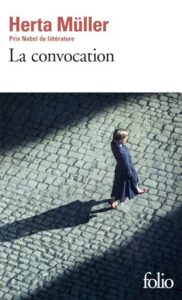
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Une femme monte dans un tramway de Bucarest, convoquée « à dix heures précises » dans les bureaux de la Securitate. Nous sommes dans la Roumanie communiste des années 1980, sous la dictature de Ceaușescu. Cette convocation n’est pas la première : depuis qu’elle a tenté de fuir sa condition en glissant des « bouteilles à la mer », des messages dans les poches de pantalons destinés à l’export italien, la police politique la harcèle d’interrogatoires.
Le roman suit le trajet en tramway qui la mène vers cette énième convocation. Dans l’angoisse de l’attente, ses pensées divaguent : son premier mariage raté, sa relation avec Paul qui noie son mal-être dans l’alcool, sa meilleure amie Lilli abattue en tentant de franchir la frontière. Entre les descriptions des autres passagers du tramway surgissent les fragments d’une vie marquée par la surveillance constante et la peur.
Autour du livre
À travers le prisme d’un trajet en tramway de quatre-vingt-dix minutes, « La convocation » dépeint la Roumanie sous le régime totalitaire de Ceaușescu. Cette œuvre, publiée initialement en allemand en 1997 sous le titre « Heute wär ich mir lieber nicht begegnet », constitue l’un des piliers ayant mené Herta Müller au Prix Nobel de littérature en 2009.
Une narration à la fois minimaliste et kaléidoscopique se déploie sur fond d’oppression quotidienne. La protagoniste, dont le nom n’est jamais révélé, traverse la ville pour répondre à une énième convocation du major Albu de la Securitate. Son crime ? Avoir glissé des messages « Ti aspetto » (« Je t’attends ») dans les poches de pantalons destinés à l’exportation vers l’Italie, dans l’espoir d’épouser un étranger qui l’aiderait à fuir le pays. Cette transgression lui vaut d’être accusée de « prostitution sur le lieu de travail » et la place sous la surveillance constante de la police politique.
Les pensées de la narratrice oscillent entre présent et passé, dessinant un portrait fragmenté de la société roumaine. Les figures qui peuplent son univers mental témoignent de l’absurdité du système : Lilli, son amie dévorée par des chiens lors d’une tentative de fuite vers la Hongrie ; Paul, son second mari qui noie son désespoir dans l’alcool ; le « Commissaire Parfumé », son ancien beau-père qui a envoyé ses grands-parents dans un camp de travail forcé. Chaque personnage porte en lui les stigmates d’un régime qui broie les individus.
Dans cet univers kafkaïen, la paranoïa règne en maître. Le concierge note scrupuleusement les allées et venues dans des cahiers d’écolier qu’il doit acheter lui-même. Un doigt humain tranché apparaît mystérieusement dans le sac à main de la narratrice. Les interrogatoires commencent invariablement par un baisemain mouillé du major Albu, rituel humiliant qui symbolise la perversion du pouvoir. La frontière entre normalité et folie s’estompe progressivement.
La construction narrative défie les conventions. Sans chapitres ni ponctuation traditionnelle – les points d’interrogation sont notamment absents – le texte mime le flux de conscience désordonné de la narratrice. Les souvenirs surgissent par associations d’idées, créant une mosaïque narrative où la moindre observation du présent peut déclencher une plongée dans le passé. Cette structure labyrinthique reflète l’état d’une femme qui lutte pour préserver sa santé mentale face à l’absurdité bureaucratique.
L’atmosphère étouffante s’incarne également dans les descriptions précises du quotidien : les files d’attente devant les magasins vides, l’eau-de-vie « Deux Prunes » qui coule à flots, les antennes de télévision bricolées pour capter les chaînes étrangères. Ces détails concrets ancrent l’oppression dans une réalité tangible et montrent comment la dictature infiltre les moindres aspects de l’existence.
La critique a salué la puissance évocatrice de « La convocation ». Le New York Times note cependant que le livre représente « plus une épreuve d’endurance qu’un plaisir », tandis que le Guardian souligne la « surréelle absurdité de la vie sous Ceaușescu ». Oscar Ross, dans le Helsingin Sanomat, loue la capacité de Müller à « éviter le sentimentalisme » tout en dépeignant « sur le même pied d’égalité la vie dans ses aspects beaux et horribles ».
Aux éditions FOLIO ; 272 pages.
4. Le renard était déjà le chasseur (1992)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Dans la Roumanie de Ceaușescu à la fin des années 1980, Adina, une jeune institutrice proche des milieux dissidents, découvre que des inconnus s’introduisent régulièrement dans son appartement pour découper, morceau par morceau, la fourrure d’un renard qui orne son intérieur. Cette intrusion symbolique marque le début d’une surveillance étroite par la Securitate, la redoutable police politique du régime.
Le piège se referme peu à peu. Clara, sa meilleure amie qui travaille comme ingénieure dans une usine, fréquente Pavel, un officier des services secrets. Paul, l’ancien compagnon d’Adina devenu son ami proche, milite dans les cercles contestataires aux côtés d’Abi, un musicien dissident. Dans un climat de suspicion généralisée où les amis disparaissent ou se trahissent, Adina tente de préserver sa liberté tandis que le régime vacille. Hélas, même la chute du dictateur ne suffira pas à dissiper cette atmosphère délétère.
Autour du livre
Premier roman de Herta Müller après son exil en Allemagne en 1987, « Le renard était déjà le chasseur » dépeint les derniers mois du régime de Ceaușescu en Roumanie. Cette œuvre marque un tournant dans sa carrière : elle y aborde frontalement la dictature des années 1980 et s’impose alors comme l’une des voix majeures de la littérature politique contemporaine.
Le génie de Müller réside dans sa capacité à transmettre l’expérience du totalitarisme à travers une écriture poétique qui défie les conventions narratives. Face à la langue de bois du régime qui avait perverti le langage, elle forge un style unique fait de phrases brèves et incisives, de métaphores inattendues. Cette écriture fragmentée reflète la désintégration d’une société sous surveillance permanente. Le fil narratif se dissout dans une succession de tableaux où chaque détail prend une dimension symbolique. La trame centrale – une peau de renard mutilée pièce par pièce dans l’appartement d’Adina – cristallise la terreur insidieuse instillée par la Securitate. Ce n’est pas tant l’intrigue qui importe que l’atmosphère suffocante qu’elle parvient à créer.
Les personnages évoluent dans un monde où la frontière entre bourreaux et victimes s’estompe. Clara fréquente un agent de la police secrète, Pavel infiltre un groupe d’amis – la paranoïa contamine jusqu’aux relations les plus intimes. Cette ambiguïté morale fait écho aux observations de Dostoïevski sur la porosité des rôles entre oppresseurs et opprimés.
L’originalité de Müller tient aussi à sa position d’écrivaine germanophone issue de la minorité souabe du Banat. Cette double appartenance culturelle lui permet de porter un regard singulier sur la Roumanie de Ceaușescu. Elle crée une langue littéraire hybride qui traduit le déracinement et l’aliénation.
La réception critique s’est montrée contrastée. Si certains saluent la puissance poétique du texte, d’autres jugent le style hermétique, voire irritant. Le « Literarisches Quartett », émission littéraire allemande de référence, a vivement débattu de la pertinence des choix formels. Pour les uns, la fragmentation narrative et l’omniprésence des métaphores servent admirablement le propos ; pour d’autres, elles entravent la lisibilité. Charlotte Ryland, dans le Times Literary Supplement, souligne la force intacte du texte dans sa traduction anglaise de 2016 : la cruauté de la vie sous le régime et l’exaltation fragile de sa chute y sont rendues avec une acuité saisissante.
« Le renard était déjà le chasseur » figure aujourd’hui parmi les œuvres majeures de Müller, derrière « Animal du cœur » et « La bascule du souffle » en termes de succès public. Une adaptation cinématographique, « Der Fuchs der Jäger », a été produite en collaboration avec Harry Merkel. Le roman contient d’ailleurs une dimension cinématographique dans sa construction par séquences et sa façon de travailler les images.
Aux éditions FOLIO ; 288 pages.
5. L’homme est un grand faisan sur terre (1986)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Au cœur d’un village roumain des années 1980, le meunier Windisch compte les jours – deux ans et deux cent vingt et un jours exactement – depuis qu’il a entamé les démarches pour émigrer en Allemagne avec sa famille. Comme beaucoup d’autres membres de la minorité germanophone sous le régime de Ceaușescu, il rêve de quitter ce pays où la vie devient chaque jour plus difficile.
Malgré les sacs de farine livrés au maire et l’argent versé aux autorités, les papiers tardent à venir. Dans ce village où règnent la corruption et les abus de pouvoir, chacun doit faire des compromissions pour survivre. Sa femme Katharina porte encore les stigmates de son passé en Russie où elle s’est prostituée pour ne pas mourir de faim. À présent, c’est au tour d’Amélie, leur fille, de se soumettre aux exigences du milicien et du prêtre pour accélérer l’obtention des documents.
Autour du livre
Dans « L’homme est un grand faisan sur terre », publié en allemand en 1986 sous le titre « Der Mensch ist ein grosser Fasan auf der Welt », Herta Müller dépeint la vie quotidienne d’une communauté germanophone dans la Roumanie de Ceaușescu. Cette œuvre s’inscrit dans une période sombre de l’histoire roumaine, où la corruption gangrène chaque strate de la société et où l’émigration constitue l’unique échappatoire pour les minorités opprimées.
Le titre, tiré d’un dicton roumain, recèle une symbolique puissante : le faisan, oiseau maladroit et vulnérable sur terre, incarne parfaitement la condition des personnages, proies faciles dans un système totalitaire. Cette métaphore traverse l’ensemble du récit, où les oiseaux occupent une place prépondérante – notamment la chouette, messagère de mort dans les croyances populaires.
La narration se déploie à travers une succession de saynètes autonomes, fragmentées, qui peuvent se lire comme des récits indépendants. Cette construction atypique crée un effet de mosaïque où chaque chapitre apporte sa pierre à l’édifice tout en conservant son autonomie narrative. Le texte alterne entre réalisme cru et touches de surréalisme, notamment à travers des images saisissantes comme celle du pommier dévorant ses propres fruits.
La dimension autobiographique transparaît en filigrane : née dans la minorité germanophone du Banat, Müller a elle-même vécu sous le régime de Ceaușescu avant d’émigrer en Allemagne de l’Ouest en 1987, soit un an après la publication de ce livre. Cette expérience personnelle insuffle au texte une authenticité poignante, particulièrement dans la description des mécanismes de corruption et d’oppression.
Le cadre spatio-temporel, un village roumain figé dans une temporalité oppressante, se mue en microcosme de la dictature. Les éléments naturels – pluie incessante, sécheresse dévastatrice – participent à créer une atmosphère étouffante qui reflète l’état psychologique des personnages. Le village devient ainsi le théâtre d’une déshumanisation progressive, où la survie prime sur toute considération morale.
Certains critiques établissent des parallèles avec l’univers de Garcia Marquez, notamment dans le traitement du surnaturel, tandis que d’autres rapprochent son style de celui de Vladimir Sorokine ou évoquent des similarités avec « La femme du tigre » de Téa Obreht.
Aux éditions FOLIO ; 124 pages.