Edmond Moore Hamilton naît le 21 octobre 1904 à Youngstown, Ohio. Enfant prodige, il entre à l’université de Westminster à seulement 14 ans, mais abandonne ses études trois ans plus tard. Sa carrière d’écrivain débute en 1926 avec la publication de sa première nouvelle « Le Dieu monstrueux de Mamurth » dans le magazine Weird Tales, dont il devient l’un des contributeurs les plus prolifiques.
Dans les années 1930-40, Hamilton s’impose comme l’un des pionniers du space opera aux côtés d’Edward Elmer « Doc » Smith. Il acquiert le surnom de « World Wrecker » (Le Destructeur de Mondes) pour ses histoires d’aventures spatiales spectaculaires. Sa série la plus populaire, « Capitaine Futur », connaît un grand succès auprès du jeune public. En 1942, il commence à écrire pour DC Comics, participant notamment aux aventures de « Superman » et « Batman ».
En 1946, Hamilton épouse l’écrivaine Leigh Brackett. Cette union marque le début d’une période particulièrement créative, durant laquelle il produit certaines de ses œuvres les plus abouties, comme « Les Rois des étoiles » (1949) et « La Ville sous globe » (1951). Son style évolue alors vers plus de réalisme.
Hamilton meurt le 1er février 1977 à Lancaster, Californie, des suites de complications après une opération des reins. La même année, son œuvre connaît un regain d’intérêt grâce à l’adaptation en anime de « Capitaine Futur » par le studio Toei, qui lui vaut une nouvelle popularité, particulièrement en Europe.
Voici notre sélection de ses romans majeurs.
1. Les Loups des étoiles (1967-1968)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Morgan Chane, seul humain parmi les redoutables « Loups des étoiles », a grandi sur Varna, une planète à la gravité écrasante qui confère à ses habitants une force physique exceptionnelle. Orphelin de missionnaires terriens, il a été adopté par ces pirates de l’espace qui sèment la terreur dans toute la galaxie. Mais après avoir tué l’un des siens en légitime défense, il doit fuir la vendetta du clan Ranroi. Poursuivi sans relâche, son vaisseau endommagé dérive dans l’espace jusqu’à ce qu’il soit secouru par John Dilullo et son équipe de mercenaires.
Le capitaine Dilullo, seul à connaître la véritable identité de Chane, lui propose un marché : rejoindre son équipe pour une mission périlleuse sur la planète Kharal, en échange de quoi il taira son secret. Les mercenaires doivent retrouver et détruire une arme mystérieuse convoitée par les Vhollans, ennemis jurés des Kharali. L’enquête les mène jusqu’à une épave gigantesque dans une nébuleuse, où ils découvrent que l’arme tant recherchée n’est autre qu’un vaisseau des Krii, une race extraterrestre aux immenses pouvoirs.
Autour du livre
Cette trilogie d’Edmond Hamilton, publiée entre 1967 et 1968, prend place à une période charnière de la science-fiction. Alors que le Prix Hugo récompense « Dune », « Révolte sur la Lune », « Seigneur de lumière » et « Tous à Zanzibar », et que « 2001, l’Odyssée de l’espace » s’apprête à sortir au cinéma, « Les Loups des étoiles » perpétue la tradition du space opera classique tout en y insufflant des préoccupations contemporaines.
Le duo formé par Morgan Chane et John Dilullo évoque irrésistiblement celui de Martin Riggs et Roger Murtaugh dans l’espace. Cette dynamique entre le jeune impétueux et le vétéran endurci constitue l’une des forces de la série, notamment dans le deuxième tome où l’allégorie de la drogue transparaît à travers l’Errance Libre. Hamilton mêle ainsi les codes du genre à une réflexion sur les enjeux sociétaux des années 1960.
L’influence de cette œuvre sur la science-fiction populaire s’avère considérable, en particulier sur la saga « Star Wars ». L’épouse d’Hamilton, Leigh Brackett, participera d’ailleurs à l’écriture du scénario de « L’Empire contre-attaque ». Les similitudes entre Morgan Chane et Han Solo sautent aux yeux, jusqu’au compagnon poilu qui préfigure Chewbacca. La série inspire également une adaptation en série télévisée au Japon, plus tard remontée en deux films présentés dans l’émission « Mystery Science Theater 3000 ».
Si certains aspects scientifiques peuvent paraître datés aujourd’hui, comme les imprimantes dans les vaisseaux spatiaux, la justification des différentes races extraterrestres s’appuie sur des concepts de panspermie et d’évolution adaptative qui donnent une cohérence à cet univers foisonnant. Les trois tomes forment un ensemble organique où chaque épisode ajoute une nouvelle dimension à la quête d’identité du protagoniste, partagé entre ses origines terriennes et son éducation varnane.
Aux éditions FOLIO ; 631 pages.
2. Capitaine Futur – L’Empereur de l’espace (1940)
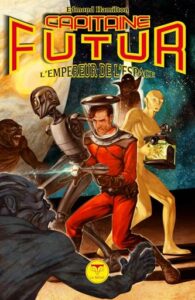
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Dans les années 1990, l’humanité s’est répandue à travers le système solaire. Le Capitaine Futur, de son vrai nom Curtis Newton, patrouille l’espace à bord de son vaisseau, le Comète, accompagné d’une équipe hors du commun : Grag le robot, Otho l’androïde métamorphe, et le professeur Simon Wright, dont seul le cerveau survit dans une boîte high-tech. Orphelin élevé sur la Lune après l’assassinat de ses parents scientifiques, il a fait le serment de protéger l’humanité contre ceux qui détournent la science à des fins criminelles.
Sa nouvelle mission le mène sur Jupiter, où un mystérieux « Empereur de l’espace » utilise une technologie inconnue pour transformer les humains en singes primitifs. Alors que la panique se répand dans la colonie terrienne de Jovopolis, le Capitaine doit naviguer entre les complots politiques, les pièges mortels et une possible révolte des natifs joviens. L’enquête le conduira dans les profondeurs de la planète géante, où les ruines d’une civilisation ancienne pourraient receler le secret de cette terrible arme de régression.
Autour du livre
L’épopée spatiale imaginée par Edmond Hamilton en 1940 s’inscrit dans la lignée du space opera classique, où optimisme scientifique et aventures grandioses se mêlent avec candeur. Les héritages sont multiples : Superman et Batman pour la dimension super-héroïque, Doc Savage pour l’expertise scientifique, Flash Gordon pour les péripéties interplanétaires. Cette filiation se manifeste notamment dans la conception du personnage principal, Curtis Newton, qui emprunte plusieurs caractéristiques à Bruce Wayne : parents assassinés, base secrète, signal lumineux pour l’appeler à l’aide, et arsenal de gadgets high-tech.
La description du système solaire dans « L’Empereur de l’espace » reflète les connaissances astronomiques limitées des années 1940. Jupiter y abrite une atmosphère respirable, cinquante continents recouverts de jungles et trente océans. Cette vision désuète ne nuit pas à la cohérence interne du récit, qui compense par une attention méticuleuse portée aux explications scientifiques des technologies utilisées.
L’impact de cette œuvre sur la science-fiction dépasse largement le cadre de sa publication initiale. Des éléments comme la prise vulcaine de Star Trek trouvent leur origine dans une technique de combat similaire utilisée par le Capitaine Futur. Le mystérieux Empereur de l’espace, avec son costume noir et sa voix déformée, préfigure certains aspects de Dark Vador. L’adaptation en dessin animé par la Tōei Animation en 1978 sous le titre « Capitaine Flam » a contribué à perpétuer cet héritage, particulièrement en France où la série a marqué toute une génération.
La dimension manichéenne des personnages et la simplicité apparente de l’intrigue masquent une réflexion sous-jacente sur les dangers du progrès technologique détourné à des fins malveillantes. Hamilton soulève également des questions sur la colonisation et les relations entre espèces intelligentes, notamment à travers le traitement des Joviens autochtones.
Figure centrale de l’Âge d’or de la science-fiction américaine, Hamilton a posé avec cette série les jalons d’une sous-culture populaire qui trouvera son apogée dans les grandes sagas cinématographiques comme Star Wars, Battlestar Galactica et Star Trek. Premier volet d’une série qui comptera vingt tomes, « L’Empereur de l’espace » constitue un précieux témoignage d’une époque où la conquête spatiale nourrissait encore tous les fantasmes.
Aux éditions LE BÉLIAL’ ; 213 pages.
3. Capitaine Futur – À la rescousse (1940)
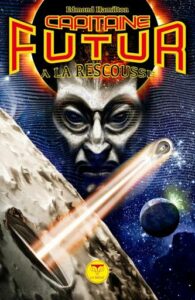
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
En 1940, les lecteurs américains découvrent une nouvelle aventure du Capitaine Futur, protecteur attitré d’un système solaire où les neuf planètes grouillent de vie et de civilisations. Cette fois, une menace sans précédent ébranle la paix interplanétaire : sur tous les écrans apparaît le Dr Zarro, proclamant qu’une mystérieuse planète noire s’apprête à pulvériser la Terre. Il exige le pouvoir absolu en échange de son aide pour écarter le danger.
Mandaté par le président du Gouvernement intersidéral, le Capitaine Futur se lance sur les traces du mystérieux docteur avec ses inséparables compagnons : Simon Wright, Grag le robot et Otho l’androïde. L’enquête les mène d’abord sur Mars, où Joan Randall de la Police des Planètes est kidnappée sous leurs yeux. S’ensuit une course-poursuite à travers le cosmos, jusqu’aux confins glacés de Pluton et ses trois lunes énigmatiques, domaine des « montagnes qui marchent » et d’une civilisation alien aux pouvoirs extraordinaires.
Autour du livre
Publié durant l’âge d’or de la science-fiction américaine, « À la rescousse » témoigne d’une époque où l’imagination primait sur la rigueur scientifique. Les connaissances astronomiques de 1940 permettent à Hamilton de dépeindre un système solaire grouillant de vie, où chaque planète abrite ses propres civilisations. Cette liberté créatrice engendre des situations surprenantes : des émissions de télévision qui atteignent instantanément tous les points du système solaire, bafouant la vitesse limite de la lumière, ou encore la mention de l’Éther, concept scientifique pourtant invalidé au début du XXe siècle.
La prescience d’Hamilton étonne néanmoins lorsqu’il cite trois satellites de Pluton – Charon, Styx et Cerbère – dont l’existence ne sera confirmée que plusieurs décennies plus tard. Charon ne sera découvert que dans les années 1970, tandis que les deux autres attendront l’avènement du télescope spatial Hubble au XXIe siècle pour être observés.
Les affrontements entre Grag et Otho insufflent une dimension humoristique bienvenue, chacun revendiquant sa supériorité sur l’autre en matière d’humanité. L’ajout d’Ik, chiot lunaire friand de métal doté de pouvoirs télépathiques, renforce cette veine comique. Le traitement de Joan Randall reflète en revanche les stéréotypes de genre de l’époque : bien que présentée comme l’une des meilleures agents de la police interplanétaire, elle multiplie les maladresses et tombe régulièrement en pâmoison devant le Capitaine Futur.
Les péripéties s’enchaînent à un rythme effréné : des Sargasses spatiales aux plaines glacées de Pluton en passant par les « Montagnes qui marchent », l’inventivité narrative ne faiblit jamais. Cette débauche d’imagination trouvera un second souffle dans les années 1970 avec l’adaptation en dessin animé « Capitaine Flam » par la Tôei Animation. L’anime modifiera certains éléments – le Docteur Zarro devient Professeur Zarro, le vaisseau Comète se transforme en Cyberlab – tout en conservant l’essence aventureuse du récit original.
Publié initialement dans « Captain Future Magazine » puis repris dans « Startling Stories », « À la rescousse » s’impose comme un jalon essentiel du space opera, préfigurant des succès planétaires comme « Star Wars », « Battlestar Galactica » ou « Star Trek ».
Aux éditions LE BÉLIAL’ ; 243 pages.
4. Capitaine Futur – Le Défi (1940)
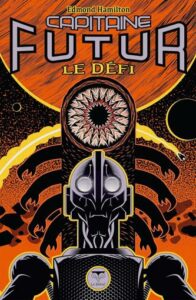
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Dans un système solaire futuriste des années 1940, le capitaine Futur, imposant héros aux cheveux roux, veille sur la paix interplanétaire depuis sa base lunaire. Secondé par une équipe hétéroclite – Simon Wright, un cerveau conservé dans du sérum, Grag, un puissant robot, et Otho, un androïde métamorphe – il répond aux appels de détresse grâce à un signal lumineux situé au pôle Nord terrestre.
Leur nouvelle mission est de la plus haute importance : un certain « Destructeur » orchestre la destruction systématique des mines de gravium, un minerai indispensable permettant aux humains de supporter les différentes gravités planétaires. Sans cette ressource, le commerce interplanétaire et toute l’économie du système solaire s’effondreraient. Le capitaine Futur doit identifier le coupable parmi les principaux propriétaires de mines, alors que les gisements sont détruits les uns après les autres sur Mercure, Mars et Saturne.
Autour du livre
Troisième volet des aventures du capitaine Futur, « Le Défi » perpétue la formule établie dans « L’Empereur de l’espace » et « À la rescousse » en y ajoutant quelques nuances notables. L’antagoniste passe des manipulations politiques à une stratégie économique, insufflant une dimension contemporaine au récit de 1940. La menace du monopole commercial et la destruction délibérée des ressources naturelles résonnent avec les préoccupations actuelles.
L’imagination scientifique de 1940 imprègne chaque page : un système solaire habitable de part en part, des Uraniens aux Plutoniens en passant par les Vénusiens, Neptune transformée en planète-océan et Saturne couverte de prairies verdoyantes. Cette vision d’avant-guerre témoigne d’un optimisme technologique débridé, où l’énergie atomique incarne encore toutes les promesses, bien avant Hiroshima. Les innovations techniques parsèment le récit : verrières en « verrite », télévisions primitives, et surtout cette machine capable de transférer un esprit d’un corps à l’autre.
Le texte gagne en profondeur psychologique par rapport aux épisodes précédents. Les doutes assaillent parfois le héros, nuançant son image de superman spatial. La conclusion elle-même s’imprègne d’une certaine amertume, humanisant ce justicier interplanétaire. L’enquête policière à la Sherlock Holmes s’entremêle aux péripéties spatiales, multipliant les fausses pistes et maintenant le suspense jusqu’au dénouement.
L’adaptation en dessin animé dans les années 1970 sous le titre « Capitaine Flam » a métamorphosé certains éléments : Joan Randall devient blonde, le professeur Simon Wright gagne en autonomie grâce à un système autoporteur, et le « Destructeur » se transforme en « Wrackar ». Le succès de cette version animée, particulièrement en France avec son générique devenu culte, a offert une seconde vie à cette série initialement publiée dans les magazines pulp américains.
Aux éditions LE BÉLIAL’ ; 213 pages.




