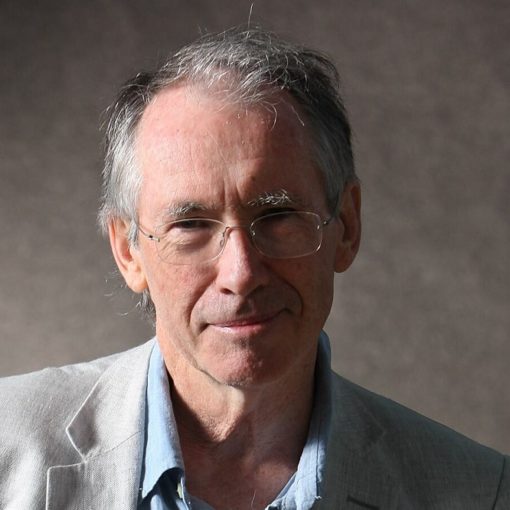Zadie Smith est une romancière, essayiste et critique littéraire britannique née le 25 octobre 1975 à Londres. Née d’un père anglais et d’une mère jamaïcaine, elle grandit dans le nord-ouest de Londres où elle pratique les claquettes et le théâtre durant son enfance.
Diplômée en littérature anglaise du King’s College de Cambridge en 1997, elle connaît un succès fulgurant dès son premier roman « Sourires de loup » (2000), vendu à plus d’un million d’exemplaires et récompensé par plusieurs prix prestigieux. Elle poursuit sa carrière en publiant plusieurs romans acclamés, dont « De la beauté » (2005) qui remporte l’Orange Prize for Fiction, et « Ceux du Nord-Ouest » (2012) adapté par la BBC.
Parallèlement à son activité de romancière, elle mène une carrière universitaire en enseignant l’écriture créative, notamment à Harvard et à l’Université de New York. Elle est également une essayiste et critique culturelle reconnue, collaborant régulièrement avec des publications comme The New Yorker et The Guardian.
Son roman « L’imposture » (2023), marque son entrée dans le genre historique et figure parmi les dix meilleurs livres de l’année selon le New York Times. Mariée depuis 2004 au poète Nick Laird, avec qui elle a deux enfants, Zadie Smith est considérée comme l’une des voix majeures de la littérature britannique contemporaine.
Voici notre sélection de ses romans majeurs.
1. Sourires de loup (2000)
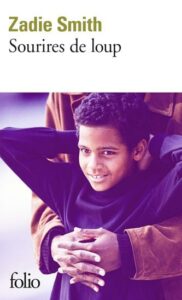
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Cette saga londonienne suit les parcours de deux amis que tout sépare : Archie Jones, Anglais jusqu’au bout des ongles, et Samad Iqbal, musulman du Bengale. Leur amitié naît dans les tranchées de la Seconde Guerre mondiale et se poursuit dans le quartier populaire de Willesden. Sur près de cinquante ans, le récit entrecroise leurs destins et ceux de leurs familles, témoins des mutations de la société britannique.
Autour du livre
Premier roman de Zadie Smith publié en 2000, « Sourires de loup » naît d’une circonstance éditoriale peu commune : un éditeur repère une nouvelle de la jeune autrice dans un recueil universitaire d’Oxford et lui demande si elle a d’autres textes. Elle lui envoie les 80 premières pages d’une histoire plus longue. Sur la base de cet extrait, l’éditeur Simon Prosser lui offre une avance de 250 000 livres sterling – un pari audacieux pour une écrivaine de 24 ans.
L’histoire se déploie dans le Londres multiculturel des années 1970-1990, entremêlant les destinées de trois familles : les Jones (anglo-jamaïcains), les Iqbal (bengalis) et les Chalfen (juifs d’Europe de l’Est). À travers leurs parcours, Smith interroge l’immigration, l’identité et l’héritage culturel dans la société britannique contemporaine. Elle y fait résonner les échos du colonialisme britannique tout en dépeignant ses répercussions sur les générations suivantes.
La réception critique s’avère enthousiaste dès la parution. Le New York Times salue un talent « préternaturel » tandis que le Guardian loue l’humour et la chaleur du texte. « Sourires de loup » remporte de nombreuses distinctions : le Guardian First Book Award, le James Tait Black Memorial Prize, le Whitbread Book Award et le Betty Trask Award. Il figure également dans la liste des 100 meilleurs romans anglophones établie par Time Magazine.
Pourtant, Smith elle-même porte un regard critique sur son œuvre. Elle qualifie la fin de « calamiteuse » et compare son écriture à celle « d’un scénariste des Simpson qui aurait brièvement rejoint une secte religieuse avant de découvrir Foucault ». Le critique James Wood forge même le terme de « réalisme hystérique » pour caractériser ce style qui mêle descriptions minutieuses de phénomènes sociaux et situations absurdes.
Le texte connaît plusieurs adaptations : une mini-série télévisée en quatre épisodes sur Channel 4 en 2002, puis une version théâtrale au Kiln Theatre de Londres en 2018, enrichie de treize chansons originales de Paul Englishby. À travers sa structure complexe et ses personnages hauts en couleur, « Sourires de loup » s’inscrit dans la lignée des grandes fresques sociales britanniques, de Dickens à Rushdie. L’ouvrage marque l’émergence d’une voix singulière dans la littérature anglophone contemporaine, celle d’une romancière capable de saisir les contradictions et les espoirs de la Grande-Bretagne moderne.
Aux éditions FOLIO ; 738 pages.
2. De la beauté (2005)
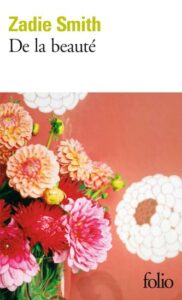
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Howard Belsey, professeur d’université anglais installé près de Boston, accumule les déboires. Sa carrière de spécialiste de Rembrandt patine, son épouse Kiki ne lui pardonne pas sa récente infidélité. Leurs trois enfants métis s’éloignent : Jerome s’est réfugié dans la religion, Zora se lance corps et âme dans les études, tandis que Levi, le benjamin, renie ses origines bourgeoises pour s’inventer une identité de jeune noir des quartiers.
Le chaos s’installe quand Monty Kipps débarque comme professeur à Wellington. Cet universitaire conservateur d’origine antillaise est l’adversaire intellectuel d’Howard – ils s’opposent sur tout, de l’interprétation de Rembrandt à la discrimination positive. Les relations entre les deux familles se compliquent quand leurs enfants commencent à se fréquenter, tandis qu’une amitié inattendue naît entre les deux épouses.
Autour du livre
Librement inspiré de « Howards End » de E. M. Forster, « De la beauté » transpose brillamment les thèmes de ce classique victorien dans l’Amérique contemporaine. La transposition ne se limite pas à un simple exercice de style : Smith s’approprie la trame narrative pour aborder des questionnements brûlants sur l’identité, la race et la culture dans le microcosme d’une université américaine.
Le milieu universitaire de Wellington (une Harvard à peine voilée) devient le théâtre d’affrontements idéologiques entre deux professeurs que tout oppose : Howard Belsey, intellectuel de gauche blanc anglais, et Monty Kipps, conservateur noir originaire de Trinidad. Smith dépeint les postures et les hypocrisies du monde académique, où les débats sur la discrimination positive masquent souvent des querelles d’ego. Les deux rivaux se révèlent aussi imparfaits l’un que l’autre, leurs convictions politiques servant de façade à leurs propres faiblesses.
La question raciale irrigue l’ensemble du récit sans jamais tomber dans le didactisme. Les enfants Belsey, issus d’un couple mixte, développent chacun un rapport différent à leur identité : Jerome se tourne vers la religion, Zora embrasse le militantisme universitaire tandis que Levi cherche une authenticité qu’il croit trouver auprès des immigrés haïtiens. Smith déconstruit avec tact les clichés sur l’identité noire à travers ces personnages qui refusent d’être réduits à leur couleur de peau.
L’art et la beauté constituent un autre fil rouge du roman. La spécialisation d’Howard en histoire de l’art, centrée sur Rembrandt, permet à Smith d’interroger notre rapport à la beauté, qu’elle soit physique ou artistique. Le contraste entre l’approche théorique et désincarnée d’Howard et la sensualité assumée de son épouse Kiki symbolise cette tension entre différentes conceptions de la beauté.
« De la beauté » a reçu en 2006 l’Orange Prize for Fiction et a été nominé pour le Man Booker Prize, confirmant la place de Smith parmi les voix majeures de la littérature britannique contemporaine. Sa capacité à mêler comédie sociale et réflexion sur des enjeux contemporains rappelle la tradition du roman anglais tout en la renouvelant radicalement.
Aux éditions FOLIO ; 608 pages.
3. Swing Time (2016)
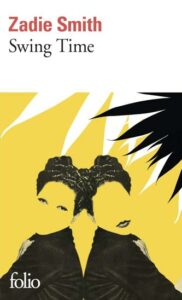
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
En 1982, dans un quartier modeste du nord-ouest londonien, deux petites filles métisses se lient d’amitié autour de leur passion pour la danse. Tracey possède un don naturel, tandis que la narratrice, handicapée par ses pieds plats, compense par son intelligence. Entre cours de claquettes et visionnage de comédies musicales avec Fred Astaire, leur complicité grandit malgré des familles aux valeurs opposées.
L’adolescence marque la première rupture. Tandis que Tracey s’inscrit dans une école de danse prestigieuse, la narratrice suit un cursus universitaire qui la mène jusqu’au poste d’assistante d’Aimee, une pop star internationale. Cette nouvelle vie la propulse entre New York et un village d’Afrique où sa patronne finance une école. Pendant ce temps, Tracey enchaîne les échecs professionnels et sombre dans une spirale autodestructrice. Leurs retrouvailles, des années plus tard, marqueront un dernier pas de danse ensemble.
Autour du livre
La structure non linéaire de « Swing Time » oscille entre deux périodes : l’enfance de la narratrice dans le Londres des années 1980 et sa vie d’adulte comme assistante d’une superstar internationale. Cette construction en va-et-vient reflète les thématiques du roman : l’identité métisse, les relations de pouvoir, le déterminisme social.
La comparaison avec « L’amie prodigieuse » d’Elena Ferrante s’impose naturellement. Les deux œuvres suivent des amies d’enfance aux destins divergents, l’une douée mais prisonnière de son milieu, l’autre moins talentueuse mais capable de s’élever socialement. Mais là où Ferrante creuse l’introspection psychologique, Smith maintient une distance à travers sa narratrice anonyme, dont la neutralité sert de prisme pour observer les autres personnages. Le choix de ne jamais nommer la narratrice n’est pas anodin : il souligne son effacement, sa tendance à se définir uniquement par rapport aux autres. Cette passivité contraste avec la force des personnages qui l’entourent : Tracey l’amie d’enfance rebelle, Aimee la pop star égocentrique, sa mère militante féministe.
Le projet humanitaire en Afrique de l’Ouest permet à Smith d’aborder les questions de l’aide internationale et du néocolonialisme avec une ironie mordante. La narratrice s’y trouve confrontée à l’ambiguïté de sa propre identité raciale : trop noire pour Londres, trop blanche pour l’Afrique. Cette réalité cristallise les contradictions entre les bonnes intentions occidentales et les réalités du terrain.
Sélectionné pour le Man Booker Prize 2017 et finaliste du National Book Critics Circle Award, « Swing Time » divise la critique. Certains y voient l’œuvre la plus aboutie de Smith quand d’autres regrettent un manque de cohérence narrative. Cette divergence d’opinions reflète peut-être la nature même du roman : comme une danse, il privilégie le mouvement et le rythme sur la progression linéaire. Le titre, emprunté à un film de 1936 avec Fred Astaire, établit un dialogue avec l’histoire de la danse et de la pop culture. À travers les références aux comédies musicales classiques et aux icônes comme Michael Jackson, Smith interroge l’appropriation culturelle et la place des artistes noirs dans l’industrie du spectacle.
Aux éditions FOLIO ; 576 pages.
4. Ceux du Nord-Ouest (2012)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
À l’approche de la quarantaine, quatre anciens camarades du quartier populaire de Caldwell, au nord-ouest de Londres, suivent des chemins divergents. Leah stagne dans un emploi associatif et ment à son mari sur son désir d’enfant. Keisha a effacé ses origines modestes en devenant Natalie, une brillante avocate qui élève ses enfants loin de la cité de son enfance. Le quotidien du quartier est rythmé par les apparitions fantomatiques de Nathan, leur ancien camarade devenu toxicomane, et les visites sporadiques de Felix qui tente de reconstruire sa vie après des années d’errance. Un événement tragique va faire voler en éclats leurs certitudes et mettre à nu les tensions qui couvent depuis tant d’années.
Autour du livre
Quatrième roman de Zadie Smith, « Ceux du Nord-Ouest » marque une rupture nette avec ses œuvres précédentes. La romancière britannique délaisse la narration classique pour adopter une structure expérimentale découpée en parties distinctes, chacune employant des techniques narratives différentes. Cette architecture fragmentée reflète la multiplicité de Londres et de ses habitants, tout particulièrement dans ce quartier populaire du nord-ouest qui donne son titre au livre.
À travers les destins croisés de quatre trentenaires issus de la cité Caldwell, Smith dissèque les mécanismes sociaux à l’œuvre dans la société britannique contemporaine. La mobilité sociale constitue l’un des fils conducteurs du récit : tandis que Natalie Blake (née Keisha) s’extirpe de son milieu d’origine pour devenir avocate, d’autres personnages comme Nathan restent prisonniers de la précarité et de la drogue. Le changement de prénom de Keisha en Natalie symbolise cette volonté d’effacement des origines, thème récurrent dans l’œuvre.
La structure même du livre épouse les trajectoires des personnages. La partie consacrée à Natalie se compose ainsi de 185 vignettes numérotées qui reflètent son parcours méthodique vers l’ascension sociale. À l’inverse, la partie dédiée à Leah adopte un style plus décousu fait de fragments et d’associations d’idées, à l’image de son indécision face à l’avenir. Cette variation des styles narratifs permet à Smith d’explorer différentes façons d’être londonien aujourd’hui.
« Ceux du Nord-Ouest » questionne également la notion d’authenticité dans un monde où les identités se construisent et se déconstruisent. Les personnages oscillent entre fidélité à leurs origines et désir de réinvention sociale. La tension entre ces deux pôles traverse l’ensemble du récit, notamment à travers la relation entre Leah et Natalie, amies d’enfance aux trajectoires divergentes.
Le multilinguisme y occupe également une place centrale : Smith reproduit fidèlement les différents registres de langue et accents qui coexistent dans ce quartier cosmopolite. Cette attention portée aux variations linguistiques témoigne de la diversité culturelle de Londres tout en soulignant les fractures sociales qui la traversent. La ville elle-même devient un personnage à part entière, décrite tantôt via des itinéraires précis empruntés aux plans Google Maps, tantôt à travers des impressions sensorielles. Cette double approche traduit la tension permanente entre l’objectif et le subjectif qui structure le roman.
L’accueil critique s’avère partagé : si certains saluent l’audace formelle et la profondeur de l’analyse sociale, d’autres regrettent un certain hermétisme. Le livre est néanmoins nommé pour le Women’s Prize for Fiction en 2013 et adapté en téléfilm par la BBC en 2016. Sept ans après « De la beauté », Smith livre avec « Ceux du Nord-Ouest » une œuvre ambitieuse qui renouvelle sa manière d’écrire la ville et ses habitants.
Aux éditions FOLIO ; 484 pages.
5. L’imposture (2023)
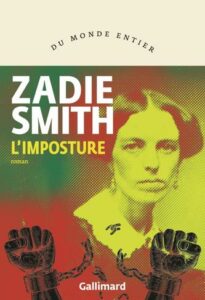
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
L’Angleterre des années 1870 s’enflamme pour l’affaire Tichborne : un boucher australien affirme être l’héritier disparu en mer d’une fortune bâtie sur l’esclavage en Jamaïque. Au cœur de ce scandale, Eliza Touchet, veuve intelligente et libre d’esprit, observe les remous qui agitent la société victorienne. Gouvernante chez son cousin William Ainsworth, écrivain ami de Dickens dont la gloire décline, elle corrige ses manuscrits médiocres tout en cachant sa propre acuité intellectuelle dans un monde qui refuse aux femmes le droit de penser.
Le destin la met sur la route d’Andrew Bogle, un ancien esclave jamaïcain devenu témoin clé du procès Tichborne. Ses révélations sur l’enfer des plantations sucrières ébranlent les certitudes d’Eliza sur son pays et sa classe sociale. Tandis que l’opinion publique se déchire autour de cette possible imposture, elle s’interroge sur les mensonges qui fondent la respectabilité victorienne.
Autour du livre
Avec « L’imposture », son premier roman historique, Zadie Smith, qui avait juré ne jamais écrire de fiction historique ni mentionner Dickens, transgresse ses propres interdits pour livrer une œuvre ambitieuse sur l’Angleterre victorienne. Le projet naît en 2012 lorsque Smith découvre par hasard l’affaire Tichborne, un procès retentissant qui passionna l’Angleterre des années 1870.
La narration, délibérément éclatée, épouse la forme des romans-feuilletons victoriens avec ses huit volumes et ses chapitres courts. Cette architecture divise la critique : certains y voient une prouesse formelle quand d’autres déplorent un manque de cohésion. Les multiples lignes temporelles s’entremêlent, créant un effet kaléidoscopique qui déstabilise parfois le lecteur mais permet d’éclairer différentes facettes de la société victorienne.
Le personnage d’Eliza Touchet constitue le pivot du récit. Cette figure historique méconnue devient sous la plume de Smith une héroïne paradoxale : à la fois témoin privilégié et outsider, catholique et abolitionniste dans une Angleterre protestante et coloniale, intellectuelle brillante cantonnée au rôle d’intendante. Sa relation complexe avec William Ainsworth, écrivain médiocre mais prospère qui fut un temps le rival de Dickens, permet à Smith de brosser un portrait mordant du milieu littéraire victorien.
L’affaire Tichborne, qui voit un boucher australien revendiquer l’identité d’un aristocrate disparu, sert de miroir aux questionnements contemporains sur la vérité et le mensonge en politique. Les parallèles avec l’ère de la « post-vérité » et certaines figures politiques actuelles s’imposent naturellement, bien que Smith se garde de tout didactisme appuyé.
La romancière aborde frontalement l’héritage de l’esclavage et du colonialisme britannique, notamment à travers le personnage d’Andrew Bogle, ancien esclave devenu témoin clé du procès Tichborne. Cette dimension historique révèle les hypocrisies d’une société qui s’enrichit de l’exploitation coloniale tout en cultivant une image de respectabilité morale.
Publié en 2023, « L’imposture » reçoit un accueil contrasté. Si la virtuosité stylistique de Smith fait l’unanimité, l’architecture narrative complexe et l’ampleur des thèmes abordés divisent les critiques. Le livre est néanmoins sélectionné parmi les meilleurs livres de l’année 2023 par le New York Times et le New Yorker.
Aux éditions GALLIMARD ; 546 pages.