Victoria Hislop naît en 1959 à Bromley, en Angleterre. Après des études de littérature anglaise au St Hilda’s College d’Oxford, elle travaille d’abord dans l’édition et les relations publiques avant de se tourner vers le journalisme. Elle voyage à travers le monde pour des reportages sur l’éducation et le voyage.
En 2005, inspirée par une visite de Spinalonga, une ancienne colonie de lépreux grecque, elle publie son premier roman « L’île des oubliés ». Le livre connaît un succès international retentissant avec plus de 6 millions d’exemplaires vendus et des traductions dans 40 langues. Il est par la suite adapté en série télévisée en Grèce.
Passionnée par la Méditerranée, Victoria Hislop continue d’explorer cette région dans ses romans suivants. Elle s’intéresse notamment à la guerre civile espagnole dans « Une dernière danse » et à l’histoire de Thessalonique au XXe siècle dans « Le Fil des souvenirs ». Son œuvre, qui embrasse fiction et histoire, lui vaut de nombreuses récompenses littéraires, particulièrement en France.
Son engagement pour la Grèce, sa culture et son histoire lui vaut d’obtenir la citoyenneté grecque honoraire en 2020. Mariée au journaliste Ian Hislop depuis 1988, avec qui elle a deux enfants, elle partage aujourd’hui sa vie entre Sissinghurst, dans le Kent, et son autre résidence en Crète. Elle est également ambassadrice de Lepra, une association caritative britannique qui soutient les personnes atteintes de la lèpre à travers le monde.
Voici notre sélection de ses romans majeurs.
1. L’île des oubliés (2005)
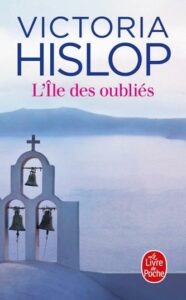
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Alexis, une jeune archéologue anglaise de vingt-cinq ans, part en Crète avec son fiancé Ed. Cette terre est celle de sa mère Sophia, qui n’a jamais rien dévoilé de son passé ni de ses origines. Désireuse de comprendre ce silence, Alexis se rend à Plaka, le village natal de sa mère. Face au rivage se dresse l’île de Spinalonga, une ancienne forteresse vénitienne qui servit de léproserie de 1903 à 1957.
Dans ce village baigné de soleil, elle rencontre Fotini, une vieille amie de sa mère. Cette dernière lui révèle l’histoire bouleversante de sa famille : son arrière-grand-mère Eleni, institutrice à Plaka, fut contrainte de quitter son mari Giorgis et ses deux filles quand la lèpre la frappa. Elle dut s’exiler sur Spinalonga, comme tant d’autres malades grecs. Le destin s’acharna sur cette famille quand la cadette Maria contracta à son tour la maladie. Entre drames familiaux et secrets enfouis, Alexis découvre peu à peu les raisons qui ont poussé sa mère à fuir son pays.
Autour du livre
Premier roman de Victoria Hislop, « L’île des oubliés » s’inscrit dans la lignée des grandes sagas méditerranéennes qui ont marqué la littérature anglaise, à l’instar de « La Mandoline du capitaine Corelli » de Louis de Bernières. La romancière s’empare d’un pan méconnu de l’histoire crétoise : l’existence de la dernière léproserie d’Europe sur l’îlot de Spinalonga, qui accueillit des malades jusqu’en 1957.
L’autrice britannique, passionnée par la Grèce, choisit ce cadre singulier après une visite qui la bouleverse. Son engagement transcende la fiction puisqu’elle devient par la suite ambassadrice de Lepra, une organisation caritative dédiée à la lutte contre cette maladie millénaire. Cette implication personnelle transparaît dans le soin méticuleux apporté à la reconstitution historique et sociologique de la vie quotidienne des lépreux.
Le texte se distingue par sa construction en strates temporelles qui s’interpénètrent, faisant alterner le présent d’Alexis et le passé de ses aïeules. Cette architecture narrative met en lumière la transmission générationnelle des traumatismes et la persistance des préjugés. La force du récit réside dans sa capacité à transcender le simple drame familial pour aborder des thématiques universelles : l’exclusion, la résilience communautaire, la quête identitaire. La période décrite – des années 1930 aux années 1950 – permet d’observer l’évolution des mentalités face à la maladie et aux traitements médicaux.
La dimension historique s’avère particulièrement aboutie dans l’évocation de la médecine de l’époque et des avancées scientifiques qui conduiront à la fermeture de la léproserie. Les descriptions de la vie sur Spinalonga révèlent un paradoxe saisissant : cet espace d’exclusion devient progressivement un lieu d’émancipation où les malades, libérés du regard social, reconstituent une société harmonieuse dotée d’institutions démocratiques. Spinalonga est décrit non comme un mouroir mais comme un microcosme social dynamique. Les habitants y organisent des élections, publient un journal, fréquentent cafés et cinéma. Cette perspective renverse les attentes du lecteur et nuance la perception traditionnelle des léproseries.
Le succès commercial considérable de « L’île des oubliés » – plusieurs millions d’exemplaires vendus et des traductions dans quarante langues – s’accompagne d’une reconnaissance critique avec l’obtention du Prix de la Révélation littéraire en Grande-Bretagne. La chaîne grecque Mega Channel adapte le roman en série télévisée de vingt-six épisodes intitulée « To Nisi », avec un budget de quatre millions d’euros – le plus important de l’histoire de la télévision grecque. L’implication de Victoria Hislop dans l’adaptation témoigne de son attachement à l’authenticité du récit.
Cette légitimité acquise auprès du public grec culmine avec l’octroi de la citoyenneté hellénique à la romancière en reconnaissance de sa contribution à la diffusion de la culture grecque moderne. Le roman connaît également une adaptation en bande dessinée par Roger Seiter et Fred Vervisch, parue en 2021 aux éditions Philéas.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 528 pages.
2. Cette nuit-là (2020)
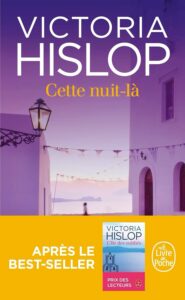
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Le 25 août 1957, la colonie de lépreux de l’île de Spinalonga, en Crète, ferme définitivement ses portes. Maria, guérie de la lèpre, retrouve enfin Plaka et son mari, le docteur Kyritsis. Ce soir-là, le village organise une grande fête pour célébrer le retour des malades. Mais la joie laisse place au drame quand Andreas assassine sa femme Anna, la sœur de Maria, après avoir découvert sa liaison avec son cousin Manolis.
Cette tragédie bouleverse la communauté de Plaka. Manolis s’exile en Grèce continentale où il tente de reconstruire sa vie dans les chantiers navals du Pirée. Andreas purge sa peine en prison tandis que Maria, devenue la tutrice de Sofia, la fille d’Anna, emprunte le difficile chemin du pardon en rendant visite à son beau-frère incarcéré.
Autour du livre
Publié en 2020, « Cette nuit-là » trouve ses origines dans une circonstance imprévue : le confinement mondial lié à la pandémie de Covid-19. Victoria Hislop établit alors un parallèle saisissant entre l’isolement contemporain et celui vécu par les lépreux de Spinalonga, cette île crétoise qui constitue le cœur de son best-seller « L’île des oubliés » paru en 2005. Ce contexte particulier l’incite à revenir sur certains personnages dont le destin, esquissé dans le premier opus, méritait selon elle un éclairage plus approfondi.
Le succès considérable de « L’île des oubliés », vendu à plusieurs millions d’exemplaires et adapté en série télévisée grecque de 26 épisodes, a profondément transformé la vie de Victoria Hislop. Son engagement pour la cause des lépreux dépasse désormais le cadre littéraire : elle est ambassadrice de Lepra, une organisation caritative dédiée à la lutte contre cette maladie. En juin 2020, reconnaissance ultime de son apport à la culture hellénique, le président de la Grèce lui accorde la citoyenneté honoraire.
Si « Cette nuit-là » se présente comme une suite, il s’apparente davantage à un contrepoint narratif. L’intrigue ne prolonge pas tant l’histoire qu’elle ne la décale, offrant une perspective différente sur des événements déjà relatés. Cette approche inhabituelle suscite des réactions contrastées chez les critiques, certains déplorant l’absence de la dimension historique qui imprégnait le premier tome, d’autres saluant l’approfondissement psychologique des personnages.
La narration s’articule principalement autour de trois protagonistes dont les destins s’entremêlent : Maria, la rescapée de la lèpre qui choisit la voie du pardon ; Manolis, l’amant en fuite qui tente de reconstruire son existence au Pirée ; et Andreas, le meurtrier emprisonné qui cherche la rédemption. Victoria Hislop déploie autour d’eux plusieurs fils où s’entrechoquent les notions d’honneur, de culpabilité et de rédemption, le tout ancré dans les traditions crétoises des années 1950-1960.
Le concept grec de « philotimo » (l’honneur) occupe une place centrale dans la narration. Cette valeur culturelle fondamentale de la société grecque structure les relations entre les personnages et motive leurs actions, parfois jusqu’au drame. Victoria Hislop intègre également des termes grecs dans son texte, notamment des mots de tendresse, renforçant ainsi l’authenticité de son récit.
À travers le personnage de Manolis, Victoria Hislop accorde une attention particulière à la musique traditionnelle grecque comme vecteur d’émotions. Une scène emblématique se déroule dans une taverne où Manolis, submergé par le chagrin, exécute un zeibékiko, une danse populaire exprimant la douleur. Ce moment traduit la manière dont la culture grecque permet l’expression publique du deuil et de la souffrance.
Un volet social émerge également à travers l’évocation du développement touristique naissant en Crète et l’essor des chantiers navals au Pirée. Ces mutations économiques servent de toile de fond à la transformation des personnages, illustrant comment le changement personnel s’inscrit dans une évolution sociétale plus large.
La postface, rédigée en octobre 2020, éclaire la genèse de « Cette nuit-là » et inclut un état des lieux de la lèpre au XXIe siècle. Cette démarche didactique prolonge l’engagement de l’autrice contre les préjugés qui entourent encore cette maladie, son roman étant autant un instrument de sensibilisation qu’une œuvre littéraire.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 352 pages.
3. Ceux qu’on aime (2019)
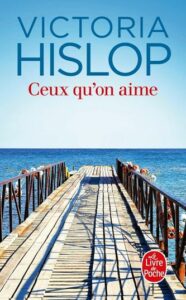
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
En 2016, dans un appartement d’Athènes, Themis fête ses 90 ans entourée de sa famille. Une fois les invités partis, elle décide de confier à deux de ses petits-enfants le récit de sa vie. Elle leur raconte son enfance dans les années 1930, élevée par sa grand-mère avec ses frères et sa sœur après l’internement de leur mère. La fratrie se déchire rapidement sur fond de montée du nazisme : tandis que Thanasis et Margarita soutiennent les occupants, Themis et son frère Panos s’engagent dans la résistance.
Dans la Grèce d’après-guerre, Themis rejoint les rangs communistes pour lutter contre le nouveau régime. Arrêtée, elle est envoyée sur l’île de Makronissos, véritable camp de prisonniers à ciel ouvert. Elle y noue une amitié profonde avec Aliki, une autre détenue. Mais quand celle-ci est condamnée à mort, Themis prend une décision qui la hantera pendant des décennies : signer une lettre de repentir pour renier ses convictions et retrouver sa liberté.
Autour du livre
Dans « Ceux qu’on aime », Victoria Hislop poursuit son travail de mise en lumière des périodes tumultueuses de l’histoire grecque contemporaine. L’idée du livre germe lorsqu’elle découvre l’île de Makronisos et apprend son utilisation comme camp de prisonniers communistes pendant la guerre civile – un pan historique méconnu qu’elle décide d’incorporer à sa fiction.
Le titre, emprunté au poème « Epitáfios » de Yannis Ritsos, résonne particulièrement avec le destin du personnage principal. Ce poème, écrit en 1936 après la mort d’un jeune ouvrier tué par les forces de l’ordre lors d’une grève, a lui-même subi la censure et la destruction sous la dictature – miroir des épreuves traversées par les personnages du roman.
La structure narrative s’articule autour d’une table de famille, objet symbolique qui traverse les décennies comme témoin silencieux des déchirements et des réconciliations. Cette table devient le point d’ancrage où convergent passé et présent, permettant à Themis de transmettre son histoire à ses petits-enfants en 2016. Le choix de ce cadre intime souligne l’entrelacement constant entre la grande Histoire et les destins individuels.
À travers la fratrie Koralis, Hislop met en scène les fractures idéologiques qui ont divisé la société grecque. Chaque membre incarne une position politique distincte : Thanasis représente l’extrême-droite et devient policier, Margarita symbolise la collaboration avec l’occupant nazi, tandis que Panos et Themis embrassent la cause communiste. Ces oppositions fraternelles illustrent comment les convictions politiques peuvent déchirer jusqu’aux liens du sang.
Le roman aborde ainsi frontalement la question des choix impossibles auxquels sont confrontés les individus en temps de guerre civile. La transformation de Themis, d’adolescente studieuse en combattante communiste puis en mère de famille gardant ses secrets, interroge le prix de l’engagement et les compromis nécessaires à la survie. Son dilemme face à la « dilosi » (déclaration de repentir) dans le camp de Makronisos cristallise cette tension entre idéaux et instinct de survie.
Les critiques soulignent la minutie de la documentation historique, qui permet de suivre l’évolution de la Grèce des années 1930 jusqu’aux années 1980 : dictature de Metaxás, occupation nazie, guerre civile, junte des colonels. Cette succession de régimes autoritaires dessine en creux le portrait d’une nation marquée par la violence politique cyclique. Si certains lecteurs relèvent des longueurs dans la partie centrale du récit, la majorité salue la capacité de l’autrice à transmettre la complexité de cette période sans tomber dans le manichéisme. L’évolution de Thanasis, d’abord présenté comme antagoniste puis humanisé par les épreuves, illustre cette approche nuancée des positions politiques.
La dimension féminine du récit mérite d’être soulignée : en plaçant une femme au cœur de la lutte armée puis de la répression carcérale, Hislop met en lumière un aspect souvent négligé des conflits. Les scènes dans le camp de Makronisos, basées sur des témoignages historiques, documentent la brutalité spécifique réservée aux prisonnières politiques.
« Ceux qu’on aime » s’inscrit dans la continuité thématique des ouvrages précédents de Hislop sur la Grèce, notamment « L’île des oubliés », mais s’en distingue par son ambition chronologique plus vaste et son traitement plus nuancé des antagonismes politiques. Le roman confirme la place particulière qu’occupe l’écrivaine anglaise dans la transmission de l’histoire grecque moderne auprès du grand public international.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 192 pages.
4. Le Fil des souvenirs (2011)
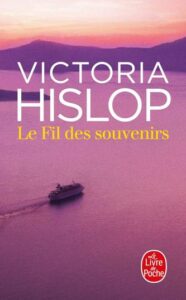
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
En 1917, un incendie dévaste Thessalonique, ville grecque où cohabitent paisiblement chrétiens, juifs et musulmans. Ce même jour naît Dimitris Komninos, fils d’un riche marchand de tissus. Sa famille, contrainte de quitter leur demeure bourgeoise, s’installe dans la modeste rue Irini où se côtoient toutes les communautés religieuses. Quelques années plus tard, une petite fille prénommée Katerina y trouve refuge après avoir été arrachée à sa mère lors de l’invasion turque de Smyrne.
Ces deux destins vont s’entrelacer pendant près d’un siècle, sur fond de bouleversements historiques qui transforment la ville multiculturelle en profondeur. L’expulsion des musulmans vers la Turquie, la déportation des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, puis la dictature des colonels façonnent leur existence, entre résistance et résilience. En 2007, devenus grands-parents, Dimitris et Katerina transmettent à leur petit-fils l’histoire de leur ville bien-aimée.
Autour du livre
Victoria Hislop signe avec « Le Fil des souvenirs » une fresque historique qui embrasse la petite et la grande Histoire de Thessalonique, deuxième ville de Grèce, au fil du XXe siècle. Le titre du roman se réfère autant au fil de la couture, métier exercé par la protagoniste Katerina, qu’au fil de la mémoire qui relie les générations et les communautés.
Cette saga transgénérationnelle s’inscrit dans la lignée du précédent succès de l’autrice, « L’île des oubliés », vendu à plusieurs millions d’exemplaires dans le monde. Comme pour ce dernier, Victoria Hislop choisit la Grèce comme théâtre de son récit, pays pour lequel elle nourrit une véritable passion qui transparaît dans chaque page. Sa popularité y est d’ailleurs considérable : « L’île des oubliés » a même été adapté en série télévisée de 26 épisodes.
La particularité de ce roman réside dans son traitement de la ville de Thessalonique, élevée au rang de personnage à part entière. À travers ses rues et particulièrement la symbolique rue Irini (qui signifie « paix »), se dessine le portrait d’une cité cosmopolite où chrétiens, juifs et musulmans cohabitaient harmonieusement au début du XXe siècle, avant que les bouleversements historiques ne viennent dynamiter cet équilibre. Cette dimension multiculturelle constitue l’un des points forts du récit.
Le choix d’une structure narrative en flashback, où les protagonistes nonagénaires relatent leur histoire à leur petit-fils en 2007, divise les lecteurs. Si certains critiques y voient un artifice superflu qui dévoile trop tôt le dénouement, d’autres apprécient cette mise en abyme qui souligne l’importance de la transmission intergénérationnelle.
Victoria Hislop s’appuie sur des recherches historiques minutieuses pour reconstituer des épisodes méconnus de l’histoire grecque : l’incendie dévastateur de 1917, l’échange forcé de populations entre la Grèce et la Turquie dans les années 1920, la déportation de la communauté juive pendant la Seconde Guerre mondiale, la guerre civile et la dictature des colonels. Cette documentation robuste donne au récit une crédibilité historique saluée par plusieurs critiques grecs.
« Le Fil des souvenirs » se distingue d’ailleurs des productions littéraires habituelles sur la Grèce qui se concentrent majoritairement sur Athènes. Cette focalisation sur la « deuxième ville » du pays offre un éclairage inédit sur la complexité de l’histoire grecque moderne.
Le traitement des personnages suscite toutefois des réactions contrastées. Si leur évolution psychologique manque parfois de nuances selon certains critiques, d’autres saluent la manière dont ils incarnent les tensions sociales et politiques de leur époque. La relation entre Dimitri et Katerina, qui traverse les clivages de classe, illustre la possibilité d’un dépassement des déterminismes sociaux.
Publié en 2011, « Le Fil des souvenirs » s’inscrit dans une tendance plus large des sagas historiques méditerranéennes, aux côtés d’œuvres comme « La Mandoline du capitaine Corelli » ou « Des oiseaux sans ailes » de Louis de Bernières, qui abordent également la question des relations gréco-turques. Certains critiques établissent aussi un parallèle avec « Mille soleils splendides » de Khaled Hosseini pour sa manière de traiter l’impact des bouleversements politiques sur la vie quotidienne.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 576 pages.
5. Une dernière danse (2008)
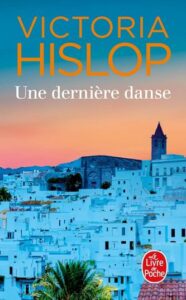
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
En 2001, Sonia quitte Londres et son mari alcoolique pour un séjour à Grenade. Venue prendre des cours de flamenco avec son amie Maggie, elle pousse la porte du café El Barril où Miguel, le patron, lui dévoile peu à peu l’histoire tragique des anciens propriétaires.
Soixante-dix ans plus tôt, le café appartient aux Ramirez. La famille vit au rythme des danses de Mercedes, leur fille cadette, prodige du flamenco amoureuse d’un guitariste gitan. Ses trois frères – Antonio le professeur républicain, Ignacio le torero franquiste et Emilio le musicien – se déchirent quand éclate la guerre civile en 1936. Alors que Franco impose sa dictature, la répression s’abat sur Grenade. Les arrestations, les exils et les drames s’enchaînent, forçant chacun à choisir entre ses convictions et sa famille.
Autour du livre
Avec « Une dernière danse », Victoria Hislop nous embarque dans l’Espagne franquiste des années 1930. L’écrivaine anglaise s’est documentée pendant deux ans et aurait lu pas moins de 60 ouvrages pour restituer avec précision cette période historique peu traitée dans la littérature contemporaine. Le roman se distingue par sa capacité à transmettre les soubresauts de la guerre civile espagnole à travers le prisme d’une famille ordinaire, les Ramirez, dont les destins individuels incarnent les multiples facettes du conflit.
Le choix de Grenade comme toile de fond ne relève pas du hasard : cette ville emblématique, avec son héritage mauresque et son intense vie culturelle, symbolise les contradictions et les déchirements de l’Espagne de l’époque. Les descriptions du flamenco, art majeur de l’Andalousie, transcendent leur simple fonction esthétique pour devenir un vecteur d’émotions brutes et un moyen de survie pendant les années noires. Ces passages sur la danse constituent d’ailleurs les moments les plus saisissants du texte ; Hislop parvient à transformer les mouvements en mots avec une sensibilité particulière.
La structure narrative en deux temporalités, si elle peut sembler convenue, sert efficacement le propos en établissant un dialogue entre le présent et le passé. Cette architecture permet d’aborder des thèmes universels comme la transmission intergénérationnelle, le poids des secrets familiaux, la quête identitaire. Le personnage de Sonia, anglaise contemporaine, offre au lecteur un point d’entrée accessible vers les événements historiques.
Le traitement des personnages de la famille Ramirez révèle une complexité psychologique remarquable. Chaque membre incarne une position différente face au conflit : Antonio le républicain convaincu, Ignacio le fasciste, Emilio l’artiste homosexuel persécuté, Mercedes la danseuse passionnée. Cette multiplicité des points de vue permet de saisir les nuances d’une guerre qui a divisé non seulement un pays mais aussi les familles.
« Une dernière danse » se démarque aussi par son traitement des aspects méconnus de la guerre civile espagnole : la persécution des homosexuels, le sort des réfugiés dans les camps français, l’envoi des enfants basques en Angleterre pendant les bombardements de Bilbao. Ces éléments historiques s’intègrent naturellement à la narration sans jamais tomber dans le didactisme.
Publié en 2008, « Une dernière danse » s’inscrit dans un moment particulier de l’histoire espagnole, celui de la rupture du « Pacto del Olvido » (le pacte d’oubli). Le roman participe ainsi à un mouvement plus large de réappropriation de la mémoire historique, alors que l’Espagne commence enfin à affronter son passé traumatique.
Le succès du livre auprès du public britannique a contribué à faire connaître cette période historique par-delà les frontières espagnoles. Comme le souligne Alfred Hickling dans The Guardian, le roman a probablement eu le même impact sur le tourisme à Grenade que « L’île des oubliés », le premier roman de Hislop, avait eu sur celui de la Crète.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 624 pages.
6. La statuette (2023)
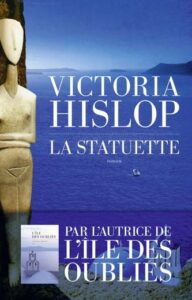
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
En 1968, Helena, huit ans, découvre pour la première fois la Grèce chez ses grands-parents maternels. Chaque été, cette jeune Britannique revient à Athènes auprès d’une grand-mère aimante et d’un grand-père militaire, austère et intimidant. Sa mère, qui a fui le pays natal dans sa jeunesse, tient à ce que sa fille s’imprègne de cette culture dont elle est aussi l’héritière. Les séjours s’interrompent quand la situation politique se dégrade.
Des années plus tard, devenue adulte, Helena hérite de l’appartement familial athénien. En triant les affaires de ses grands-parents, elle met au jour une vérité glaçante : son grand-père a activement participé à la dictature des colonels. Plus troublant encore, elle découvre une importante collection d’antiquités dont l’origine semble douteuse. Passionnée d’archéologie après avoir participé à des fouilles dans les îles grecques, Helena décide d’enquêter sur la provenance de ces objets et de réparer les torts causés par son aïeul.
Autour du livre
Victoria Hislop confirme son attachement à la Grèce avec « La statuette », un récit qui s’inscrit dans la lignée de « L’île des oubliés », son premier roman devenu un best-seller international. Cette fois-ci, l’intrigue aborde la question sensible du trafic d’antiquités, une problématique d’autant plus pertinente que les débats sur la restitution des œuvres d’art à leur pays d’origine demeurent d’actualité.
La construction narrative suit une progression singulière : il faut attendre plus de 150 pages avant que la statuette éponyme ne fasse son apparition, une audace qui divise les critiques. Cette structure atypique permet néanmoins de tisser patiemment la toile de fond historique et politique, notamment la période sombre de la dictature des colonels dans les années 1960-1970, essentielle pour comprendre les enjeux qui se nouent autour du patrimoine culturel grec.
Le personnage d’Helena incarne cette dualité culturelle si chère à Hislop, à la croisée de l’Écosse et de la Grèce. Sa transformation, de l’enfant naïve à la femme déterminée, s’opère en parallèle d’une prise de conscience politique et morale. Son héritage familial devient le catalyseur d’une quête qui dépasse la simple vengeance personnelle pour questionner la responsabilité collective face au pillage culturel.
La dimension pédagogique s’entremêle naturellement à la narration grâce à l’immersion dans le monde de l’archéologie. Les scènes de fouilles offrent un éclairage précis sur les méthodes scientifiques tout en servant l’intrigue. Cette approche documentée rappelle le soin que porte Hislop à ses recherches, une marque de fabrique qui a contribué au succès de ses précédents ouvrages.
L’amplitude temporelle – des années 1960 à nos jours – permet d’aborder plusieurs périodes cruciales de l’histoire grecque contemporaine. Les descriptions d’Athènes et des îles grecques ne se limitent pas à un simple décor mais deviennent le théâtre d’une réflexion sur l’identité culturelle et la préservation du patrimoine.
Certains critiques pointent la longueur excessive du récit et une certaine prévisibilité dans le développement de l’intrigue. D’autres saluent justement cette construction patiente qui permet de saisir toute la complexité des enjeux abordés. Le personnage d’Helena cristallise également ces divergences d’opinion : sa naïveté exaspère autant qu’elle touche, selon les sensibilités. Si le livre ne fait pas l’unanimité comme « L’île des oubliés », il confirme la capacité de la romancière à tisser des liens entre passé et présent, entre cultures et générations, tout en questionnant notre rapport au patrimoine culturel.
Aux éditions LES ESCALES ; 496 pages.
7. La Ville orpheline (2014)
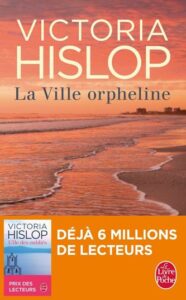
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
À l’été 1972, le Sunrise ouvre ses portes à Famagouste, sur la côte est de Chypre. Cet hôtel luxueux symbolise la réussite éclatante de Savvas Papacosta, homme d’affaires ambitieux, et de son épouse Aphroditi. La station balnéaire attire les touristes fortunés du monde entier, dans une atmosphère où Chypriotes grecs et turcs coexistent paisiblement. Mais plus Savvas s’investit dans ses projets grandioses, plus Aphroditi se sent délaissée et trouve du réconfort auprès de Markos, le charismatique responsable du night-club.
En 1974, un coup d’État orchestré par les nationalistes grecs précipite l’île dans le chaos. L’intervention militaire turque provoque l’exode massif de la population de Famagouste. Dans la ville bombardée et pillée, deux familles refusent l’exil : les Georgiou et les Özkan. Ces voisins que tout oppose culturellement n’ont d’autre choix que de s’unir pour échapper aux soldats et trouver de quoi subsister.
Autour du livre
Cinquième roman de Victoria Hislop, « La Ville orpheline » s’inscrit dans la lignée des fresques méditerranéennes qui ont fait la renommée de cette écrivaine britannique, notamment « L’île des oubliés » qui avait conquis le public. Cette fois, direction Chypre et plus particulièrement Famagouste, cité balnéaire prospère des années 1970 devenue ville fantôme à la suite de l’invasion turque.
Le choix de Famagouste comme cadre principal ne relève pas du hasard : Victoria Hislop n’a jamais pu y pénétrer puisque la ville reste inaccessible, cernée de barbelés depuis 1974. Cette impossibilité nourrit paradoxalement l’écriture, la romancière s’appuyant sur une documentation minutieuse pour reconstituer l’atmosphère de ce lieu singulier. Les descriptions de la station balnéaire à son apogée contrastent ainsi fortement avec celles de la cité dévastée où ne subsistent que deux familles.
Le texte se structure en deux temps marqués : d’abord la montée en puissance de l’hôtel Sunrise et de ses propriétaires dans une ville insouciante, puis la descente aux enfers provoquée par le putsch grec et l’invasion turque. Cette construction binaire met en relief le caractère brutal des événements historiques qui ont bouleversé l’île. Les personnages principaux incarnent d’ailleurs cette rupture : Aphroditi, reine déchue du Sunrise, voit son monde s’effondrer tandis que les familles Georgiou et Özkan doivent apprendre à survivre ensemble malgré leurs origines différentes.
L’un des aspects les plus saisissants tient dans la transformation de la ville elle-même : les rues animées deviennent désertes, les magasins luxueux sont pillés, les rats envahissent les bâtiments abandonnés. Cette métamorphose tragique fait écho aux bouleversements intimes vécus par les protagonistes. La trahison amoureuse subie par Aphroditi résonne ainsi avec celle, plus large, qui frappe toute une population contrainte à l’exil.
Le roman soulève également la question de l’appartenance et de l’identité à travers les deux familles qui restent dans Famagouste. Leur cohabitation forcée dans la ville assiégée illustre la possibilité d’une entente entre communautés que la grande Histoire a voulu séparer. Victoria Hislop évite toutefois le piège de l’angélisme en montrant aussi les tensions et les préjugés qui persistent.
Si certains critiques regrettent une première partie trop descriptive ou des personnages parfois manichéens, la force du livre réside dans sa capacité à éclairer un pan méconnu de l’histoire méditerranéenne. Le destin de Famagouste interpelle d’autant plus qu’il reste d’actualité : quarante ans après les événements, la ville demeure une zone interdite, symbole des blessures non cicatrisées de Chypre.
« La Ville orpheline » témoigne ainsi de la faculté de Victoria Hislop à transformer un fait historique en matière romanesque. Les drames intimes s’entremêlent aux soubresauts politiques pour créer une narration où la grande Histoire se lit à hauteur d’homme. Le titre même du roman suggère cette dimension humaine : Famagouste n’est pas seulement une ville abandonnée, elle est « orpheline » comme les personnages qui ont perdu leurs repères et leurs illusions.
Le récit prend une résonance particulière à la lumière de l’actualité contemporaine, alors que d’autres villes subissent des destins similaires. Sans jamais tomber dans le didactisme, Victoria Hislop parvient à faire comprendre les mécanismes qui peuvent transformer un paradis touristique en ville fantôme, rappelant que la paix reste toujours fragile.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 480 pages.
8. Cartes postales de Grèce (2016)
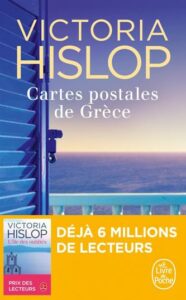
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
À Londres, Ellie Thomas reçoit chaque semaine dans sa boîte aux lettres des cartes postales de Grèce signées d’un mystérieux « A ». Ces missives, destinées à une certaine S. Ibbotson, illuminent son quotidien morose. Intriguée par ces fragments de vie qui ne lui sont pas destinés, elle suit avec passion le périple de leur auteur à travers les paysages helléniques jusqu’au jour où les envois cessent.
Lassée de sa vie londonienne sans relief, Ellie décide de partir sur les traces de cet inconnu. Le matin de son départ, elle découvre dans sa boîte aux lettres un carnet bleu : le journal intime d’Anthony, l’expéditeur des cartes postales. De ville en ville, elle lit les récits de ses rencontres avec les habitants, les légendes locales et les traditions ancestrales qu’il a collectés lors de son odyssée pour guérir d’une déception amoureuse.
La narration se déploie en trois strates qui s’entrecroisent : le présent d’Ellie, le carnet d’Anthony et les récits des habitants. Cette mosaïque dessine une Grèce où les légendes antiques côtoient la crise économique, où chaque rencontre devient le prétexte à une nouvelle histoire.
Autour du livre
Publié en 2016, « Cartes postales de Grèce » marque une rupture dans la bibliographie de Victoria Hislop. Cette collaboration inédite avec le photographe grec Alexandros Kakolyris se démarque des conventions éditoriales par son format hybride, mêlant texte et photographie. L’autrice britannique décide en effet d’intégrer des clichés en couleur au cœur même de la narration.
Le projet naît d’une habitude de l’écrivaine anglaise qui, pour ses précédents romans comme « L’île des oubliés », s’entourait déjà de centaines de photographies punaisées sur un tableau lors de la phase d’écriture. Cette fois, elle choisit de partager directement son processus créatif avec ses lecteurs en incorporant les images qui ont nourri son imaginaire. Les photographies ne servent pas simplement d’illustrations : elles constituent le point de départ même des histoires, leur « raison d’être » selon les mots de Hislop.
Cette structure en poupées russes enchâsse plusieurs niveaux narratifs : le récit-cadre d’Ellie, le journal intime d’Anthony, et une constellation de récits rapportés par les habitants. Ces histoires tissent une mosaïque contrastée de la Grèce contemporaine, oscillant entre traditions ancestrales et modernité, entre sites touristiques et villages reculés hostiles aux étrangers. Hislop y aborde frontalement la crise économique qui frappe alors le pays, mais aussi des thèmes universels comme la place des femmes dans une société patriarcale.
Certains critiques regrettent la minceur du fil narratif principal, estimant que les personnages d’Ellie et Anthony manquent d’épaisseur et ne servent que de prétexte pour enchaîner les nouvelles. D’autres saluent au contraire cette structure éclatée qui permet de multiplier les points de vue sur un pays en pleine mutation. Le livre a d’ailleurs connu une adaptation télévisée sur la chaîne publique grecque ERT.
À travers ces histoires parfois sombres – vendetta familiale, superstitions tenaces, xénophobie larvée – transparaît le profond attachement de Victoria Hislop pour la Grèce. Mais loin de tout idéalisme béat, elle brosse le portrait nuancé d’un pays où cohabitent l’hospitalité légendaire et la méfiance envers l’étranger, la beauté des paysages et la dureté des rapports sociaux. Cette approche en clair-obscur fait écho au travail photographique d’Alexandros Kakolyris qui capture « la lumière unique de la Grèce » tout en révélant ses zones d’ombre.
« Cartes postales de Grèce » se démarque ainsi dans la bibliographie de Hislop comme une expérimentation formelle ambitieuse. En fusionnant roman, recueil de nouvelles, carnet de voyage illustré et témoignage social, l’ouvrage propose une immersion sensorielle dans la diversité grecque. Cette hybridité générique, si elle déroute certains lecteurs habitués aux sagas historiques de l’autrice, ouvre de nouvelles perspectives narratives en phase avec la fragmentation du monde contemporain.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 480 pages.




