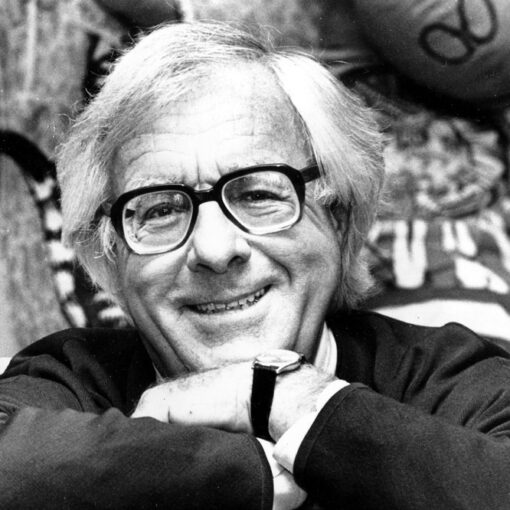Mary Higgins Clark (1927-2020), surnommée la « reine du suspense », est une romancière américaine d’origine irlandaise qui a marqué la littérature policière du XXe siècle.
Née à New York dans une famille modeste, elle perd son père à l’âge de dix ans. Cette épreuve précoce la force à travailler jeune comme secrétaire, puis comme hôtesse de l’air pour la Pan American Airways. Elle commence à écrire dès l’âge de six ans, mais sa carrière littéraire ne débute véritablement qu’après le décès de son premier mari, Warren Clark, en 1964, la laissant veuve avec cinq enfants.
Après un premier livre sans succès sur George Washington, elle trouve sa voie dans le roman à suspense avec « La maison du guet » (1975). Son deuxième roman, « La Nuit du renard » (1977), lui vaut le Grand Prix de Littérature Policière en France. Dès lors, elle publie un roman par an, devenant l’une des autrices les plus populaires de son genre.
Femme résiliente, elle reprend ses études tardivement et obtient un doctorat en philosophie. Elle collabore également avec sa fille Carol Higgins Clark pour plusieurs romans. Ses œuvres, traduites dans le monde entier, se sont vendues à plus de 100 millions d’exemplaires aux États-Unis et 20 millions en France.
Fervente catholique, décorée de nombreux prix, Mary Higgins Clark décède le 31 janvier 2020 à Naples, en Floride, à l’âge de 92 ans, laissant derrière elle un héritage de plus de cinquante romans à suspense.
Voici notre sélection de ses romans majeurs.
1. La Nuit du renard (1977)
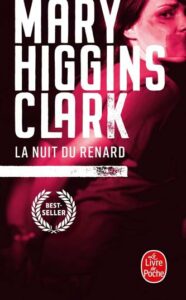
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Dans le Connecticut des années 1970, Steve Peterson peine à surmonter l’assassinat de sa femme Nina, étranglée deux ans plus tôt dans leur maison. Son fils Neil, témoin du meurtre, reste traumatisé malgré l’arrestation et la condamnation à mort de Ronald Thompson, un jeune homme de 19 ans qui ne cesse de clamer son innocence.
À quelques jours de l’exécution, Sharon Martin, une journaliste qui s’est rapprochée de Steve, est kidnappée avec Neil par un homme qui se fait appeler « Renard ». Le ravisseur les enferme dans un local désaffecté de Grand Central Station à New York, menaçant de faire exploser une bombe au moment précis où Ronald Thompson sera exécuté. Steve et les enquêteurs du FBI se lancent dans une course contre la montre pour retrouver les otages, alors que des liens troublants commencent à apparaître entre le kidnapping et le meurtre de Nina.
Autour du livre
Publié en 1977, « La Nuit du renard » marque un tournant dans la carrière de Mary Higgins Clark. Ce deuxième thriller psychologique la propulse sur le devant de la scène littéraire internationale, notamment grâce à l’obtention du Grand prix de littérature policière en 1980.
L’originalité du roman réside dans sa construction narrative qui alterne les points de vue des différents protagonistes au fil de chapitres courts et rythmés. Cette technique permet de créer une tension dramatique soutenue, où chaque information révélée au lecteur demeure cachée aux personnages. La simultanéité des événements, associée aux multiples perspectives narratives, intensifie l’effet d’urgence qui imprègne le récit.
Le choix de situer une partie de l’action dans les sous-sols désaffectés de Grand Central Terminal à New York confère au texte une atmosphère oppressante. Les descriptions des lieux souterrains et l’omniprésence des sans-abris qui y trouvent refuge ajoutent une dimension sociale. Le personnage de Lally, clocharde qui joue un rôle crucial dans le dénouement, illustre cette volonté d’ancrer l’intrigue dans une réalité urbaine complexe.
La question de la peine capitale, sujet brûlant aux États-Unis à l’époque de la rédaction, traverse l’ensemble du roman. Entre 1967 et 1977, les exécutions avaient été suspendues suite à une décision de la Cour Constitutionnelle. « La Nuit du renard » s’inscrit précisément dans ce contexte historique particulier de reprise des exécutions capitales, ce qui donne au débat entre les personnages une résonance contemporaine forte.
Adapté au cinéma en 1982 sous le titre « Otages » (A Stranger Is Watching) par Sean S. Cunningham, avec Kate Mulgrew et Rip Torn dans les rôles principaux, le roman conserve aujourd’hui sa force malgré quelques éléments datés comme l’utilisation de radiotéléphones. Le rythme soutenu de l’action compense largement ces anachronismes techniques.
« La Nuit du renard » pose les bases de ce qui deviendra la signature de Mary Higgins Clark : une héroïne en danger, un environnement urbain menaçant, un tueur psychopathe, une course contre la montre. Si cette formule sera maintes fois reprise dans ses œuvres ultérieures, elle atteint ici un équilibre particulièrement réussi.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 221 pages.
2. Deux petites filles en bleu (2006)
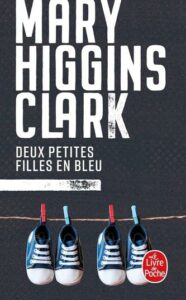
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Tout commence lors d’une fête d’anniversaire : Kelly et Kathy Frawley, des jumelles de trois ans, soufflent leurs bougies entourées de leurs parents. Le soir même, profitant de l’absence de Steve et Margaret partis dîner au restaurant, des ravisseurs s’introduisent dans la maison. Ils neutralisent la baby-sitter et enlèvent les fillettes. Le message est clair : huit millions de dollars contre la vie des enfants.
L’espoir renaît quand l’entreprise qui emploie Steve propose de payer la rançon. Mais le jour de l’échange, seule Kelly est libérée. L’autre jumelle serait morte, selon les kidnappeurs. Kelly, elle, maintient que sa sœur est en vie. Entre les deux fillettes existe un lien télépathique troublant : l’une ressent ce que vit l’autre, même à distance. Cette connexion devient l’unique piste pour localiser Kathy, retenue par un mystérieux commanditaire connu sous le nom du « Joueur de flûte ».
Autour du livre
« Deux petites filles en bleu » s’inscrit dans la lignée d’autres succès de Mary Higgins Clark traitant d’enlèvements d’enfants, comme « La Nuit du renard » ou « Nous n’irons plus au bois », tout en y ajoutant une dimension paranormale qui renouvelle la formule.
La télépathie gémellaire constitue en effet l’élément distinctif de ce thriller publié en 2006. Cette particularité narrative divise les critiques : certains y voient un ressort scénaristique audacieux tandis que d’autres jugent le procédé artificiel, notamment dans son application à des enfants de trois ans. Le phénomène des communications extrasensorielles entre jumeaux, documenté scientifiquement, prend ici une dimension dramatique puisqu’il permet de maintenir le lien vital entre les deux sœurs séparées.
La structure narrative alterne les points de vue et multiplie les suspects potentiels, créant un effet kaléidoscopique qui maintient la tension. Les chapitres courts, de deux à trois pages maximum, impriment un rythme haletant à l’intrigue. Une particularité réside dans le choix de dévoiler très tôt l’identité des ravisseurs, à l’exception du mystérieux « Joueur de flûte » qui tire les ficelles en coulisses.
Le titre lui-même revêt une dimension inquiétante puisqu’il fait référence à une comptine que fredonne l’un des personnages les plus dérangeants du roman, Angie/Mona, dont la folie et l’obsession pour les fillettes créent un malaise croissant. Cette femme qui ne peut avoir d’enfants incarne une figure archétypale du conte cruel.
Le roman a fait l’objet d’une adaptation télévisée en France en 2014, avec Christine Citti, Marie Guillard et Lizzie Brocheré dans les rôles principaux. La réalisation est signée Jean-Marc Thérin.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 384 pages.
3. Nous n’irons plus au bois (1992)
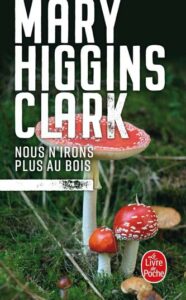
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
À 21 ans, Laurie Kenyon se retrouve au cœur d’une affaire criminelle : cette étudiante est accusée d’avoir assassiné son professeur de littérature. Tout l’accable, des empreintes digitales aux lettres d’amour qu’elle lui aurait envoyées, mais elle ne garde aucun souvenir des événements.
Convaincue de l’innocence de sa sœur, Sarah Kenyon abandonne son poste de substitut du procureur pour assurer sa défense. Elle fait appel à un psychiatre qui découvre que Laurie souffre d’un trouble dissociatif de l’identité. Cette pathologie trouve son origine dans un traumatisme enfoui : à l’âge de 4 ans, Laurie a été enlevée et retenue captive pendant deux ans par un couple qui l’a terrorisée.
Les séances de thérapie font peu à peu remonter à la surface ces souvenirs refoulés. Mais les ravisseurs, qui se cachent désormais sous l’identité d’un couple de prédicateurs respectables, ont retrouvé sa trace. Ils semblent prêts à tout pour l’empêcher de révéler la vérité sur son passé.
Autour du livre
Publié en 1992, ce thriller psychologique de Mary Higgins Clark s’inscrit dans une période où la littérature américaine commence à s’intéresser aux troubles dissociatifs de l’identité. La romancière s’appuie sur un important travail documentaire, notamment auprès du Dr C. Young, directeur du centre scientifique et psychiatrique Aurora dans le Colorado. Elle a également consulté des enregistrements de séances thérapeutiques avec des patients atteints de troubles de la personnalité multiple, ce qui confère une assise clinique à son traitement du sujet.
La construction narrative se distingue par ses 117 chapitres très courts (2 à 4 pages chacun), une technique qui insuffle un rythme haletant au récit. Cette structure fragmentée fait écho aux personnalités multiples de Laurie : Kate, Leona, Debbie et un petit garçon, chacune prenant la parole à des moments stratégiques de l’intrigue.
L’Amérique des années 1990 transparaît à travers plusieurs aspects sociologiques : l’influence grandissante des télévangélistes, la naïveté d’un public en quête de spiritualité, mais aussi le tabou qui entoure encore les abus sexuels sur mineurs. Les parents de Laurie choisissent d’ailleurs de ne pas creuser le traumatisme de leur fille, illustrant le déni social de l’époque face à ces questions.
Le roman a fait l’objet d’une adaptation télévisuelle en 2002 sous le même titre, dans une production canado-britannico-américaine réalisée par Paolo Barzman, avec Nastassja Kinski dans le rôle principal.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 309 pages.
4. La Clinique du docteur H. (1980)
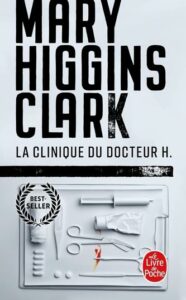
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Katie DeMaio, jeune adjointe au procureur dans le New Jersey des années 1980, se retrouve à la clinique Westlake après un accident de voiture. Durant sa nuit d’hospitalisation, elle aperçoit une silhouette familière transportant un corps inerte vers une voiture. Le lendemain, elle apprend le décès de Vangie Lewis, une voisine enceinte supposément morte par suicide. Cette coïncidence troublante pousse Katie à enquêter.
L’investigation la mène vers le docteur Edgar Highley, un obstétricien réputé de la clinique Westlake. Alors que les morts suspectes s’accumulent, Katie découvre peu à peu les secrets inavouables qui se cachent derrière la façade respectable de l’établissement. Un jeu du chat et de la souris s’engage entre la jeune procureure et le médecin, qui sait qu’elle représente une menace pour ses activités.
Autour du livre
La singularité de « La Clinique du docteur H. » réside dans son parti pris narratif : contrairement aux conventions du genre policier, l’identité du meurtrier est dévoilée dès les premières pages. Cette construction atypique déplace l’intérêt du « qui » vers le « pourquoi » et le « comment », créant une tension qui naît non pas de l’enquête classique mais de l’observation simultanée du criminel et des enquêteurs.
Publié en 1980 et traduit en français dès 1981, ce quatrième roman de Mary Higgins Clark s’inscrit dans le contexte des avancées médicales en matière de procréation assistée. À l’époque, les techniques évoquées dans le livre relevaient presque de l’anticipation. L’ancrage dans le monde médical ne se limite pas à un simple décor : il soulève des questions éthiques sur le pouvoir des médecins et la confiance aveugle parfois accordée aux « faiseurs de miracles ». Le personnage du Dr Highley incarne cette ambivalence entre génie et monstruosité, entre progrès scientifique et hubris médicale.
La structure narrative alterne habilement les points de vue, multipliant les perspectives sur l’action. Les chapitres, volontairement courts, créent un rythme haletant qui culmine dans un final où le découpage devient encore plus serré. Cette construction fragmentée permet de suivre simultanément le criminel dans ses machinations et les enquêteurs dans leurs errements, générant une forme de suspense paradoxal où le lecteur en sait plus que les personnages.
Le temps a néanmoins laissé son empreinte sur certains aspects du texte. Les critiques contemporains relèvent le traitement daté de thèmes comme l’avortement ou les relations hommes-femmes. Le portrait d’une société bourgeoise aux codes rigides et la vision de la maternité reflètent les mentalités des années 1980. Ces éléments, qui pouvaient paraître modernes à l’époque, confèrent aujourd’hui au roman une dimension presque historique.
« La Clinique du docteur H. » a connu trois adaptations télévisées : en 1983 avec Lauren Hutton (« Mort suspecte »), en 2004 avec Angie Everhart, et en 2015 dans une version française avec Aurélien Recoing.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 311 pages.
5. La maison du guet (1975)
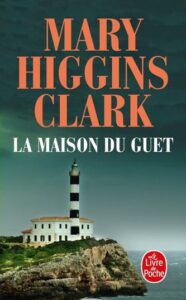
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Cape Cod, années 1970. Nancy Eldredge mène une vie paisible avec son mari Ray et leurs deux enfants, Michael et Missy. Mais sous cette apparente tranquillité se cache un passé douloureux : sept ans plus tôt, ses deux premiers enfants ont été retrouvés noyés en Californie. Accusée de leur meurtre, elle n’a échappé à la prison que grâce à un vice de procédure.
Un matin, alors que ses enfants jouent dans le jardin, Nancy découvre dans le journal local un article qui ravive cette sombre affaire. La photo d’une femme qui lui ressemble fait la une, accompagnée du récit de ce drame survenu sur la côte ouest. Quelques heures plus tard, Michael et Missy disparaissent à leur tour. Pour Nancy, c’est le début d’une course contre la montre tandis que les soupçons de la police se portent naturellement sur elle.
Autour du livre
Premier thriller de Mary Higgins Clark paru en 1975, « La maison du guet » pose d’emblée les fondements qui caractériseront l’œuvre future de celle qui deviendra « la reine du suspense ». L’intrigue se déroule sur une seule journée, un choix narratif qui insuffle au récit un rythme particulièrement soutenu et élimine tout risque de digression superflue.
Mary Higgins Clark puise sa source dans un fait divers réel, l’affaire Alice Crimmins, dont elle s’inspire librement. Cette capacité à transformer un drame authentique en fiction constitue l’une des signatures de la romancière. L’ancrage géographique à Cape Cod, avec ses paysages austères et sa mer tumultueuse, participe pleinement à l’atmosphère oppressante du récit.
La narration alterne entre passé et présent, permettant de tisser progressivement les liens entre les deux disparitions d’enfants survenues à sept ans d’intervalle. Cette structure temporelle maintient la tension tout en dévoilant par touches successives les zones d’ombre du passé de Nancy.
L’originalité du roman réside dans le fait que l’identité du coupable est révélée très tôt au lecteur. Le suspense ne repose donc pas sur la traditionnelle recherche du « qui a fait ça ? », mais sur une course contre la montre pour sauver les enfants et découvrir la vérité sur les événements d’il y a sept ans.
Le succès critique ne tarde pas : « La maison du guet » se hisse à la 50e place du classement des cent meilleurs livres policiers de tous les temps établi en 1995 par l’association des Mystery Writers of America. Le roman connaît également une adaptation cinématographique en 1986 avec Jill Clayburgh dans le rôle principal. En mai 2023, une suite intitulée « Les enfants du guet », co-écrite avec Alafair Burke est parue à titre posthume après le décès de Mary Higgins Clark en janvier 2020.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 221 pages.
6. Dans la rue où vit celle que j’aime (2001)
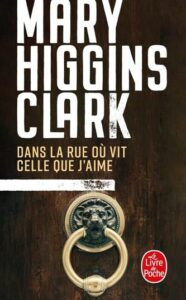
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Spring Lake, New Jersey. Cette paisible station balnéaire est secouée en 1891 par la disparition mystérieuse de trois jeunes femmes. Un siècle plus tard, Emily Graham, brillante avocate new-yorkaise, s’y installe pour échapper à un harceleur. Elle achète une majestueuse demeure victorienne qui appartenait jadis à Madeline, son arrière-arrière-grand-tante – l’une des victimes du tueur jamais retrouvé.
Le passé ressurgit brutalement lorsque des ouvriers découvrent dans le jardin deux corps enterrés : celui de Martha Lawrence, une jeune femme disparue quatre ans plus tôt, et les ossements de Madeline. La ville est à nouveau frappée par une série de meurtres qui reproduisent avec une précision effrayante ceux perpétrés au XIXe siècle. Emily se trouve rapidement au centre de cette affaire quand elle commence à recevoir des photos d’elle prises à son insu.
Entre les enquêteurs qui privilégient la piste d’un copycat et ceux qui évoquent une possible réincarnation du tueur originel, Emily tente de comprendre ce qui relie ces meurtres séparés par plus de cent ans. La découverte de journaux intimes relatant les crimes de 1891 pourrait bien être la clé de l’énigme.
Autour du livre
Publié en 2001, ce roman s’inscrit dans une période où Mary Higgins Clark commençait à être critiquée pour des histoires jugées répétitives. Pourtant, l’ajout d’éléments surnaturels et l’ancrage historique permettent à « Dans la rue où vit celle que j’aime » de se démarquer de ses œuvres précédentes.
L’histoire se déploie dans une petite station balnéaire chic de la côte atlantique, Spring Lake, dont le cadre victorien constitue bien plus qu’un simple décor. Les grandes demeures avec leurs galeries où l’on se repose « un bouquin à la main » insufflent une atmosphère particulière qui séduit immédiatement les lecteurs. Cette dimension architecturale s’entremêle habilement avec les références constantes au XIXe siècle, créant un pont temporel entre deux époques marquées par des meurtres en série.
La narration alterne entre deux périodes distinctes, celle des crimes originels de 1891 et leur écho contemporain, tout en maintenant une cohérence remarquable grâce à des personnages et des lieux bien campés. Les chapitres courts et le changement fréquent de point de vue, incluant celui du tueur lui-même, insufflent un rythme soutenu au récit. Cette technique narrative, si elle désoriente parfois certains lecteurs qui peinent à suivre la multiplicité des protagonistes, permet néanmoins de tisser une toile complexe de suspects potentiels.
La dimension paranormale, avec l’hypothèse d’une réincarnation du tueur, apporte une touche d’originalité au schéma classique du roman policier. Cette piste mystique laisse planer le doute jusqu’au dénouement, tout en servant de fil conducteur à l’enquête menée par Emily Graham. Le parallélisme entre les meurtres d’hier et d’aujourd’hui crée une tension constante qui culmine dans les dernières pages. La force du livre réside moins dans la recherche du meurtrier que dans la façon dont Mary Higgins Clark parvient à maintenir l’intérêt en semant le doute sur l’innocence des autres personnages.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 363 pages.
7. Ni vue ni connue (1997)
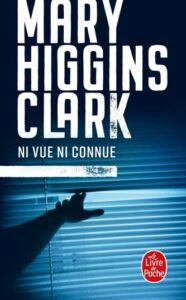
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
New York, fin des années 1990. À Manhattan, Lacey Farrell mène une vie tranquille comme agent immobilier jusqu’au jour où elle assiste au meurtre d’une de ses clientes. La victime, Isabelle Waring, lui avait confié ses doutes sur la mort suspecte de sa fille Heather, jeune actrice de Broadway décédée dans un prétendu accident de voiture. Avant de mourir, elle avait remis à Lacey le journal intime de Heather.
Seule à pouvoir identifier le tueur et en possession d’un document compromettant, Lacey devient une cible. Le FBI la place sous protection rapprochée et l’oblige à déménager à Minneapolis sous une nouvelle identité. Coupée de sa famille et de ses proches, elle tente de reconstruire sa vie tout en sachant que le meurtrier est à ses trousses.
Autour du livre
Ce thriller s’inscrit dans la lignée des romans de l’autrice américaine, tout en présentant une particularité notable : il offre un éclairage sur le programme de protection des témoins aux États-Unis. « Ni vue ni connue » a d’ailleurs fait l’objet d’une adaptation en téléfilm canado-britannico-américain en 2002, réalisé par René Bonnière avec Emma Samms dans le rôle principal.
Le personnage de Lacey Farrell perpétue la tradition des héroïnes de Mary Higgins Clark : une New-yorkaise sophistiquée évoluant dans les quartiers huppés de Manhattan. Cette constante dans la caractérisation des protagonistes féminins découle des conseils prodigués par son professeur, qui lui avait recommandé de créer des personnages à son image. Si les premiers romans mettaient en scène des femmes divorcées ou veuves avec enfants, jonglant entre vie professionnelle et familiale, le succès a progressivement orienté Mary Higgins Clark vers un archétype plus conventionnel : la trentenaire carriériste qui aspire secrètement à fonder un foyer.
La construction narrative repose sur une mécanique éprouvée : des chapitres courts maintiennent la tension, tandis que la multiplication des suspects potentiels installe une atmosphère paranoïaque. Le dénouement, révélé dans les ultimes pages, divise les critiques : certains saluent l’effet de surprise alors que d’autres déplorent le manque d’indices permettant d’anticiper la révélation finale.
Les critiques soulignent aussi la disproportion entre le temps consacré à la mise en place de l’intrigue (95 % du roman) et sa résolution précipitée. Les motivations du commanditaire des meurtres demeurent par ailleurs insuffisamment développées, laissant certains lecteurs sur leur faim. Cette économie d’explications contraste avec les premiers romans de l’autrice, notamment « La Nuit du renard », qui accordaient davantage d’importance à la psychologie des antagonistes.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 317 pages.
8. Rien ne vaut la douceur du foyer (2005)
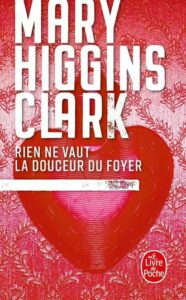
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Dans la petite ville de Mendham, New Jersey, une fillette de dix ans tue accidentellement sa mère en voulant la défendre des coups de son beau-père violent. Vingt-quatre ans plus tard, Liza Barton a changé d’identité : sous le nom de Celia, elle s’est construite une nouvelle vie avec son fils Jack et Alex, son second mari qui ignore tout de son passé tragique.
Mais le passé resurgit brutalement quand Alex, son époux, lui offre une maison dans le New Jersey pour son anniversaire. Par un cruel hasard, il s’agit de la demeure de son enfance, celle où s’est déroulée la tragédie. Dès leur emménagement, des messages menaçants apparaissent sur les murs. Quelqu’un connaît sa véritable identité et cherche à lui faire porter le chapeau pour une série de meurtres qui commence à secouer la petite communauté de Mendham.
Autour du livre
Ce thriller psychologique de Mary Higgins Clark, publié en 2005, alterne entre la première personne pour les chapitres consacrés à Celia, permettant d’accéder à ses tourments intérieurs, et la troisième personne pour les passages liés à l’enquête. Cette dichotomie narrative accentue la tension psychologique.
L’intrigue s’appuie sur une loi spécifique du New Jersey qui contraint les agents immobiliers à informer les acheteurs potentiels des événements tragiques survenus dans une propriété. La dimension psychologique du personnage principal se révèle ambivalente : Celia/Liza oscille entre culpabilité et sentiment d’injustice. Cette dualité nourrit la complexité du personnage, bien que plusieurs critiques soulignent sa naïveté parfois excessive face aux événements.
« Rien ne vaut la douceur du foyer » a reçu un accueil mitigé de la critique. Le New York Times, sous la plume de Marilyn Stasio, souligne notamment comment Mary Higgins Clark « exploite les tensions inhérentes à l’emménagement dans une nouvelle maison ». MSNBC le qualifie de « mystère criminel prenant ».
Le roman a fait l’objet d’une adaptation télévisée en 2017 par Laurent Jaoui, attestant de son potentiel dramatique. La référence initiale à la comptine de Lizzie Borden, célèbre affaire criminelle américaine, place d’emblée le récit sous le signe d’une filiation littéraire avec les crimes familiaux historiques.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 448 pages.
9. Un cri dans la nuit (1982)
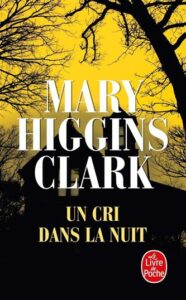
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Dans le New York des années 1980, Jenny MacPartland élève seule ses deux filles après son divorce. Employée dans une galerie d’art, elle peine à joindre les deux bouts jusqu’à sa rencontre avec Erich Krueger, un peintre fortuné au charme irrésistible. En quelques semaines à peine, ils se marient et Jenny quitte la ville pour s’installer avec ses filles dans l’imposante demeure familiale d’Erich, au cœur du Minnesota.
La lune de miel tourne court. Derrière ses airs d’époux modèle, Erich cache une personnalité trouble, obsédé par le souvenir de sa mère Caroline, morte dans des circonstances mystérieuses. Les murs de la demeure suintent les non-dits, les domestiques murmurent. Jenny s’enfonce dans un piège dont elle ne mesure pas encore la portée. Des événements étranges surviennent la nuit, sa raison vacille. Plus elle cherche à comprendre, plus l’étau se resserre.
Autour du livre
Publié en 1982 aux États-Unis, « Un cri dans la nuit » compte parmi les premiers romans de Mary Higgins Clark. Contrairement à ses autres œuvres où le mystère réside dans l’identité du coupable, ce thriller psychologique dévoile d’emblée le prédateur, préférant miser sur la tension croissante et l’atmosphère oppressante qui se développe autour de l’héroïne.
La force du roman tient dans sa construction progressive du malaise. À partir d’une situation initiale proche du conte de fées – une rencontre fortuite dans une galerie d’art new-yorkaise – le récit bascule méthodiquement dans l’horreur psychologique. Le Minnesota glacial et ses paysages enneigés servent de toile de fond parfaite à cette descente aux enfers, où l’isolement géographique reflète l’emprisonnement mental de Jenny.
Pour créer son antagoniste, Mary Higgins Clark s’est appuyée sur les conseils de psychiatres, ce qui confère au personnage d’Erich une crédibilité clinique troublante. La romancière y dépeint avec justesse les mécanismes de manipulation et d’emprise psychologique : isolement progressif, gaslighting, jalousie maladive, obsession morbide pour la figure maternelle. Cette précision dans le portrait du pervers narcissique s’avère particulièrement novatrice pour l’époque.
Mary Higgins Clark puise son inspiration dans les classiques du genre, notamment « Rebecca » de Daphné du Maurier et « Psychose » d’Alfred Hitchcock, tout en proposant sa propre variation sur le thème de la femme prisonnière d’un mariage cauchemardesque. Cette filiation assumée n’empêche pas le roman de tracer sa propre voie, notamment à travers une critique sociale sous-jacente du statut des femmes mariées et de leur dépendance financière.
« Un cri dans la nuit » a fait l’objet d’une adaptation télévisuelle en 1992, avec Carol Higgins Clark et Annie Girardot dans les rôles principaux. Le film, resté fidèle au livre, a notamment été salué pour l’interprétation de ses actrices principales.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 311 pages.
10. Souviens-toi (1994)
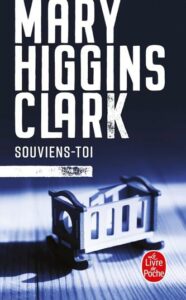
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Une jeune mère traumatisée par la mort accidentelle de son premier enfant s’installe avec son mari et leur bébé dans une demeure historique de Cap Cod, station balnéaire huppée du Massachusetts. Menley et Adam Nichols espèrent que ce séjour estival leur permettra de se reconstruire après le drame. Mais la maison baptisée « Remember » cache de sombres secrets qui remontent au XVIIIe siècle.
L’atmosphère s’alourdit quand une riche héritière périt en mer dans des circonstances troubles. Son époux Scott Covey, soupçonné de meurtre, engage Adam comme avocat. Pendant que celui-ci prépare la défense de son client, Menley commence à percevoir d’étranges manifestations dans la maison. Les fantômes du passé semblent vouloir lui parler. Est-elle victime d’hallucinations post-traumatiques ou quelqu’un cherche-t-il délibérément à la déstabiliser ?
Autour du livre
Publié en 1994, « Souviens-toi » s’impose rapidement comme l’un des succès majeurs de Mary Higgins Clark en atteignant la première place des best-sellers du New York Times pendant plusieurs semaines. Le manuscrit connaît pourtant un parcours semé d’embûches : il faut vingt ans à l’autrice pour convaincre son éditeur, notamment en raison de la dimension surnaturelle qu’elle souhaite insuffler à l’intrigue.
La structure narrative se démarque par ses 110 chapitres courts qui entretiennent la tension dramatique. Cette construction fragmentée permet d’alterner entre les points de vue des protagonistes tout en tissant progressivement les liens entre deux enquêtes parallèles : celle sur la mort suspecte de Vivian Carpenter et les investigations de Menley sur le passé mystérieux de la maison Remember.
Le cadre de Cap Cod ne constitue pas un simple décor : cette péninsule du Massachusetts, où débarquèrent les premiers colons du Mayflower en 1620, porte en elle une histoire maritime riche en drames et légendes. Les vieilles demeures d’armateurs et de marchands qui la jalonnent deviennent les témoins silencieux d’histoires entremêlées, où les fantômes du passé semblent vouloir ressurgir.
Le thème du souvenir irrigue l’ensemble des pages, à commencer par le nom même de la maison, « Remember », jusqu’aux troubles post-traumatiques de Menley hantée par la mort de son fils. La maladie d’Alzheimer dont souffre le personnage de Phoebe ajoute une dimension supplémentaire à cette exploration de la mémoire et de ses défaillances.
L’accueil critique se révèle particulièrement chaleureux aux États-Unis. Le Nashville Banner salue « une chevauchée mystérieuse et pleine de suspense », tandis que le Plain Dealer met en avant « un thriller remarquablement prenant ». People établit même un parallèle avec Daphné du Maurier.
« Souviens-toi » a fait l’objet de deux adaptations télévisées : une version américaine en 1995 avec Kelly McGillis, dans laquelle Mary Higgins Clark fait une apparition, et une adaptation française en 2015 réalisée par Philippe Venault avec Émilie Dequenne dans le rôle principal. Si le téléfilm de 1995 reçoit un accueil favorable, la version française de 2015 suscite des critiques plus mitigées.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 316 pages.
11. Recherche jeune femme aimant danser (1991)
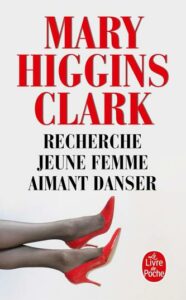
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Dans le New York des années 1990, Nona Roberts prépare un reportage sur les petites annonces de rencontre. Elle sollicite l’aide de ses amies Erin Kelley et Darcy Scott pour répondre aux messages et rencontrer les hommes qui les publient. L’exercice s’avère plutôt divertissant jusqu’à la disparition brutale d’Erin.
Le corps de la jeune femme est découvert peu après, dans une mise en scène glaçante : une chaussure de bal à un pied, sa propre chaussure à l’autre. Cette signature évoque un meurtre survenu quinze ans plus tôt. Bouleversée par la mort de sa meilleure amie, Darcy poursuit les rendez-vous avec les auteurs d’annonces, déterminée à identifier l’assassin malgré l’opposition de la police.
En parallèle, le lecteur suit les agissements de Charley, un tueur méthodique qui publie invariablement la même annonce : « Recherche jeune femme aimant danser ». Dans sa propriété reposent déjà sept victimes, chacune parée d’un soulier de bal au pied droit, témoignage de sa passion morbide pour la danse.
Autour du livre
Publié en 1991, « Recherche jeune femme aimant danser » s’inscrit dans la lignée des grands succès de Mary Higgins Clark. Il figure notamment parmi les dix meilleures ventes de l’année selon Publishers Weekly. Le livre tire son origine d’un fait divers authentique des années 1950, impliquant Harvey Glatman, un tueur en série qui sévissait via les petites annonces. Pour nourrir son inspiration et garantir la véracité des éléments policiers, Mary Higgins Clark s’est d’ailleurs documentée à l’école du FBI de Quantico.
L’intrigue se déroule dans un New York soigneusement dépeint, avec ses restaurants en vogue et ses bars prisés des années 1990, offrant une immersion dans l’atmosphère de la métropole. Cette description minutieuse de la vie new-yorkaise constitue une toile de fond sociale qui ancre le récit dans son époque. Le roman témoigne notamment d’une période charnière où les rencontres se faisaient encore principalement par petites annonces dans les journaux, bien avant l’avènement d’Internet et des applications de rencontre.
Le personnage du tueur, Charley, se distingue par sa dualité psychologique. Son dédoublement de personnalité, entre l’homme respectable et le psychopathe obsessionnel, constitue l’un des ressorts narratifs les plus puissants du livre. Cette épaisseur psychologique s’accompagne d’un rituel macabre signature : chaque victime est retrouvée avec une chaussure de bal soigneusement choisie à un pied, et sa propre chaussure à l’autre.
L’expertise professionnelle des protagonistes enrichit la trame narrative : une productrice de télévision qui enquête sur les petites annonces, une créatrice de bijoux, des agents du FBI… Ces professions ne sont pas de simples faire-valoir mais s’intègrent organiquement à l’intrigue. Mary Higgins Clark incorpore également une réflexion sur la psychologie des utilisateurs des petites annonces, à travers le personnage du Dr Michael Nash qui étudie leurs motivations profondes et leurs fantasmes.
Le succès du livre a conduit à son adaptation en téléfilm en 2001, réalisé par Mario Azzopardi, avec Patsy Kensit dans le rôle de Darcy Scott. Cette version télévisuelle a été diffusée sur la chaîne Pax TV (aujourd’hui Ion).
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 277 pages.
12. Ce que vivent les roses (1995)
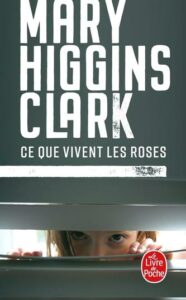
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
New York, milieu des années 1990. Kerry McGrath accompagne sa fille Robin chez le Dr Smith, un éminent chirurgien esthétique, suite à un accident de voiture. Dans la salle d’attente, son regard est attiré par deux patientes différentes arborant le même visage – celui de Suzanne Reardon, victime d’un meurtre brutal dix ans plus tôt. Cette affaire avait marqué les esprits : la jeune femme avait été retrouvée morte, des roses disposées autour de son corps, et son mari Skip purge depuis une peine de prison.
Troublée par cette découverte, Kerry, procureure adjointe en lice pour devenir juge, ne peut s’empêcher de réexaminer l’affaire malgré les avertissements de ses proches. Son enquête la conduit sur des pistes inquiétantes : un médecin qui reproduit obsessionnellement le visage de sa fille morte sur ses patientes, un amateur d’art aux activités suspectes, des liens avec la pègre locale. Alors que les menaces se multiplient autour d’elle et de sa fille, Kerry s’obstine à découvrir la vérité, quitte à remettre en question ses propres certitudes sur l’affaire Reardon.
Autour du livre
Ce thriller de Mary Higgins Clark publié en 1995 se démarque par son angle original centré sur la chirurgie esthétique et l’obsession de la beauté. La « reine du suspense » y mêle plusieurs thématiques : la quête de perfection physique, le monde de l’art et les rouages du système judiciaire américain.
La narration s’articule autour de Kerry McGrath, une procureure-adjointe qui incarne la figure type des héroïnes de l’autrice : une femme de carrière sophistiquée évoluant dans les hautes sphères new-yorkaises. Sa vie bascule quand elle remarque que le Dr Smith, chirurgien plastique renommé, recrée sur ses patientes le visage de sa fille assassinée. Cette découverte la pousse à rouvrir une affaire classée depuis dix ans, contre l’avis de son entourage.
L’originalité du roman réside dans son traitement du thème de la réplication esthétique, qui fait écho au mythe de Pygmalion. Le chirurgien façonne ses patientes comme des œuvres d’art vivantes, dans une quête morbide de résurrection de sa fille disparue. Cette dimension artistique se retrouve également à travers le personnage du voleur d’œuvres d’art, qui ne dérobe que pour posséder la beauté.
La narration maintient le suspense jusqu’aux dernières pages, même si certains lecteurs expérimentés de Mary Higgins Clark décèleront des schémas narratifs familiers. Le roman a fait l’objet de deux adaptations télévisuelles : une version américaine en 1997 avec Meredith Baxter, puis une version française en 2017 réalisée par Frédéric Berthe.
Les critiques soulignent toutefois quelques faiblesses, notamment le caractère trop mature des dialogues de Robin, la fille de dix ans de l’héroïne, ainsi qu’une certaine prévisibilité dans la construction des personnages. Malgré ces réserves, « Ce que vivent les roses » demeure un thriller efficace qui interroge les dérives de la quête de perfection esthétique.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 315 pages.
13. Tu m’appartiens (1998)
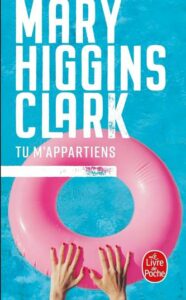
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
À New York, le Dr Susan Chandler anime une émission de radio consacrée aux affaires criminelles non résolues, les fameux cold case. Ancienne adjointe du procureur reconvertie en psychologue, elle s’intéresse au mystère qui entoure Regina Clausen, une journaliste qui n’est jamais revenue d’une escale à Hong Kong lors d’une croisière de luxe. Dans les affaires de la disparue, on n’a retrouvé qu’une bague gravée des mots « Tu m’appartiens ».
Un soir, une auditrice témoigne avoir reçu un bijou identique lors d’une croisière. D’autres femmes se manifestent bientôt, toutes évoquant le même scénario : un homme séduisant, une bague offerte, puis plus rien. Susan se lance alors dans une investigation qui va réveiller la folie meurtrière d’un psychopathe. Celui-ci, déterminé à protéger son secret, commence à éliminer systématiquement tous les témoins potentiels. Susan figure désormais en bonne place sur sa liste macabre.
Autour du livre
Ce thriller de Mary Higgins Clark publié en 1998 se distingue par sa construction autour d’une émission de radio, dispositif qui sert de catalyseur à l’intrigue. Le choix d’une psychologue comme protagoniste principale permet d’enrichir la dimension psychologique du récit, même si certains critiques regrettent que cet aspect ne soit pas davantage approfondi.
La structure narrative alterne les points de vue grâce à une narration à la troisième personne, ce qui offre un panorama complet de New York et de ses habitants : « serveuse, chauffeur, vendeur de sex-shop, taxi-man, le tout New-York est là ! » Les chapitres courts maintiennent un rythme soutenu et créent une tension qui pousse à poursuivre la lecture.
Si le roman s’inscrit dans les codes habituels de la romancière américaine – une héroïne issue d’un milieu aisé, professionnellement accomplie mais sentimentalement seule – il se démarque par son traitement des personnages féminins, jugé « agréablement surprenant » par plusieurs critiques malgré quelques stéréotypes caractéristiques des années 90.
L’intrigue criminelle s’articule autour d’un objet symbolique fort : une bague portant l’inscription « Tu m’appartiens », signature du tueur en série. Ce motif récurrent crée un fil conducteur efficace tout au long du récit. Le roman a d’ailleurs fait l’objet d’une adaptation en téléfilm en 2001, réalisée par Paolo Barzman avec Lesley-Anne Down dans le rôle principal.
Les critiques divergent sur la capacité du livre à maintenir le mystère jusqu’au bout. Si certains percent rapidement à jour l’identité du meurtrier, d’autres saluent le travail de Mary Higgins Clark pour brouiller les pistes à travers différents suspects potentiels. Les motivations du tueur, révélées en fin de roman, divisent également : certains les trouvent « tirées par les cheveux » tandis que d’autres y voient une conclusion satisfaisante.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 379 pages.
14. Toi que j’aimais tant (2002)
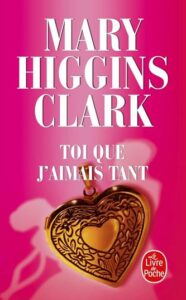
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Dans une petite ville côtière américaine, la vie d’Ellie Cavanaugh bascule à l’âge de sept ans quand elle trouve sa sœur Andrea assassinée. Le petit ami de cette dernière, Rob Westerfield, héritier d’une famille puissante, est condamné grâce au témoignage d’Ellie. Ce drame fracasse sa famille : son père policier s’enferme dans le travail, sa mère s’enfuit en Floride avec elle avant de succomber à ses démons.
Vingt-deux ans plus tard, Rob sort de prison. Soutenu par sa famille et motivé par l’héritage considérable de sa grand-mère, il clame son innocence et entreprend de faire réviser son procès. Ellie, maintenant journaliste d’investigation, retourne à Odham. Elle crée un site internet pour rassembler des témoignages sur Rob et découvre un passé marqué par la violence : agressions, renvois d’écoles prestigieuses, comportements déviants. Mais sa détermination lui vaut des menaces de plus en plus pressantes.
Autour du livre
La singularité de ce thriller publié en 2002 réside dans sa narration à la première personne, une première dans la bibliographie de Mary Higgins Clark. Cette particularité transforme radicalement l’expérience de lecture en créant une proximité inédite avec l’héroïne Ellie, dont le lecteur partage les pensées les plus intimes et les tourments psychologiques.
Le titre français « Toi que j’aimais tant » diverge sensiblement de l’original anglais « Daddy’s Little Girl ». Cette différence ne se limite pas à une simple traduction mais témoigne d’une réinterprétation subtile : là où le titre français suggère un amour révolu envers la victime, le titre anglais met en lumière la relation père-fille qui perdure tout au long du récit, ajoutant ainsi une dimension supplémentaire à l’intrigue.
La construction du suspense s’écarte des codes habituels du genre policier. Plutôt que de bâtir le mystère autour de l’identité du meurtrier, dévoilée dès les premières pages, l’intrigue se concentre sur la quête obsessionnelle d’Ellie pour empêcher la réhabilitation de Rob Westerfield. Cette inversion des mécanismes traditionnels du thriller permet d’approfondir la dimension psychologique des personnages et les ravages causés par le drame initial sur chaque membre de la famille.
L’utilisation novatrice d’un blog comme outil d’investigation par l’héroïne ancre le récit dans son époque tout en servant de catalyseur à l’action. Cette modernité technique contraste avec l’ancrage temporel du crime initial, créant un pont entre passé et présent qui structure efficacement la narration.
La thématique centrale de la résilience face au traumatisme s’incarne dans la métaphore de la chrysalide qui se transforme en papillon, illustrant le parcours d’Ellie vers sa libération personnelle. Cette dimension psychologique prend le pas sur la traditionnelle histoire d’amour, reléguée à l’arrière-plan, marquant ainsi une évolution notable dans les schémas narratifs habituels de Mary Higgins Clark.
« Toi que j’aimais tant » a fait l’objet d’une adaptation télévisée en 2014 par Olivier Langlois.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 416 pages.
15. Et nous nous reverrons… (1999)
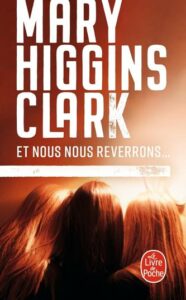
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Molly Lasch, jeune femme de la haute société new-yorkaise, purge une peine de prison pour le meurtre de son mari Gary, éminent médecin de Manhattan. Après six ans derrière les barreaux, elle obtient une libération conditionnelle. Malgré sa condamnation, Molly n’a cessé de clamer son innocence, affirmant ne garder aucun souvenir de cette nuit fatidique.
À sa sortie de prison, une série d’événements troublants se précipite. Annamarie Scalli, l’ancienne maîtresse de Gary, est retrouvée assassinée peu après avoir rencontré Molly. Les soupçons se portent à nouveau sur elle. Déterminée à prouver son innocence, Molly peut compter sur deux alliées : Fran Simmons, une journaliste d’investigation qui fut son amie d’enfance, et Jenna, restée proche depuis le lycée. L’enquête révèle peu à peu un réseau complexe d’intérêts autour de l’hôpital Lash, dirigé par Gary avant sa mort.
Autour du livre
Publié en 1999, ce thriller psychologique de Mary Higgins Clark connaît un succès commercial immédiat. Il occupe la première place du classement des best-sellers du New York Times pendant deux semaines consécutives en mai 1999 pour son édition reliée, avant d’être détrôné par la novelisation de Star Wars Episode I. L’année suivante, l’édition de poche répète cette performance en trustant la première place des ventes pendant plusieurs semaines.
L’intrigue se déroule dans l’univers médical new-yorkais, un cadre qui n’est pas sans rappeler « La Clinique du docteur H. », l’un des premiers succès de l’autrice. Mais cette fois-ci, Mary Higgins Clark innove en plaçant au centre de son récit une femme incarcérée qui tente de prouver son innocence. Cette trame s’articule autour de thématiques sociétales comme la corruption du système judiciaire, la privatisation des soins de santé et les dérives éthiques dans le milieu hospitalier.
Les critiques saluent majoritairement ce thriller même si certains pointent du doigt son aspect parfois formulaire. Le Star Tribune note que « ce qui devient une formule le devient parce que cela fonctionne à chaque fois ». L’Associated Press se montre plus sévère, qualifiant l’ouvrage de « peu intéressant et mal écrit ».
« Et nous nous reverrons… » bénéficie d’une adaptation télévisée en 2002 sur la chaîne PAX TV, avec Laura Leighton et Brandy Ledford dans les rôles principaux. Michael Storey assure la réalisation de ce téléfilm qui compte également au générique Gedeon Burkhard, Andrew Jackson et Anne Openshaw.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 348 pages.