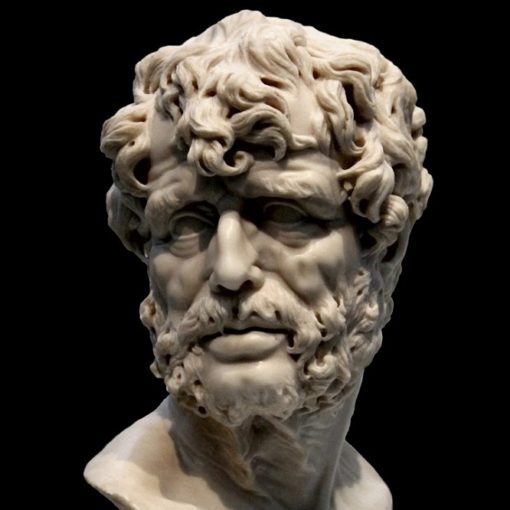Louis Aragon (1897-1982) est l’une des figures majeures de la littérature française du XXe siècle. Né à Paris d’une relation adultérine entre Louis Andrieux, préfet de police, et Marguerite Toucas-Massillon, il grandit dans le secret de sa naissance, une blessure qui marquera son œuvre.
Dans les années 1920, il participe à l’aventure dadaïste puis surréaliste aux côtés d’André Breton. Il adhère au Parti communiste français en 1927, engagement qu’il conservera toute sa vie malgré des périodes de doute. Sa rencontre avec Elsa Triolet en 1928 est déterminante : elle devient sa muse et sa compagne jusqu’à sa mort en 1970.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, il s’illustre dans la Résistance, tant par son action que par sa poésie patriotique (« Les Yeux d’Elsa », « La Rose et le Réséda »). Après-guerre, il devient une figure majeure de la vie intellectuelle française, dirigeant notamment Les Lettres françaises de 1953 à 1972. Romancier (« Le Monde réel »), poète engagé puis critique du stalinisme, il est aussi l’un des auteurs français les plus mis en musique, notamment par Léo Ferré et Jean Ferrat.
Son œuvre considérable oscille entre engagement politique et lyrisme amoureux, innovation formelle et retour à la tradition poétique. Il meurt à Paris le 24 décembre 1982, laissant l’image d’un intellectuel complexe, à la fois fidèle à ses engagements et capable de les remettre en question.
Voici notre sélection de ses livres majeurs.
1. Aurélien (roman, 1944)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Dans le Paris des années 1920, Aurélien Leurtillois mène une existence oisive de rentier, hanté par les souvenirs de la Grande Guerre. À trente ans, ce jeune bourgeois désœuvré enchaîne les conquêtes sans lendemain et les soirées mondaines, incapable de trouver un sens à sa vie.
Un soir, chez son ami Edmond Barbentane, il rencontre Bérénice Morel, une provinciale mariée venue passer quelques semaines dans la capitale. Sa première impression est sans appel : il la trouve « franchement laide ». Pourtant, touché par sa voix de contralto et son aura, Aurélien succombe peu à peu à une passion dévorante. Entre les deux êtres naît un amour impossible, fait d’hésitations et de non-dits. Bérénice, en quête d’absolu, refuse de céder à ses avances malgré leur attirance mutuelle.
Dix-huit ans plus tard, en plein exode de 1940, le hasard les réunit à nouveau. Mais le temps a fait son œuvre : ils ne sont plus les mêmes et leurs retrouvailles ne feront que confirmer l’impossibilité de leur amour.
Autour du livre
Quatrième volet du cycle du « Monde réel », « Aurélien » paraît en 1944 pendant la Libération, dans un contexte difficile pour Aragon : sa femme Elsa Triolet songe à le quitter. Cette tension transparaît dans le texte, notamment à travers le célèbre poème « Il n’y a pas d’amour heureux », composé pendant l’écriture du livre.
La trame sentimentale sert de prétexte pour peindre le Paris des années 1920 avec ses artistes d’avant-garde, ses mondanités et ses lieux emblématiques. Les figures de l’époque s’y croisent sous des noms à peine voilés : Picasso devient Zamora, Picabia et d’autres membres du mouvement Dada peuplent les vernissages et les soirées. Cette évocation du milieu artistique permet à Aragon de renouer avec sa jeunesse surréaliste, qu’il avait reniée depuis 1934.
Le personnage d’Aurélien emprunte ses traits à Pierre Drieu La Rochelle, ami de jeunesse d’Aragon avant leur rupture idéologique – l’un devenant résistant communiste, l’autre collaborateur. Cette dimension autobiographique teinte le récit d’une mélancolie particulière. L’impossibilité de l’amour entre Aurélien et Bérénice fait écho à l’impossibilité de maintenir certaines amitiés face aux choix politiques de l’entre-deux-guerres.
Aragon interroge aussi la condition féminine à travers le personnage de Bérénice, qui incarne une forme de modernité : elle refuse les compromis amoureux, revendique son indépendance et développe une conscience politique, notamment lors de l’aide aux réfugiés espagnols. Cette émancipation contraste avec la dérive d’Aurélien vers le pétainisme.
« Aurélien » a fait l’objet de deux adaptations télévisées : en 1978 par Michel Favart avec Philippe Nahoun, puis en 2003 par Arnaud Sélignac avec Olivier Sitruk et Romane Bohringer. Son succès ne s’est jamais démenti, comme en témoignent ses nombreuses rééditions, dont la prestigieuse collection de la Pléiade en 2003.
Aux éditions FOLIO ; 635 pages.
2. Les beaux quartiers (roman, 1936)
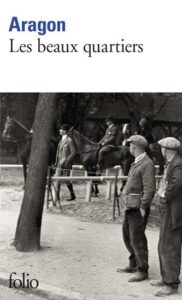
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
À la veille de la Première Guerre mondiale, deux frères issus de la bourgeoisie provinciale suivent des trajectoires radicalement différentes. À Sérianne, petite ville du Sud, Edmond brille par son charme et son ambition, et marche dans les pas de son père médecin. Son frère Armand, plus sensible, se dégage peu à peu de l’emprise maternelle qui le destinait à la prêtrise.
Le destin les mène tous deux à Paris, où leurs chemins divergent encore davantage. Edmond, étudiant en médecine, s’enfonce dans une spirale d’ambition et de séduction après sa rencontre avec Carlotta, une courtisane entretenue par un homme fortuné. Armand, lui, rompt avec son milieu social et s’engage aux côtés des ouvriers dans les usines de Levallois-Perret, où il est confronté aux premières luttes syndicales.
Autour du livre
Cette réflexion sur la France d’avant 1914 s’inscrit dans un moment crucial : publié en 1936, l’année du Front Populaire, « Les beaux quartiers » reçoit le prix Renaudot. Deuxième tome du cycle du « Monde réel » après « Les cloches de Bâle », il porte en lui les tensions d’une époque où la menace de la Seconde Guerre mondiale se fait déjà sentir.
L’écriture d’Aragon puise dans ses propres expériences : la campagne électorale à Sérianne s’inspire de souvenirs avec son père et son oncle. Les rapports complexes entre le docteur Barbentane et son fils font écho à sa relation avec son père Louis Andrieux. La figure de Carlotta emprunte certains traits à Nancy Cunard, héritière d’une compagnie de paquebots transatlantiques avec qui Aragon eut une liaison. Les scènes du « Passage Club », notamment l’assassinat de Mme Beurdeley et la descente de police, tirent leur substance de son travail de journaliste à L’Humanité.
La dimension spatiale de la lutte des classes structure le récit : d’un côté les beaux quartiers de l’ouest parisien où la bourgeoisie se tient à distance des fumées d’usines, de l’autre la « couronne ouvrière » qui s’étend dans les arrondissements pauvres. Cette ségrégation sociale révèle une interdépendance paradoxale : les bourgeois ont besoin des pauvres autant que l’inverse. Le monde décrit résonne encore aujourd’hui dans ses aspects les plus sombres, des manœuvres politiciennes aux inégalités sociales.
Aragon se projette de manière singulière dans ses deux personnages principaux, comme il le confiera plus tard à Elsa Triolet en 1965 dans « La Mise à mort » : « Il subit au vrai ton influence car tu m’as toujours identifié à Armand malgré mes dénégations. » Cette dualité fait écho aux héros des « Thibault » de Roger Martin du Gard – également deux frères, l’un médecin, l’autre rebelle. Les figures de Julien Sorel et Eugène de Rastignac se profilent derrière Edmond et Armand Barbentane, inscrivant « Les beaux quartiers » dans la tradition du roman de formation du XIXe siècle.
Aux éditions FOLIO ; 624 pages.
3. La Semaine Sainte (roman, 1958)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
La semaine du 19 au 26 mars 1815 bouleverse la France. Napoléon, échappé de l’île d’Elbe, marche sur Paris. Dans la panique, Louis XVIII et sa Maison fuient vers le nord. Théodore Géricault, qui a troqué ses pinceaux contre un uniforme de mousquetaire royal, se retrouve embarqué dans cette retraite précipitée.
La débâcle révèle les failles d’une société fracturée. D’un côté, une cour en déroute qui court vers Béthune puis la Belgique. De l’autre, un peuple qui observe, las des guerres mais sensible aux promesses de l’Empereur. Entre les deux, des maréchaux d’Empire ralliés aux Bourbons s’interrogent sur leur fidélité.
Dans ce tourbillon d’événements, chaque personnage affronte ses propres démons. Le maréchal Berthier pressent sa fin tragique, le duc de Richelieu manœuvre diplomatiquement, tandis que des révolutionnaires conspirent dans la vallée de la Somme. Pour Géricault, cette fuite pose une question essentielle : doit-on quitter son pays par loyauté envers un roi ?
Autour du livre
Paru en 1958 dans la collection « Blanche » des éditions Gallimard, « La Semaine Sainte » se distingue des productions antérieures comme « Les Communistes » ou « Les cloches de Bâle » par sa manière singulière d’entrelacer la grande Histoire et les destins individuels.
La publication survient à un moment charnière pour Aragon : les révélations du XXe congrès du Parti communiste de l’Union soviétique en 1956 ébranlent ses certitudes politiques. Cette crise intérieur transparaît dans le traitement des personnages, peints avec une complexité psychologique qui transcende les clivages idéologiques. Le choix même de cette période historique – les Cent-Jours – fait écho aux questionnements de l’écrivain sur la nature de l’engagement et de la fidélité politique.
Contrairement aux apparences, il ne s’agit pas d’un simple roman historique. Comme l’affirme Aragon lui-même : « La part de l’imagination y est plus grande que dans ‘Les Communistes’, par exemple, où ma documentation était de première main. » Cette liberté créatrice permet à l’écrivain d’insuffler une dimension contemporaine au récit, notamment à travers des incursions dans le XXe siècle, comme l’évocation de l’occupation de la Sarre en 1919.
L’accueil critique s’avère exceptionnel. Dans Le Monde, l’académicien Émile Henriot salue un « vrai chef-d’œuvre » et loue sa « force », son « jet », sa « vitalité ». Cette reconnaissance unanime fait de « La Semaine Sainte » le plus grand succès public d’Aragon de son vivant. L’ouvrage inaugure également une nouvelle période dans son écriture, qualifiée de métaromanesque, qui trouvera son prolongement dans « La Mise à mort » et « Blanche ou l’oubli ».
Aux éditions FOLIO ; 835 pages.
4. Les cloches de Bâle (roman, 1934)
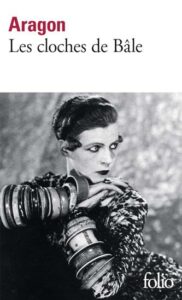
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
À l’aube de la Première Guerre mondiale, la haute société parisienne vit ses dernières heures d’insouciance. Diane, issue d’une noblesse ruinée, enchaîne les liaisons avec des hommes fortunés. Catherine Simonidzé, aristocrate géorgienne déracinée, mène une existence oisive grâce à la fortune pétrolière de son père. Leur monde bascule quand Catherine rencontre Victor, un chauffeur de taxi militant qui lui ouvre les yeux sur les luttes sociales.
Le roman entrecroise les destins de ses personnages avec les soubresauts de l’Histoire : la grève des horlogers de Cluses, les revendications des taxis parisiens, les crimes de la bande à Bonnot. L’intrigue atteint son paroxysme au Congrès socialiste de Bâle en 1912, où se joue l’avenir de la paix en Europe. Clara Zetkin, figure du socialisme allemand, incarne l’espoir d’un monde nouveau porté par l’émancipation des femmes.
Autour du livre
La genèse des « Cloches de Bâle » débute avec la lecture du premier chapitre « Diane » à Elsa Triolet. Sa réaction – « Et tu vas continuer longtemps comme ça ? » – pousse paradoxalement Aragon à intensifier son travail d’écriture. Cette remarque souligne l’ambition qui sous-tend l’œuvre : dépasser le simple portrait d’une bourgeoise désœuvrée pour peindre une fresque sociale plus ambitieuse.
Premier volume du cycle « Le Monde réel », ce texte de 1934 marque la transition d’Aragon qui s’éloigne alors du surréalisme pour se rapprocher du réalisme socialiste. Il y mêle avec habileté personnages fictifs et figures historiques réelles, comme Jean Jaurès ou Clara Zetkin. Cette dernière incarne dans l’épilogue la femme nouvelle, symbole d’un idéal communiste qui transcende l’individu.
La force du livre réside dans sa capacité à superposer une chronique sociale minutieuse et des personnages qui conservent leur singularité. Le parcours de Catherine illustre ce double mouvement : son désabusement initial face à une existence mondaine vide de sens la conduit vers l’engagement politique, d’abord anarchiste puis socialiste. Les grands événements sociaux de l’époque – comme la grève des taxis parisiens de 1911-1912 – servent de toile de fond à cette évolution.
Remanié en 1964, trente ans après sa première publication, le texte témoigne aussi d’une réflexion sur la transmission de la mémoire historique. Comme l’écrit Aragon lui-même : « le roman est demeuré le même, mais les yeux ont changé. Le nouveau lecteur ignore une foule de choses encore vivantes, en marge du texte, il y a trente ans. » Cette conscience aiguë de la distance temporelle qui sépare les différentes générations de lecteurs confère au livre une dimension supplémentaire : celle d’un témoignage sur une époque dont les tensions et les espoirs continuent de résonner avec notre présent.
Aux éditions FOLIO ; 438 pages.
5. Les Yeux d’Elsa (recueil de poèmes, 1942)
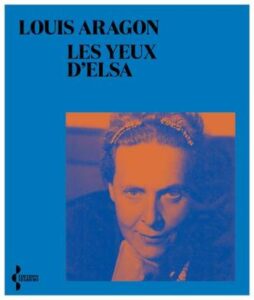
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
« Les Yeux d’Elsa », publié en 1942, réunit vingt-et-un poèmes composés par Louis Aragon entre 1941 et 1942, en pleine occupation allemande. Le recueil s’ouvre sur le poème éponyme dédié à Elsa Triolet, l’épouse du poète qu’il a rencontrée en 1928 à La Coupole et épousée en 1939. Ces vers célèbrent la beauté de sa muse à travers des images saisissantes : « Tes yeux sont si profonds qu’en m’y penchant pour boire / J’ai vu tous les soleils y venir se mirer. »
Mais derrière cet hymne à l’amour se cache aussi un message de résistance. Dans une France meurtrie par la guerre, Aragon entremêle subtilement l’éloge de sa bien-aimée et celui de son pays opprimé. Les références à la Table Ronde et aux héros médiévaux se muent en allégories de la lutte contre l’occupant. Le poète transforme ainsi sa passion pour Elsa en un chant patriotique codé qui a pu échapper à la censure de Vichy.
Ce recueil marque le début d’un long cycle poétique qu’Aragon consacrera à Elsa jusqu’à la mort de celle-ci en 1970. Ses vers ont inspiré de nombreux artistes, de Jean Ferrat à Patrick Bruel, qui les ont mis en musique. La force du recueil tient dans cette fusion entre l’intime et l’historique, entre l’amour absolu pour une femme et l’engagement pour la liberté de tout un peuple.
Aux éditions SEGHERS ; 160 pages.
6. Elsa (recueil de poèmes, 1959)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Publié en 1959, « Elsa » constitue l’un des sommets du « cycle d’Elsa », série d’œuvres poétiques qu’Aragon consacre à sa femme Elsa Triolet. Ce long poème mêle vers classiques, textes en prose et une pièce de théâtre pour dépeindre une histoire d’amour hors du commun, née de leur rencontre à la brasserie de La Coupole en 1928.
Les poèmes suivent le fil des pensées d’un homme éperdument amoureux qui scrute sa femme endormie, guette ses rêveries, s’inquiète de ses absences. La crainte du temps qui s’écoule se mêle à la difficulté de mettre des mots sur des sentiments trop grands. Entre servitude et domination, entre paradis et enfer, la relation amoureuse se dévoile dans toute sa complexité.
Paru simultanément avec « Roses à crédit » d’Elsa Triolet, ce texte dialogue avec le « Roman de la Rose » et « L’Empire des Roses » de Saadi. Dans le contexte trouble de la déstalinisation qui secoue alors le Parti communiste français, ce recueil marque pour Pierre Daix une « reconstruction » d’Aragon, tant personnelle que politique. Les incursions de la modernité (scooters, références à Aznavour) ancrent cette célébration de l’amour dans son époque tout en lui conférant une dimension universelle.
Aux éditions GALLIMARD ; 156 pages.
7. Le Fou d’Elsa (recueil de poèmes, 1963)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
En 1492, à l’heure où Grenade s’apprête à tomber aux mains des Rois Catholiques, un vieux chanteur des rues sillonne la cité. Les habitants le surnomment le Medjnoûn – le Fou. Dans cette dernière ville d’Espagne où règne encore l’Islam, sous le trône fragile de Boabdil, ce sage illuminé chante son amour impossible pour une femme qui n’existe pas encore : Elsa.
Le Fou transcende le temps dans ses visions mystiques. Il dialogue avec le poète García Lorca, croise la route de Don Quichotte, s’entretient avec les philosophes Averroès et Maïmonide. Son histoire reprend le mythe persan de Majnoun et Leila, mais le transpose dans une Grenade au carrefour des cultures, où musulmans et juifs cultivent encore un art de vivre menacé par l’avancée de l’Inquisition.
Publié en 1963, ce long poème d’Aragon fait écho aux tensions de la décolonisation et de la guerre d’Algérie. La formule devenue célèbre « L’avenir de l’homme est la femme » y apparaît, immortalisée ensuite par Jean Ferrat qui mettra en musique plusieurs textes du recueil, comme « Aimer à perdre la raison » ou « Nous dormirons ensemble ». Cette fresque poétique établit un dialogue puissant entre les civilisations, en conjuguant l’histoire de la Reconquista aux questionnements sur la place du monde arabo-musulman dans la modernité.
Aux éditions GALLIMARD ; 560 pages.
8. Le roman inachevé (recueil de poèmes, 1956)
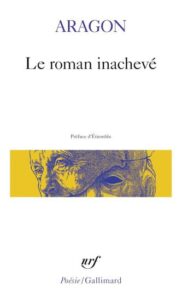
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Publié en 1956, « Le Roman inachevé » d’Aragon se présente comme une autobiographie poétique où l’écrivain, alors âgé de 59 ans, revisite les moments clés de son existence. À travers une succession de poèmes, il retrace son parcours depuis son enfance malheureuse jusqu’à sa vie d’homme mûr, en passant par les deux guerres mondiales et ses années surréalistes aux côtés d’André Breton.
Le fil conducteur de ce recueil suit une trame chronologique, même si celle-ci n’est pas strictement linéaire. Les guerres y occupent une place centrale, tout comme ses engagements politiques, notamment son adhésion au Parti communiste. Mais c’est surtout l’amour qui irrigue l’ensemble de l’œuvre, à travers la figure d’Elsa Triolet, sa compagne depuis leur rencontre en 1928.
Cette œuvre résonne particulièrement avec son époque : publiée l’année même où sont révélés les crimes de Staline, elle porte la marque d’un homme ébranlé dans ses convictions. La diversité des formes poétiques – du quintil aux vers de seize syllabes – traduit cette quête d’équilibre entre unité et dispersion. Plusieurs poèmes ont connu une seconde vie grâce à leurs adaptations musicales par Léo Ferré et Jean Ferrat, notamment « L’Affiche rouge » et « Que serais-je sans toi », devenus des classiques de la chanson française.
Aux éditions GALLIMARD ; 256 pages.
9. Le paysan de Paris (recueil de poèmes, 1926)
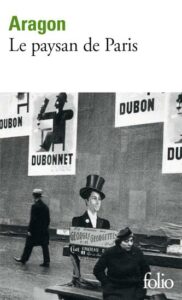
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
En 1924, alors que les grands travaux haussmanniens continuent de transformer Paris, un jeune poète observe la capitale avec des yeux neufs. Dans le Passage de l’Opéra condamné à disparaître, il prend des notes sur chaque boutique, chaque commerce, chaque personnage : le café Le Petit Grillon où il retrouve ses amis pour jouer au baccara, les salons de coiffure aux étranges mannequins de cire, les établissements de bains aux activités douteuses.
La nuit venue, sa déambulation le conduit aux Buttes-Chaumont. Accompagné d’André Breton, il parcourt les allées désertes de ce parc artificiel où les rochers côtoient une nature domestiquée. Dans ce décor propice aux rêveries, ses pensées le ramènent sans cesse à Eyre de Lanux, une femme mariée dont il est éperdument amoureux.
Écrit entre 1923 et 1926, pendant qu’Aragon vit deux passions amoureuses successives, « Le paysan de Paris » bouleverse les codes littéraires de son époque. Le texte juxtapose librement descriptions réalistes, reproductions d’affiches publicitaires, dialogues avec des statues et méditations philosophiques. Cette audace formelle lui vaut un accueil hostile à sa sortie, y compris de la part des surréalistes. Mais le temps lui donnera raison : « Le paysan de Paris » deviendra l’un des textes majeurs du surréalisme, salué pour sa capacité inédite à transfigurer le quotidien en merveilleux.
Aux éditions FOLIO ; 248 pages.