En licence, on apprend à penser le politique avec méthode, à maîtriser les cadres conceptuels et à “faire” des sciences sociales : lire, enquêter, argumenter.
La sélection ci-dessous réunit des ouvrages accessibles, solides académiquement et complémentaires : un grand introductif, un manuel de méthode, des repères sur les institutions et l’action publique, des focus sur les partis et les relations internationales, puis deux classiques pour nourrir la réflexion théorique.
L’ordre proposé va du plus fondamental au plus “situé” et vous permet de bâtir un socle robuste dès la L1.
1. La science politique (PUF, Que sais-je ?, 13e édition, 2023)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Philippe Braud condense en une synthèse rigoureuse ce que recouvre la discipline : objets (l’État, le pouvoir, la décision), démarches (empirique, comparative, historique) et principaux débats (légitimation, participation, représentations). L’ouvrage éclaire les notions-pivots — pouvoir, institutions, acteurs, socialisation politique — en montrant comment la science politique s’est constituée au carrefour de la sociologie, du droit, de l’histoire et de la philosophie politique. La prose est nette, les définitions sont précises, et les exemples replacent chaque concept dans une controverse ou dans un cas empirique.
La force du livre tient à sa clarté pédagogique : Braud tisse une cartographie de la discipline sans céder à l’encyclopédisme. Chaque chapitre met en regard approches théoriques et instruments d’enquête, ce qui vous aide à passer de l’idée à l’opérationnalisation. L’ouvrage rappelle aussi que la science politique n’est pas une tour d’ivoire : elle s’alimente d’élections, de mobilisations, d’institutions en action, et de données qui se critiquent.
Il donne le vocabulaire commun et l’architecture d’ensemble : vous repérez où se situent vos cours, comment articuler concepts et méthodes, et comment éviter les faux dilemmes (normatif vs. empirique, micro vs. macro). En 120 pages, vous obtenez une vue d’ensemble fiable — de quoi guider vos fiches et vos révisions sans vous perdre.
Comment l’utiliser ?
- Faire une lecture active en L1 : surligner définitions et exemples, créer une carte mentale des notions.
- Ouvrir chaque nouveau chapitre de cours en relisant le passage correspondant pour gagner du temps de préparation.
- Constituer un glossaire personnel (pouvoir, légitimité, socialisation…) avec renvoi aux pages.
- En révision, transformer les titres de sections en sujets de dissertation pour s’entraîner à problématiser.
2. Manuel de recherche en sciences sociales (Armand Colin, 6e édition, 2022)
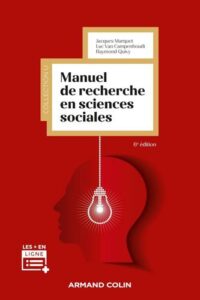
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Le trio Quivy – Van Campenhoudt – Marquet est devenu le compagnon méthodologique des mémoires comme des dossiers de TD. Le livre déroule, pas à pas, la chaîne complète d’une recherche : de la question de départ à la problématisation, de la revue de littérature à la stratégie d’enquête (qualitative, quantitative, mixte), jusqu’à la construction d’un dispositif (échantillonnage, guide d’entretien, questionnaire) et à l’analyse des données.
Son intérêt majeur : il ne confond pas “recettes” et “méthode”. On y apprend à justifier ses choix (entretiens semi-directifs vs. observation), à anticiper les biais (désidérabilité, non-réponse), à documenter les limites et à écrire en articulant faits et arguments. Les encadrés et exemples aident à passer du concept à l’opérationnalisation (variables, indicateurs), tandis que les chapitres sur l’argumentation vous donnent des modèles clairs pour présenter résultats et discussion.
La réussite en licence ne se joue pas qu’au contenu : elle repose sur la capacité à enquêter et à rédiger avec méthode. Ce manuel vous fera gagner un temps précieux et vous évitera les erreurs classiques (questions suggestives, hypothèses floues, bibliographies hors sujet). Il devient vite votre garde-fou méthodologique, du brief de TD au mini-mémoire de L3.
Comment l’utiliser ?
- Avant tout dossier, suivre la checklist “question → hypothèses → opérationnalisation” pour cadrer le sujet.
- Piocher dans les modèles de guides et questionnaires, puis adapter à votre terrain.
- Après la collecte, appliquer les fiches d’analyse (codage thématique, tableaux simples) pour structurer les résultats.
- Pendant l’écriture, utiliser le chapitre “argumentation” pour relier faits, raisonnement et citations.
3. Droit constitutionnel (LGDJ, 46e édition, 2025)
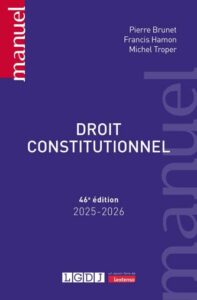
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Hamon, Troper et Brunet livrent le manuel de référence sur le constitutionnalisme et l’architecture des pouvoirs en France (et en perspective comparée). Clair et complet, il replace les institutions (Parlement, Exécutif, Conseil constitutionnel) dans leur genèse, leurs compétences et leurs équilibres, en montrant comment les règles formelles croisent les pratiques (responsabilité politique, 49.3, contrôle de constitutionnalité, QPC).
La mise à jour 2025-2026 intègre les évolutions récentes et propose une lecture dynamique des textes : procédures, jurisprudence, acteurs, usages. Pour les étudiant·es en science politique, ce n’est pas “du droit pour juristes”, c’est la grammaire des régimes démocratiques : comprendre comment s’écrivent, se contournent et se disputent les règles du jeu, et comment les pratiques transforment la lettre constitutionnelle.
Nombre de sujets de dissertation (responsabilisation de l’exécutif, rationalisation du parlementarisme, représentativité) exigent une maîtrise positive et vivante des institutions, au-delà des slogans. Ce manuel vous arme pour mobiliser dispositions et jurisprudence comme de véritables arguments, et non de simples illustrations.
Comment l’utiliser ?
- Ficher les articles et décisions clés (art. 5, 20, 34, 49), avec exemples récents.
- Pour chaque chapitre, dresser un schéma des rapports de pouvoirs (qui peut quoi, quand, comment).
- En commentaire de documents, mobiliser la jurisprudence comme argument central.
- Croiser avec l’actualité institutionnelle pour problématiser vos devoirs.
4. Sociologie de l’action publique (Armand Colin, 2e édition, 2018)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Lascoumes et Le Galès expliquent ce que signifie “faire de l’action publique” aujourd’hui : une constellation d’acteurs (administrations, collectivités, juges, ONG, entreprises), des instruments (normes, incitations, contrats, indicateurs) et des temporalités (agenda, mise en œuvre, évaluation). Le livre propose une véritable boîte à outils pour appréhender la fabrication des politiques, depuis la définition des problèmes jusqu’aux effets inattendus des dispositifs.
On y comprend comment l’État n’est plus seul, comment l’Europe, les villes ou les agences reconfigurent l’action, et pourquoi l’étude des instruments (gouverner par les chiffres, par les standards) révèle autant que les grands textes. Passer d’une approche “textes et institutions” à une approche processuelle et empirique devient naturel : l’analyse se déplace vers la mise en œuvre, là où surgissent résistances, traductions et apprentissages.
Nombre de sujets concrets (école, hôpital, climat, sécurité) se lisent mieux par l’examen des instruments et des acteurs que par un simple rappel des lois. Ce livre offre des concepts transportables et des grilles d’observation que vous pourrez immédiatement appliquer à vos exposés ou mini-terrains.
Comment l’utiliser ?
- Pour tout thème, dresser la carte des acteurs et la liste des instruments employés.
- Transformer un chapitre en grille d’observation (agenda → mise en œuvre → évaluation) pour un mini-terrain.
- Mobiliser les notions d’instrumentation et de traduction pour expliquer résultats et résistances.
- Illustrer chaque concept par un cas français et un cas européen.
5. Les partis politiques (PUF, Que sais-je ?, 10e édition, 2022)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Michel Offerlé propose une synthèse dense et actuelle sur ces organisations qui structurent la compétition et l’offre politique. L’ouvrage répond aux questions clés : qu’est-ce qu’un parti ? Comment naît-il, se finance-t-il, se professionnalise-t-il ? Quels rapports entretient-il avec l’État, les syndicats, les médias et les mouvements sociaux ?
Offerlé met en perspective la diversification organisationnelle (partis-cartels, partis-mouvements, start-ups électorales) et les transformations contemporaines (affaiblissement partisan, personnalisation, plateformes numériques). On y trouve aussi des clés pour analyser la sélection des élites, la fabrique des programmes, la discipline interne et les coalitions, avec un constant souci d’articulation entre concepts et exemples.
Pourquoi c’est indispensable ? Parce qu’on ne comprend pas les électorats, les campagnes ou l’activité parlementaire sans prendre au sérieux l’organisation partisane — même à l’heure des candidatures “hors partis”. Ce petit format “Que sais-je ?” concentre l’essentiel sans s’appauvrir, idéal pour nourrir vos dissertations et études de cas.
Comment l’utiliser ?
- Construire des fiches-acteurs (dirigeants, organigrammes, sections locales, finances).
- Relier un concept (parti-cartel, parti-professionnel) à un exemple français ou européen.
- Comparer statuts et règles internes de deux partis (investitures, discipline de vote) pour un exposé.
- En dissertation sur la crise de la représentation, mobiliser données d’adhésion et de financement.
6. Sociologie des relations internationales (La Découverte, 2023)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Guillaume Devin (avec Marieke Louis) propose une entrée sociologique aux relations internationales : considérer les faits internationaux comme des faits sociaux. L’ouvrage organise le domaine autour de quatre axes : acteurs (États, organisations internationales, ONG, firmes), puissance (ressources, capacités, dépendances), objectifs (sécurité, commerce, idées) et instruments (diplomatie, droit, force).
On y apprend à lire le système international au-delà des seuls États, à articuler empirie et théorie, continuités et changements. Les chapitres clarifient le multilatéralisme, la conflictualité, la circulation des normes, et montrent comment enquêter (sources, indicateurs, bases de données). La perspective est résolument comparative et outillée, ce qui aide à transformer l’actualité en objets d’analyse cumulables.
En licence, on vous demandera de passer d’une actualité foisonnante à des grilles d’analyse capables de comparer crises, organisations et politiques étrangères dans la durée. Ce “Repères” vous donne des catégories opératoires, immédiatement réutilisables en exposé ou en dissertation.
Comment l’utiliser ?
- Pour chaque crise (sécurité, climat, commerce), remplir la grille “acteurs–puissance–objectifs–instruments”.
- Constituer des fiches d’organisations (ONU, OMC, UE, OTAN) avec compétences, modes de décision et budgets.
- Croiser vos lectures avec quelques indicateurs pour objectiver les arguments.
- Mobiliser un concept (sécuritisation, diffusion des normes) et le tester sur un cas précis.
7. Le savant et le politique (La Découverte, 2003)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Deux conférences de Max Weber, devenues classiques : “La profession de savant” et “La profession de politique”. Weber y traite des éthiques (conviction vs. responsabilité), du rapport aux valeurs (neutralité axiologique), de la vocation (discipline, lucidité, patience), et livre une définition fameuse de l’État comme détenteur du monopole de la violence légitime.
Loin de fétichiser l’abstraction, Weber parle métier : quelles exigences pour produire un savoir fiable ? Que signifie agir politiquement dans la durée, accepter les effets non intentionnels et le tragique du compromis ? Pour un·e étudiant·e, ce texte est un vaccin contre le moralisme et contre le cynisme : il apprend à tenir ensemble faits et valeurs, rigueur et responsabilité, idéal et limites du possible.
Il éclaire la posture intellectuelle demandée à l’Université et la nature du politique : un domaine de conflits réglés, d’institutions et de choix lourds. Ces deux conférences, brèves et denses, se relisent à chaque étape de la licence pour recalibrer vos exigences.
Comment l’utiliser ?
- Au début du semestre, lire “Le savant” pour installer des routines (prise de notes, vérification, prudence conceptuelle).
- Pour une dissertation “éthique et politique”, contraster éthique de conviction et éthique de responsabilité.
- Relever les citations-clés (définition de l’État) et les placer en exergue de vos fiches.
- En TD, discuter des limites et de l’héritage de Weber pour problématiser.
8. De la démocratie en Amérique (Flammarion, 2023)
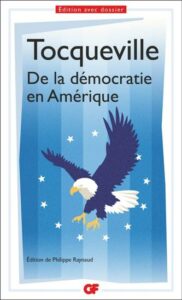
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Tocqueville observe les États-Unis des années 1830 pour penser plus largement le destin démocratique. Il analyse les mœurs, les institutions, les contre-pouvoirs (fédéralisme, communes, associations), la place de la religion, l’égalité des conditions. Sa thèse n’est pas un éloge naïf : la démocratie porte aussi des risques — tyrannie de la majorité, conformisme, passion de l’égalité au détriment de la liberté.
La force du livre tient à sa méthode comparée (regard “extérieur” sur l’Europe) et à sa capacité d’anticipation (rôle de l’administration, des juges, de l’opinion). L’édition GF 2023, avec dossier, contextualise, propose repères et pistes bibliographiques, ce qui facilite la lecture par thèmes et la mobilisation en devoir sur table.
Pour discuter la “crise démocratique”, il faut connaître une grande théorie de la démocratie réellement existante : institutions, société civile, mœurs. Tocqueville vous donne un langage pour lire les tensions de nos régimes et un répertoire d’exemples qui se citent aisément.
Comment l’utiliser ?
- Lire par thèmes (communes, associations, justice) en reliant aux institutions françaises ou européennes.
- Constituer un tableau “promesses/risques” de la démocratie avec pages à l’appui.
- Réutiliser les exemples tocquevilliens (compétence civique, localisme) dans vos copies.
- En commentaire de texte, insister sur la méthode (comparaison, observation, concepts opératoires).
Trois conseils pour tirer le meilleur de cette bibliographie
- Fiches courtes, régulières : 1 page max par chapitre (idée directrice, 3 notions, 2 exemples, 1 citation). Vous réviserez plus vite et mieux.
- Carnet de sujets : transformez chaque titre de section en question de dissertation ; entraînez-vous à bâtir un plan en 10 minutes.
- Aller-retour cours/actualité : pour chaque notion (instrumentation, légitimité…), cherchez un fait récent qui l’illustre. C’est le réflexe qui distingue une copie “mémoire” d’une copie “analyse”.
Références
- ONISEP — Licence mention science politique : programme et matières
- Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne — Licence Science politique : présentation et maquettes
- Université Lumière Lyon 2 — Licence Science politique : contenus et organisation
- Vie publique — Fiches “Institutions de la Ve République”
- Légifrance — Texte consolidé : Constitution du 4 octobre 1958
- Conseil constitutionnel — Recherche experte des décisions et QPC




