Réussir sa licence de sciences de l’éducation, c’est apprendre à enquêter, argumenter et écrire avec méthode. Cette page propose une sélection d’ouvrages de référence choisis pour leur utilité directe dans les travaux de L1–L3 : notes de lecture, dossiers, enquêtes de terrain, exposés et partiels.
Classés dans un ordre qui va du socle disciplinaire aux méthodes (qualitatives et quantitatives), puis à la pédagogie, à l’évaluation et aux outils du quotidien, ces bouquins vous aideront à problématiser un sujet, à construire un protocole réaliste et à relier concepts, données et pratiques. Chaque titre peut se lire seul, mais l’ensemble forme un parcours cohérent pour gagner en assurance tout au long du semestre.
L’objectif est simple : transformer vos lectures en progrès visibles — des idées mieux structurées, des analyses plus rigoureuses, des écrits universitaires qui font la différence.
1. Manuel de sciences de l’éducation et de la formation (De Boeck Supérieur, 1ʳᵉ éd., 2021)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Ce manuel collectif offre un panorama ambitieux et très actuel de la discipline : histoire et contours des sciences de l’éducation, grandes questions vives (démocratisation, numérique, curriculum, professionnalisation), et outillage méthodologique accessible pour conduire des enquêtes. Son intérêt majeur est de tenir ensemble les registres théoriques (pédagogie, sociologie, psychologie, didactiques, politiques éducatives) et les méthodes (entretiens, questionnaires, observations, analyses de contenu), avec une écriture claire et des exemples qui parlent aux étudiants.
Les chapitres sont courts, bien structurés, et s’achèvent sur des bibliographies guidées : idéal pour bâtir une base de révisions ou un plan de lecture raisonné. On y trouve aussi des repères terminologiques et des synthèses qui aident à problématiser un sujet — compétences clés en licence lorsqu’il s’agit de passer d’un thème général (“le décrochage”, “la mixité sociale”, “l’évaluation”) à une question de recherche formulée et argumentée.
Enfin, l’ouvrage intègre les débats contemporains (controverses sur les pédagogies actives, place des émotions en classe, pilotage par les résultats), ce qui en fait un compagnon pertinent pour les exposés, les examens et la préparation de stages.
Comment l’utiliser ?
- Construisez votre fiche de la discipline : définitions, domaines, méthodes, questions vives.
- Avant un exposé, lisez l’introduction de la partie correspondante puis repérez 2–3 encadrés clés.
- Pour chaque dossier, résumez un chapitre en 10 lignes et relevez 5 notions à recroiser ailleurs.
- Reprenez les bibliographies en fin de chapitres pour élargir vos lectures ciblées.
- Transformez les schémas du livre en cartes mentales pour vos révisions.
2. Sociologie de l’école (Armand Colin, 6ᵉ éd., 2022)
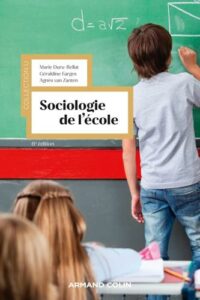
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Référence incontournable, ce manuel présente la sociologie de l’éducation à la fois de manière panoramique et problématisée. Il revient sur les grands apports (Bourdieu, Dubet, Bernstein, etc.), met en perspective les inégalités de parcours, la ségrégation scolaire et résidentielle, les effets d’établissement, les transformations du métier enseignant et l’expérience des élèves.
La force de cette 6ᵉ édition est d’actualiser les données empiriques (indicateurs, comparaisons internationales, dispositifs de politique scolaire) et de montrer comment les structures (programmes, filières, carte scolaire) interagissent avec les pratiques de classe et les ressources familiales. Le livre parle directement aux étudiants de licence : chaque chapitre articule concepts, résultats d’enquêtes et implications pour l’action publique — un modèle de problématisation utile pour vos devoirs.
Les encadrés et exemples de terrains permettent d’apprendre à lire des tableaux, interpréter des graphiques et relier micro-situations et macro-enjeux. C’est aussi un excellent réservoir de questions de dissertation : massification vs. démocratisation, autonomie des établissements, effets des évaluations standardisées, etc.
Comment l’utiliser ?
- Pour chaque chapitre, dressez un tableau “Concept → Auteur → Exemple → Limites”.
- Gardez une feuille dédiée aux indicateurs (PISA, IPS, taux de réussite…) avec définitions sourcées.
- En TD, testez la transposition : “Comment ce concept éclaire-t-il ma scène de stage ?”.
- Faites une mini-revue de littérature en partant des références clés de fin de chapitre.
- Révisez en binôme : l’un résume, l’autre propose une mise en débat.
3. Les nouvelles politiques éducatives (PUF, 2007 ; rééd. numérique 2015)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Cet ouvrage propose une lecture comparée des réformes conduites en France à l’aune d’expériences étrangères : décentralisation, autonomie des établissements, carte scolaire, pilotage par les résultats, collège unique, dispositifs d’évaluation, et tensions entre équité et efficacité.
Il retrace le tournant des politiques publiques d’éducation à partir des années 1990–2000 et montre comment des instruments (indicateurs, contrats d’objectifs, accountability) reconfigurent le système. Utile en licence pour comprendre les “arènes” où se décident les orientations (État, collectivités, établissements) et pour situer les débats (libéralisation, mixité sociale, choix de l’école) dans une perspective informée.
Le style est didactique et les chapitres se prêtent bien aux exposés thématiques. Vous y trouverez de quoi nourrir des dissertations de culture éducative et des introductions de dossiers (problèmes publics, acteurs, instruments, effets attendus ou inattendus). Même si l’édition papier date de 2007, la réédition numérique et les analyses proposées offrent des cadres d’interprétation encore très opérants pour comprendre les réformes plus récentes.
Comment l’utiliser ?
- Constituez une fiche “instruments de politique” (indicateurs, évaluations, autonomie, carte scolaire).
- Pour chaque réforme étudiée ailleurs, repérez son “chaînage” : objectifs → instruments → effets.
- Entraînez-vous à écrire une introduction problématisée en 10 lignes à partir d’un chapitre.
- Croisez avec des données actuelles (notes DEPP, PISA) pour actualiser vos exemples.
- Préparez des schémas acteur-réseau (État, rectorat, chef d’établissement, familles, enseignants).
4. Manuel de recherche en sciences sociales (Armand Colin, 6ᵉ éd., 2022)
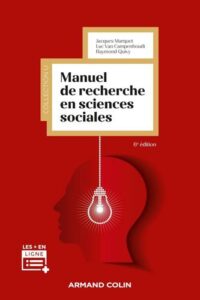
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
C’est le guide pas-à-pas pour concevoir et mener une recherche : de la formulation d’une question à la discussion des résultats, en passant par l’opérationnalisation, l’échantillonnage, les dispositifs d’enquête, l’analyse et la rédaction. La 6ᵉ édition a été révisée pour intégrer de nouveaux usages (ressources en ligne, exercices, corpus à analyser) et insiste sur l’“aller-retour” entre terrain et théorie.
Son apport décisif pour la licence : apprendre à problématiser et à transformer une idée initiale en protocole réaliste (qui ? quoi ? comment ? avec quelles contraintes éthiques ?), puis à rapporter ses résultats clairement. Les encadrés méthodologiques, check-lists et exemples d’outils (grilles d’entretien, plans d’observation) évitent les pièges classiques (questions trop larges, biais d’enquête, confusion variables/indicateurs).
Vous y puiserez aussi une méthode de prise de notes et de tenue d’un carnet de recherche, précieuse pour vos dossiers et mini-mémoires.
Comment l’utiliser ?
- Avant tout devoir “méthodo”, rédigez une fiche protocole (question, hypothèses, terrain, outils).
- Reprenez la check-list d’opérationnalisation pour vérifier vos indicateurs.
- Tenez un journal de terrain : dates, incidents, verbatims, décisions méthodo.
- Utilisez les modèles d’entretien pour écrire votre guide, puis testez-le en pilote.
- En fin de projet, suivez la grille de discussion : limites, biais, transférabilité, pistes.
5. L’analyse qualitative en sciences humaines et sociales (Armand Colin, 5ᵉ éd., 2021)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Véritable manuel de l’enquête qualitative, l’ouvrage couvre les fondements épistémologiques et surtout les gestes d’analyse : préparation du terrain, recueil (observations, entretiens), choix d’un corpus, codage, catégorisation, analyses thématique et structurale, écriture des résultats.
L’intérêt pour une licence tient à son double niveau : d’un côté, une vision conceptuelle claire (ce que “faire parler” des données veut dire) ; de l’autre, des procédés opératoires (du carnet de terrain au tableau de codes) illustrés par des exemples. Le livre montre comment passer du verbatim à la conceptualisation sans perdre la rigueur (triangulation, saturation, validation), et comment équilibrer littératie méthodo et sens du terrain.
Les chapitres sur l’écriture sont particulièrement utiles pour apprendre à construire un résultat “lisible” (extraits situés, catégories motivées, limites explicites). En licence, il vous aidera à argumenter des choix (type d’entretien, posture d’observation), à structurer des analyses et à documenter vos décisions — attente fréquente des jurys.
Comment l’utiliser ?
- Créez un codebook évolutif (définitions, exemples, contre-exemples).
- Travaillez par cycles courts : coder → comparer → reformuler → valider auprès d’un pair.
- Insérez 2–3 verbatims “ancrages” pour chaque catégorie lors de la rédaction.
- Tenez une audit trail (chronologie des choix, versions de codes, mémos).
- Ajoutez un paragraphe “qualité” : triangulation, saturation, réflexivité.
6. Méthodes statistiques en sciences humaines (De Boeck Supérieur, 3ᵉ éd., 2024)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Conçu pour des publics non spécialistes, ce classique actualisé développe pas à pas les statistiques au service des questions de recherche en SHS : description (tendances centrales, dispersion, visualisations), inférence (tests, intervalles de confiance), comparaisons (t, khi², ANOVA), régressions (linéaire, logistique), puissance et taille d’échantillon, sans oublier un chapitre d’initiation à la méta-analyse.
L’ouvrage se distingue par ses exemples contextualisés, ses nombreux graphiques et ses exercices progressifs ; il relie constamment choix de test et structure de la question (variables, plan, hypothèses). Pour la licence, c’est le compagnon idéal pour passer “de l’intuition au calcul” : comprendre ce que mesure un indicateur, vérifier des conditions d’application, interpréter proprement une valeur p et une taille d’effet, présenter un tableau clair et éviter les pièges (p-hacking, confusion corrélation/causalité).
Les encarts pratiques (démos SPSS, rappels algorithmiques) offrent un double accès : compréhension conceptuelle et mise en œuvre. À utiliser autant pour réviser avant partiels que pour outiller votre mini-enquête.
Comment l’utiliser ?
- Faites une fiche “choix de tests” par type de variables et plan expérimental.
- Rejouez 2 exercices par chapitre en expliquant vos étapes à voix haute.
- Pour vos dossiers, rapportez toujours statistique du test + ddl + p + taille d’effet + IC.
- Tenez une liste d’arguments “interprétation prudente” (biais, puissance, limites de l’échantillon).
- Reproduisez un graphique du livre avec vos données pour vérifier votre compréhension.
7. Apprendre… oui, mais comment (ESF, rééd. 2017)
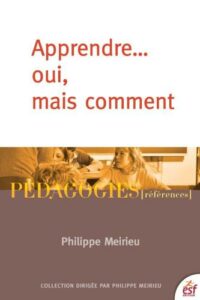
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Texte devenu “classique” de la pensée pédagogique francophone, ce livre explore l’acte d’apprendre en déconstruisant illusions, routines et injonctions : motivation, attention, relation pédagogique, stratégies d’étude, aide méthodologique, différenciation. Ce n’est pas un recueil d’astuces, mais une réflexion opérationnelle : récits d’expériences, cas commentés, tableaux d’outils (aide à l’anticipation des tâches, construction de consignes, organisation de l’autonomie), qui montrent comment tenir ensemble exigence et bienveillance.
Pour la licence, l’ouvrage ouvre un pont entre savoirs académiques et gestes professionnels : il aide à analyser une situation de classe (quels obstacles ? quelles médiations ? quelle place donnée à l’erreur ?) et à en tirer des principes de conception (activités, étayage, régulation). Son approche de la différenciation — distinguer groupes de besoin et niveaux, penser les supports et la temporalité — outille les stages et les dossiers orientés “pratiques”. C’est aussi une excellente source pour travailler l’écriture réflexive : à partir d’une vignette, repérer représentations, hypothèses et décisions.
Comment l’utiliser ?
- Choisissez un chapitre et transformez-le en grille d’observation pour votre stage.
- Construisez une “boîte à outils” personnelle (fiches d’aide, grilles d’auto-évaluation, routines).
- Rédigez une vignette réflexive : situation → analyse → hypothèses → actions → bilan.
- En TD, organisez un débat contradictoire autour d’une notion (motivation, autonomie, sanctions).
- Testez une micro-séquence inspirée du livre et auto-évaluez-la avec un pair.
8. L’évaluation des élèves – De la fabrication de l’excellence à la régulation des apprentissages (De Boeck, 1997)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Indispensable pour comprendre pourquoi et comment on évalue, ce bouquin distingue deux logiques : l’évaluation certificative/stratificatrice (qui classe, oriente, sélectionne) et l’évaluation formative (qui informe l’apprentissage et régule l’enseignement). À partir de textes fondateurs et d’analyses de pratiques, il met au jour les effets systémiques des notes, les biais (effet de halo, attentes, normes implicites), les tensions entre justice et efficacité, et les conditions d’une évaluation au service des progrès : explicitation des critères, observation outillée, rétroactions constructives, pédagogie différenciée.
Pour un étudiant, c’est une clé pour articuler savoirs théoriques et gestes concrets : écrire des critères lisibles, séparer retour formatif et jugement certificatif, varier les modes de recueil (traces, oraux, productions), penser la place de l’auto- et co-évaluation. Le livre éclaire aussi les politiques d’évaluation (standardisée vs. classe) et aide à parler l’évaluation de façon argumentée dans vos écrits — sujet fréquent d’examens et de dossiers.
Il constitue enfin une base solide pour concevoir des outils d’évaluation cohérents avec les objectifs d’apprentissage et pour analyser leurs effets réels sur les progrès des élèves.
Comment l’utiliser ?
- Construisez une typologie des situations d’évaluation (diagnostique, formative, sommative, certificative).
- Réécrivez une consigne avec critères et indicateurs observables.
- En stage, testez une grille critériée et analysez la qualité des rétroactions produites.
- Rédigez un court essai : “Pourquoi la note ne suffit pas — et quand elle est nécessaire”.
- Faites un audit de vos évaluations (validité, fidélité, effets sur les apprentissages).
9. Dictionnaire de l’éducation (PUF, 2ᵉ éd., 2017)
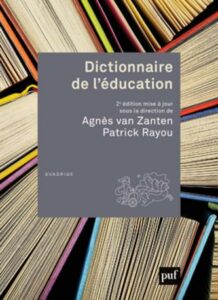
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Outil de travail quotidien, ce dictionnaire réunit plusieurs centaines d’entrées rédigées par des spécialistes (concepts, méthodes, institutions, dispositifs) et propose des définitions stabilisées, des repères historiques, des enjeux contemporains et des bibliographies capées.
En licence, c’est un gain de temps précieux : clarifier un terme avant un TD, situer une notion (compétence, différenciation, socialisation, curriculum, inclusion, évaluation standardisée), ou vérifier l’usage exact d’un concept avant de rédiger. Sa structure permet une lecture “à la demande”, mais aussi des parcours thématiques (évaluation, politiques éducatives, métiers, gouvernance, comparaisons internationales).
C’est un excellent support pour doter vos écrits académiques d’un vocabulaire précis et référencé, éviter les contresens et préparer les introductions. À garder à portée de main lorsqu’un enseignant prononce un mot-clef… et à utiliser pour nourrir la partie “cadre conceptuel” de vos dossiers.
Comment l’utiliser ?
- Avant chaque devoir, listez 5 mots-clés et vérifiez leurs définitions savantes.
- Construisez un glossaire personnel (définition → exemple → référence).
- Parcourez une famille d’entrées (ex. “inégalités”) pour enrichir votre problématique.
- Rebondissez depuis une entrée vers 1–2 sources citées pour étoffer votre bibliographie.
- En oral, servez-vous des définitions courtes comme accroches introductives.
Conseils de méthode additionnels
- Faites dialoguer les livres : par exemple, appuyez une dissertation avec Sociologie de l’école (cadre), un chapitre des Nouvelles politiques éducatives (instruments), et un passage d’Apprendre… (conséquences en classe).
- Fichez stratégiquement : 10 lignes par chapitre (idée centrale, 3 notions, 1 piste méthodo, 1 référence). Accumuler n’est pas comprendre.
- Méthodisez votre semestre : 2 créneaux récurrents par semaine (1 “théorie”, 1 “méthodes”). Alternez qualitatif/quantitatif.
- Écrivez tôt, révisez tard : après chaque lecture, rédigez 8–10 lignes de synthèse dans vos mots. Avant l’examen, relisez vos propres fiches.
- Travaillez en binôme : explicitez vos raisonnements ; ce que vous savez expliquer, vous le savez pour de bon.
- Soignez la bibliographie : notez systématiquement auteur, année, édition, éditeur et ISBN ; vous gagnerez des points et… des heures.
Références
- ONISEP — Présentation de la licence Sciences de l’éducation et de la formation (contenus, approches, débouchés)
- Université Paris Cité — Licence Sciences de l’éducation et de la formation : présentation et parcours
- Université Lumière Lyon 2 (ISPEF) — Licence Sciences de l’éducation et de la formation : objectifs et programme
- Université Toulouse — Jean Jaurès — Licence Sciences de l’éducation et de la formation : programme et modalités
- Université de Bordeaux — Formations en Sciences de l’éducation




