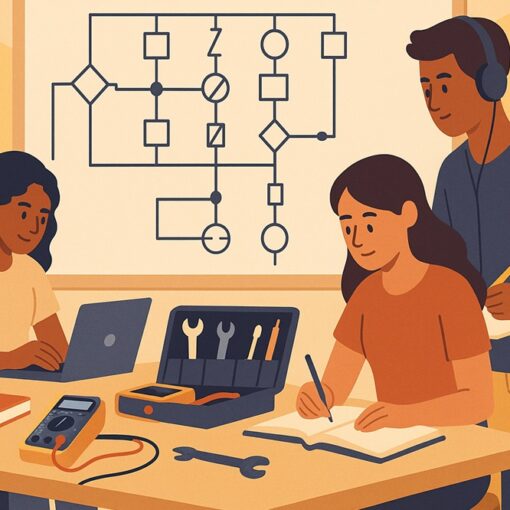Réussir sa licence de philo ne consiste pas à empiler des noms, mais à apprendre à penser par problèmes, à lire patiemment des textes parfois rugueux et à écrire avec une clarté qui rende justice aux arguments. Cette exigence suppose une méthode : des repères solides pour situer les doctrines, un vocabulaire précis pour éviter les contresens, des œuvres canoniques pour forger le jugement.
La sélection qui suit réunit des livres qui jouent à la fois le rôle de boussole (panoramas, dictionnaires, manuels) et d’atelier (textes à commenter, outils logiques, dossiers critiques). L’ordre retenu est progressif : des repères généraux vers les instruments d’argumentation, puis vers les œuvres majeures à fréquenter tout au long de la licence.
L’objectif n’est pas d’« avoir lu » plus, mais de mieux lire, mieux raisonner, mieux écrire, cours après cours.
1. Histoire de la philosophie (PUF, 2ᵉ éd. revue, 2012)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Conçu comme une traversée continue des penseurs, des écoles et des problèmes, l’ouvrage d’Émile Bréhier est le compagnon idéal pour structurer vos connaissances. En un volume dense, l’auteur déroule une chronologie claire – des Présocratiques aux années 1940 – et restitue l’économie interne des doctrines sans sacrifier la nuance.
Ce livre vaut moins comme encyclopédie exhaustive que comme architecture d’ensemble : on y comprend comment se posent et se transforment les questions (être, connaissance, langage, éthique, politique…), comment se répondent les courants, et où situer chaque œuvre étudiée en TD. La prose, nette et pédagogique, rend accessibles des pans réputés austères (métaphysique médiévale, idéalisme allemand).
Pour une licence, son atout décisif est de relier la lecture d’un texte à une histoire des problèmes, ce qui aide à construire des copies qui dépassent le simple commentaire. On y revient sans cesse : avant d’aborder un auteur, après un cours pour consolider, ou lors des révisions pour cartographier rapidement un champ. C’est la charpente sur laquelle accrocher dictionnaires, monographies et fiches.
Comment l’utiliser ?
- Avant chaque cours sur un auteur, lisez l’encart biographique et la synthèse doctrinale.
- Repérez 2–3 idées directrices et notez-les en marge de vos cours.
- En révision, reconstituez les lignes de filiation (ex. Platon → Plotin → Augustin).
- Pour une dissertation, utilisez Bréhier pour formuler l’état du problème à l’époque étudiée.
- Faites une fiche « époque → auteurs → thèses » à partir des chapitres.
2. Dictionnaire philosophique (PUF, éd. actualisée, 2021)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Ni simple lexique, ni doctrine figée : le dictionnaire d’André Comte-Sponville propose des entrées thématiques (Amour, Devenir, Éthique, Vérité…) écrites dans une langue limpide, souvent illustrées d’exemples et de contre-exemples. Sa force est double : il clarifie vite une notion quand vous butez sur un sujet et il aiguise votre style, tant la concision argumentative de l’auteur donne de bons réflexes de rédaction.
On apprécie surtout la capacité du livre à articuler définitions précises et enjeux : ce que change tel concept dans une démonstration, comment s’imbriquent distinctions et exemples. Utilisé à petite dose mais très régulièrement, il nourrit l’introduction et la conclusion de vos dissertations, ou débloque une transition.
Ce n’est pas un manuel d’histoire de la philosophie : l’auteur engage parfois son point de vue. Mais c’est aussi l’intérêt du livre : apprendre à penser avec et contre, à situer une thèse. Pour une licence, il devient vite une trousse d’urgence conceptuelle, autant qu’un laboratoire de style.
Comment l’utiliser ?
- Avant/pendant un devoir, lisez 1–2 entrées clés pour poser des définitions opératoires.
- Notez les exemples qui éclairent une distinction ; réutilisez-les en copie.
- Croisez chaque entrée avec un auteur au programme (ex. « Temps » ↔ Aristote, Augustin, Bergson).
- Constituez un glossaire personnel : recopiez la définition, puis reformulez-la.
- En révisions, faites des cartes mentales reliant 4–5 entrées par problématique.
3. Vocabulaire technique et critique de la philosophie (PUF, 2010)
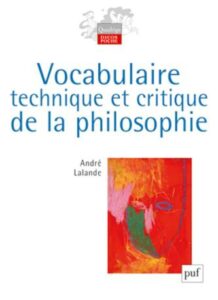
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Surnommé « le Lalande », ce monument de la lexicographie philosophique est l’outil pour ne pas confondre sens courant et sens technique. Chaque article distingue les acceptions, relève les ambiguïtés, signale l’histoire d’un terme, cite des usages et met en garde contre les contresens.
À l’université, où l’on évalue votre précision conceptuelle, il évite des fautes coûteuses (par exemple, employer « métaphysique », « phénomène » ou « transcendantal » à contresens). Le livre n’est pas un manuel de méthodologie, mais il forme à la rigueur : définir exactement ce que l’on avance, choisir le bon mot et l’assumer dans un argument.
À l’usage, on s’y rend pour éclaircir un point ponctuel, puis l’on découvre que nombre d’entrées résonnent entre elles : le vocabulaire dessine une cartographie des disputes philosophiques. Indispensable pour les dossiers, exposés, dissertations longues et mémoires de L3.
Comment l’utiliser ?
- Quand un terme vous résiste, lisez l’entrée entière et notez la définition à retenir.
- Ajoutez dans vos fiches les variantes sémantiques selon les auteurs/époques.
- Repérez les « pièges » (faux amis conceptuels) et faites-en une liste d’alerte.
- Ouvrez l’index pour élargir : quelles entrées voisines affinent votre propos ?
- Relisez les définitions clés avant une soutenance ou une épreuve écrite.
4. Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale (PUF, 4ᵉ éd. augmentée, 2004)
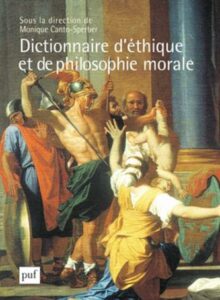
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
La licence comporte toujours une part substantielle d’éthique (normes, vertus, déontologie, conséquentialisme, justice…). Ce dictionnaire en deux volumes, dirigé par Monique Canto-Sperber, réunit des spécialistes et propose des articles problématisés plutôt que de simples notices.
Chaque entrée situe l’enjeu, rappelle la généalogie du concept, en expose la version « classique » et cartographie les débats contemporains (bioéthique, justice globale, droits, responsabilité…). C’est un outil hybride : répertoire de notions pour bâtir une introduction solide, mini-bibliographie raisonnée pour nourrir le développement, boussole pour orienter un dossier ou un exposé.
Exigeant, mais hautement rentable dès la L2 : il aide à transformer un sujet moral trop général en problème ciblé, avec thèses formalisées et objections nettes. Un accélérateur pour comprendre et argumenter avec méthode.
Comment l’utiliser ?
- Pour chaque devoir d’éthique, lisez 1–2 entrées nucléaires (ex. « justice », « autonomie »).
- Notez 3 références incontournables par entrée à réutiliser (auteurs, articles).
- Faites une fiche controverse : thèse, contre-thèse, distinction clef, exemple type.
- Reprenez les définitions normatives (déontologique/utilitariste/vertuiste) en une page.
- Avant l’oral, entraînez-vous à résumer une entrée en 2 minutes.
5. La logique (PUF, « Que sais-je ? », 3ᵉ éd., 2024)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
La réussite en philosophie demande des réflexes logiques : identifier un type d’argument, éviter un paralogisme, formuler une objection valable. Dans ce petit volume, Pierre Wagner expose les basiques de la logique contemporaine (validité, langage formel, connecteurs, quantificateurs) et montre comment la logique travaille au contact de la philosophie du langage, des sciences cognitives et de l’informatique.
Le propos est clair, serré, illustré, et convient parfaitement à un entraînement régulier. L’intérêt, pour une licence, est immédiat : apprendre à traduire des énoncés ordinaires en structures logiques, à tester la solidité d’une thèse, à distinguer valide et vrai, à repérer les inférences fautives (pétition de principe, faux dilemme, etc.).
Le livre fonctionne comme un atelier d’argumentation qui professionnalise votre écriture : chaque sous-section suggère des gestes reproductibles (poser des hypothèses, déployer une conséquence, vérifier une contradiction). Compact et à jour, il se glisse dans le sac pour des révisions express.
Comment l’utiliser ?
- Faites 15–20 minutes d’exercices deux fois par semaine (traductions, tables de vérité).
- Construisez une check-list d’argumentation (validité, pertinence, objection, reformulation).
- Réécrivez un paragraphe de dissertation en éliminant toute ambiguïté logique.
- Tenez un carnet de sophismes rencontrés en lectures/cours, avec correction.
- À l’oral, schématisez vos arguments (⇒, ↔, ∀, ∃) pour gagner en clarté.
6. La République (Flammarion, 2016)
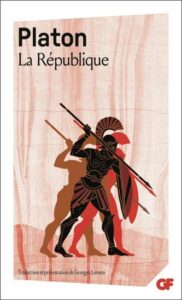
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Texte-monde où se rencontrent justice, connaissance, politique et éducation, La République de Platon demeure un pivot de la formation philosophique. L’édition GF propose une traduction soignée, une introduction substantielle, des notes riches, et un dossier critique permettant de situer la portée du dialogue : théorie des Formes, allégorie de la caverne, mathêmata, rôle des gardiens, critique de la démagogie.
Pour l’étudiant, le livre apprend à lire un dialogue : repérer les interlocuteurs, distinguer les moments dialectiques, suivre la montée en généralité jusqu’aux thèses centrales (idée de Bien, tripartition de l’âme, cité juste). La contemporanéité du texte frappe : rapports entre savoir et pouvoir, manipulation des images, éducation, place des arts – autant de thèmes qui nourrissent dissertations et exposés.
L’édition GF, avec ses repères, rend praticable une œuvre longue ; elle invite à croiser Platon avec Aristote, Machiavel, Rousseau, Rawls, ou les critiques modernes de l’utopie. Indispensable pour apprendre à argumenter depuis un texte et pour prendre la mesure de ce que « penser politiquement » veut dire.
Comment l’utiliser ?
- Lisez livre par livre, en résumant en 10 lignes l’avancée de l’argument.
- Faites un tableau des personnages et rôles dialectiques.
- Relevez 5 passages-nœuds (caverne, soleil, ligne, mythe d’Er…) avec explication.
- Constituez un lexique platonicien (Forme, doxa/épistémè, mimèsis…).
- En dissertation politique, mobilisez des distinctions platoniciennes pour poser le problème.
7. Méditations métaphysiques – Objections et réponses (Flammarion, 2011)
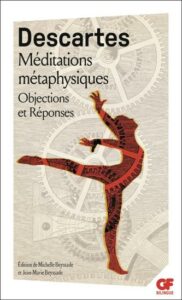
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Texte fondateur de la modernité, les Méditations de René Descartes mettent en scène une méthode (le doute, l’évidence, l’intuition), une ontologie (la substance pensante, l’existence de Dieu, la distinction âme/corps) et une épistémologie (critères de vérité). L’édition GF réunit le texte latin et la traduction française, avec un appareil critique et les Objections & Réponses qui montrent la philosophie en discussion.
Pour un étudiant, l’ouvrage est une école de lecture fine : suivre une démonstration, repérer une présupposition, anticiper une objection. Il aide aussi à écrire : l’économie cartésienne (définitions, preuves, corollaires) offre un modèle d’argumentation.
La mise en scène du « je » méditant éclaire la différence entre méthode subjective et portée objective des thèses. Enfin, le volume permet de tisser des ponts vers Malebranche, Spinoza, Leibniz, Hume, Kant… Une édition annotée qui rend ce classique exigeant abordable et productif pour dossiers et examens.
Comment l’utiliser ?
- Lisez une Méditation par séance, en isolant thèse, argument, objection interne.
- Reconstituez la chaîne des évidences (du doute à la certitude).
- Fichez 5 définitions-clé (substance, idée, évidence, clarté/distinction, erreur).
- Comparez la démonstration dans le texte et la réponse aux Objections.
- Entraînez-vous à paraphraser un passage en 8–10 lignes logiquement ordonnées.
8. Fondation de la métaphysique des mœurs (Flammarion, 2024)
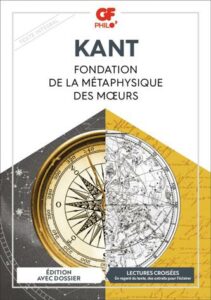
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Court traité, difficulté maximale, puissance conceptuelle rare : la Fondation (ou Fondements) formalise la morale du point de vue de la raison (impératif catégorique, universalisation, autonomie, fin-en-soi). L’édition récente offre un texte net et un dossier actualisé, précieux pour l’entrée dans Kant : repères terminologiques (impératif / hypothétique), transitions clefs (de l’usage commun de la raison morale à sa systématisation), enjeux (dignité, liberté, devoir).
À l’université, l’ouvrage est incontournable : il entraîne à argumenter par principes et à distinguer « agir conformément au devoir » et « agir par devoir ». Il est aussi fécond pour l’éthique appliquée : médecine, droit, écologie, IA…
La lecture demande de la patience ; mais, bien guidée, elle devient structurante pour tout le cursus. Astuce : lire d’abord la Préface et la Section II, puis revenir à la Section I pour voir comment Kant passe de l’expérience morale ordinaire à la forme universelle de la loi.
Comment l’utiliser ?
- Lisez la Section II en premier (formulation de l’impératif catégorique).
- Fichez les trois formulations (loi universelle, fin en soi, autonomie) avec exemples.
- Faites un tableau des distinctions (devoir / inclination, maxime / loi…).
- En éthique appliquée, testez vos cas par universalisation de la maxime.
- Relisez la Préface pour situer le projet (méthode, place de la métaphysique).
Quelques conseils de méthode
- Alternez « ressources » et « textes » : un chapitre de Bréhier ou du Canto-Sperber prépare, puis vous lisez le texte (Platon/Descartes/Kant) en profitant des notes.
- Fichez systématiquement (définitions + schémas d’arguments). Une bonne fiche vaut mieux qu’une lecture survolée.
- Entraînez la logique : 20 minutes régulières avec Wagner améliorent concrètement plans et transitions.
- Travaillez à plusieurs : répartissez lectures et croisez vos fiches pour densifier vos copies.
- Écrivez souvent : courts paragraphes argumentés, reformulations, micro-commentaires — le style se travaille.
Références
- Onisep — Licence mention philosophie : programme, objectifs et débouchés
- Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne — Licence Philosophie : contenus et parcours
- Sorbonne Université — Licence Philosophie : présentation et programme
- Persée — Portail de revues et publications scientifiques (accès libre)
- OpenEdition Journals — Revues de philosophie (sélection par discipline)
- PhilPapers — Index et bibliographie en philosophie
- Gallica (BnF) — Textes et sources primaires en accès libre