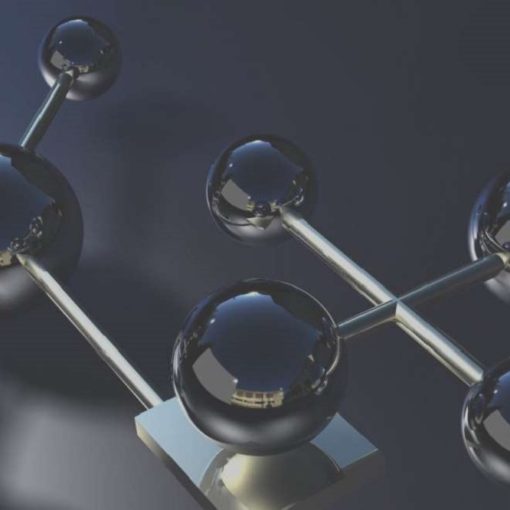La licence « information-communication » est une formation-pivot : elle fait dialoguer des savoirs théoriques (modèles de la communication, sociologie des médias, sémiotique, histoire des idées) avec des compétences très concrètes (mener une enquête, analyser un corpus, construire un plan de communication, lire les dispositifs numériques). Pour ne pas se perdre dans cette diversité, il faut une petite bibliothèque de base : quelques livres bien écrits qui vous donnent les cadres, les méthodes, les bons exemples.
La sélection qui suit réunit des références francophones reconnues dans les filières info-com. Elles couvrent le cœur de la discipline (origines, objets, méthodes), puis ses principaux terrains (médias, image, communication des organisations). L’idée n’est pas de tout lire d’un bloc, mais d’avoir sous la main les bouquins vers lesquels revenir à chaque TD, à chaque dossier, à chaque partiel.
1. Histoire des théories de la communication (La Découverte, 4ᵉ éd., 2018)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Ce petit « Repères » a l’épaisseur des grands manuels : Armand et Michèle Mattelart y déroulent la cartographie des pensées de la communication du XXᵉ siècle à nos jours. De Lasswell à la socio-sémiotique, des effets des médias aux Cultural Studies, des modèles mathématiques aux approches critiques, l’ouvrage rend lisibles les lignages, les controverses et les emprunts croisés.
En licence, c’est un excellent fil rouge pour comprendre ce qui relie des cours qui, de prime abord, paraissent disparates. Le mérite du livre tient à sa capacité à situer chaque courant dans son contexte (technique, politique, académique) et à montrer comment l’essor du numérique reconfigure des questions classiques : pouvoir des médias, publics, réception.
Ce n’est pas une « somme » encyclopédique, mais un guide d’orientation qui évite de perdre de vue l’ensemble quand on plonge dans un point précis.
Comment l’utiliser ?
- Construisez une ligne du temps des courants et associez-y vos cours.
- Fichez chaque chapitre en 5 points : idée-force, auteurs, concepts, méthode, limites.
- Avant un exposé, repérez où se place votre sujet dans l’histoire des théories.
- En partiels, citez 1–2 controverses situées (auteurs + période) pour gagner en densité.
2. Sciences de l’information et de la communication — Objets, savoirs, discipline (PUG, éd. actualisée, 2013)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Dirigé par Stéphane Olivesi, ce collectif PUG clarifie ce que recouvrent les SIC à la française : une interdiscipline qui pense ensemble information et communication. Le livre offre des panoramas synthétiques sur les grands objets étudiés au niveau licence : médias et publics, information-documentation, journalisme, communication publique et politique, organisations, médiation culturelle, TIC.
L’intérêt est double : vous obtenez une vue d’ensemble fiable (définitions, méthodes usuelles, biblios de départ) qui prépare à l’éclectisme de la L1–L3 ; chaque chapitre dessine aussi un paysage de recherche : qui travaille sur quoi, avec quels outils, et quelles questions vives (plateformisation, attention, datafication, participation, etc.). Un manuel d’orientation qui aide à relier vos TD à des cadres théoriques et à choisir un axe pour vos dossiers.
Comment l’utiliser ?
- Cartographiez vos cours : rattachez-les aux objets du sommaire.
- Pour chaque devoir, piochez 2 références de chapitre pour cadrer la problématique.
- Repérez les méthodes mobilisées (enquête, analyse, observation) pour inspirer vos TD.
- En L3, servez-vous-en pour délimiter un sujet de mémoire réaliste.
3. Méthodes empiriques de recherche en information et communication (De Boeck Supérieur, 2ᵉ éd., 2019)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Le manuel de Gérard Derèze est l’outil méthodologique le plus directement actionnable en licence. Il explique comment concevoir une enquête (question, hypothèses, terrain), puis déroule pas à pas observations, entretiens, questionnaires, en insistant sur les choix concrets : échantillonnage, guides, grilles, biais, éthique.
L’ouvrage se distingue par ses exemples contextualisés en info-com (journalisme, dispositifs médiatiques, organisations, espaces publics numériques), ses encadrés « check-list » et ses tableaux de synthèse qui, en fin de semestre, sauvent du flottement. Pour chaque outil, il discute les limites, les conditions de validité et la triangulation avec d’autres données (documents, traces numériques, images).
De quoi poser un terrain crédible en 48 h (guide d’entretien, canevas d’observation) et argumenter vos choix méthodologiques dans l’introduction d’un dossier.
Comment l’utiliser ?
- Avant tout terrain, faites la grille « objet → question → outil » proposée.
- Réutilisez les modèles de guides (entretiens/obs.) en les adaptant.
- Ajoutez une section « limites et biais » à tous vos rapports.
- Pensez triangulation : combinez au moins deux méthodes.
4. L’analyse de contenu (PUF, 2ᵉ éd., 2013)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Classique incontournable de Laurence Bardin, ce livre formalise l’analyse de contenu — qualitative et quantitative — comme instrument d’investigation applicable aux médias, aux réseaux sociaux, aux entretiens, aux affiches, etc. Bardin propose une démarche en trois temps : pré-analyse (corpus, hypothèses), codage/catégorisation (définitions opératoires, fiabilité), interprétation (retour à la problématique).
Pour la licence, c’est précieux : nombre de dossiers exigent un corpus balisé et un système de catégories défendable. L’ouvrage détaille l’analyse thématique, lexicale, catégorielle, et présente les questions de fiabilité inter-juge et d’outillage (du tableur aux logiciels).
Pour justifier une méthode d’analyse autrement que par l’intuition, Bardin fournit la grammaire et les critères qui rendent le traitement réplicable et argumenté.
Comment l’utiliser ?
- Construisez vos catégories à partir d’un questionnement (pas l’inverse).
- Testez votre codebook sur 10 % du corpus, puis révisez.
- Notez exemples et contre-exemples par catégorie.
- Croisez avec des verbatims d’entretiens pour dépasser la « quanti sèche ».
5. L’image et les signes — Approche sémiologique de l’image fixe (Armand Colin, 4ᵉ éd., 2011)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Martine Joly offre la meilleure initiation francophone à la sémiologie de l’image. L’ouvrage part des fondamentaux (signifiant/signifié, connotation/dénotation, ancrage/relai) et montre comment l’image produit du sens : cadrage, composition, lumière, couleur, typographie, dispositifs.
La force du livre tient à sa dimension opératoire : problématiser, découper l’image en unités pertinentes, décrire sans sur-interpréter, puis mettre en perspective (genres, usages, contextes). Pour les dossiers de licence (publicité, affiches institutionnelles, iconographie de presse, visuels de réseaux), c’est une boîte à outils qui évite les commentaires impressionnistes. Un manuel structuré pour passer de « je vois » à « je démontre » lorsqu’on analyse un visuel.
Comment l’utiliser ?
- Avant d’écrire, faites une description neutre → ensuite seulement l’interprétation.
- Dressez une check-list visuelle (cadrage, échelle, angles, couleurs, texte).
- Comparez trois images d’un même thème (analyse différentielle).
- Ajoutez une conclusion d’usages : qui voit, où, pour quoi faire ?
6. Sociologie du journalisme (La Découverte, 6ᵉ éd., 2024)
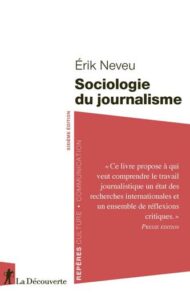
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
En « Repères », Érik Neveu livre une synthèse actualisée sur les métiers, organisations et contraintes du journalisme. Parfait pour les UE « médias », il aborde les trajectoires sociales des journalistes, les relations aux sources et aux propriétaires, la précarisation du travail, la standardisation des formats, ainsi que les effets de la plateformisation et des métriques.
Le livre dédramatise les clichés (« les médias font l’opinion ») en présentant des résultats de recherche : effets limités, médiations, publics actifs, enjeux d’éthique. Pour l’étudiant, c’est un cadre rigoureux pour analyser des cas (couvertures, crises, mouvements sociaux) sans tomber dans l’opinion brute. De quoi problématiser tout sujet touchant aux pratiques d’information.
Comment l’utiliser ?
- Avant une étude de cas, situez l’échelle (rédaction, titres, filières, plateformes).
- Repérez trois contraintes structurelles qui pèsent sur votre cas (temps, économie, métriques).
- Mobilisez un concept par section (gatekeeping, routines, champs) avec exemple sourcé.
- En conclusion, discutez effets vs réceptions.
7. Le plan de communication — Définir et organiser votre stratégie de communication (Dunod, 6ᵉ éd., 2023)
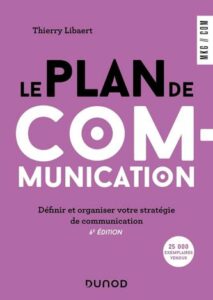
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Outil incontournable pour les TD « projet », Thierry Libaert structure l’art du plan de communication : diagnostic (audit, publics, cartographie des parties prenantes), objectifs, messages, canaux, calendrier, budget & évaluation, scénarios de crise, et désormais place des outils numériques.
La 6ᵉ édition intègre les retours d’expérience (crises récentes) et la montée de l’incertitude, en proposant des plans agiles et des tableaux de bord mesurables. Au niveau licence, ce manuel aide à passer du « quoi faire » au « comment » grâce à des modèles directement réutilisables en groupe. Un cadre méthodique et réaliste pour livrer un plan crédible, argumenté et évaluable.
Comment l’utiliser ?
- Commencez par un diagnostic chiffré (données + verbatims).
- Posez 2–3 objectifs SMART et alignez vos indicateurs.
- Construisez un calendrier avec marges et scénarios (plan B/C).
- Terminez par une évaluation (KPI, ROI et critères qualitatifs).
8. Communicator — Toute la communication à l’ère de l’IA (Dunod, 10ᵉ éd., 2025)
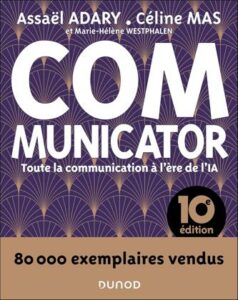
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Véritable manuel-univers (près de 700 pages), le Communicator accompagne depuis trente ans étudiants et praticiens. La 10ᵉ édition met l’accent sur trois bascules : IA générative & data, responsabilité (RSE) et nouveaux canaux d’influence. On y trouve des synthèses à jour (écosystèmes, réputation, influenceurs, communication interne, publique, événementielle).
La valeur ajoutée, côté licence : disposer d’un répertoire de bonnes pratiques (cas, templates) et de repères critiques : cadrage de l’IA (gouvernance, transparence), articulation communication/éthique, mesure de l’efficacité sans fétichisme des métriques. C’est aussi un excellent pont vers l’alternance : trames, livrables, vocabulaire professionnel. Un compendium pour transformer des connaissances de cours en plans actionnables, sans perdre la prudence méthodologique.
Comment l’utiliser ?
- Pour chaque projet, dupliquez un template (brief, calendrier, budget) et adaptez-le.
- Repérez trois risques IA (données, biais, droit) et proposez des garde-fous.
- Croisez les études de cas avec vos cours théoriques (effets, publics, réceptions).
- Faites un glossaire perso des notions pro (utile en entretien).
Conseils de travail additionnels
- Fichez intelligemment : 1 page par chapitre (problème → méthode → résultat → limites).
- Croisez théorie/méthode : toute idée citée doit être illustrée par un mini-terrain (ex. 10 posts codés, 2 entretiens, 1 affiche analysée).
- Citez sobrement mais précisément : auteur + année + page si vous citez/paraphrasez.
- Soignez les annexes : guides d’entretien, grilles de codage, tableaux de bord.
- Entraînez-vous à l’oral : 5 slides max, un message par slide, et toujours une slide « limites ».
Références
- Onisep : La licence information-communication (présentation nationale, débouchés et poursuites d’études)
- Onisep : Fiche « Licence mention information-communication » (organisation et programme type)
- SFSIC : Présentation de la discipline et de la société savante (repères, publications, événements)
- Université Rennes 2 : Programme de la Licence Information-Communication
- Université Bordeaux Montaigne : Licence Sciences de l’information et de la communication (catalogue et UE)
- Université Paris 8 – UFR Culture & Communication : Licence Information-Communication (présentation)