En licence, les attendus sont clairs : maîtriser les repères chronologiques et stylistiques, acquérir un vocabulaire précis, savoir problématiser et mobiliser des méthodes pour réussir le commentaire d’œuvre, la dissertation et l’exposé. Côté archéologie, le programme insiste sur la stratigraphie, la typologie, les datations et la compréhension de la chaîne « terrain → laboratoire → interprétation », sans oublier l’initiation aux sources et à la bibliographie scientifique.
La sélection ci-dessous colle à ces exigences : un panorama pour fixer les repères, des manuels de méthodes en histoire de l’art, un guide de méthodes en archéologie, un outil d’interprétation iconologique, un manuel chronologique « de travail » et un guide des sources primaires. Chaque bouquin est accompagné d’une notice « Comment l’utiliser ? ».
1. Histoire de l’art (Phaidon, 2023)
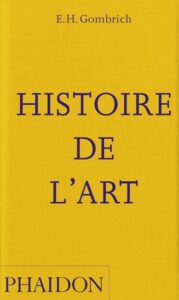
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Classique absolu, l’ouvrage d’Ernst H. Gombrich demeure l’une des introductions les plus claires à l’histoire de l’art, des premières images préhistoriques à l’époque contemporaine. Sa force n’est pas de « tout dire », mais de raconter l’art : enchaînement des traditions, métamorphoses des formes, raisons des ruptures. La récente édition de poche française réaffirme la vocation pédagogique du livre : texte fluide, reproductions en regard, repères chronologiques bien nets.
Pour la licence, son apport majeur est de relier styles et contextes sans jargon : il offre un socle sûr pour réviser les grandes périodes, préparer les commentaires d’œuvres et situer rapidement un artiste. On y apprend à reconnaître des continuités (héritages antiques, relances renaissantes) et des fractures (modernités, avant-gardes) sans perdre de vue les enjeux de réception.
Ce manuel n’est pas un livre de fiches mais une vision d’ensemble sur laquelle greffer vos cours et vos méthodes. Lisez-le comme un fil directeur : vous y reviendrez avant chaque partiel pour ancrer dates, œuvres phares et notions qui ordonnent la discipline.
Comment l’utiliser ?
- Lire en continu les chapitres de votre période d’option, puis parcourir les transitions pour saisir les continuités.
- Ficher 10 à 15 œuvres « phares » par chapitre : date, matériau, musée, 3 idées-clés.
- Repérer le vocabulaire récurrent (style, école, influence) et le réutiliser dans vos copies.
- Recouper chaque chapitre avec votre CM/TD pour enrichir les exemples.
- Avant un partiel, tracer une ligne du temps à partir des titres de chapitres.
2. Histoire de l’art – Théories, méthodes et outils (Armand Colin, 2e éd., 2023)
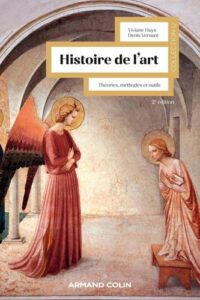
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Ce manuel de Viviane Huys et Denis Vernant est la boîte à outils méthodologique indispensable pour comprendre ce que « faire de l’histoire de l’art » signifie aujourd’hui. Il présente les grands cadres d’analyse : approche formaliste, iconographie et iconologie, sémiotique, anthropologie, sociologie, esthétique, sans oublier la réception des œuvres et les questions d’empathie et de perception.
La nouvelle édition actualisée, structurée pour le premier cycle, propose définitions nettes, mini-bibliographies actionnables et exemples d’applications. Point décisif : elle apprend à choisir une méthode et à la justifier selon l’objet (peinture, sculpture, photo, architecture) et selon la question (forme, sens, usage, circulation). C’est exactement ce que l’on attend d’un commentaire composé ou d’un dossier bien mené en L1–L2.
Ce livre n’impose pas une école ; il offre un répertoire de gestes intellectuels à mobiliser. Utilisé régulièrement, il transforme la prise de note en stratégie d’enquête : question → corpus → méthode → résultats, avec des garde-fous pour éviter les contresens.
Comment l’utiliser ?
- Lire l’introduction puis une méthode par semaine ; l’illustrer avec une œuvre vue en TD.
- En commentaire, annoncer l’angle (ex. iconologie) et citer une notion du manuel.
- Constituer un glossaire personnel : 30 mots définis en 3 lignes chacun.
- Pour un exposé, reprendre les schémas d’argumentation proposés.
- En révisions, dresser un tableau « méthode → questions typiques → pièges à éviter ».
3. L’histoire de l’art – Objet, sources et méthodes (Presses Universitaires de Rennes, 2015)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Guillaume Glorieux propose un panorama réflexif sur la discipline : comment s’est-elle constituée depuis la Renaissance ? Où se situent ses frontières avec la critique, l’archéologie, l’histoire sociale et économique de l’art ? Qu’appelle-t-on « source » pour l’historien de l’art ? Le livre pose des fondamentaux épistémologiques clairs, indispensables pour éviter les confusions fréquentes en début de cursus.
Conçu pour le premier cycle, l’ouvrage cartographie les types de sources (textes, images, archives), explique leur traitement, et montre l’apport des sciences humaines (philologie, sociologie, anthropologie) à la méthode. Il aide à comprendre la place des acteurs : chercheurs, conservateurs, marché de l’art, institutions, publics ; autant d’éléments que l’on retrouve dans les sujets d’exposés et d’essais.
À la croisée du manuel et de l’essai, il apprend à penser sa pratique : formuler une question précise, constituer un corpus, annoncer une méthode, et discuter les limites de l’enquête. Un compagnon sobre, mais précieux, pour structurer vos travaux écrits et vos introductions problématisées.
Comment l’utiliser ?
- Le lire en tout début d’année pour cadrer vocabulaire et attentes.
- Ficher les catégories de sources et noter des exemples (musées/archives locaux).
- Tester une même œuvre avec deux approches (forme vs. contexte) et comparer.
- Reprendre le plan « question → corpus → méthode → résultats » dans vos dossiers.
- S’en servir pour écrire l’introduction problématisée de vos commentaires.
4. Guide des méthodes de l’archéologie (La Découverte, 4e éd. augmentée, 2020)
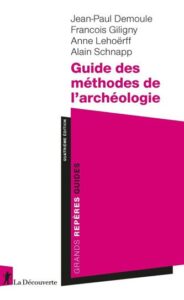
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Coordonné par Jean-Paul Demoule, François Giligny, Anne Lehoërff et Alain Schnapp, ce manuel couvre l’archéologie de A à Z : histoire de la discipline, prospection, fouille et enregistrement stratigraphique, typologie, datations, paléoenvironnements, interprétation, valorisation, et cadre légal. La 4e édition, actualisée et illustrée, intègre l’archéologie numérique, les SIG, les protocoles de conservation et les nouvelles pratiques de médiation.
Pour l’étudiant en histoire de l’art et archéologie, il montre comment naît une donnée matérielle : du terrain au laboratoire puis à l’interprétation. Comprendre cette chaîne est crucial pour lire les objets, discuter leurs contextes et éviter les anachronismes d’usage ou de datation. Les chapitres sur la France (institutions, archéologie préventive, métiers) répondent très concrètement aux attentes de stages et de rapports.
Dense mais clair, ce guide devient une référence durable : on y pioche des procédures, des schémas et des check-lists pour transformer l’observation en argument. Idéal pour articuler techniques, contextes et récits archéologiques dans vos dossiers.
Comment l’utiliser ?
- Avant une fouille-école, lire les chapitres stratigraphie et enregistrement.
- Faire des fiches-méthodes (prospection, typologie, datation) avec schémas.
- Appliquer les grilles de description du mobilier à un lot d’objets de TD.
- Relier la chaîne opératoire aux cours d’histoire des techniques.
- Relire « archéologie dans la société » pour vos dossiers pro.
5. Archaeology – Theories, Methods and Practice (Thames & Hudson, 9th ed., 2024)
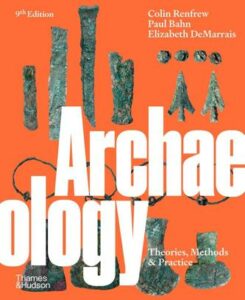
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Le manuel mondialement utilisé de Colin Renfrew et Paul Bahn demeure la synthèse la plus complète et la plus pédagogique sur la théorie, les méthodes et les applications de l’archéologie à l’échelle globale. La 9e édition actualise des sections clés : archéologie indigène, approches post-coloniales, ontologies, patrimoine immatériel, archéologie historique, et enjeux éthiques de la protection.
Très illustré et riche en études de cas, l’ouvrage relie avec clarté technique et interprétation : du lidar à l’analyse spatiale, des datations à la culture matérielle, chaque chapitre montre comment passer des données aux hypothèses solides. Pour un cursus combinant histoire de l’art et archéologie, il offre le regard comparatif parfois absent des manuels francophones : diversité des terrains, des chronologies et des traditions académiques.
Oui, c’est en anglais ; mais la rédaction limpide, les schémas et encadrés en font un investissement très rentable du L1 au M1. C’est aussi une excellente porte d’entrée vers la littérature scientifique internationale grâce aux bibliographies « Further reading » à la fin de chaque thème.
Comment l’utiliser ?
- Lire une étude de cas par thème (prospection, datation, interprétation).
- Tenir un lexique bilingue des mots techniques vus en TD.
- Pour un exposé, reprendre la structure « question → données → méthode → conclusion ».
- Comparer ses exemples avec les contextes français de vos cours.
- Utiliser les « Further reading » pour bâtir vos bibliographies.
6. Essais d’iconologie – Thèmes humanistes dans l’art de la Renaissance (Gallimard, rééd. 2021)
![]()
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Classique de méthode, le livre d’Erwin Panofsky formalise l’iconologie : au-delà de l’identification des motifs (iconographie), il s’agit d’interpréter les œuvres comme produits d’une culture de pensée (humanisme, néoplatonisme, mythographie). La réédition française propose une présentation et des notes qui facilitent l’appropriation en licence.
Pour l’étudiant, Panofsky n’est pas seulement à « citer » : il enseigne l’art de lier textes et images, d’articuler niveau descriptif, niveau thématique et niveau intrinsèque, et d’étayer une hypothèse par des sources. C’est l’ouvrage idéal pour transformer un commentaire descriptif en lecture problématisée, particulièrement en cours sur la fin du Moyen Âge et la Renaissance.
On y apprend une logique de preuve : repérage des motifs, contextualisation érudite, et démonstration graduée. Utilisé tôt, il devient un modèle de raisonnement que l’on adapte ensuite à d’autres périodes et objets.
Comment l’utiliser ?
- Lire l’introduction puis un essai relié à votre CM Renaissance.
- En commentaire, annoncer vos trois niveaux : pré-iconographique, iconographique, iconologique.
- Aller chercher un texte humaniste (Ovide, Ficin…) pour étayer l’interprétation.
- Constituer une banque d’allégories (Temps, Fortune, Mélancolie…).
- Comparer Panofsky à une lecture formaliste pour mesurer les écarts.
7. Manuel d’histoire des arts – De l’Antiquité au XXIe siècle (Ellipses, 2021)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Ce manuel de Maylis Poulot-Cazajous propose une progression chronologique compacte, de l’Antiquité au XXIe siècle, jalonnée de 44 études de cas méthodiquement conduites (contexte, description, enjeux, bibliographie). Pensé pour le premier cycle, il mêle lignes de force (mouvements, notions) et zooms analytiques qui entraînent au commentaire composé.
Les textes sont clairs, les repères visuels nombreux, et le cadre occidental assumé tout en s’ouvrant à des corpus moins attendus. Très utile pour réviser rapidement avant un partiel thématique (portrait, paysage, avant-gardes), l’ouvrage permet aussi de s’exercer à la problématisation en piochant des questions dans chaque étude.
Complémentaire de Gombrich, il sert de manuel de travail : fichable, exploitable, et adapté au rythme soutenu de la licence. Sa structure récurrente en fait un excellent support pour bâtir des plans d’exposés et des dossiers illustrés.
Comment l’utiliser ?
- Alterner chapitres de synthèse et études de cas pour entraîner l’analyse.
- Refaire chaque étude avec une œuvre proche mais différente (musées en ligne).
- Préparer des QCM maison à partir des encadrés pour réviser en binôme.
- Tenir une frise par siècle ; la compléter à chaque lecture.
- En fin de chapitre, noter deux « ouvertures » (comparaisons, postérité).
8. Guide des sources de l’histoire de l’art aux Archives nationales et aux Archives de Paris (CTHS, 2012)
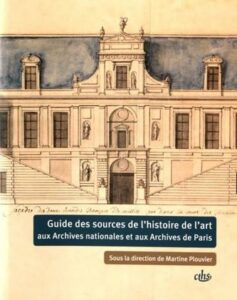
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Dirigé par Martine Plouvier, ce guide volumineux oriente dans le labyrinthe des fonds publics et privés utiles à l’histoire de l’art : Archives nationales (Ancien Régime, modernes, contemporaines), Minutier central des notaires, archives d’architectes, photographies, cartes et plans, manuscrits enluminés, collections sigillographiques, etc.
À l’heure où l’on valorise les travaux fondés sur des sources primaires, il devient un précieux allié pour préparer un mémoire ou un exposé : il indique où chercher, comment chercher, et quels types de documents existent pour un artiste, un chantier, un marché d’art. Le chapitre dédié aux Archives de Paris est particulièrement utile pour un terrain de proximité.
Ce n’est pas un manuel de méthode, mais un répertoire intelligemment problématisé qui fait gagner un temps considérable dès qu’il faut dépasser les compilations en ligne. À avoir sous la main dès la L2 pour structurer vos démarches en salle de lecture.
Comment l’utiliser ?
- Avant un dossier, cerner votre question puis explorer les chapitres correspondants (ex. fonds d’architectes).
- Noter les cotes types à demander en salle de lecture.
- Croiser avec les inventaires en ligne des Archives nationales/Archives de Paris.
- Repérer les documents figurés (photos, plans) exploitables en iconographie.
- Tenir un journal de recherche (cotes consultées, résultats, pistes).
Conseils de travail supplémentaires
- Fichez chaque ouvrage avec : 5 idées-clés, 3 notions, 2 citations utiles, 1 limite.
- Variez les exercices : commentaire comparé, analyse de technique, étude de réception.
- Construisez une bibliographie vivante en ajoutant chaque semaine un article (revue, catalogue) à votre corpus.
- En archéologie, reliez systématiquement chaîne opératoire et contextes : une donnée n’a de sens que replacée (stratigraphie, datation, environnement).
- Enfin, conjuguez ces lectures avec des visites et des musées en ligne (zoom haute définition) pour garder l’œil au centre de votre apprentissage.
Références
- Programme et attendus — Licence Histoire de l’art et archéologie (Onisep)
- Fiche formation — Licence Histoire de l’art et Archéologie (Parcoursup, Univ. Paris 1)
- Fiche 2025–2026 (PDF) — Licence Histoire de l’art et archéologie (Université Paris 1)
- POP — Plateforme Ouverte du Patrimoine (Ministère de la Culture)
- AGORHA — Bases de données de l’INHA (histoire de l’art & archéologie)
- Persée — Portail de revues et publications scientifiques en SHS
- Gallica — Bibliothèque numérique de la BnF




