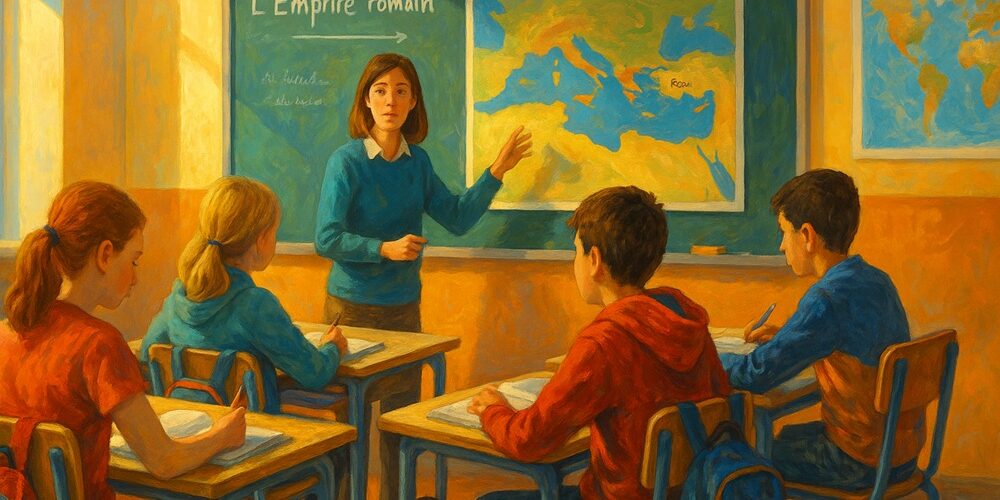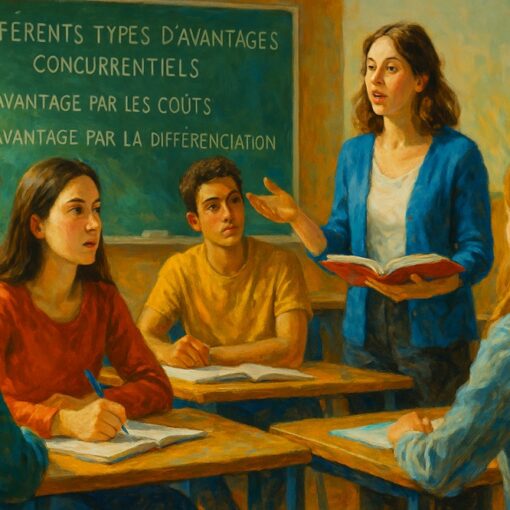En sixième, l’histoire-géographie devient une discipline à part entière : les élèves quittent la logique de « découverte du monde » de l’école primaire pour entrer dans un enseignement structuré, avec des chapitres, des évaluations régulières et des attentes nettement plus précises. Le programme de cycle 3 demande de savoir se repérer dans le temps et dans l’espace, de lire des cartes, des frises, et de rédiger de courts paragraphes explicatifs.
Cette marche peut sembler haute, surtout lorsqu’il faut mémoriser des repères (dates, lieux, personnages) tout en apprenant une méthode de travail rigoureuse. Beaucoup d’élèves peinent, par exemple, à raconter un épisode de l’Antiquité dans le bon ordre ou à comprendre ce qu’une carte essaie de montrer. La moyenne chute vite si l’on perd des points à la fois sur les connaissances et sur la méthode.
Un bon livre de soutien ne remplace pas le cours du professeur, mais il offre un cadre rassurant : exercices gradués, corrigés accessibles et rappels de méthode au moment où l’élève en a besoin. L’idée n’est pas d’ajouter des heures de travail, mais de transformer le temps de révision en séances courtes, efficaces, qui ciblent vraiment les difficultés.
1. Réussite collège – Histoire-Géographie 6e (Rue des écoles, 2023)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Pensé pour le travail à la maison, ce Réussite collège Histoire-Géographie 6e rassemble dans un format compact tout ce dont un élève a besoin pour reprendre confiance. Chaque double page traite une partie du programme en s’appuyant sur un rappel de cours très synthétique, immédiatement suivi d’exercices ciblés.
L’ouvrage couvre l’ensemble de la sixième : premières civilisations, Grèce et Rome, naissance des monothéismes, mais aussi les thèmes de géographie comme « Habiter une métropole » ou les espaces de faible densité. Les activités mobilisent cartes, frises, photographies et courts textes, ce qui aide à s’entraîner aux mêmes types de documents que ceux rencontrés en évaluation.
Surtout, le livre se distingue par ses nombreux quiz, cartes muettes, exercices sur les dates essentielles et ses corrigés complets en fin d’ouvrage. L’élève peut ainsi vérifier seul ses réponses, repérer précisément ses erreurs et revoir les notions mal maîtrisées. C’est un support particulièrement adapté aux élèves qui ont besoin de repères clairs et de progrès rapides pour remonter leur moyenne.
Comment l’utiliser ?
- Cibler les chapitres problématiques. Commencer par feuilleter le sommaire avec votre enfant et faire ressortir les thèmes où les dernières notes ont été faibles (par exemple l’Empire romain ou « Habiter une métropole »). Travailler en priorité ces pages : lecture du rappel de cours, puis réalisation de tous les exercices du chapitre en conditions calmes.
- Transformer les quiz en entraînement régulier. Deux ou trois soirs par semaine, choisir une page de quiz et demander à l’élève de répondre sans regarder le cours, en temps limité. Par exemple, refaire plusieurs fois le quiz sur les dates clés de l’Antiquité jusqu’à obtenir 90 % de bonnes réponses de mémoire, sans hésitation.
- Apprendre à lire une carte ou une frise. Utiliser les activités de géographie pour ritualiser la méthode : repérer le titre, la légende, puis les figurés. On peut, par exemple, travailler une carte sur les métropoles mondiales en demandant à l’élève d’expliquer à voix haute ce que montre chaque symbole avant d’écrire la réponse dans le cahier.
- S’entraîner à rédiger des phrases complètes. Après une série d’exercices réussis, choisir une question de fin de page et demander une réponse rédigée en trois ou quatre phrases. La consigne peut être : « Raconte la journée d’un citoyen romain » en utilisant les mots de la leçon. Relire ensemble, corriger les phrases trop courtes et souligner les mots importants du vocabulaire.
2. Histoire Géographie EMC 6e – Cahier de l’élève (Bordas, 2022)
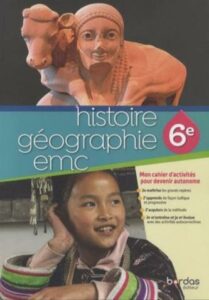
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Ce cahier Bordas se présente comme un véritable « cahier de réussite » : il accompagne l’élève tout au long de l’année, chapitre après chapitre, avec des activités très progressives. Chaque leçon commence par quelques documents simples et des questions guidées qui conduisent pas à pas vers les notions essentielles.
Les thèmes du programme de sixième y sont tous traités : du Néolithique à l’Empire romain, des grandes métropoles aux espaces ruraux de faible densité, ainsi que l’enseignement moral et civique. Les exercices font alterner travail sur frise chronologique, cartes, croquis, étude de textes et de statues, ce qui permet de renforcer les compétences attendues en fin de cycle 3.
Des encadrés de méthode et des rappels de vocabulaire sont intégrés aux pages d’activités et guident la démarche. En parallèle, le cahier numérique enseignant regroupe les corrigés, ce qui permet à l’adulte de vérifier les réponses. Utilisé en soutien, ce cahier structure le travail et habitue l’élève au format des exercices donnés en classe.
Comment l’utiliser ?
- Suivre le rythme de la classe. Repérer dans le sommaire le chapitre étudié en ce moment en cours (par exemple « Les débuts du judaïsme » ou « Habiter les littoraux ») et faire, à la maison, les doubles pages correspondantes. L’élève voit alors les mêmes notions sous un autre angle, avec davantage de questions guidées que dans le manuel.
- Utiliser les encadrés méthode comme liste de vérification. Avant chaque contrôle, reprendre les encadrés de méthode du chapitre : « Comment lire une frise ? », « Comment raconter un événement historique ? ». Demander à l’élève d’expliquer la démarche à voix haute, puis de l’appliquer immédiatement sur un exercice du cahier, par exemple un récit sur la fondation de Rome.
- Faire des séances courtes mais régulières. Plutôt que de remplir plusieurs pages d’un coup, viser une page par jour : un document, quelques questions, une correction rapide avec l’adulte. Sur une semaine, cela permet par exemple de revoir entièrement un thème de géographie avant une évaluation, sans surcharge ni fatigue excessive.
- S’en servir pour repérer les lacunes. Lorsque plusieurs questions d’une même page posent problème (vocabulaire inconnu, difficulté à comprendre la légende d’une carte), les noter dans un petit carnet. Le cours du professeur ou un manuel pourront ensuite être relus précisément à partir de cette liste, en ciblant les passages non compris plutôt qu’en relisant tout au hasard.
3. Mon cahier bi-média d’Histoire-Géographie 6e (Nathan, 2021)
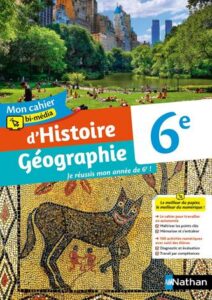
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Avec Mon cahier bi-média d’Histoire-Géographie 6e, Nathan propose un outil qui marie cahier papier et ressources numériques. Chaque chapitre reprend une grande question du programme et la décline en activités guidées, courtes, pensées pour faire travailler l’élève en autonomie à la maison aussi bien qu’en classe.
Le principe est simple : sur le cahier, l’élève observe des documents variés (cartes, frises, textes, images) et répond à une série de questions progressives. En parallèle, il peut accéder à une plateforme d’exercices interactifs autocorrigés, avec un suivi de ses scores. Cette alternance entre papier et numérique entretient l’attention et permet de retravailler plusieurs fois la même compétence sans lassitude.
La structure par compétences (décrire, raconter, situer dans le temps et l’espace, utiliser un vocabulaire précis) correspond directement aux attentes du cycle 3. Utilisé en soutien scolaire, ce cahier bi-média aide à installer des routines : une activité sur le papier, un exercice en ligne, puis une courte mise en commun avec l’adulte pour verbaliser ce qui a été réussi ou non.
Comment l’utiliser ?
- Instaurer un « duo papier/numérique ». Choisir un chapitre, faire d’abord les activités du cahier, puis passer sur les exercices interactifs associés. Par exemple, après une leçon sur les cités grecques, l’élève répond aux questions sur les documents du cahier avant de refaire un exercice en ligne sur la même carte pour vérifier qu’il retient bien les repères.
- Exploiter les scores comme indicateur de progrès. Noter dans un tableau les résultats obtenus aux séries d’exercices en ligne (dates, cartes, vocabulaire). L’objectif peut être de gagner quelques points d’une séance à l’autre. Si l’élève stagne à 50 % sur les métropoles mondiales, on reprend le cours et les pages du cahier, puis on retente l’exercice jusqu’à dépasser 80 %.
- Travailler la compréhension des consignes. Lire ensemble la consigne d’une activité numérique ou du cahier et demander à l’élève de la reformuler avec ses propres mots : « Que dois-je faire ? Avec quels documents ? ». On évite ainsi les erreurs « bêtes » fréquentes en contrôle, par exemple confondre « citer » et « expliquer » lors d’un exercice sur le Néolithique.
- Préparer une évaluation en mode « simulation ». La veille d’un contrôle, sélectionner quelques activités du cahier et une série d’exercices en ligne et les faire en temps limité, sans le cours sous les yeux. Les questions mal réussies deviennent une liste claire de notions à revoir dans le manuel ou le cahier de classe.
4. Fiches d’activités – Histoire-Géographie-EMC 6e (Hatier, 2021)
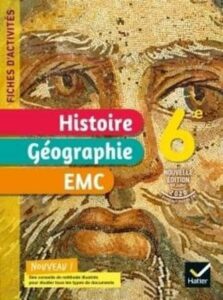
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Les Fiches d’activités d’Hatier se présentent sous forme de fiches en couleurs, détachables, pensées pour être collées dans le cahier de cours. Chaque fiche correspond à une séance ou à une notion clé du programme et propose un ensemble d’exercices plutôt courts, immédiatement exploitables à la maison.
La dernière édition, mise à jour du programme et de ses repères, enrichit la sixième de nouvelles fiches, notamment sur les thématiques d’EMC et sur certains chapitres de géographie. On y trouve des cartes simplifiées, des documents iconographiques clairs, ainsi que des frises à compléter qui conviennent bien aux élèves ayant besoin d’un guidage fort.
Des encadrés « méthode » illustrés rappellent comment lire un document, organiser un récit ou remplir une carte. L’ensemble donne un support souple : on peut utiliser une fiche ponctuellement pour préparer un contrôle ou les enchaîner pour retravailler tout un thème. Pour les élèves qui se découragent devant un gros cahier, ce format par fiches rend l’entraînement plus concret et moins impressionnant.
Comment l’utiliser ?
- Coller les fiches au bon moment. Plutôt que de les utiliser toutes à la fois, garder les fiches dans le cahier Hatier et les détacher seulement lorsque le thème est étudié en classe. Avant une évaluation sur la Grèce antique, par exemple, coller la fiche correspondante dans le cahier de cours et la remplir en révision, crayon à la main.
- Traiter une fiche comme une séance complète. Chaque fiche peut structurer un temps de travail de trente à quarante minutes : lecture des documents, réponse aux questions, puis vérification rapide avec l’adulte. Pour un thème comme « Habiter une métropole », on prend le temps d’observer la photographie, de repérer les éléments dans la légende, puis de rédiger les phrases demandées.
- Revenir sur les points méthode. Lorsque l’élève bloque sur la rédaction ou la compréhension d’une carte, reprendre ensemble l’encadré méthode de la fiche. On peut lui demander d’appliquer immédiatement la consigne sur un exemple précis : par exemple, transformer une liste d’idées sur le mode de vie des paysans au Moyen Âge en un paragraphe cohérent, avec connecteurs logiques.
- Se constituer un « dossier de secours ». Les fiches déjà complétées peuvent être rangées dans une pochette transparente, thème par thème. Avant le brevet blanc de cinquième ou de quatrième, ce dossier servira de base de révision : les fiches de sixième sur les premières grandes civilisations ou sur la Méditerranée antique deviennent alors des repères déjà assimilés.
5. Mon carnet de réussite – Histoire-Géographie 6e (Hatier, 2023)
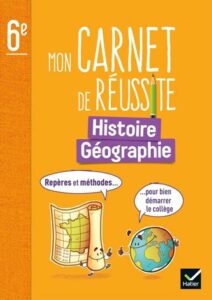
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Ce Carnet de réussite est un petit format utile pour consolider les bases. Plutôt qu’un cahier d’exercices classique, il rassemble l’essentiel des méthodes, repères et outils à maîtriser à la fin de la sixième : lire une frise, décrire un paysage, situer un événement dans l’espace et dans le temps.
Chaque double page aborde une difficulté fréquente des élèves : rédiger quelques lignes claires, utiliser correctement le vocabulaire historique, distinguer carte de localisation et croquis, mémoriser un ensemble de dates ou de lieux. Des documents simples servent de support à des activités courtes, avec des consignes très explicites et un guidage qui rassure les élèves fragiles.
Le carnet peut accompagner n’importe quel manuel ou cahier d’activités : il agit comme une « boîte à outils » à portée de main. En travaillant régulièrement ces fiches, l’élève consolide ses automatismes, ce qui a un effet direct sur ses contrôles. Moins de points perdus sur les compétences et la présentation, davantage de marges pour réussir les questions de fond.
Comment l’utiliser ?
- Installer un rituel de quelques minutes. Le carnet se prête bien à de très courtes séances : une page par jour, après les devoirs. Par exemple, un soir on choisit une fiche sur la lecture de frise chronologique, on la remplit en dix minutes, puis on demande à l’élève de raconter oralement la période étudiée en s’aidant de sa frise complétée.
- Relier chaque fiche à une erreur réelle. Après un contrôle, identifier avec l’élève les remarques du professeur : « Carte non complétée », « Récit trop court », « Dates mal connues ». Chercher dans le carnet la fiche correspondante (rédiger un récit, utiliser une carte, apprendre les repères) et la travailler immédiatement, en refaisant un exercice proche de la question ratée.
- Préparer les évaluations de repères. Beaucoup d’enseignants organisent des contrôles réguliers sur les cartes ou les frises. Utiliser les pages de repères du carnet pour programmer à l’avance de petites révisions : cinq minutes par soirée pour revoir les fleuves, les mers, les grandes métropoles, puis une auto-interrogation en traçant soi-même la carte sur une feuille blanche.
- En faire un outil de bilan de fin d’année. Au troisième trimestre, reprendre toutes les fiches et cocher celles que l’élève maîtrise sans difficulté. Les pages encore hésitantes deviennent un programme de révision ciblé pour l’entrée en cinquième : par exemple, retravailler la rédaction d’un paragraphe explicatif ou la distinction entre carte politique et carte physique.
Conseils supplémentaires pour bien utiliser ces livres
Pour tirer pleinement parti de ces ouvrages, l’enjeu n’est pas de « tout faire », mais de choisir intelligemment. Mieux vaut quelques séances bien ciblées qu’un remplissage massif de pages qui finit par décourager. On peut, par exemple, consacrer deux soirs par semaine à l’histoire et un soir à la géographie, en alternant un travail sur les repères (dates, cartes, vocabulaire) et une activité de rédaction courte.
Un autre point décisif consiste à expliciter les attentes scolaires. En sixième, beaucoup d’élèves n’ont pas encore compris ce que l’on attend d’eux lorsqu’on parle de « récit », de « description » ou d’« analyse de document ». Utiliser les encadrés de méthode, les modèles de réponses et les corrigés proposés dans ces livres permet de rendre ces exigences concrètes : on montre un exemple, puis on invite l’élève à faire « à la manière de ».
Enfin, il reste essentiel de garder le lien avec le professeur. Les remarques écrites dans le cahier ou sur les copies sont de précieux indicateurs pour choisir les exercices des cahiers de soutien. Un échange rapide en début ou fin de cours peut également aider à repérer les priorités : retravailler les cartes ? Les frises ? La rédaction ? En articulant cours, manuel et livre de soutien, l’histoire-géographie devient progressivement un terrain de réussite plutôt qu’une source d’angoisse.
Références
- Programme d’histoire-géographie au cycle 3 – ressources d’accompagnement (Eduscol)
- Histoire-géographie – programmes et ressources officiels (Eduscol)
- Programme d’enseignement du cycle 3 – texte officiel
- Programmes et ressources en histoire-géographie et EMC pour le cycle 3 (académie de Créteil)
- Les programmes du collège – ministère de l’Éducation nationale