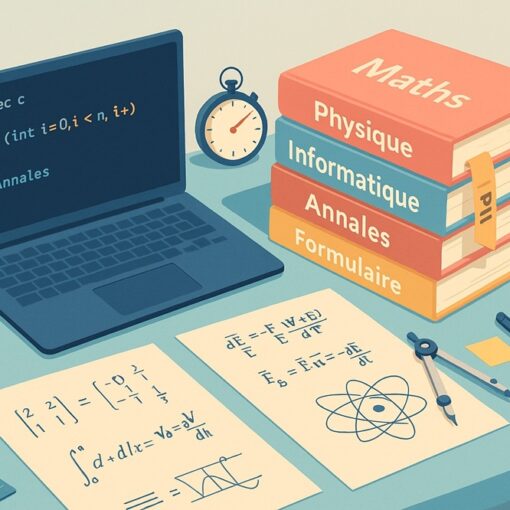En 4ᵉ, l’histoire-géographie devient plus exigeante : il faut comprendre les révolutions des XVIIIᵉ–XIXᵉ siècles, l’industrialisation, la colonisation, mais aussi les dynamiques de la mondialisation, les mobilités et les inégalités de développement.
Le programme de cycle 4 demande de se repérer dans le temps et dans l’espace, analyser des documents, maîtriser le vocabulaire disciplinaire et rédiger des réponses structurées.
Pour beaucoup d’élèves, la difficulté vient moins du “cours” que de la méthode : apprendre des repères, lire une carte complexe, rédiger un développement construit, comprendre précisément ce que signifie « justifier » ou « montrer que » dans un sujet. Les évaluations, elles, s’appuient de plus en plus sur ces compétences.
La sélection ci-dessous rassemble des ouvrages qui peuvent aider à remonter une moyenne d’histoire-géographie de 4ᵉ, à condition d’être utilisés régulièrement et avec stratégie.
1. Réussite collège – Histoire-Géographie 4e (Rue des écoles, 2023)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Ce cahier de la collection « Réussite collège » propose un entraînement ciblé sur l’ensemble du programme d’histoire-géographie de 4ᵉ. Chaque double-page reprend une notion clé – révolution industrielle, urbanisation, mondialisation – avec un rappel de cours synthétique, puis des exercices gradués. L’élève revoit ainsi l’essentiel sans se perdre dans les détails, ce qui rassure lorsque les chapitres s’enchaînent vite en classe.
L’ouvrage insiste sur les compétences attendues en cycle 4 : analyse de documents, lecture de cartes, réalisation de croquis, réponses rédigées courtes. Les consignes sont simples, les questions progressives, ce qui convient aux élèves qui ont du mal à démarrer. Les corrigés aident à comprendre ses erreurs et à repérer ce qui bloque.
Le format mince et le prix modéré en font un outil facile à glisser dans le sac. On peut y travailler un chapitre avant une interrogation, ou suivre le sommaire pour une révision complète avant le passage en 3ᵉ. C’est un support polyvalent, adapté autant à l’auto-révision qu’au travail accompagné avec un parent ou un professeur particulier.
Comment l’utiliser ?
- Réserver chaque semaine une séance courte de trente minutes pour un chapitre précis. Par exemple, avant un contrôle sur la Révolution française, reprendre la double-page correspondante, relire le rappel de cours, puis réaliser tous les exercices de connaissances pour vérifier que les dates et les acteurs clés sont maîtrisés.
- Utiliser les exercices de documents comme entraînement systématique. Après un devoir raté parce qu’un tableau statistique n’a pas été compris, choisir une page avec graphique ou carte et s’imposer la lecture ligne par ligne : titre, légende, source, puis rédaction d’une ou deux phrases de synthèse.
- Travailler les croquis en plusieurs fois plutôt qu’en une seule séance. Pour une carte sur « Les espaces de faible densité en France », commencer par repasser le fond de carte, puis placer les figurés le lendemain, enfin rédiger la légende complète un troisième jour.
- Transformer le cahier en support de mémorisation active. À chaque exercice, barrer les questions réussies du premier coup et noter en marge celles qui posent problème ; ce sont elles qui devront être retravaillées la veille d’un contrôle ou pendant les vacances.
- Faire intervenir un adulte ou un camarade comme « examinateur ». L’autre personne lit les consignes et chronomètre, tandis que l’élève explique à voix haute sa démarche sur un développement court, par exemple « Pourquoi Londres est-elle une ville mondiale ? », en s’appuyant sur les questions du cahier.
2. Mes fiches d’activités Histoire Géographie EMC 4e (Belin éducation, 2025)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Cette nouvelle édition rassemble 112 fiches recto verso détachables, organisées pour couvrir l’ensemble du programme de 4ᵉ. Chaque fiche associe documents variés, questions progressives et rappels méthodologiques, utilisables avec n’importe quel manuel. Le format détachable permet de ne sortir que la fiche utile.
L’originalité de l’ouvrage tient à la différenciation par niveaux, signalés par un système d’étoiles : 1*, 2**, 3***. Un même thème – par exemple les mobilités touristiques ou la révolution industrielle – peut ainsi être abordé sous forme d’activité très guidée, puis de tâche plus autonome. L’élève gagne en confiance en constatant qu’il franchit des paliers visibles.
Les fiches d’enseignement moral et civique (EMC) complètent le dispositif : elles aident à préparer les débats, à structurer un argumentaire et à maîtriser le vocabulaire citoyen exigé en cycle 4. L’ensemble forme un véritable « kit » de pratique régulière, adapté aux élèves qui progressent mieux en manipulant des supports concrets, qu’il s’agisse de cartes, de textes ou de frises chronologiques.
Comment l’utiliser ?
- Commencer par repérer, avec l’élève, quels chapitres posent le plus de problèmes. Révolution industrielle, colonisation, villes mondiales… Puis sélectionner une ou deux fiches par semaine sur ces thèmes en commençant systématiquement par le niveau 1*, très guidé, pour réactiver les connaissances de base.
- Lorsque les évaluations portent sur l’analyse de documents, prendre une fiche niveau 2** et travailler au brouillon la démarche complète. Sur un texte sur l’abolition de l’esclavage, souligner les repères de temps, entourer les acteurs, dégager l’idée principale, puis rédiger une réponse en trois phrases.
- Exploiter le système 1*/2**/3*** comme un petit contrat de progression. Après un contrôle insuffisant en géographie, l’élève s’engage, par exemple, à réussir deux fiches de niveau 2** sur les mobilités et une fiche de niveau 3***, plus exigeante, sur les inégalités de développement.
- Détacher les fiches d’EMC pour préparer un débat ou un oral. Avant une prise de parole en classe sur la liberté d’expression, utiliser la fiche dédiée : l’élève répond aux questions écrites, puis s’appuie sur ses réponses comme support de notes pour parler plus sereinement.
- Pendant les vacances ou un week-end chargé en devoirs, mélanger histoire, géographie et EMC. Construire un « menu » de trois fiches variées, par exemple un document de géographie, une activité d’histoire et une fiche de citoyenneté, afin d’entretenir les acquis sans saturer sur un seul chapitre.
3. Histoire Géo EMC 4ᵉ – Mon cahier de compétences (Nathan, 2017)
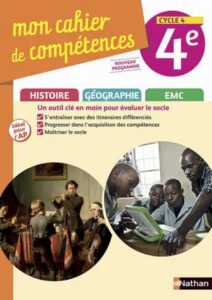
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Ce bouquin se distingue des cahiers d’exercices classiques : il organise le programme autour des grandes compétences à maîtriser au cycle 4. Pour chacune d’elles, l’élève commence par un diagnostic qui lui permet de mesurer où il en est, sans note, grâce à des réussites ou des points à améliorer.
Viennent ensuite plusieurs fiches d’entraînement avec itinéraires différenciés. Sur la même compétence – par exemple « lire et critiquer un document » – certains exercices sont très guidés, d’autres demandent davantage d’autonomie. Les consignes invitent à cocher, surligner, annoter, ce qui rend le travail plus actif et plus visuel. L’élève voit concrètement sa progression au fil des pages.
Chaque bloc se termine par une évaluation courte, dans l’esprit du socle commun, qui peut servir de test blanc avant un devoir surveillé. Le cahier devient un carnet de bord des progrès en histoire, géographie et enseignement moral et civique, très utile pour les élèves qui manquent de méthode et peinent à relier les notions entre elles.
Comment l’utiliser ?
- Identifier d’abord, avec l’élève, deux ou trois compétences fragiles. « Raconter un événement », « situer dans le temps », « lire une carte ». Puis n’ouvrir que les chapitres concernés, pour éviter l’effet de masse ; l’objectif est d’améliorer des points précis, pas de tout refaire.
- Avant un contrôle d’histoire, choisir la compétence « raconter et expliquer ». Par exemple, sur le chapitre de la traite négrière, remplir la fiche de diagnostic, puis refaire une activité guidée en demandant à l’élève de raconter l’itinéraire d’un esclave en cinq phrases simples mais complètes.
- Utiliser le cahier comme support de remédiation après une mauvaise note. Le professeur peut entourer la compétence en cause sur la copie ; à la maison, l’élève réalise les fiches correspondantes, puis s’autoévalue à nouveau. Cela transforme l’échec en plan de travail concret.
- En géographie, travailler la lecture de cartes en respectant toutes les étapes proposées. Sur un croquis de métropole, commencer par décrire simplement ce que l’on voit, repérer la légende, retrouver les figurés dans la carte, puis seulement rédiger un petit paragraphe explicatif.
- Régulièrement, deux fois par trimestre, parcourir les pages remplies pour prendre la mesure des progrès. L’élève entoure en vert les compétences désormais maîtrisées, en orange celles qui restent à consolider ; cette visualisation nourrit la motivation et donne des repères clairs à la famille comme à l’enseignant.
4. Mon cahier bi-média d’Histoire-Géographie 4e (Nathan, 2022)
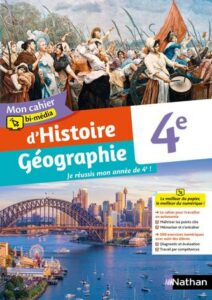
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Ce cahier propose une approche qui combine un cahier papier et une plateforme numérique associée. Chaque chapitre suit la même structure : activités d’entrée dans le thème, exercices pour comprendre les points clés, tâches d’entraînement en vue de l’évaluation. L’élève peut avancer en autonomie tout en restant guidé par des consignes nettes.
La partie numérique prolonge le travail avec des exercices interactifs, des parcours individualisés et des quiz de vérification des acquis. Pour un usage en soutien scolaire, l’intérêt est de pouvoir répéter la même compétence – lire une frise, interpréter un diagramme, décrire un paysage – avec des documents renouvelés. Les résultats immédiats permettent de repérer les lacunes et de cibler les révisions.
Le cahier papier reste le socle du dispositif. On y retrouve cartes, textes, photos et schémas en lien avec le programme de 4ᵉ. Les activités sont courtes, visuelles, et se prêtent à des séances de travail régulières. L’ensemble convient aux élèves qui aiment les supports numériques, mais ont besoin d’un cadre structuré pour organiser leur révision.
Comment l’utiliser ?
- Commencer par la version papier pour installer les notions. Sur un chapitre de géographie sur les villes mondiales, remplir les activités du cahier en soulignant les mots de vocabulaire importants ; ensuite seulement, refaire la même compétence sur la plateforme numérique pour vérifier que ces mots sont compris.
- Programmer des « séances mixtes » de quarante minutes : vingt minutes sur le cahier, vingt minutes en ligne. Par exemple, après avoir complété un exercice de description d’un paysage industriel, passer au quiz correspondant pour s’entraîner à rédiger de courtes réponses sous contrainte de temps.
- Utiliser les résultats numériques comme tableau de bord. Quand l’élève échoue systématiquement aux questions sur les repères chronologiques, revenir au cahier papier et reprendre les activités d’entrée dans le chapitre d’histoire concerné, en construisant une frise à la main pour fixer les dates clés.
- En période de révision intense, alterner un jour sur deux papier et numérique pour éviter la lassitude. Le lundi, travailler sur carte les espaces maritimes ; le mardi, se concentrer sur un questionnaire en ligne sur les routes maritimes, en visant un score cible avant de passer à un autre thème.
- Pour les élèves qui se dispersent facilement, imposer un rituel. Ouvrir le cahier, lire la consigne, faire l’activité sur le support papier, puis seulement prendre l’ordinateur pour valider la même compétence. Cette succession limite le zapping et donne une progression claire dans le travail.
5. Mon carnet de réussite – Histoire-Géographie 4e (Hatier, 2025)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Ce petit cahier souple est pensé pour accompagner l’élève tout au long de l’année. Il concentre l’essentiel : méthodes de base, repères chronologiques et spatiaux, vocabulaire et consignes fréquentes. L’idée est de proposer un support léger, facile à garder dans le sac.
Chaque double-page associe documents simples, exercices courts et encadrés de conseils. On y travaille, par exemple, la description d’un paysage, la lecture d’un tableau statistique ou la construction d’un paragraphe organisé. Les activités d’application permettent de passer rapidement de la règle à la pratique, ce qui facilite l’appropriation des méthodes.
Le carnet accorde aussi une place importante à la mémorisation : listes de dates, cartes muettes et rappels de notions sont présentés de manière visuelle. Un « dico des consignes » aide à décoder des verbes souvent mal compris – « justifier », « expliquer », « montrer que ». L’ouvrage joue ainsi le rôle de compagnon de route, adapté aux élèves qui se sentent vite dépassés par la densité des manuels.
Comment l’utiliser ?
- Installer le carnet comme outil de tous les jours, non comme un cahier supplémentaire. À chaque séance de travail, commencer par feuilleter la partie « méthodes » : avant un exercice de récit, relire la fiche sur le paragraphe organisé, puis appliquer immédiatement la démarche à l’activité donnée par le professeur.
- Utiliser les pages de repères pour construire un rituel de mémorisation. Chaque soir, choisir trois dates ou trois lieux de la carte et demander à l’élève de les réciter, puis de les placer de mémoire sur une feuille blanche ; la semaine suivante, on vérifie que ces repères sont toujours connus.
- En géographie, exploiter les cartes muettes pour s’entraîner avant un contrôle de localisation. Par exemple, avant une évaluation sur les grandes métropoles, remplir la carte proposée dans le carnet, puis la refaire sans modèle le lendemain ; on corrige ensuite en comparant avec le manuel.
- Avant un devoir surveillé, passer par le « dico des consignes ». L’élève relève sur sa dernière copie les verbes qui posent problème, comme « justifier » ou « montrer que », puis recherche dans le carnet la définition et l’exemple associé ; cela évite de perdre des points faute d’avoir compris la demande.
- Après la correction d’un contrôle, noter dans une marge du carnet les conseils donnés par l’enseignant. On pourra relire ces remarques avant le devoir suivant, en les reliant aux fiches concernées, pour transformer les critiques en axes de progrès concrets.
Quelques conseils pour tirer pleinement parti de ces ouvrages
- Choisir peu, mais bien. Inutile d’empiler trois cahiers d’exercices différents : mieux vaut un seul support principal, utilisé chaque semaine, complété par un petit carnet de méthodes ou de repères. Le choix peut se faire selon le profil de l’élève : besoin de pratique régulière, appétence pour le numérique, difficulté surtout méthodologique, etc.
- Raisonner en compétences, pas seulement en chapitres. Le programme de cycle 4 insiste sur la progression des compétences d’analyse de documents, de repérage dans le temps et l’espace, de rédaction. Lorsqu’un devoir est raté, identifier la compétence en cause (par exemple « raconter un événement historique ») et utiliser les ouvrages ci-dessus pour la retravailler spécifiquement.
- Installer des rituels courts. Les académies rappellent l’importance d’un travail personnel régulier, appuyé sur des tâches ciblées plutôt que sur des soirées entières de “par cœur”. Dix à quinze minutes par jour suffisent souvent : une fiche, un exercice de document, une carte muette, une série de repères à réciter.
- Articuler avec les ressources officielles. Les manuels et ces cahiers de soutien prennent tout leur sens s’ils restent en phase avec les attendus du programme. Les sites institutionnels (Eduscol, sites académiques) publient des exemples de séquences et de démarches qui peuvent aider à comprendre ce que l’on attend réellement d’un élève de 4ᵉ en histoire-géographie.
Références
- Programmes du collège – site du ministère de l’Éducation nationale
- Histoire-géographie – cycle 4 : ressources d’accompagnement (Eduscol)
- J’enseigne au cycle 4 – attendus de fin de cycle et repères annuels (Eduscol)
- Méthodologie de l’évaluation de l’enseignement de l’histoire et de la géographie au collège
- Les essentiels de la discipline en histoire-géographie – académie de Toulouse
- Comment aider les élèves à mémoriser avec le numérique en Histoire-Géographie ? – MOOC HG