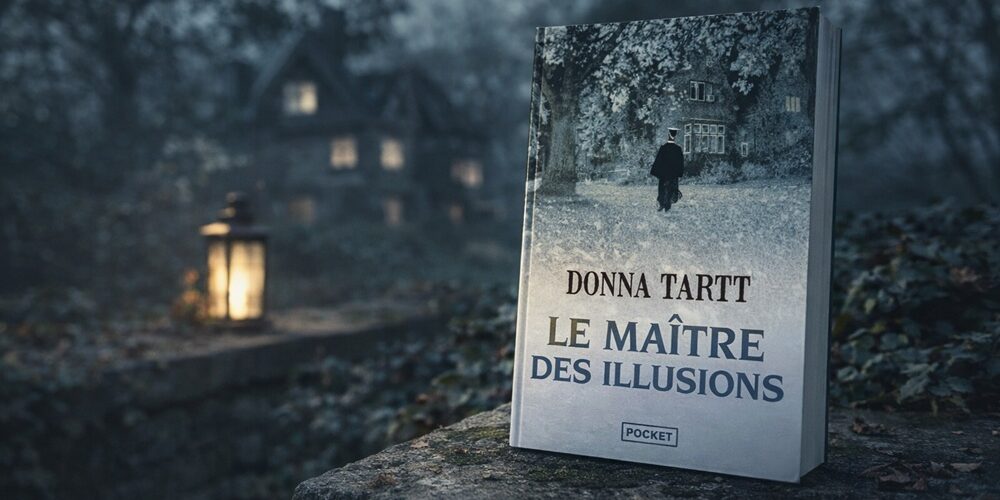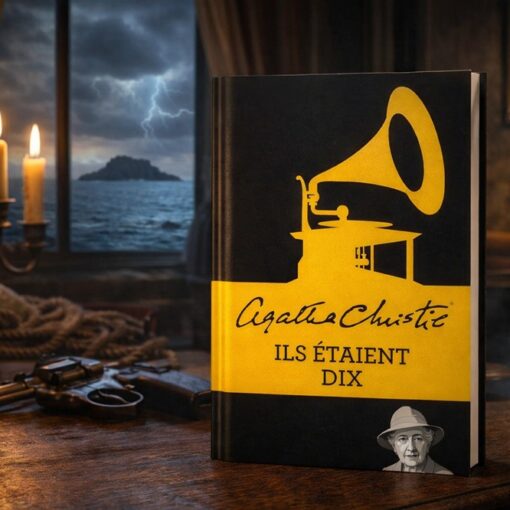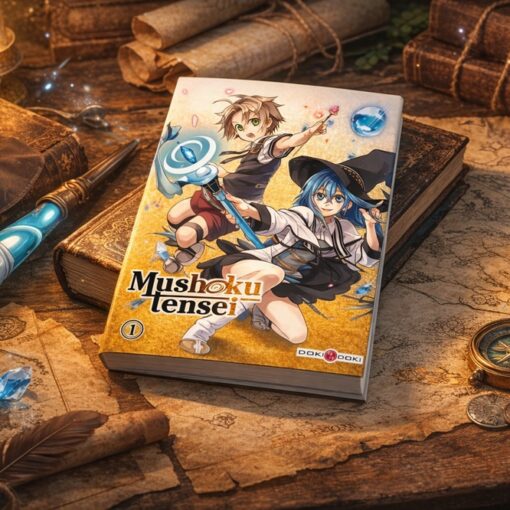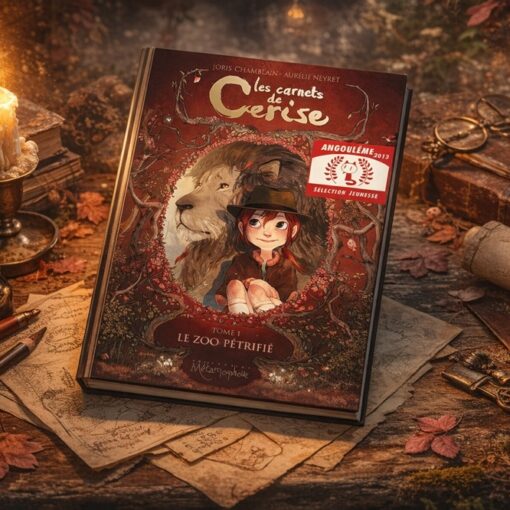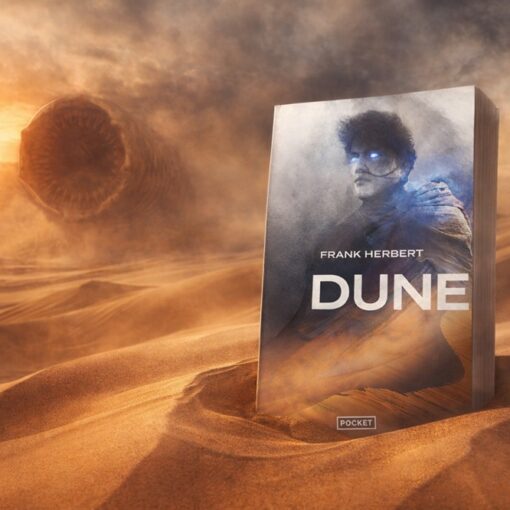Publié en 1992, Le Maître des illusions (The Secret History) de Donna Tartt suit un groupe d’étudiants en lettres classiques dans une université fictive du Vermont. Sous l’emprise de leur professeur charismatique, ces jeunes gens s’enfoncent dans l’obsession intellectuelle, le secret et le meurtre.
Le roman est devenu une référence incontournable du genre que l’on nomme aujourd’hui dark academia — un sous-genre littéraire qui conjugue cadre universitaire prestigieux, esthétique sombre et tensions morales. Si vous vous demandez quoi lire ensuite, voici quelques suggestions du même acabit.
1. If We Were Villains (M. L. Rio, 2017)
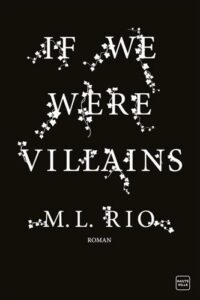
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Souvent cité comme l’héritier le plus direct du roman de Donna Tartt, If We Were Villains transpose la formule dans le monde du théâtre shakespearien. Oliver Marks, libéré après dix ans de prison, revient sur les événements qui ont déchiré son groupe d’amis au conservatoire de Dellecher, une école d’art dramatique élitiste de l’Illinois.
Sept étudiants y incarnent les mêmes archétypes — héros, tyran, tentatrice, ingénue — pièce après pièce, jusqu’à ce qu’un changement de distribution fasse voler en éclats l’équilibre du groupe.
M. L. Rio, titulaire d’un master en études shakespeariennes du King’s College de Londres, ancre son récit dans une connaissance érudite du répertoire classique. Les répliques de Shakespeare s’infiltrent dans la vie quotidienne des personnages et brouillent la frontière entre le plateau et le réel.
Comme chez Tartt, un narrateur rétrospectif déroule une confession teintée de culpabilité, et l’on sait dès les premières pages qu’un drame a eu lieu. La question n’est pas qui, mais pourquoi.
2. Les Muses (Alex Michaelides, 2021)
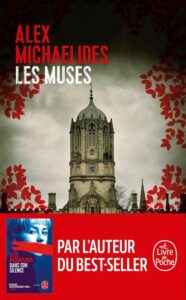
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Avec Les Muses (The Maidens), Alex Michaelides déplace le huis clos universitaire dans les couloirs feutrés de Cambridge. Mariana, psychothérapeute londonienne encore endeuillée par la noyade de son mari, se rend sur le campus pour soutenir sa nièce Zoé après le meurtre brutal d’une étudiante. Très vite, ses soupçons se portent sur Edward Fosca, un séduisant professeur de grec ancien qui entretient des liens troubles avec un cercle d’étudiantes triées sur le volet : les « Muses ».
Le roman entrelace thriller psychologique, mythologie grecque et tragédie antique. Michaelides, lui-même diplômé de Cambridge, restitue l’atmosphère brumeuse et les traditions séculaires de l’université avec une précision qui rappelle l’emprise des lieux sur les personnages de Tartt.
On retrouve ici la figure du professeur magnétique dont l’ascendant sur ses élèves frise la dévotion — un écho direct à Julian Morrow dans Le Maître des illusions. Les faux-semblants s’accumulent jusqu’à un dénouement qui redistribue toutes les cartes.
3. Dans l’ombre d’April (Ruth Ware, 2022)
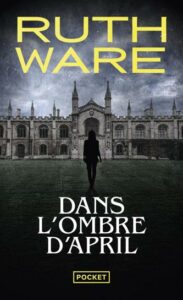
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Ruth Ware situe Dans l’ombre d’April (The It Girl) dans le décor d’Oxford et structure son récit autour d’une double temporalité : l’« Avant », celui des années d’études, et l’« Après », dix ans plus tard. Hannah, étudiante effacée, avait partagé sa chambre avec April — belle, charismatique, adorée et enviée. Jusqu’à la nuit où Hannah a découvert son corps sans vie.
Un homme a été condamné. Il vient de mourir en prison. Et Hannah, désormais mariée, commence à douter : le coupable était-il le bon ? Pour le savoir, elle devra rouvrir le passé et interroger ses anciens amis — y compris celui qu’elle a épousé.
Le parallèle avec Tartt tient à la mécanique du souvenir et de la culpabilité. Hannah, comme Richard Papen, est une observatrice aspirée dans l’orbite d’une personnalité solaire et destructrice. La tension naît moins du crime lui-même que des non-dits sédimentés entre les protagonistes. Un suspense psychologique construit sur les fissures de l’amitié.
4. La Neuvième Maison (Leigh Bardugo, 2019)
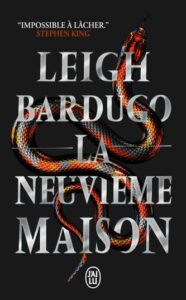
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Leigh Bardugo, diplômée de Yale, s’appuie sur sa propre expérience pour bâtir un roman de dark academia mêlé de fantastique. Galaxy « Alex » Stern, jeune femme au passé ravagé par la drogue et la violence, est recrutée pour intégrer Yale grâce à un don singulier : elle voit les morts. Sa mission : surveiller les huit sociétés secrètes de l’université, qui pratiquent une magie occulte au service des puissants.
Là où Tartt dissimulait la dimension rituelle sous un vernis d’hellénisme, Bardugo la met à nu. Les sociétés secrètes de Yale — inspirées de celles qui existent sur le campus — manipulent des forces susceptibles de tuer. Alex, étrangère à ce monde de privilège, porte un regard acéré sur les mécanismes de classe qui structurent l’Ivy League.
Le roman pose la même question que Le Maître des illusions : que se passe-t-il lorsqu’une élite se croit affranchie des règles communes ? La réponse prend ici une tournure surnaturelle et brutale.
5. Babel (R. F. Kuang, 2022)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Sous-titré La Nécessité de la violence, le roman de R. F. Kuang se présente explicitement comme une réponse thématique au Maître des illusions. L’action se déroule dans un Oxford alternatif des années 1830, où l’Institut royal de traduction — surnommé Babel — constitue le cœur de la suprématie britannique. La traduction y est un acte magique : des barres d’argent enchantées capturent ce qui se perd entre deux langues.
Robin Swift, orphelin cantonais recueilli par un professeur d’Oxford, découvre que son savoir linguistique sert un empire colonial qui opprime son pays d’origine. Le dilemme est celui de tout étudiant absorbé par une institution dont il perçoit la toxicité sans parvenir à s’en détacher — un écho au malaise de Richard Papen chez Tartt.
Kuang radicalise la critique : là où Tartt décrivait la séduction de l’élitisme, Babel en démonte les fondations coloniales avec une érudition redoutable, nourrie de notes de bas de page et de réflexions sur la philologie.
6. Atlas Six (Olivie Blake, 2020)
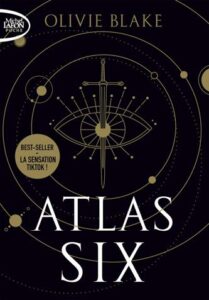
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Phénomène viral sur BookTok avant d’être repris par un éditeur traditionnel, Atlas Six (The Atlas Six) installe six magiciens d’exception dans un concours à haut risque. La Société alexandrine, gardienne des savoirs perdus de l’Antiquité, recrute chaque décennie six candidats pour une année probatoire. Cinq seront initiés. Le sixième sera éliminé — au sens littéral.
Chaque personnage maîtrise une branche de la magie : manipulation physique, télépathie, illusion, empathie coercitive. Leurs alliances se font et se défont au gré de calculs où le désir, la rivalité et l’instinct de survie s’entremêlent.
Le lien avec Le Maître des illusions tient à l’architecture du récit : un groupe fermé, un savoir interdit, un prix moral exorbitant. Olivie Blake pousse la logique jusqu’à son terme : l’accès à la connaissance devient un jeu de sélection darwinien. Le ton est plus contemporain que celui de Tartt, mais la question reste la même : jusqu’où iriez-vous pour accéder au cercle des élus ?
7. Bunny (Mona Awad, 2019)
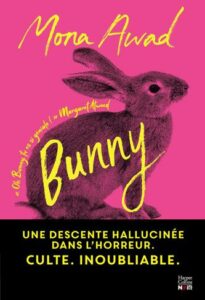
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Bunny est sans doute le titre le plus déstabilisant de cette liste. Samantha Heather Mackey, boursière solitaire dans un master en écriture créative à la très sélective Warren University, méprise ses camarades — un quatuor de jeunes femmes fortunées et mielleuses qui s’appellent mutuellement « Bunny ». Jusqu’au jour où elle reçoit une mystérieuse convocation à leur « Salon de Smut ».
Ce qui commence comme une satire mordante du milieu universitaire bascule dans l’horreur et le réalisme magique. Les « ateliers » des Bunnies cachent des rituels sanglants, et la frontière entre fiction et réalité se dissout sous les yeux de Samantha.
Mona Awad, elle-même diplômée d’un MFA à Brown, détourne les codes de la dark academia par le grotesque et le conte cruel. Là où Tartt traitait la fascination pour le groupe avec gravité, Awad la retourne comme un gant : le conformisme de la clique, sa violence feutrée et son emprise sont rendus avec un humour féroce.
8. Vita Nostra (Marina et Sergueï Diatchenko, 2007)
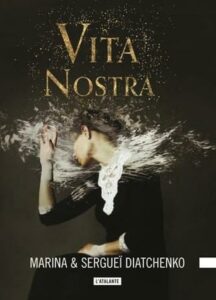
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Publié à l’origine en russe et traduit en anglais en 2018, Vita Nostra est un roman inclassable, à mi-chemin du conte philosophique et de la dark academia. Sasha Samokhina, adolescente ordinaire, est contrainte par un individu nommé Farit Kozhennikov d’intégrer l’Institut des Technologies Spéciales, une école perdue dans une bourgade russe.
Les cours y sont aberrants : mémoriser des pages de charabia, résoudre des problèmes insolubles, écouter des enregistrements de silence. L’échec est sanctionné par des menaces sur les proches. Pourtant, ces exercices transforment les étudiants en profondeur — littéralement. Leur humanité même vacille.
Là où Le Maître des illusions décrivait la corruption morale par le savoir, Vita Nostra va plus loin : l’apprentissage y devient un acte de métamorphose ontologique. Les Diatchenko — elle ancienne actrice, lui ancien psychiatre — signent un roman où l’angoisse de la vie étudiante prend des proportions cosmiques. Une lecture exigeante, comparée par la critique à un « Harry Potter écrit par Kafka ».