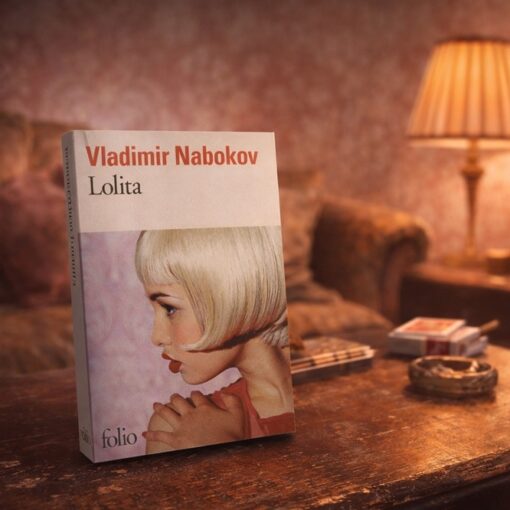Chef-d’œuvre intemporel de la pensée stratégique, « L’Art de la guerre » de Sun Tzu a inspiré aussi bien les généraux que les entrepreneurs, les diplomates ou les sportifs. Que lire pour mieux comprendre la stratégie, le leadership ou le rapport au conflit ? Voici une sélection d’ouvrages — modernes et plus anciens — qui, chacun à leur manière, éclairent et complètent les enseignements du maître chinois.
1. Responsabilité absolue (Jocko Willink, Leif Babin, 2015)
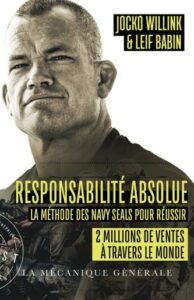
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
« Responsabilité absolue » raconte l’histoire et les enseignements de Jocko Willink et Leif Babin, deux anciens officiers des Navy SEALs ayant mené l’unité la plus décorée de la guerre en Irak. Leur mission : reprendre Ramadi, une ville considérée comme perdue. Ils y affrontent pertes humaines, chaos et décisions vitales à prendre en quelques secondes. Chaque épisode de terrain sert de base à un principe de leadership, ensuite transposé à des situations du monde civil, notamment en entreprise. De retour aux États-Unis, ils forment de nouvelles générations de leaders, puis fondent une société de conseil qui diffuse ces méthodes à des équipes de tous horizons.
Ce livre peut séduire un lecteur de « L’Art de la guerre » par la rigueur stratégique et la philosophie d’action qu’il défend. Là où Sun Tzu insiste sur la préparation, la lucidité et l’adaptation, Willink et Babin affirment que la clé réside dans l’appropriation totale de la mission par le leader. Rien n’est imputable au hasard ou à un tiers : si quelque chose échoue, c’est que le chef n’a pas su prévoir, expliquer ou ajuster. Cette idée, appliquée sans compromis, pousse à agir au lieu de chercher des excuses, et rappelle la discipline personnelle prônée dans les textes classiques sur la guerre.
Les principes énoncés sont concrets : clarifier les objectifs et en expliquer le sens, garder les plans simples pour pouvoir s’adapter lorsque la réalité les bouscule, prioriser les actions au lieu de se disperser, déléguer efficacement pour que chaque échelon sache agir sans attendre un ordre. Le livre souligne aussi les paradoxes du leadership : être confiant sans arrogance, agressif sans domination, humble sans passivité. Cette nuance dans l’attitude rejoint l’équilibre que Sun Tzu exige d’un stratège capable de diriger dans l’incertitude.
Enfin, « Responsabilité absolue » illustre comment l’examen systématique des succès et des échecs — à travers le débriefing post-action — permet d’ajuster les tactiques et d’améliorer constamment la performance. Cette logique de réévaluation permanente fait écho aux enseignements de « L’Art de la guerre » sur la nécessité d’apprendre de chaque affrontement. Un manuel de conduite qui conjugue fermeté, lucidité et sens pratique, utile à quiconque veut transformer une équipe ordinaire en force coordonnée et résiliente.
Aux éditions LA MÉCANIQUE GÉNÉRALE ; 423 pages.
2. Stratégie – Les 33 lois de la guerre (Robert Greene, 2006)
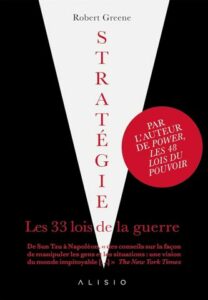
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
« Stratégie – Les 33 lois de la guerre » part du constat que la vie elle-même est un champ de bataille. Robert Greene y réunit trois millénaires de conflits, de manœuvres politiques et de luttes de pouvoir pour en dégager trente-trois principes d’action. Chacun est illustré par des exemples précis empruntés à l’histoire militaire (d’Alexandre le Grand à Napoléon), à la politique (Margaret Thatcher), aux affaires (Rockefeller), au sport (Mohamed Ali) ou à la culture (Hitchcock). L’ouvrage se divise en stratégies offensives pour garder l’initiative, défensives pour éviter les guerres perdues d’avance, mais aussi en tactiques destinées à neutraliser des adversaires plus puissants. Greene ne livre pas seulement des récits, il expose comment chaque approche peut se transposer dans les affrontements quotidiens : négociations, rivalités professionnelles, luttes d’influence.
Si vous avez aimé « L’Art de la guerre » de Sun Tzu, ce livre agit comme un prolongement moderne. Là où Sun Tzu formule des principes intemporels, Greene les met en scène à travers une mosaïque d’exemples et les relie directement à des situations contemporaines. On y retrouve l’importance de connaître son adversaire, de choisir ses batailles avec discernement, de maintenir l’initiative et de rester imprévisible — autant de notions chères à l’héritage de Sun Tzu, mais développées avec un ton direct et une diversité de contextes qui parlent autant aux décideurs qu’aux individus confrontés à des rapports de force plus discrets.
L’un des attraits majeurs du livre réside dans sa capacité à montrer que les conflits les plus déterminants ne se jouent pas toujours sur un champ de bataille classique : ils peuvent se dérouler dans une salle de réunion, au sein d’une équipe, ou même dans des échanges familiaux. Greene insiste sur la nécessité d’une discipline mentale à toute épreuve, sur l’art de brouiller les pistes, sur la valeur d’un repli stratégique face à un adversaire supérieur. Cette vision pragmatique, dénuée d’illusions, séduit par sa lucidité : elle prépare autant à affronter l’attaque frontale qu’à déjouer l’hostilité feutrée. Pour celui qui cherche à affiner sa pensée stratégique après Sun Tzu, « Stratégie – Les 33 lois de la guerre » déploie un arsenal intellectuel dense, ancré dans l’histoire mais tourné vers les combats d’aujourd’hui.
Aux éditions ALISIO ; 468 pages.
3. L’art de la guerre pour les femmes (Chin-Ning Chu, 2002)
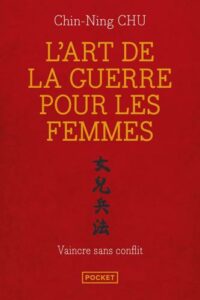
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
« L’art de la guerre pour les femmes » de Chin-Ning Chu part de la sagesse intemporelle de Sun Tzu pour en faire un guide pratique à l’usage des femmes dans leur vie professionnelle et personnelle. L’ouvrage s’appuie sur les principes du stratège chinois — obtenir le meilleur résultat en évitant les affrontements directs — et les adapte aux enjeux que peuvent rencontrer les femmes au travail ou dans leurs choix de vie. L’autrice y développe des axes comme la connaissance de soi, la définition claire de ses objectifs, l’art de s’adapter à son environnement, ou encore la capacité à créer et innover pour progresser sans renoncer à ses valeurs.
Ce livre intéressera particulièrement celles qui, après « L’Art de la guerre », veulent prolonger la réflexion en l’ancrant dans des situations concrètes et contemporaines. Chin-Ning Chu insiste sur la sélection des combats à mener, sur l’importance du timing et sur la maîtrise des rapports de force subtils. Elle transpose la notion de terrain de Sun Tzu au contexte du bureau : savoir lire un environnement, identifier les alliances possibles, anticiper les obstacles. Les conseils portent autant sur la stratégie d’influence que sur la protection de ses positions, avec des applications directes pour gérer la compétition, éviter les conflits stériles et transformer les périodes d’insatisfaction en levier de créativité.
L’intérêt de cet ouvrage tient aussi à son équilibre entre réflexion stratégique et recommandations applicables au quotidien. On y trouve des pistes pour renforcer son leadership même sans titre officiel, pour tirer parti de ses forces perçues comme atypiques, ou encore pour rester efficace en période de crise. Là où Sun Tzu parlait de victoire avant le combat, Chin-Ning Chu invite à se préparer mentalement et à adopter une posture qui inspire confiance et respect. Cette adaptation offre ainsi une continuité logique pour celles qui ont apprécié la clarté tactique de « L’Art de la guerre » et souhaitent la mettre au service de leurs ambitions, tout en conservant une cohérence entre éthique personnelle et réussite.
Aux éditions POCKET ; 272 pages.
4. Diplomatie (Henry Kissinger, 1994)
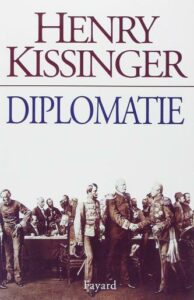
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
« Diplomatie » de Henry Kissinger retrace plusieurs siècles d’histoire des relations internationales, depuis l’Europe du XVIIe siècle jusqu’à la fin du XXe. L’ouvrage met en lumière les grandes figures politiques – de Richelieu à Bismarck, de Roosevelt à De Gaulle – et les stratégies qui ont façonné l’équilibre mondial. Kissinger y défend une vision réaliste de la politique étrangère, centrée sur la raison d’État et la Realpolitik, tout en analysant les tournants majeurs du siècle dernier : les deux guerres mondiales, la guerre froide, la détente, ou encore la recomposition géopolitique après 1991.
Ce livre intéressera tout lecteur de « L’Art de la guerre » pour sa manière d’articuler pensée stratégique et action concrète. Comme Sun Tzu, Kissinger s’attache à comprendre comment évaluer les forces en présence, choisir le moment opportun et adapter ses objectifs aux conditions réelles. Il montre, par des exemples historiques précis, que la survie et la prospérité des nations tiennent souvent à leur capacité à équilibrer puissance et prudence, ambition et lucidité. Là où Sun Tzu déploie des principes intemporels sur la conduite du conflit, Kissinger en observe l’application dans un contexte diplomatique, là où la négociation, la menace et l’alliance remplacent l’affrontement direct.
La lecture de « Diplomatie » offre aussi un éclairage sur les dilemmes que rencontrent les dirigeants : comment défendre ses intérêts sans déclencher un conflit ingérable ? Comment négocier avec un adversaire idéologique tout en préservant sa position ? Ces interrogations, Kissinger les illustre avec des cas comme la crise de Suez, les pourparlers sur le Vietnam ou la politique triangulaire entre Washington, Moscou et Pékin. Pour un lecteur sensible aux enseignements de Sun Tzu, ces récits montrent que la stratégie ne s’arrête pas aux champs de bataille : elle se joue aussi dans les salles de conférence, à travers des choix calibrés et des rapports de force souvent invisibles.
Aux éditions FAYARD ; 864 pages.
5. L’Art de la paix (Morihei Ueshiba, 1992)
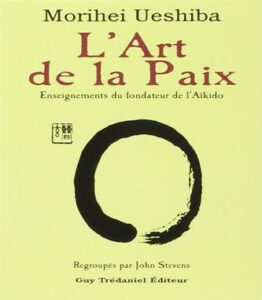
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
« L’Art de la paix » réunit les paroles, aphorismes et poèmes de Morihei Ueshiba, fondateur de l’aïkido, recueillis par son disciple John Stevens. Ueshiba y expose une vision où la voie du guerrier repose sur la compassion, la sagesse, le courage et l’harmonie avec la nature. La victoire ne passe pas par la force ou la destruction, mais par l’union avec l’univers et la capacité à désamorcer la violence. L’ouvrage, ponctué de courts enseignements, propose une philosophie applicable autant dans la pratique martiale que dans la vie quotidienne.
Pour un lecteur ayant apprécié « L’Art de la guerre », ce livre est un contrepoint. Là où Sun Tzu élabore des stratégies pour vaincre l’adversaire, Ueshiba invite à dépasser la logique de confrontation pour atteindre un état où il n’y a plus de vaincu. Cette approche ne nie pas le conflit, mais cherche à le résoudre par la maîtrise de soi, la lucidité et l’utilisation intelligente de l’énergie adverse. On y retrouve une même exigence de discipline, d’observation et d’adaptation, mais au service d’une finalité différente : préserver la vie plutôt que l’ôter.
L’intérêt du livre réside aussi dans son format condensé : chaque phrase est pensée pour être méditée et intégrée, comme un principe tactique que l’on affûte avec le temps. Loin des manuels de technique, « L’Art de la paix » agit comme un entraînement mental qui affine la perception et renforce la stabilité intérieure. Ses enseignements touchent autant à la stratégie qu’à la posture morale : comprendre la nature humaine, neutraliser sans blesser, accueillir l’imprévu sans perdre son centre.
En somme, ce texte offre à celle ou celui qui a goûté à la pensée de Sun Tzu une continuité dans l’étude du rôle du guerrier, mais en déplaçant le champ de bataille : il ne s’agit plus seulement de manœuvrer contre l’autre, mais aussi de transformer la relation que l’on entretient avec lui et avec le monde. C’est une lecture qui ne remplace pas « L’Art de la guerre », mais qui l’équilibre et le complète, en élargissant la notion de victoire.
Aux éditions GUY TRÉDANIEL ; 125 pages.
6. L’art du commandement (John Keegan, 1987)
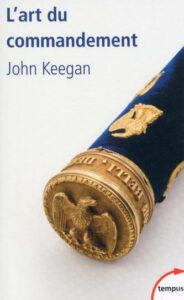
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
« L’art du commandement » de John Keegan suit le parcours de quatre figures majeures de l’histoire militaire — Alexandre le Grand, le duc de Wellington, Ulysses S. Grant et Adolf Hitler — pour comprendre comment leur époque, leur personnalité et leurs choix façonnent leur manière de diriger. Keegan montre qu’à chaque époque correspond une forme particulière de commandement : Alexandre, figure de l’héroïsme antique, mène ses hommes au cœur du combat ; Wellington incarne l’anti-héros méthodique, attentif à la discipline et à la préparation ; Grant représente la proximité avec ses troupes et l’adaptation aux réalités d’une guerre industrielle ; Hitler illustre un commandement centralisé et coupé du terrain, marqué par la propagande et les erreurs stratégiques. À travers ces portraits, l’auteur réfléchit à ce qui définit un chef et à la manière dont les évolutions technologiques et sociales transforment cette fonction.
Ce livre intéressera un lecteur de « L’Art de la guerre » parce qu’il prolonge la réflexion sur le rapport entre stratégie et leadership, mais en la plaçant dans un cadre historique concret et contrasté. Là où Sun Tzu élabore des principes intemporels, Keegan confronte ces principes aux réalités de contextes très différents : la guerre à cheval d’Alexandre n’impose pas les mêmes décisions que la guerre mécanisée du XXᵉ siècle, et encore moins que l’ère nucléaire. Cette mise en perspective historique permet de mesurer combien la position physique et symbolique d’un chef — sur le front, à proximité, ou à distance — influence la perception et l’efficacité de son commandement.
L’analyse de Keegan se démarque aussi par l’attention qu’il porte aux qualités humaines et aux limites des chefs : capacité à inspirer, clarté des ordres, maîtrise de soi, sens de l’exemple. Ces dimensions, déjà présentes chez Sun Tzu, prennent ici corps à travers des situations concrètes : un discours de Wellington avant la bataille, la manière dont Grant utilise le télégraphe pour coordonner plusieurs fronts, ou encore la rigidité d’Hitler face à la réalité du terrain. Le lecteur retrouve ainsi, sous un angle narratif et critique, l’interrogation centrale de « L’Art de la guerre » : comment diriger efficacement des hommes dans un contexte de conflit, et quels choix distinguent le stratège avisé du chef voué à l’échec.
Aux éditions TEMPUS ; 600 pages.
7. De la guerre (Carl von Clausewitz, 1832)
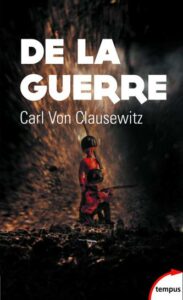
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
« De la guerre » de Carl von Clausewitz est un traité majeur, rédigé au XIXe siècle, qui cherche à comprendre la guerre dans toutes ses dimensions. S’appuyant sur son expérience des campagnes napoléoniennes et sur une réflexion théorique poussée, Clausewitz définit la guerre comme la « continuation de la politique par d’autres moyens ». Il analyse le rapport entre objectifs politiques et militaires, distingue stratégie et tactique, introduit des notions durables comme le « brouillard de guerre » ou la « friction », et met en évidence le rôle déterminant des facteurs moraux et psychologiques dans l’issue des conflits. Bien que l’ouvrage soit inachevé, il constitue l’une des pierres angulaires de la pensée stratégique occidentale.
Si vous avez apprécié « L’Art de la guerre » de Sun Tzu, ce livre propose un prolongement naturel, mais dans un autre cadre culturel et historique. Là où Sun Tzu privilégie la ruse, la flexibilité et l’économie des moyens, Clausewitz examine les affrontements sous l’angle d’un duel entre volontés politiques, en intégrant la complexité des institutions, de la société et des armées modernes de son temps. Sa réflexion, plus systématique, met en relief le lien indissociable entre guerre et contexte politique, ce qui éclaire des situations allant des conflits étatiques classiques aux tensions contemporaines.
L’intérêt réside aussi dans la profondeur psychologique que Clausewitz accorde au commandement. Il insiste sur la force de caractère, la lucidité face à l’incertitude, la capacité à décider dans la « semi-obscurité » où toute donnée est partielle. Ces qualités, pensées pour le champ de bataille, trouvent des échos dans d’autres domaines où il faut agir sous pression. Enfin, ses analyses sur la supériorité défensive, le point culminant de l’offensive ou la singularité de chaque guerre offrent un cadre de réflexion adaptable, qui aide à dépasser les recettes toutes faites et à penser la stratégie comme un art lié aux circonstances. C’est cette combinaison de rigueur conceptuelle et d’attention au réel qui fait de « De la guerre » un complément stimulant à Sun Tzu.
Aux éditions TEMPUS ; 448 pages.
8. Traité des cinq roues (Miyamoto Musashi, 1645)
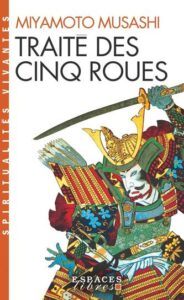
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Le « Traité des cinq roues » de Miyamoto Musashi naît dans les dernières années de vie du célèbre samouraï, alors qu’il se retire dans la grotte du Reigandō. Structuré en cinq chapitres – Terre, Eau, Feu, Vent et Vide – il expose les fondements de son école de sabre, la Hyōhō Niten Ichi Ryū. Chaque partie associe principes tactiques, observations issues de l’expérience et réflexions sur la posture, le rythme, la maîtrise des armes et l’état d’esprit du combattant. Musashi y décrit comment adapter ses méthodes aux circonstances, qu’il s’agisse d’un duel ou d’une bataille, et insiste sur l’importance de la pratique assidue et de l’adaptation constante. L’ouvrage alterne conseils techniques, considérations stratégiques et passages plus philosophiques, en particulier dans le dernier chapitre consacré au « Vide ».
Musashi, comme Sun Tzu, ne réduit pas la stratégie à une liste de manœuvres militaires : il en fait un état d’esprit, fondé sur l’observation, la maîtrise de soi et l’anticipation. Le texte invite à penser la confrontation dans toute sa diversité – confrontation physique, mais aussi affrontement d’intentions et de volontés. Les parallèles sont nombreux : connaissance de soi et de l’adversaire, capacité à tirer parti du terrain, recherche du moment juste pour agir. Là où Sun Tzu parle de souplesse et d’opportunité, Musashi illustre ces notions par des images concrètes, par exemple l’eau qui prend la forme du récipient ou la nécessité de « connaître le grand comme le petit ».
Le « Traité des cinq roues » ajoute toutefois une dimension propre à l’expérience du duel. Musashi insiste sur l’importance de ne pas s’enfermer dans une seule méthode, de comprendre et d’assimiler les forces et faiblesses d’autres écoles, de rester prêt à changer d’approche si la situation l’exige. Cette flexibilité, alliée à une discipline stricte, rejoint la philosophie de Sun Tzu tout en la plaçant au plus près de l’action individuelle. Enfin, le chapitre du « Vide » ouvre une perspective plus abstraite, qui dépasse la tactique immédiate pour toucher à la manière de percevoir et d’agir sans se laisser limiter par ce qui est visible ou convenu. Pour qui cherche, comme après « L’Art de la guerre », à approfondir la réflexion sur la stratégie, ce texte déploie une vision ancrée dans l’expérience et en même temps tournée vers l’universel.
Aux éditions ALBIN MICHEL ; 190 pages.
9. Le Prince (Nicolas Machiavel, 1532)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
« Le Prince » de Nicolas Machiavel paraît en 1532, quelques années après la mort de son auteur. Ce traité, rédigé à l’origine pour Laurent de Médicis, s’appuie sur l’expérience politique de Machiavel et sur de nombreux exemples tirés de l’histoire antique et de l’Italie de la Renaissance. L’ouvrage décrit les différents types de principautés, les moyens de conquérir et de conserver le pouvoir, les choix militaires qui assurent la stabilité d’un État, et les comportements qui permettent à un dirigeant de se maintenir face aux menaces internes ou externes. La morale y occupe une place secondaire : ce qui compte avant tout, c’est l’efficacité dans l’action et la capacité à s’adapter aux circonstances.
« Le Prince » prolonge la réflexion stratégique de « L’Art de la guerre », mais en l’appliquant au champ politique. Sun Tzu analyse la préparation, la discipline et l’usage judicieux de la force militaire ; Machiavel, lui, montre comment ces mêmes principes peuvent soutenir un pouvoir civil et consolider un État. Les deux partagent une idée centrale : un dirigeant ne peut se contenter de bonnes intentions, il doit savoir agir de façon décisive, parfois brutale, pour préserver son autorité. Chez Machiavel, la maîtrise de l’art militaire est indissociable du gouvernement : un prince qui néglige la guerre se condamne à perdre son trône. Ce dernier insiste aussi sur l’importance de lire le terrain — non pas seulement les champs de bataille, mais les rapports de force politiques, les alliances, les inimitiés — et de choisir le moment propice pour agir.
L’intérêt pour l’amateur de Sun Tzu tient aussi à la lucidité avec laquelle Machiavel aborde la nature humaine : il ne part pas de ce que les hommes devraient être, mais de ce qu’ils sont. Comme dans « L’Art de la guerre », cette lucidité sert à élaborer des stratégies réalistes, capables de résister aux coups du sort. Les conseils donnés — qu’il s’agisse de gagner l’appui du peuple, de neutraliser les rivaux ou de gérer la crainte et l’amour qu’inspire le dirigeant — forment un ensemble cohérent de principes d’action. Ce mélange d’analyse froide, d’attention à la préparation et de sens du moment en fait un complément naturel à la lecture de Sun Tzu, avec la différence que Machiavel s’adresse directement à celui qui détient le pouvoir civil et non au seul chef militaire.
Aux éditions FOLIO ; 480 pages.
10. Pensées pour moi-même (Marc Aurèle, 180)
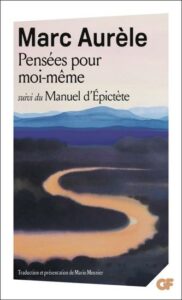
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
« Pensées pour moi-même » rassemble les réflexions que Marc Aurèle rédige pour lui seul, sans intention de publication. Empereur romain au IIᵉ siècle et philosophe stoïcien, il y consigne, en douze livres, de courts textes qui mêlent conseils, rappels et exhortations. Écrits pour maintenir sa propre droiture en pleine instabilité politique et militaire, ces fragments abordent la maîtrise de soi, le devoir envers la communauté, l’acceptation de la mort et la capacité à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. L’ensemble forme une sorte de manuel de vie où la lucidité face à l’impermanence s’accompagne d’une exigence morale constante.
Pour qui a apprécié « L’Art de la guerre » de Sun Tzu, ce livre propose un autre versant de la discipline et de la stratégie : celle qui se mène à l’intérieur de soi. Là où Sun Tzu met en avant l’importance de la préparation, du discernement et de l’adaptation pour vaincre un ennemi extérieur, Marc Aurèle rappelle que la bataille la plus difficile est souvent contre nos propres jugements, nos émotions et nos désirs. Ses pages enseignent à rester maître de ses réactions, à voir chaque événement comme une composante d’un ordre global, et à agir en cohérence avec ses valeurs, quelles que soient les circonstances.
La proximité entre les deux ouvrages tient aussi à leur concision et à leur nature pratique : chacun condense une pensée en maximes simples, directement utilisables dans la vie courante. Chez Marc Aurèle, ces formules servent à forger une « citadelle intérieure » qui protège des aléas et des pressions extérieures ; elles renforcent la capacité à rester clairvoyant au milieu de l’incertitude. Ainsi, le lecteur de Sun Tzu retrouvera dans « Pensées pour moi-même » cette même recherche d’équilibre entre lucidité et action juste, avec pour terrain non pas le champ de bataille, mais l’ensemble de l’existence.
Aux éditions FLAMMARION ; 222 pages.