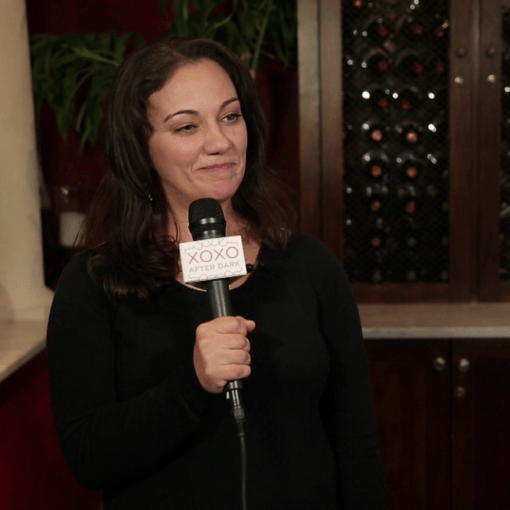Janine Boissard est une romancière française née le 18 décembre 1932 dans le 7e arrondissement de Paris. Issue d’une famille bourgeoise – son père était sous-gouverneur d’une banque et elle est la petite-fille d’Adéodat Boissard – elle débute sa carrière littéraire à 22 ans avec son premier roman « Driss », publié sous le nom de Janine Oriano.
En 1971, elle marque l’histoire en devenant la première femme publiée dans la célèbre « Série noire » de Gallimard avec « B comme Baptiste ». Après quelques polars, dont « OK Léon » adapté au cinéma, elle change de registre et connaît un immense succès populaire avec la série « L’Esprit de famille » à partir de 1979.
Au cours d’une carrière s’étendant sur plus de 60 ans, Janine Boissard a écrit plus de cinquante livres, touchant un large public avec ses romans dits « populaires », une étiquette qu’elle revendique avec fierté. Plusieurs de ses œuvres ont été adaptées à la télévision et au cinéma, notamment « L’Esprit de famille », « Une femme en blanc » et « Marie-Tempête ».
Qualifiée de « virtuose d’un style simple » par Paris-Match et de « plume inoxydable » par Le Figaro, elle continue d’écrire et de publier régulièrement, son dernier roman « Elle parlait aux fleurs » étant paru en 2023 chez Fayard.
Voici notre sélection de ses romans majeurs.
1. L’Esprit de famille (1979)
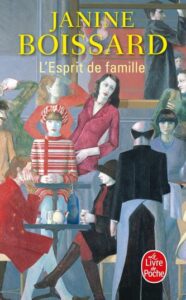
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Dans la banlieue parisienne des années 1970, la famille Moreau mène une existence paisible à La Marette, une maison entourée de pommiers. Le père exerce comme médecin généraliste tandis que la mère veille sur leurs quatre filles : Claire, 21 ans, qui cherche encore sa voie ; Bernadette, 19 ans, passionnée d’équitation ; Pauline, 17 ans, qui rêve de devenir écrivaine ; et Cécile, 13 ans, la plus espiègle.
À travers le regard de Pauline, nous suivons le quotidien de cette famille unie mais dissemblable, entre disputes et réconciliations. L’arrivée impromptue de l’amour dans la vie de la narratrice bouleverse cet équilibre : elle s’éprend de Pierre, un homme de 40 ans qui partage déjà sa vie avec une compagne et leur fille. Cette relation impossible confronte l’adolescente aux premiers chagrins amoureux.
Autour du livre
Publié en 1979, « L’Esprit de famille » ouvre une saga en six tomes qui a marqué toute une génération. Cette chronique familiale des années 1970 se lit comme une version modernisée des « Quatre filles du Docteur March », transposée dans la banlieue parisienne. La maison familiale, La Marette, s’érige en personnage à part entière – un refuge chaleureux où chaque membre revient puiser force et réconfort.
Janine Boissard puise dans son propre vécu pour nourrir cette fresque : elle-même a grandi dans une fratrie de quatre sœurs et un frère. Cette proximité avec son sujet insuffle une authenticité aux dynamiques familiales décrites. La romancière saisit avec justesse les tensions et les liens qui unissent les sœurs Moreau, leurs disputes comme leurs moments de complicité.
Le succès du livre a conduit à son adaptation en feuilleton télévisé au début des années 1980, avec le regretté Maurice Biraud dans le rôle du père. La série a contribué à étendre la popularité de l’œuvre, incitant de nombreux téléspectateurs à découvrir les romans. Chaque tome suivant se concentre sur une des filles : « L’Avenir de Bernadette » (1980), « Claire et le bonheur » (1981), « Moi Pauline » (1981), puis « Cécile la poison » (1984) et « Cécile et son amour » (1984).
La relation controversée entre Pauline, 17 ans, et Pierre, 40 ans, suscite des réactions contrastées chez la critique. Si ce « grand amour » pouvait paraître acceptable dans les années 1980, les relectures contemporaines questionnent davantage cette différence d’âge et la nature de cette relation. Cette évolution des perceptions témoigne des changements sociétaux survenus depuis la publication initiale.
« L’Esprit de famille » continue de séduire les nouvelles générations, notamment par sa capacité à transcender son époque. Les thèmes universels – les premiers émois amoureux, les conflits générationnels, la quête d’identité – résonnent toujours auprès des lecteurs actuels. Le livre conserve sa place dans le paysage littéraire français comme un témoignage sur la vie familiale des années 1970.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 221 pages.
2. La Maison des enfants (2000)
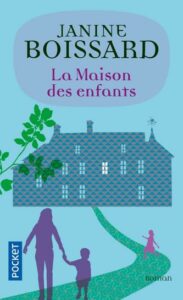
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
À quarante ans, Margaux Lespoir a rangé sa blouse de chirurgienne après la mort accidentelle de son compagnon sur sa table d’opération. Désormais, elle travaille au Ministère de la Santé à Paris, où elle s’occupe des dossiers d’enfants maltraités. Sa nouvelle mission l’amène à Auxerre pour enquêter sur le suicide d’une fillette de onze ans dans un établissement spécialisé, « La Maison des enfants ».
Sur place, Margaux découvre une équipe exceptionnelle qui se bat pour offrir un nouveau départ à des enfants meurtris par la vie. France, rescapée du Cambodge amputée d’une jambe ; Kenza, délaissée depuis la naissance de son petit frère ; Martin, muet depuis qu’il a vu son frère se noyer – chaque enfant porte ses blessures. Touchée par leur histoire et séduite par l’engagement de l’équipe, Margaux décide de quitter son poste au Ministère pour rejoindre l’établissement.
Mais « La Maison des enfants » fait l’objet de pressions : des notables locaux cherchent à la faire fermer pour des raisons douteuses. Entre son combat pour sauver le refuge et une histoire d’amour naissante avec Brice, le pédiatre-sophrologue, Margaux retrouve peu à peu le goût de vivre et d’aider les autres.
Autour du livre
« La Maison des enfants » s’inscrit dans la continuité de « Une femme en blanc », dont Janine Boissard reprend l’héroïne Margaux Lespoir. Cette suite délaisse l’univers médical pour se concentrer sur le domaine social et la protection de l’enfance. Les personnages secondaires, minutieusement construits, contribuent à la crédibilité du récit : une équipe médicale engagée, des enfants aux histoires singulières comme France, rescapée du Cambodge, ou Martin, devenu muet après un traumatisme.
La force du texte réside dans sa capacité à traiter un sujet grave – la maltraitance infantile – sans tomber dans le mélodrame. Les moments de tension alternent avec des séquences plus légères, notamment grâce à l’humour que Janine Boissard insuffle à certaines scènes. L’intrigue principale se double d’une histoire d’amour et de rivalités locales qui dynamisent le récit sans jamais éclipser le propos central sur la protection de l’enfance.
Les situations décrites sonnent juste, en particulier dans la présentation des différentes formes de traumatismes : physiques, psychologiques, familiaux. Le personnage d’Hugues illustre la complexité du sujet – un enfant qui exprime sa souffrance par la malveillance, avec une évolution incertaine. Cette nuance dans le traitement des personnages évite l’écueil d’une vision simpliste de la réhabilitation.
Le dénouement autour d’un concours de chant symbolise la réinsertion possible de ces enfants dans la société, tout en maintenant une certaine retenue – tous les problèmes ne se résolvent pas comme par magie. Cette sobriété dans le traitement du sujet, couplée à une écriture accessible, explique l’accueil favorable reçu par ce livre qui réussit le pari difficile de divertir tout en sensibilisant à une cause sociale majeure.
Aux éditions POCKET ; 448 pages.
3. Loup, y es-tu ? (2009)
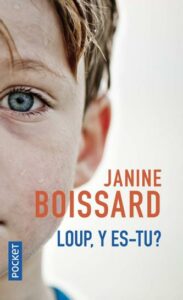
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Manon, 28 ans, mène une vie tranquille à Paris où elle travaille comme présentatrice à la télévision. Un soir, en rentrant chez elle, elle découvre sur son paillasson un petit garçon de quatre ans accompagné d’un mystérieux message : « Sauvez-le ». Cet incident va faire voler en éclats sa vie soigneusement organisée et la ramener vers les zones d’ombre de son histoire familiale.
L’enfant semble lié à Agathe, la sœur cadette de Manon, officiellement morte quatre ans plus tôt dans l’incendie d’une villa sicilienne. Déterminée à comprendre, Manon quitte Paris pour l’Italie. Son enquête la conduit sur les traces d’Agathe, qui s’était enfuie à seize ans du domicile familial pour échapper à l’emprise d’un père autoritaire. Elle découvre peu à peu les liens troublants entre sa sœur et un membre influent de la mafia locale.
Autour du livre
« Loup, y es-tu ? » marque un virage dans la bibliographie de Janine Boissard, connue jusqu’alors pour ses sagas familiales comme « L’Esprit de famille », best-seller des années 70 adapté à l’écran. Cette fois-ci, l’intrigue s’apparente davantage à un thriller psychologique, sans pour autant délaisser les thèmes qui ont fait le succès de l’autrice : les liens familiaux, la résilience, la quête d’identité.
La construction du récit en trois temps donne son rythme particulier à l’histoire. La première partie suit Manon dans sa découverte de l’enfant et ses premières investigations. La deuxième adopte le point de vue de Juan, le détective, qui poursuit l’enquête en Sicile. La dernière, intitulée « Monagathe », apporte les pièces manquantes du puzzle et mène à un dénouement inattendu. Les phrases en italien parsemées dans le texte ajoutent une touche d’authenticité à l’atmosphère sicilienne.
Les personnages secondaires contribuent aussi à la force du récit. Le duo formé par Vic et Armelle, qui prennent Manon sous leur protection après l’incident de la tasse de café renversée, insuffle une note de tendresse et d’humour. Le père tyrannique et la mère soumise incarnent quant à eux les blessures du passé qui hantent encore la protagoniste.
Si certains critiques relèvent des similitudes avec les romans de Marc Lévy, Guillaume Musso ou Harlan Coben dans le traitement des secrets de famille, Janine Boissard réussit néanmoins à imposer sa propre voix. Elle évite les écueils du genre en privilégiant la justesse émotionnelle à l’accumulation de rebondissements artificiels.
Aux éditions POCKET ; 384 pages.
4. Belle-grand-mère (1983)
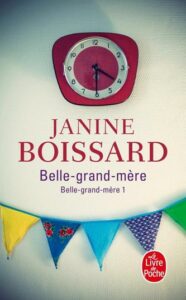
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Dans les années 80, Joséphine, surnommée « Babou », règne sur une grande maison en Normandie. À presque 60 ans, cette grand-mère moderne partage sa vie entre son mari, dit « Le Pacha », un ancien marin au caractère autoritaire, et une tribu qui débarque chaque week-end : ses deux filles, leurs enfants et les nouveaux venus d’une famille recomposée. Seule ombre au tableau : l’absence de son fils Thibaut, parti au Brésil après une violente dispute avec son père.
Le quotidien de Babou oscille entre petits bonheurs et défis de la vie. Elle doit gérer le harcèlement scolaire dont souffre son petit-fils Timothée, organiser le remariage de sa fille à l’église orthodoxe et accueillir le fils malade de son gendre, en attente d’une greffe. Face à ces épreuves, Babou ne renonce pas à ses aspirations personnelles et tente de s’épanouir au-delà de son rôle familial, notamment à travers la peinture.
Autour du livre
Premier tome d’une quadrilogie qui se poursuit avec « Chez Babouchka » (1994), « Toi, mon pacha » (1999) et « Allô, Babou… viens vite ! On a besoin de toi » (2004), « Belle-grand-mère » s’inscrit dans la lignée de « L’Esprit de famille », précédent succès de Janine Boissard adapté pour la télévision. Cette saga des années 80 met en scène les bouleversements de la société française à travers le prisme d’une famille recomposée. La force du livre réside dans sa capacité à saisir les mutations sociales de l’époque : l’émergence de nouvelles configurations familiales et l’évolution du rôle des grands-parents.
Il convient de souligner la double lecture possible de l’œuvre : d’un côté, une chronique familiale légère et optimiste qui séduit par son ton enjoué, de l’autre, une réflexion plus profonde sur l’émancipation féminine et les défis de la famille contemporaine. Certains lecteurs apprécieront cette dualité quand d’autres regretteront des personnages secondaires trop nombreux et parfois superficiels. Le personnage de Babou cristallise ces tensions : femme épanouie ou grand-mère sacrifiée ? La question divise les critiques, entre ceux qui saluent ce portrait novateur et ceux qui le trouvent artificiel.
« Belle-grand-mère » fait écho aux préoccupations de son époque tout en conservant une certaine actualité. Les thématiques abordées – harcèlement scolaire, conflits intergénérationnels, équilibre entre vie personnelle et familiale – résonnent encore aujourd’hui, même si leur traitement peut paraître daté à certains lecteurs contemporains.
Le roman a connu une adaptation télévisée avec Macha Méril dans le rôle de Babou et Victor Lanoux dans celui du Pacha. Une suite, « La Trattoria », a également été portée à l’écran, preuve du succès rencontré par ces personnages auprès du public.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 224 pages.
5. Charlotte et Millie (2001)
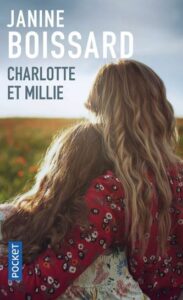
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Début des années 2000. Charlotte règne en maîtresse accomplie sur sa demeure strasbourgeoise où elle reçoit ministres et notables pour le compte de son mari ingénieur. Mais derrière cette façade parfaite, cette mère de trois enfants étouffe dans son rôle de femme au foyer. Le décès soudain de son père, maire d’un village du Haut-Rhin et fabricant de jouets en bois, fait basculer son existence.
Pour sauver l’atelier paternel menacé de destruction et empêcher l’implantation d’une grande surface, Charlotte se lance dans la bataille des élections municipales. Cette initiative divise sa famille : Millie, sa fille cadette de douze ans, et son fils l’encouragent, tandis que son mari et leur aînée désapprouvent. Son principal adversaire politique n’est autre que son amour de jeunesse d’il y a vingt ans, prêt à tout pour l’empêcher d’accéder à la mairie.
Autour du livre
Cette histoire de réinvention personnelle s’inscrit dans la continuité thématique des œuvres précédentes de Janine Boissard, notamment « L’Esprit de famille ». Le personnage de Millie la Furette évoque d’ailleurs fortement Cécile, surnommée la Poison, une figure marquante de cette saga antérieure. Publié en 2001 aux éditions Robert Laffont, « Charlotte et Millie » se situe précisément au moment où le téléphone portable commence à entrer dans les mœurs quotidiennes, un repère temporel qui ancre l’histoire dans une époque charnière.
La structure narrative à deux voix constitue la particularité majeure du texte : les chapitres alternent entre le point de vue de Charlotte et celui de sa fille Millie, une préadolescente qui rappelle le personnage de Zazie par sa verve et sa franchise. Cette dualité des regards enrichit la dimension familiale du récit et multiplie les angles d’observation sur les événements.
Les lectrices et lecteurs des années 1980-1990 retrouvent ici les ingrédients qui ont fait le succès de Boissard : des conflits familiaux, une héroïne en quête d’épanouissement, et une dimension sociale contemporaine – ici la politique municipale et la menace de la grande distribution sur le petit commerce. Contrairement à « Une femme en blanc » (1996) qui avait bénéficié d’une adaptation télévisée avec Sandrine Bonnaire, « Charlotte et Millie » n’a pas connu de transposition à l’écran malgré son potentiel dramatique.
Le livre s’inscrit dans une période prolifique pour Boissard qui, après avoir signé neuf romans sous le nom d’Oriano, a construit une œuvre considérable couronnée par les Palmes Académiques pour son action auprès de la jeunesse. Son engagement envers ce public transparaît notamment dans le personnage de Millie, qui porte un regard acéré sur le monde des adultes.
Aux éditions POCKET ; 512 pages.
6. Chuuut ! (2013)
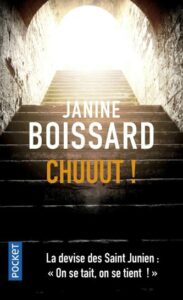
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Au cœur des vignobles de Cognac trône le château des Saint-Junien, où le patriarche Edmond règne sur son empire familial et ses précieuses vignes. Dans ce domaine divisé en appartements pour chacun de ses enfants, une aile reste inhabitée : celle de Roselyne, la fille aînée disparue sans laisser de traces. Un jour, Nils, son fils de 18 ans dont l’existence était restée secrète, frappe à la porte du château après la mort de sa mère.
Si les grands-parents et certains cousins, notamment la timide Fine, l’accueillent chaleureusement, d’autres membres de la famille restent sur leurs gardes. Le drame éclate lorsque la petite Maria, la fille des gardiens, est découverte sans vie. Les soupçons se portent immédiatement sur Nils. Emprisonné malgré ses protestations, il sort avant terme pour bonne conduite et revient au château, résolu à démasquer le véritable coupable.
Autour du livre
Publié en 2013, ce livre s’inscrit dans la longue série des succès de Janine Boissard, qui compte plus de 50 romans en 50 ans de carrière. La narration alterne les points de vue entre plusieurs personnages, notamment Fine, Nils et l’avocate. Cette technique permet de multiplier les angles d’approche sur les événements et de mieux cerner la psychologie des protagonistes. Toutefois, la narration à la première personne se limite principalement à Fine, ce qui relègue les autres chapitres au second plan.
Le monde de la noblesse charentaise y apparaît avec justesse, sans tomber dans les clichés attendus malgré un cadre propice (grande maison familiale, famille bourgeoise à la limite de la noblesse). Les personnages, bien que caractérisés avec finesse, conservent leur part de mystère et peuvent surprendre le lecteur. Le thème central des secrets de famille se révèle rapidement, peut-être trop selon certains lecteurs qui devinent les révélations avant leur dévoilement.
La dimension sociale mérite une attention particulière : l’histoire aborde des sujets contemporains comme l’autisme – même si le traitement de ce thème fait débat parmi la critique – et propose une réflexion sur l’évolution des mentalités dans les milieux traditionnels. Le comportement final des personnages, particulièrement ouvert d’esprit pour leur milieu social et leur génération, témoigne d’une volonté d’ancrer le récit dans son époque.
À mi-chemin entre le polar et la saga familiale, « Chuuut ! » ne se laisse pas facilement classer dans un genre. L’enquête policière, bien que secondaire, sert de catalyseur pour déplier les dynamiques familiales et les mécanismes de protection d’un clan face aux menaces extérieures.
Aux éditions POCKET ; 352 pages.