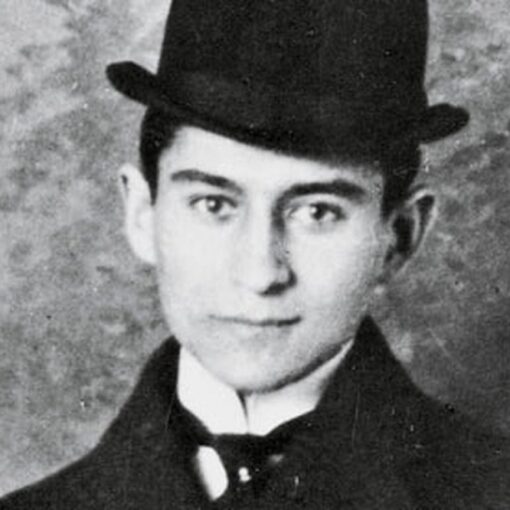Erich Maria Remarque (1898-1970) est l’un des écrivains allemands les plus marquants du XXe siècle. Né Erich Paul Remark à Osnabrück, il change son nom en hommage à sa mère décédée et adopte « Maria » comme second prénom en 1922.
Mobilisé pendant la Première Guerre mondiale en 1917, il est blessé par des éclats de grenade après seulement quelques semaines au front. Cette expérience traumatisante inspirera son chef-d’œuvre « À l’Ouest rien de nouveau » (1929), roman pacifiste qui connaît un succès mondial retentissant.
Avec l’arrivée des nazis au pouvoir, Remarque s’exile d’abord en Suisse en 1933. Ses livres sont brûlés lors des autodafés et il est déchu de sa nationalité allemande en 1938. La barbarie du régime nazi le touche personnellement : sa sœur Elfriede est exécutée en 1943 pour « atteinte au moral de l’armée ».
Émigré aux États-Unis, il obtient la nationalité américaine en 1947. Sa vie privée est marquée par ses relations avec des personnalités d’Hollywood, notamment l’actrice Paulette Goddard qu’il épouse en 1958. Il partage alors sa vie entre les États-Unis et sa villa de Porto Ronco en Suisse, où il meurt en 1970.
Son œuvre, profondément marquée par ses expériences personnelles, comprend plusieurs romans majeurs comme « Les camarades » (1936), « Arc de Triomphe » (1945) et « La nuit de Lisbonne » (1962). Ses livres, traduits dans de nombreuses langues et adaptés au cinéma, témoignent des bouleversements de son époque et portent un message humaniste et pacifiste.
Voici notre sélection de ses romans majeurs.
1. À l’Ouest rien de nouveau (1929)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
En 1916, Paul Bäumer, un jeune Allemand de 19 ans, s’engage dans l’armée avec ses camarades de classe après avoir cédé aux discours patriotiques de son professeur. Après dix semaines d’entraînement sous les ordres d’un caporal tyrannique, les gamins découvrent la réalité brutale du front occidental. Les bombardements incessants, la boue des tranchées, la vermine, la faim et la mort omniprésente brisent rapidement leurs illusions patriotiques.
Au fil des mois, Paul voit ses amis tomber les uns après les autres. Entre deux assauts meurtriers, il tente de préserver son humanité à travers la camaraderie avec les survivants, en particulier le vétéran Katczinsky qui devient son mentor. Lors d’une permission, le retour à la vie civile lui paraît impossible tant le fossé s’est creusé avec ceux qui n’ont pas connu les tranchées. Même sa mère malade ne peut comprendre ce qu’il a vécu. Dans un trou d’obus, Paul tue un soldat français et reste coincé une journée entière près du cadavre, rongé par la culpabilité.
Autour du livre
À travers les yeux d’un jeune soldat allemand de 19 ans, « À l’Ouest rien de nouveau » livre un témoignage saisissant sur l’absurdité et l’horreur de la Première Guerre mondiale. Dans ce texte devenu un classique de la littérature antibelliqueuse, Remarque puise dans sa propre expérience du conflit, bien que brève – il ne passe qu’un mois sur le front avant d’être grièvement blessé et évacué vers un hôpital militaire de Duisbourg.
La genèse de l’œuvre remonte à l’été 1917, lorsque Remarque commence à recueillir les témoignages d’autres soldats blessés pendant sa convalescence. Ces récits, conjugués à ses observations consignées dans un journal intime entre août et octobre 1918, constituent la matière première du roman qu’il entreprend d’écrire dix ans plus tard. Le manuscrit, d’abord refusé par l’éditeur S. Fischer, trouve finalement preneur chez Ullstein qui en publie des extraits dans la Vossische Zeitung fin 1928 avant la parution en volume en janvier 1929.
Le succès est immédiat et retentissant : en à peine onze semaines, 450 000 exemplaires sont vendus en Allemagne. Dans les dix-huit mois qui suivent, plus de 2,5 millions de copies s’écoulent dans 25 langues différentes. Cette réception exceptionnelle s’explique en partie par le moment de publication : alors que l’Allemagne se relève difficilement des séquelles du conflit, le roman offre un contrepoint brutal aux récits héroïques qui dominent la littérature de guerre de l’époque.
La force du texte réside dans sa capacité à rendre tangible la déshumanisation progressive des soldats. Les jeunes recrues, manipulées par des discours patriotiques, découvrent rapidement que leurs idéaux ne résistent pas à la réalité des tranchées. La camaraderie, présentée initialement comme une valeur rédemptrice, se révèle être un mécanisme de survie psychologique face à l’omniprésence de la mort.
Les nazis ne s’y trompent pas : dès 1930, ils organisent des manifestations violentes contre les projections du film tiré du roman. En 1933, le livre figure parmi les premiers brûlés lors des autodafés orchestrés par le régime. Remarque, privé de sa nationalité allemande, s’exile en Suisse puis aux États-Unis.
Le roman inspire trois adaptations cinématographiques majeures : celle de Lewis Milestone en 1930, récompensée par deux Oscars, une version télévisée en 1979 par Delbert Mann, et plus récemment, en 2022, une production allemande d’Edward Berger pour Netflix, qui remporte également de nombreuses récompenses dont quatre Oscars.
La dimension universelle du message trouve un écho dans des domaines artistiques divers : de la musique avec une chanson d’Elton John en 1983 à la bande dessinée avec une adaptation en roman graphique par Peter Eickmeyer en 2014. Cette pérennité témoigne de la puissance d’un récit qui transcende son contexte historique pour interroger la nature même de la guerre et ses effets dévastateurs sur l’humanité.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 224 pages.
2. Après (1931)
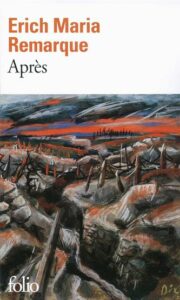
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Novembre 1918. Dans les tranchées des Flandres, Ernst Birkholz et les 31 autres survivants de sa compagnie apprennent la fin de la guerre. Ces jeunes soldats allemands, qui ont quitté les bancs de l’école pour le front quelques années plus tôt, s’apprêtent à rentrer chez eux, la tête encore pleine des horreurs des combats.
Le retour s’avère plus difficile que prévu. L’Allemagne qu’ils retrouvent, vaincue et affamée, n’a plus rien de celle qu’ils ont quittée. Leurs familles ne les reconnaissent plus, leurs fiancées sont parties, leurs emplois ont été donnés à d’autres. Ernst tente de reprendre ses études d’instituteur, mais comment enseigner quand les cris des mourants résonnent encore dans sa tête ? Comment reprendre une vie normale quand on a passé des années à tuer ? Ses camarades connaissent des destins tragiques : la folie, le suicide, la prison.
Autour du livre
Publié en 1931, « Après » est la suite naturelle de « À l’Ouest rien de nouveau ». Elle prolonge la réflexion sur les séquelles de la Première Guerre mondiale dans l’Allemagne d’après-guerre. Entre décembre 1930 et janvier 1931, le récit paraît d’abord en feuilleton dans la Vossische Zeitung, avant d’être édité en volume en avril 1931. Le succès immédiat se solde par des traductions dans 25 langues et la vente de plus de 180 000 exemplaires en Allemagne dès les premières semaines.
La singularité du texte réside dans son parti pris narratif : plutôt que de dépeindre les horreurs du front, Erich Maria Remarque s’attache à montrer comment la guerre continue de hanter ceux qui en reviennent. Le traumatisme se manifeste jusque dans les gestes les plus quotidiens : les anciens soldats volent de la nourriture par réflexe alors qu’elle est disponible, sursautent au moindre bruit, tandis que leurs nuits se peuplent de cauchemars. Cette inadaptation à la vie civile se double d’une incompréhension mutuelle avec leurs proches, qui ne peuvent concevoir ce qu’ils ont vécu. Une scène emblématique montre une mère s’offusquant d’une vulgarité de son fils, sans réaliser que cette grossièreté n’est que la partie émergée d’un iceberg de souffrances qu’elle ne soupçonne pas.
La structure narrative alterne entre le présent de la démobilisation et des flashbacks du front, un effet de superposition entre deux réalités qui ne parviennent pas à coexister. Cette technique souligne l’impossibilité pour les personnages de se défaire de leur expérience guerrière : le front les a marqués d’une empreinte indélébile.
Dans l’Allemagne de 1930-1931, minée par la crise économique et la montée des extrêmes, le livre prend une résonance particulière. Une scène prémonitoire montre des adolescents en uniforme s’entraînant au drill militaire et traitant les vétérans de « traîtres » et de « bolcheviques ». Ce passage annonce la militarisation de la jeunesse qui caractérisera le régime nazi. D’ailleurs, le roman sera interdit et brûlé publiquement par les nazis en mai 1933, aux côtés de « À l’Ouest rien de nouveau ».
Une adaptation cinématographique voit le jour en 1937 sous la direction de James Whale, mais le contexte politique de l’époque conduit à en édulcorer considérablement le propos. Les pressions du régime nazi sur Hollywood aboutissent à une version fade qui trahit l’esprit du livre.
Les critiques de l’époque saluent majoritairement l’authenticité et la force du récit, même si certains lui reprochent de ne pas assez approfondir la situation politique allemande. Les critiques américains soulignent particulièrement sa dimension humaniste. Heinrich Mann compte parmi ses grands admirateurs.
Aux éditions FOLIO ; 400 pages.
3. Les camarades (1936)
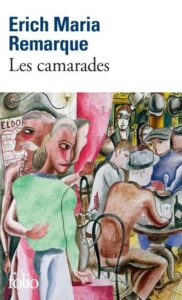
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
« Les camarades » se déroule dans une grande ville allemande à la fin des années 1920. Robert Lohkamp et ses deux amis, Otto Köster et Gottfried Lenz, rescapés comme lui des tranchées de 14-18, subsistent grâce à leur garage automobile. Dans un pays ravagé par l’inflation et le chômage, le trio s’accroche à leur amitié forgée pendant la guerre.
Le quotidien de Robert bascule quand il rencontre Pat Hollmann, une jeune femme issue d’un milieu aisé. Leur passion naît dans les bars enfumés et les courses automobiles. Mais cette parenthèse heureuse s’effondre brutalement : Pat contracte la tuberculose et doit se réfugier dans un sanatorium suisse. Dans le même temps, la violence politique s’empare des rues, le garage fait faillite, et Lenz succombe à une balle perdue lors d’affrontements avec des militants nazis.
Autour du livre
Publié initialement en danois en 1936 avant sa parution en allemand, « Les camarades » est un témoignage saisissant sur l’Allemagne de l’entre-deux-guerres. Son écriture s’étend sur quatre années, de 1932 à 1936, période durant laquelle Remarque vit en exil. Cette genèse particulière teinte l’œuvre d’une lucidité prophétique sur la montée du nazisme.
La force du roman réside dans sa capacité à entremêler l’intime et le collectif. Les traumatismes de la Première Guerre mondiale imprègnent chaque page, même lorsqu’ils ne sont pas directement évoqués. Les personnages secondaires, bien que fugaces, acquièrent une densité remarquable : le peintre Ferdinand qui tire sa subsistance des portraits de défunts, Rosa la prostituée qui tricote pour sa fille placée en orphelinat, ou encore le comptable allemand dont le nationalisme s’éveille progressivement.
L’argent, ou plutôt son absence, structure les destins. La précarité omniprésente pousse certains au suicide, d’autres à la prostitution. Dans ce contexte, l’amitié entre les trois protagonistes constitue un rempart contre le chaos social. Leur garage automobile devient un îlot de résistance où subsistent l’entraide et l’humanité.
Le nazisme n’est jamais nommé explicitement mais sa présence sourde traverse le récit, notamment lors de l’assassinat de Lenz par un militant. Cette montée des périls se lit également dans l’évolution des conversations au café International, où les discussions glissent progressivement vers le fanatisme politique.
La réception du roman témoigne de sa portée subversive : interdit en Allemagne jusqu’en 1951, il est brûlé sur ordre de Goebbels qui qualifie Remarque de « défaitiste ». Le livre connaît néanmoins un succès international, adapté dès 1938 à Hollywood par Frank Borzage avec Robert Taylor et Margaret Sullavan.
L’héritage des « Camarades » perdure à travers de multiples adaptations : théâtrales en Russie (1999), télévisées (mini-série de 2012), ou encore cinématographiques comme « Flowers from the Victors » (1999) d’Aleksander Surin qui transpose l’intrigue dans la Russie des années 1990. Cette universalité du propos, par-delà les époques et les frontières, souligne la puissance d’un texte qui interroge la possibilité même du bonheur dans un monde en déliquescence.
Aux éditions FOLIO ; 560 pages.
4. Arc de Triomphe (1945)
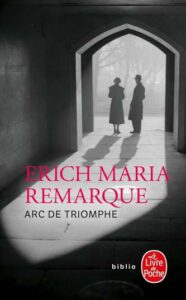
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Paris, 1938. Le docteur Ravic, chirurgien allemand ayant fui le nazisme, survit dans la clandestinité. Déchu de sa nationalité après avoir été torturé par la Gestapo et interné en camp de concentration, il opère sous couvert de médecins français moins compétents qui ne lui reversent que 10 % des honoraires. La nuit, il soigne les prostituées et répare les dégâts des avortements clandestins dans les bas-fonds de la capitale.
L’apparition de Jeanne Madou bouleverse sa vie. Cette chanteuse aux origines roumaines ranime en lui une flamme qu’il croyait éteinte. Leur amour chaotique traverse les épreuves : une expulsion vers la Suisse après un contrôle de police, une liaison parallèle avec un acteur. Mais les fantômes du passé resurgissent. Car dans ce Paris qui danse au bord du gouffre, Ravic croise un jour l’homme qui l’a jadis torturé en Allemagne.
Les derniers jours de paix s’égrènent dans une ville qui refuse de voir monter la menace de guerre. Entre les bars enfumés et les hôtels miteux où s’entassent les réfugiés, Ravic observe cette société qui court vers l’abîme. L’histoire s’achève dans les ténèbres de septembre 1939, quand les réfugiés allemands sont internés comme ressortissants ennemis.
Autour du livre
Publié en 1945, « Arc de Triomphe » occupe une place singulière dans la bibliographie de Remarque. Contrairement à ses autres romans centrés sur la guerre elle-même, ce livre dépeint les mois qui précèdent le conflit mondial, dans un Paris où se côtoient réfugiés, exilés et apatrides. Le manuscrit, achevé en décembre 1944 en langue allemande, paraît d’abord aux États-Unis en traduction anglaise, où il devient rapidement un best-seller. Le Book of the Month Club le sélectionne comme titre phare et il atteint la première place du classement du New York Times pendant huit semaines.
La publication en allemand s’avère plus complexe. Le marché du livre allemand d’après-guerre étant exsangue, c’est en Suisse que paraît la première édition germanophone, chez F.G. Micha. Ce choix se révèle désastreux : malgré un tirage initial important, seuls 40 000 exemplaires trouvent preneurs. Le reste finit soldé dans les kiosques de gare. Il faut attendre 1952 et le retour des droits à Remarque pour que l’ouvrage trouve enfin sa place chez l’éditeur Kurt Desch.
Le Paris nocturne qu’esquisse Remarque se dessine loin des clichés de la Ville Lumière. Point de monuments rutilants ni de cafés prestigieux, mais des ruelles sombres, des hôtels miteux et des bordels. C’est dans ces marges de la société que gravitent les personnages, à commencer par Ravic, médecin allemand contraint d’opérer clandestinement. Son existence précaire entre bars enfumés et cliniques louches traduit la condition des réfugiés, ces ombres qui hantent la capitale à la veille de la guerre.
L’histoire d’amour entre Ravic et Joan Madou aurait été inspirée par la liaison que Remarque entretint avec Marlene Dietrich, principalement en France. Cette dimension autobiographique ajoute une résonance particulière aux scènes parisiennes. Le personnage de Joan incarne une force vitale presque primitive, qui contraste avec le détachement cynique de Ravic.
Hollywood s’empare rapidement du roman. Dès 1948, Lewis Milestone, qui avait déjà adapté « À l’Ouest rien de nouveau », réalise une version avec Ingrid Bergman et Charles Boyer. D’autres adaptations suivent : en Argentine (1964), avec Anthony Hopkins (1985) et en Pologne (1993). La revue japonaise Takarazuka en propose même une version musicale en 2000, reprise en 2018.
Traduit dans 43 langues selon le décompte de Thomas F. Schneider en 2017, « Arc de Triomphe » témoigne d’une époque charnière où l’Europe bascule inexorablement vers la guerre, tandis que Paris maintient encore l’illusion d’être un havre pour les déracinés du continent.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 720 pages.
5. Un temps pour vivre, un temps pour mourir (1954)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
1944, front russe. Ernst Gräber, soldat de la Wehrmacht, obtient une permission de trois semaines après deux ans passés dans l’enfer des combats. De retour dans sa ville natale en Allemagne, il découvre un paysage dévasté par les bombardements alliés. Sa maison n’existe plus, ses parents sont introuvables. Durant sa quête pour les retrouver, il croise Elisabeth Kruse, une ancienne camarade de lycée dont le père croupit dans un camp de concentration.
Dans une Allemagne aux abois où la défaite approche, Gräber et Elisabeth s’éprennent l’un de l’autre. Ils décident de se marier, autant par amour que pour assurer à Elisabeth la pension d’épouse de soldat. Entre les raids aériens et la surveillance oppressante de la Gestapo, ils tentent de saisir chaque instant de bonheur possible avant le retour inéluctable de Gräber sur le front.
Autour du livre
Publié en 1954, ce récit d’Erich Maria Remarque sur la Seconde Guerre mondiale porte en lui une singularité éditoriale notable : deux versions distinctes circulent simultanément. La version allemande, épurée d’environ dix pages à la demande de l’éditeur Kiepenheuer & Witsch, atténue considérablement la portée critique du texte original. Les éditions étrangères, basées sur le manuscrit initial de Remarque, conservent quant à elles l’intégralité du propos, notamment les passages dénonçant les crimes de guerre nazis et questionnant la responsabilité individuelle des Allemands.
Le titre puise sa source dans l’Ecclésiaste, chapitre 3, versets 2 et 8, établissant d’emblée un dialogue entre l’amour et la mort, deux forces qui s’entremêlent tout au long du récit. Cette dualité se manifeste particulièrement dans la structure même du roman : encadré par des scènes de combat sur le front russe, le cœur du texte dépeint une parenthèse amoureuse en Allemagne.
La force du récit réside dans sa capacité à transcender le simple témoignage de guerre pour interroger la condition humaine face à l’horreur. Les personnages secondaires incarnent différentes postures morales : Binding représente l’opportunisme du parfait nazi, tandis que le professeur Pohlmann incarne la résistance silencieuse en cachant un Juif. Ces figures permettent de sonder les nuances de la culpabilité collective.
L’œuvre marque également une évolution dans le traitement du thème guerrier chez Remarque. Si « À l’Ouest rien de nouveau » se concentrait sur les tranchées, « Un temps pour vivre, un temps pour mourir » élargit considérablement la perspective en montrant comment la guerre dévaste aussi bien le front que l’arrière. Les bombardements transforment l’Allemagne en un paysage aussi apocalyptique que celui du front russe.
En 1957, Douglas Sirk adapte le roman au cinéma sous le titre « Le Temps d’aimer et le Temps de mourir ». Fait notable : Remarque lui-même y interprète le rôle du professeur Pohlmann, donnant ainsi corps à l’un des personnages les plus emblématiques de son œuvre.
La dimension politique du texte ne se révèle pleinement qu’avec la publication en 1989 de la version non censurée en allemand. Les passages initialement supprimés montrent notamment que le meurtre final de Steinbrenner par Graeber constitue un acte de résistance conscient plutôt qu’un simple geste de légitime défense, comme le suggérait la version expurgée.
Aux éditions FOLIO ; 512 pages.
6. La nuit de Lisbonne (1962)
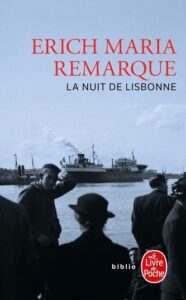
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Lisbonne, 1942. Un émigré allemand sans le sou contemple un paquebot amarré dans le port, son dernier espoir de fuir vers l’Amérique. Sans visa ni argent pour lui et sa compagne, il erre désespérément sur les quais quand un inconnu l’aborde. Ce dernier lui propose un marché singulier : les précieux documents de voyage en échange d’une nuit d’écoute.
L’homme, qui se présente sous le nom de Schwarz, dévoile alors son histoire : sa fuite de l’Allemagne nazie, son retour périlleux à Osnabrück pour retrouver son épouse Hélène, leur cavale à travers l’Europe, les camps d’internement français, les poursuites de la Gestapo menées par le propre frère d’Hélène. Mais au cœur de cette errance se dessine surtout une histoire d’amour bouleversante, celle d’un couple que la guerre rapproche paradoxalement, jusqu’à ce que la maladie d’Hélène ne vienne tout briser aux portes de la liberté.
Autour du livre
Publié en 1962, « La nuit de Lisbonne » s’inscrit dans ce que la critique nomme la « trilogie de l’émigration » de Remarque, aux côtés des « Exilés » (1939) et « Arc de Triomphe » (1945). Ce fut l’avant-dernier roman de l’auteur, lui-même contraint à l’exil en 1932 par le régime nazi.
La narration se déploie autour d’une conversation nocturne entre deux réfugiés allemands dans le Lisbonne de 1942, dernier havre européen pour ceux qui tentent d’échapper au nazisme. Cette architecture temporelle condensée sur une nuit renforce l’intensité dramatique tout en permettant d’embrasser plusieurs années à travers les récits enchâssés. Le choix de Lisbonne comme cadre n’est pas anodin : la ville représente à la fois le dernier espoir et le point de rupture entre deux mondes, celui de l’Europe en guerre et celui de la liberté promise par l’Amérique.
Les thématiques centrales – l’exil, la perte d’identité, la mémoire – résonnent avec la propre expérience de Remarque. Plus de vingt ans après sa propre fuite d’Allemagne, il continue d’interroger les traumatismes de cette période à travers ses personnages. La question de l’identité se matérialise notamment dans le jeu des passeports et des noms d’emprunt, reflet d’une époque où l’existence même se résume à des papiers administratifs.
Le succès critique fut immédiat lors de sa parution en anglais en 1964, le New York Times le maintenant dans son top 10 pendant cinq mois. Maxwell Geismar, dans sa critique pour le Times, souligne la profondeur méditative de l’œuvre. La réception mêle toutefois des voix plus nuancées, comme celle de Kirkus Reviews qui pointe un certain romantisme dans le traitement des camps de concentration.
« La nuit de Lisbonne » connaît plusieurs adaptations : une version télévisée par Zbyněk Brynych en 1971 pour la ZDF, avec Martin Benrath et Erika Pluhar, ainsi qu’une adaptation radiophonique en deux parties produite par Radio Bremen et WDR en 2019.
Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 320 pages.