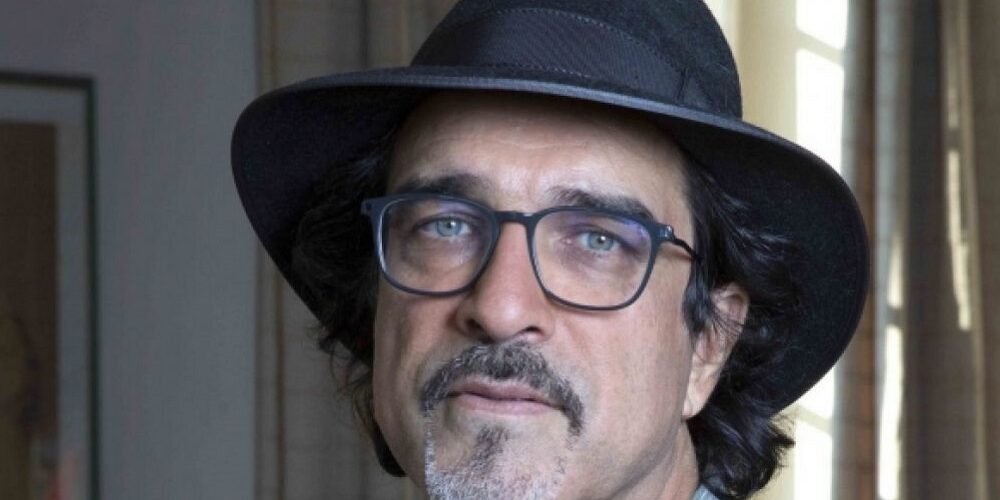Atiq Rahimi est un écrivain et cinéaste franco-afghan né le 26 février 1962 à Kaboul. En 1984, fuyant l’invasion soviétique en Afghanistan, il trouve refuge au Pakistan avant d’obtenir l’asile politique en France. Il poursuit ses études à la Sorbonne où il obtient un doctorat en audiovisuel.
Sa carrière littéraire débute en 2000 avec « Terre et cendres », qu’il adaptera plus tard au cinéma. En 2008, il reçoit le prestigieux prix Goncourt pour « Syngué sabour », son premier roman écrit en français. Son œuvre, qui compte une dizaine de romans, aborde souvent les thèmes liés à l’exil et aux conflits dans son pays natal.
Comme cinéaste, il réalise plusieurs documentaires et longs-métrages remarqués, dont « Terre et cendres » (2004) et « Notre-Dame du Nil » (2019). Il s’illustre également dans d’autres domaines artistiques, notamment en créant la callimorphie, un art graphique mêlant dessin et calligraphie persane et japonaise.
En 2023, sa carrière est couronnée par sa participation en tant que membre du jury au Festival de Cannes. Partageant sa vie entre Paris et Kaboul depuis la chute des Talibans, Rahimi contribue activement au développement des médias afghans, notamment en tant que conseiller créatif du groupe Moby, principal groupe médiatique du pays.
Voici notre sélection de ses romans majeurs.
1. Syngué sabour (2008)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Quelque part en Afghanistan, une femme se retrouve seule à veiller son mari, un combattant djihadiste dans le coma depuis qu’une balle lui a traversé la nuque. Dans leur maison isolée aux environs d’une ville en guerre, elle le soigne avec les moyens du bord : des gouttes dans les yeux, un tuyau dans la bouche, de l’eau sucrée en perfusion. Dehors, les bombes explosent et les coups de feu claquent.
Face à cet homme immobile aux yeux grands ouverts, la parole de cette femme se libère peu à peu. D’abord timidement, puis avec de plus en plus d’audace. Elle lui confie ses secrets les plus intimes : son enfance marquée par la violence paternelle, son mariage arrangé à 17 ans avec un inconnu parti à la guerre, les humiliations subies pendant leurs rares années de vie commune. Pour la première fois, elle ose dire sa souffrance, ses désirs refoulés, sa colère. Le corps inerte de son époux devient sa « syngué sabour », cette pierre magique qui, selon la tradition perse, absorbe les confessions jusqu’à éclater.
Autour du livre
Premier roman d’Atiq Rahimi directement écrit en français, « Syngué Sabour – Pierre de patience » remporte le Prix Goncourt en 2008. L’auteur y transcrit une parole féminine d’une puissance inédite dans le monde persan, à travers le monologue d’une femme afghane face à son mari dans le coma. Ce huis clos oppressant se déroule dans une unique pièce, une chambre étouffante aux murs clairs, avec pour seul décor des rideaux ornés d’oiseaux migrateurs figés dans leur élan.
L’originalité et la force du texte résident dans ce dispositif narratif minimaliste qui permet de déployer toute la complexité psychologique du personnage féminin. En faisant de son mari inconscient sa « syngué sabour » – pierre magique qui absorbe les confidences jusqu’à éclater sous leur poids selon la mythologie perse – la protagoniste se libère progressivement de son carcan culturel et social. Sa parole, d’abord craintive et hésitante, se mue en un flot puissant où se mêlent rage, désir et tendresse.
L’écriture épurée s’inspire directement du « Lied » de Schubert intitulé « Le Double », qui en rythme la cadence, ainsi que du « Christ mort » de Mantegna pour la composition picturale. Ces deux œuvres étaient d’ailleurs affichées dans la chambre de l’auteur pendant la rédaction. Cette esthétique dépouillée fait écho au dénuement du décor mais aussi à l’état de dépouillement intérieur nécessaire à la confession.
Le livre est dédié à la poétesse afghane Nadia Anjuman, assassinée par son mari à 25 ans. À travers elle, c’est toute la condition féminine afghane qui transparaît, bien que Rahimi précise dès l’incipit que l’action pourrait se dérouler « quelque part en Afghanistan ou ailleurs ». Pour lui, il ne s’agit pas de verser dans le misérabilisme mais au contraire de sublimer cette femme en madone, en icône à la manière de Roublev. La poétique devient alors politique, non pas en brandissant des slogans mais en montrant comment les êtres réagissent face à l’oppression. Cette approche donne au texte sa puissance évocatrice sans jamais tomber dans le pamphlet.
Les critiques saluent unanimement la force de ce texte court mais dense. Pour les uns, il s’agit d’un « coup de poing », d’une « claque » qui secoue les consciences. Pour d’autres, sa beauté réside dans sa capacité à transmuter la violence en poésie grâce à une langue d’une grande sobriété. Olivia Laing dans The Guardian y voit « à la fois un acte de courage politique et une nouvelle magnifiquement construite et profondément mémorable ».
En 2013, Atiq Rahimi adapte lui-même son roman au cinéma, avec l’aide du scénariste Jean-Claude Carrière. L’actrice iranienne Golshifteh Farahani incarne le rôle principal après un an de travail sur l’accent afghan. Le film touche un large public en Afghanistan, où le taux d’analphabétisme de 95 % empêchait l’accès au livre.
Aux éditions FOLIO ; 137 pages.
2. Terre et cendres (2000)
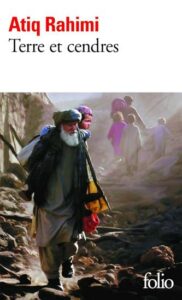
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Afghanistan, début des années 1980. Un village vient d’être bombardé par l’armée soviétique, ne laissant que deux survivants : Dastaguir, un vieil homme, et son petit-fils Yassin. L’explosion a rendu l’enfant sourd, mais celui-ci ne réalise pas son handicap. Dans son innocence, il pense que les tanks russes ont emporté les voix des adultes.
Une éprouvante mission attend Dastaguir : il doit se rendre à la mine où travaille son fils Mourad pour lui annoncer que sa femme, sa mère et tous les autres membres de la famille ont péri dans l’attaque. Alors qu’il attend avec Yassin qu’une voiture les conduise jusqu’à la mine, le vieil homme est assailli par ses pensées. Comment dire l’indicible ? Comment planter ce poignard dans le cœur de son propre fils ?
Autour du livre
Premier roman d’Atiq Rahimi, « Terre et cendres » puise sa source dans une rencontre fortuite. En 1981, alors que l’auteur réalise un reportage sur la vie des mineurs dans le nord de l’Afghanistan, il croise sur un pont un vieil homme et un petit garçon. Leurs regards le glacent sur place, lui révélant toute la catastrophe d’une guerre. Vingt ans plus tard, ces deux visages gravés dans sa mémoire ressurgissent pour donner naissance à ce texte poignant.
La narration adopte une forme singulière : un narrateur omniscient s’adresse au personnage principal à la deuxième personne du singulier, créant une proximité troublante avec le lecteur. Ce « tu » énigmatique qui parcourt le texte intensifie l’intimité du récit tout en maintenant une part de mystère – s’adresse-t-il au protagoniste, au lecteur, ou peut-être à l’Afghanistan lui-même ?
Les dialogues entre le grand-père et l’enfant devenu sourd révèlent une dimension métaphorique saisissante. Le petit Yassin, dans son innocence, imagine que les tanks soviétiques ont « volé les voix » des survivants, transformant sa surdité en une allégorie puissante de la guerre qui réduit au silence tout un peuple. Cette perception enfantine du drame transcende la simple description des horreurs pour atteindre une dimension universelle.
Le texte s’inscrit dans la tradition persane en tissant des liens avec le « Shâhnâmeh » (Le Livre des Rois), mythe fondateur de l’identité culturelle. Cette référence à l’épopée où un père tue son fils sur un champ de bataille fait écho à l’absurdité des conflits modernes, établissant un pont entre passé et présent.
La critique salue unanimement la force de ce texte épuré. Le jury du Festival de Cannes lui décerne en 2004 le prix « Regard vers l’avenir » pour son adaptation cinématographique. Rahimi réalise lui-même cette transposition à l’écran.
Aux éditions FOLIO ; 96 pages.
3. Maudit soit Dostoïevski (2011)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
Dans le Kaboul des années 1990, après le retrait des troupes soviétiques et avant l’arrivée des talibans au pouvoir, Rassoul assassine d’un coup de hache une vieille usurière qui force sa fiancée à se prostituer. Au moment précis où il commet son crime, le jeune homme se souvient de « Crime et Châtiment » de Dostoïevski, roman qu’il a lu pendant ses études en URSS. Bouleversé par cette réminiscence, il s’enfuit sans emporter l’argent ni les bijoux de sa victime.
Dans une ville ravagée par les combats entre factions rivales, Rassoul erre, rongé par la culpabilité. Il perd la voix, se réfugie dans les vapeurs du haschich, cherche désespérément à être jugé pour son crime. Mais dans ce pays où la mort est omniprésente, où les attentats et les règlements de compte font partie du quotidien, son meurtre semble insignifiant. D’autant plus que le corps de la victime a mystérieusement disparu, tout comme les traces de son forfait.
Autour du livre
Avec « Maudit soit Dostoïevski », Atiq Rahimi transpose l’intrigue de « Crime et Châtiment » dans le Kaboul des années 1990, ravagé par la guerre civile entre factions moudjahidines. Cette réécriture contemporaine questionne le sens de la culpabilité et de la justice dans une société où la violence est devenue banale. Le protagoniste Rassoul, intellectuel afghan ayant étudié en URSS, se retrouve hanté par le roman de Dostoïevski au moment même où il commet son crime.
La singularité du texte réside dans son traitement de l’absurde : le meurtre de Rassoul demeure invisible puisque le corps disparaît mystérieusement, tandis que son désir d’expiation se heurte à l’indifférence générale. Dans une société où tuer une maquerelle n’est pas considéré comme un crime, la quête de rédemption du personnage principal prend des allures kafkaïennes. Le texte oscille constamment entre onirisme et réalité, notamment à travers les scènes de fumerie de haschich où Rassoul cherche l’oubli.
Les pages acquièrent une dimension politique lorsque Rassoul découvre que son passé d’étudiant en Russie et sa possession de livres russes constituent des crimes plus graves aux yeux de la justice que son meurtre. Cette tension entre morale individuelle et loi religieuse traverse tout le récit, porté par un protagoniste qui perd symboliquement sa voix, incapable de communiquer dans un monde ayant perdu ses repères.
La critique littéraire salue la capacité d’Atiq Rahimi à créer des ponts entre Orient et Occident. Si certains lecteurs restent décontenancés par l’aspect labyrinthique du récit, la majorité souligne la puissance de cette réflexion sur la conscience morale dans un pays déchiré par la guerre. « Maudit soit Dostoïevski » reçoit un accueil particulièrement chaleureux en France, où l’auteur s’est établi après avoir obtenu l’asile politique en 1984.
Aux éditions FOLIO ; 288 pages.
4. Les porteurs d’eau (2019)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Résumé
« Les porteurs d’eau » narre une journée décisive, le 11 mars 2001, dans la vie de deux Afghans que tout sépare. Tom, exilé à Paris depuis vingt ans, décide brutalement de quitter femme et enfant pour rejoindre Nuria, une mystérieuse amante rencontrée à Amsterdam. Naturalisé français, il a changé son prénom et tente de couper les ponts avec ses origines.
À des milliers de kilomètres, à Kaboul, Yûsef remplit sa tâche quotidienne de porteur d’eau sous le joug des Talibans. Petit et difforme à force de porter son outre, il vit avec sa belle-sœur Shirine dont le mari a disparu. Alors que le régime détruit les Bouddhas millénaires de Bâmiyân, des sentiments inavouables grandissent en lui pour cette femme qu’il doit protéger.
Autour du livre
La singularité de ce roman publié en 2019 réside dans sa construction temporelle : l’intégralité de l’action se concentre sur une seule journée, celle du 11 mars 2001, date de la destruction des Bouddhas de Bâmiyân par les Talibans. Cette unité de temps permet de tisser deux récits parallèles qui ne se croiseront jamais, structurés en chapitres alternés.
La dualité narrative se reflète jusque dans l’écriture : pour Tom/Tamim, l’Afghan exilé en France, le texte adopte la deuxième personne du singulier, créant un effet de dialogue entre l’auteur et son personnage. Pour Yûsef, le porteur d’eau de Kaboul, le récit prend la forme d’un conte oriental à la troisième personne. Cette différence stylistique souligne la fracture entre deux mondes, deux façons d’appréhender l’existence.
La question de l’identité traverse « Les porteurs d’eau » comme un fil rouge. Tom/Tamim incarne le déchirement de l’exilé, prisonnier d’une paramnésie qui lui donne sans cesse l’impression du déjà-vécu. Sa difficulté à écrire en français révèle ce tiraillement : « ses mots français, empruntés fraîchement aux dictionnaires, n’ont jamais vécu en lui. Ils sont étrangers à sa pensée, à ses sentiments… en exil dans son âme afghane. »
La destruction des Bouddhas sert de catalyseur symbolique plus que d’événement central. Elle met en lumière un paradoxe : l’indignation internationale face à la destruction de statues contraste avec l’indifférence générale envers les souffrances du peuple afghan sous le régime taliban.
La critique souligne globalement la maîtrise avec laquelle Rahimi entremêle les destins de ses personnages. France Télévisions salue notamment sa capacité à traiter des thèmes de l’exil, de l’amour et de la liberté à travers « une très belle langue française ». Certains lecteurs déplorent toutefois un manque de lien entre les deux récits ou une dimension philosophique parfois trop présente.
Aux éditions FOLIO ; 272 pages.