Réussir la khâgne A/L (voie Lyon) tient moins au « génie » qu’à une discipline quotidienne et à des repères fiables. Pour gagner du temps, affiner la méthode et solidifier la culture, mieux vaut s’appuyer sur quelques ouvrages qui font réellement la différence : grammaires d’auteur, dictionnaires conceptuels, manuels de méthode et outils de traduction.
La sélection qui suit privilégie des références transversales utiles toute l’année comme le jour du concours. Classés par pertinence et par logique de travail, ces livres vous aident à poser des définitions nettes, bâtir des démonstrations propres et mobiliser des exemples sans approximation. Pour chaque titre, un encadré « Comment l’utiliser ? » indique des gestes concrets afin d’en tirer le meilleur.
Voir aussi : 11 livres pour réussir sa prépa khâgne A/L Ulm
1. Le Bon Usage (De Boeck Supérieur, 16e éd., 2016)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Bible grammaticale, « le Grevisse » est l’outil qu’on consulte pour trancher une hésitation, justifier une tournure, vérifier une concordance ou une nuance de registre. Sa force : une approche descriptive et raisonnée de la langue, appuyée sur des milliers d’exemples littéraires et journalistiques. Dans les copies de composition française, c’est un allié discret : il ne s’agit pas de citer l’ouvrage, mais de sécuriser votre expression pour ne laisser aucun « accroc » de syntaxe parasiter l’argumentation.
La 16e édition (2016) reste la référence actuelle ; elle est dense (1 760 p.), mais son index très précis permet une consultation rapide. Travaillez-le comme une grammaire d’auteur : non pour réciter des règles, mais pour affiner votre oreille, enrichir votre palette syntaxique et clarifier vos doutes de ponctuation, d’accords, de subordination ou de choix prépositionnels.
À dose régulière, il installe des réflexes qui se traduisent par une prose nette, nerveuse, sans approximations – et donc plus convaincante. Clé de voûte d’une bibliothèque de khâgneux, il rend plus efficaces toutes vos autres lectures : commentaires, fiches, traductions, dissertations.
Comment l’utiliser ?
- Tenez un carnet de « difficultés personnelles » (accord du participe, relatives, subjonctif…) et notez les pages utiles.
- Avant de rendre une copie importante, vérifiez une à deux zones de fragilité avec l’index.
- En version/thème, contrôlez une construction litigieuse (emploi des temps, infinitives, style indirect).
- Fichez des tours justes rencontrés (subordonnées, tournures passives/actives) pour les réinjecter dans vos introductions et transitions.
2. Dictionnaire de rhétorique (Georges Molinié, Le Livre de Poche, 1997)
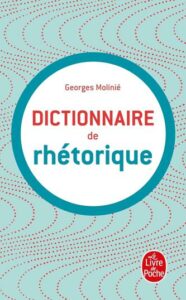
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Outil de référence pour toutes les analyses de style et d’argumentation, ce dictionnaire propose plus de 400 rubriques qui vont d’« abondance » à « zeugma », assorties de tableaux synoptiques clarifiant les grandes familles de procédés. Sa force est d’ordonner un champ souvent foisonnant : figures, schémas d’argumentation, notions de décence, éthos, modalisation…
En khâgne, il sert à nommer précisément ce que vous observez et à relier le « comment » (procédé) au « pourquoi » (effet, enjeu). Les notices, concises, donnent définitions, exemples et renvois qui permettent d’aller vite sans sacrifier la rigueur. À l’écrit, il aide à bannir les paraphrases floues : on désigne l’antonomase, l’hypotypose, la parataxe ; on explique la fonction persuasive ; on replace le tout dans une démonstration. À l’oral, il offre des repères sûrs pour répondre du tac au tac sans jargonner.
En somme, une boîte à outils opérationnelle : vous pouvez l’ouvrir au milieu d’un entraînement, vérifier une nuance, puis reformuler votre analyse. Utilisé régulièrement, il développe une sensibilité rhétorique qui se traduit par des commentaires mieux architecturés, des dissertations plus nettes et une écriture plus nerveuse.
Comment l’utiliser ?
- Avant un commentaire, listez 5–6 procédés déterminants du texte et vérifiez leur définition exacte.
- Constituez des familles de figures (répétition, opposition, amplification, atténuation) avec deux exemples types.
- En dissertation, mobilisez les rubriques sur l’argumentation (ethos, pathos, logos) pour caler l’introduction.
- En révisions, apprenez par cœur 10 couples à ne pas confondre (métaphore/comparaison, métonymie/synecdoque, litote/ironie…).
3. Dictionnaire de poétique (Michèle Aquien, Le Livre de Poche, 1997)
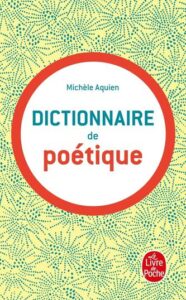
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Complément indispensable du Molinié, ce dictionnaire éclaire le langage poétique sous toutes ses faces : versification (mètres, rimes, coupes), rythmes et cadences, jeux sonores, tropes, images, statut du mot, genres et écoles. Sa grande qualité est d’articuler technique et interprétation : une définition de l’enjambement ou de la diérèse est immédiatement mise en perspective par des exemples et des renvois qui aident à lire la poésie comme une pensée en actes.
En khâgne, il permet d’éviter deux écueils : la technicité sèche (énumérer des procédés sans sens) et l’impressionnisme (parler d’« harmonie » sans appuis). Les notices donnent le vocabulaire juste pour décrire, puis intégrer le détail formel à une idée de fond (voix lyrique, ironie, figuration, modernité).
En commentaire, vous y trouverez un réservoir d’exemples et de micro-définitions qui font gagner de précieuses lignes. En dissertation, il aide à affûter les définitions d’ouverture et à tenir une problématique sur le rapport forme/sens. C’est un livre de travail quotidien : ouvert pendant l’analyse d’un sonnet ou d’un poème en prose, il transforme une intuition en argument.
Comment l’utiliser ?
- Faites une fiche versification (mètres, coupes, rimes) avec 3 exemples canoniques.
- Constituez des paires « procédé → effet » (enjambement → tension rythmique, allitération → écho thématique…).
- En commentaire, citez une définition de 2 lignes puis appliquez-la aussitôt au texte.
- Pour l’oral, apprenez 10 extraits de référence illustrant chacun un procédé clé.
4. Le dictionnaire du littéraire (PUF, 2e éd., 2010)
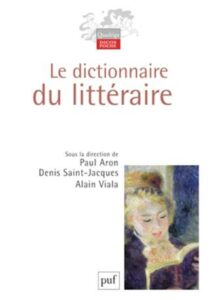
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
À la croisée de la théorie, de l’histoire littéraire et de la sociologie des lettres, ce dictionnaire éclaire les concepts de travail : auteur, œuvre, lectorat, vraisemblance, intertextualité, poétique, etc. Il complète parfaitement Molinié/Aquien : ici, l’enjeu n’est pas tant le nom d’une figure que la catégorie critique qui structure une problématique.
Chaque article synthétise un champ (origines, débats, enjeux actuels), ce qui aide à problématiser vos introductions et vos transitions : replacer un cas dans une histoire des idées, citer un jalon théorique sans pédanterie, comprendre les glissements de sens d’un terme. Sa bibliographie terminale, concise et sûre, oriente vos lectures « de fond ». À l’écrit comme à l’oral, vous gagnez en assises conceptuelles : pas de cuistrerie, mais une précision qui crédibilise votre démarche.
Comment l’utiliser ?
- Avant une colle/dissertation, définissez deux notions-clefs du sujet en vous appuyant sur les notices.
- Faites des fiches « cartes mentales » : notion → auteurs → enjeux → exemples d’œuvres.
- Lorsque vous butez sur un mot-valise (« réalisme », « classique », « moderne »), clarifiez les acceptions avant de l’employer.
- En révisions finales, bâtissez une boîte à définitions de 2–3 lignes « prêtes à l’emploi ».
5. Littérature : 150 textes théoriques et critiques (Armand Colin, 4e éd., 2015)
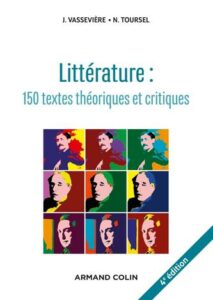
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Anthologie redoutablement pratique : de Platon à Barthes, de Boileau à Todorov, elle rassemble des extraits-jalons qui structurent la réflexion littéraire. Chaque texte est situé, contextualisé, et l’ensemble couvre les grands objets (genres, lecture, poétique, histoire, critique). Pour vous, c’est un réservoir de citations intelligentes : quelques lignes bien choisies pour étayer une idée, opposer deux positions, relancer une démonstration.
L’ouvrage apprend surtout l’art de citer : non pour étaler des noms, mais pour faire travailler la citation dans l’argument. Utilisé toute l’année en petites doses, il devient une banque de références qui évite le name-dropping vide et donne du relief à vos copies.
Comment l’utiliser ?
- Constituez 10–12 paires dialectiques (ex. « mimesis »/« fiction », « auteur »/« lecteur ») avec une citation brève pour chaque.
- Fichez les définitions-phares (poésie, réalisme, classicisme, sublime…) avec un exemple d’œuvre.
- À l’approche des concours, entraînez-vous à insérer une citation en 2 lignes, commentée en 3.
- En oral, utilisez un contre-extrait (deux textes en tension) pour nourrir la discussion.
6. Vocabulaire technique et critique de la philosophie (André Lalande, PUF, 2010)
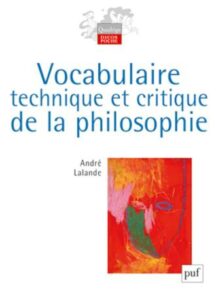
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Surnommé « le Lalande », ce dictionnaire est l’outil classique pour assainir le vocabulaire philosophique. En khâgne, il n’est pas question de « phraser » : il faut préciser. Chaque entrée démêle sens commun, acception technique, extensions et controverses, en historisant l’usage. C’est la méthode même d’une copie solide : définir → distinguer → problématiser.
En croisant Lalande avec vos cours et textes (Descartes, Kant, Bergson, etc.), vous bâtissez une trousse minimale : liberté, causalité, imagination, représentation, langage… Dans une composition de philosophie, une définition ferme et nuancée fait gagner d’emblée en clarté. Outil à garder près du bureau toute l’année.
Comment l’utiliser ?
- En préparation, écrivez vos propres définitions (2–3 lignes) à partir des notices, puis testez-les sur des sujets.
- Constituez des triptyques : notion → distinctions voisines (ex. « vrai/vérité ») → enjeux.
- En révisions, dressez une liste de 30 notions à maîtriser « les yeux fermés ».
- En LVE/philo, servez-vous de la précision lexicale pour éviter les faux-amis conceptuels.
7. Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés (Belin, 2013)
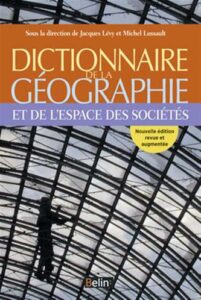
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Le grand dictionnaire qui a installé, en France, une géographie problématisée : concepts (territoire, réseau, échelle, lieu…), méthodes, auteurs. Pour la composition de géographie, il permet de poser une problématique nette et d’éviter l’empilement de données.
Les articles, brefs mais denses, éclairent le sens d’un terme, son évolution et ses controverses : idéal pour construire introduction et conclusion. C’est aussi un guide pour cartographier vos connaissances : en révisions, vous reliez concepts, exemples, bibliographie et schémas types. Résultat : une copie plus théorique, mieux architecturée, donc plus convaincante.
Comment l’utiliser ?
- Avant tout devoir, définissez les 2–3 notions structurantes du sujet (ex. « métropolisation », « mobilités », « frontière »).
- Fichez 20 concepts-clé avec déf., auteur, exemple, schéma réutilisable.
- En cartographie, faites correspondre chaque notion à un croquis type.
- En oral, appuyez-vous sur une définition rigoureuse pour conduire l’entretien.
8. Méthode pour le commentaire et la dissertation historiques (Armand Colin, 5e éd., 2025)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Le manuel de méthode qui « coche toutes les cases » côté histoire. Très concret, il détaille comment lire un document, bâtir un plan, rédiger et éviter les pièges (anachronisme, téléologie, citations décoratives). L’intérêt, en khâgne, est d’aligner pratique et attentes de jurys : une problématique clairement posée, une démonstration articulée, des exemples contrôlés.
Les chapitres sur statistiques et iconographie sont précieux pour varier les preuves. Vous y trouverez aussi un vade-mecum bibliographique et des exercices corrigés qui servent de modèles. Bref, un accélérateur de méthode qui transforme vos bonnes connaissances en copies tenues.
Comment l’utiliser ?
- Faites, chaque semaine, un mini-exercice ciblé (intro seule, transitions, conclusion-bilan).
- Constituez une grille de lecture de documents (nature, contexte, auteur, enjeux, limites).
- En révisions, entraînez des plans minute (5 min → 3 parties/3 idées-forces).
- Sur chaque cours, écrivez une problématique transversale réutilisable en concours.
9. Dictionnaire de l’historien (PUF, 2015)
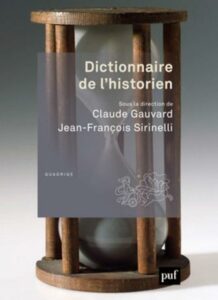
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Compagnon idéal du manuel de méthode, ce dictionnaire couvre les notions, objets, démarches et champs de l’historien contemporain (sensibilités, représentations, opinion, mondialisation, médias…). Il vous aide à nommer correctement ce que vous manipulez au quotidien et à situer vos exemples dans une historiographie claire.
Les notices, rédigées par des spécialistes, offrent une synthèse précise et des pistes bibliographiques. En composition, il sert à poser des définitions opérationnelles, à « caler » une introduction solide et à éviter les anachronismes terminologiques. En oral, il joue le rôle de défricheur : avant d’ouvrir un gros livre, vous voyez où vous mettez les pieds.
Comment l’utiliser ?
- Tenez un glossaire personnel des 20 notions d’histoire-problème qui reviennent le plus.
- Pour chaque chapitre de cours, associez 2 notices (ex. « opinion », « nation », « espace public »).
- En fin de révisions, réécrivez vos définitions en 2 lignes maximum.
- Utilisez la bibliographie des notices pour élargir intelligemment (un article, un chapitre, pas forcément un gros manuel).
10. Le Grand Gaffiot — Dictionnaire latin-français (Hachette, 2000)
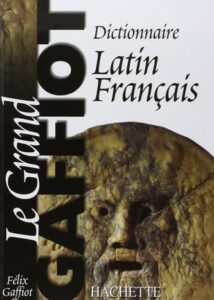
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Le classique des classiques pour les latinistes. La révision de 2016 a modernisé la présentation et consolidé les repères étymologiques et sémantiques. En khâgne, un bon usage du Gaffiot change la donne : vous cessez de traduire « mot à mot » pour lire des entrées (étymologie, constructions, expressions), choisir la bonne acception selon le contexte, repérer les valeurs syntaxiques d’un cas ou d’un verbe.
C’est l’outil qui consolide la grammaire : chaque consultation est un petit cours. Travaillez-le avec méthode (repères alphabétiques, abréviations, tableaux) et croisez-le avec vos fiches de morphologie et de syntaxe (Ernout-Thomas, Gason, etc.). À l’écrit comme à l’oral, la traduction gagne en sûreté et en élégance.
Comment l’utiliser ?
- Apprenez les conventions (abréviations, constructions régies) en début d’année.
- En version, lisez l’entrée en entier pour vérifier régime, emplois figurés, locutions.
- Fichez les verbes « pièges » avec constructions prépositionnelles et emplois pronominaux.
- En révisions, entraînez-vous à justifier un choix de sens en 1 phrase.
11. Le Grand Bailly — Dictionnaire grec-français (Hachette, 2000)
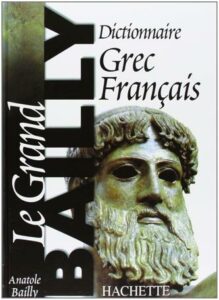
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Côté grec, le Bailly demeure la référence. D’une richesse incomparable, il exige une petite discipline de consultation : repérer l’étymon, distinguer les valeurs de base (sens « concret ») des extensions (sens figurés), noter les expressions idiomatiques et les constructions. Il est précieux pour sécuriser les valeurs d’aspect et les particules (καί, δέ, γάρ…) qui orientent le raisonnement du texte.
À l’entraînement, vous gagnerez à faire des fiches par familles lexicales (préverbes, dérivés), ce qui accélère la reconnaissance au fil des versions. En khâgne, il ne s’agit pas de « tout savoir » : il s’agit de savoir chercher vite et juste, en reconstituant le sens global de la période grecque.
Comment l’utiliser ?
- Prenez le temps d’apprivoiser la typographie des entrées (attique/ionien, dialectes, poétique).
- Entraînez-vous à choisir l’acception la plus parcimonieuse qui « fait sens » sur tout l’énoncé.
- Fichez 10 couples de faux-amis fréquents et 20 locutions utiles.
- Associez chaque mot appris à une micro-phrase grecque (mémoire active).
Quelques conseils de méthode qui font la différence
- Faites dialoguer les livres : reliez une notion (ex. « intertextualité ») dans Le dictionnaire du littéraire à un extrait de l’anthologie Vassevière/Toursel et à un procédé nommé grâce à Molinié (rhétorique) et éclairé par Aquien (poétique). Triangle : concept → texte → outil.
- Méthode avant données : en histoire et géographie, investissez d’abord dans la définition des notions et l’architecture de la démonstration ; les chiffres et exemples s’y arrimeront plus solidement.
- Rituels courts, réguliers : 20 minutes quotidiennes suffisent pour entretenir grammaire (Grevisse), notions (Lalande, Dico du littéraire) et un peu de version. Ce qui compte n’est pas la quantité ponctuelle, mais la continuité.
Références
- ENS de Lyon — Concours Lettres et Sciences humaines (présentation officielle, séries et informations clés)
- ENS de Lyon — Concours d’entrée 2025 (calendrier, sujets, résultats, informations pratiques)
- ENS de Lyon — Programme provisoire du concours littéraire (session 2026, PDF)
- Banque d’épreuves littéraires — Rapports de jury (analyses et recommandations officielles)
- Ministère de l’Enseignement supérieur — Panorama des CPGE et voies A/L & B/L
- Onisep — La prépa lettres Lyon (2e année) : profils, contenus et objectifs




