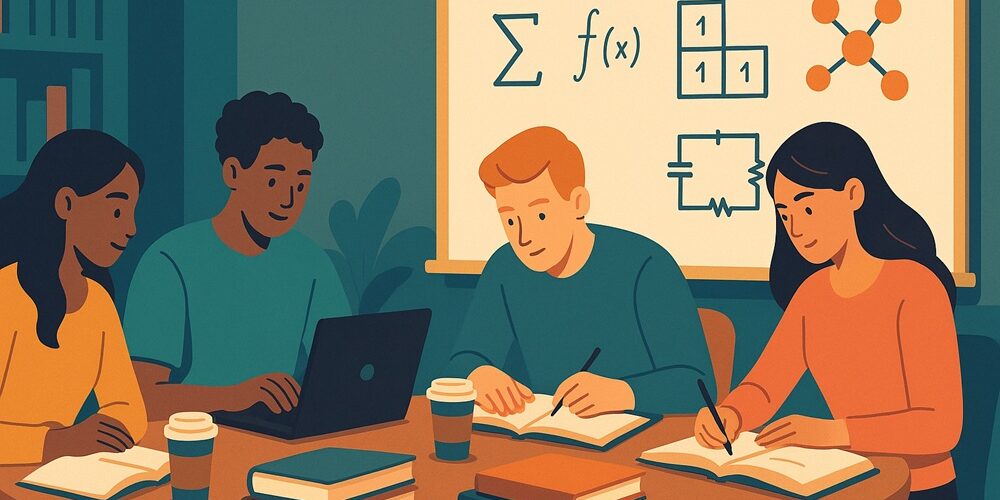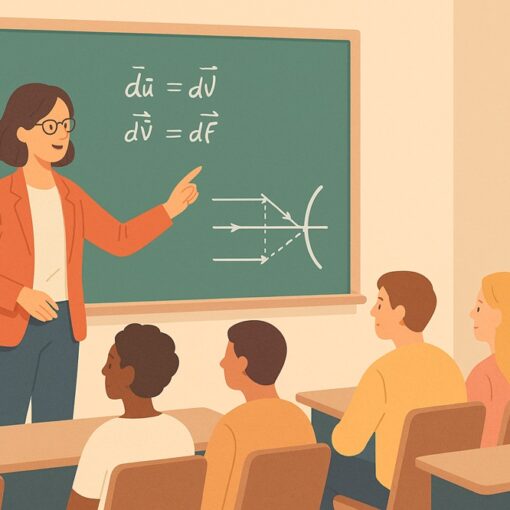La licence de sciences et technologies ressemble à un parcours où l’on assemble, semaine après semaine, des briques qui doivent tenir ensemble : logique mathématique, modèles physiques, réactions chimiques, premiers scripts. Pour progresser sans se disperser, les bons ouvrages ne servent pas à « tout savoir », mais à s’orienter, à pratiquer et à rédiger correctement.
Cette sélection de huit titres, adaptés de la L1 à la L3, est organisée dans un ordre logique : bases mathématiques → physique et chimie → programmation et méthodes numériques → communication scientifique. Vous y trouverez de quoi consolider les fondamentaux, préparer efficacement les TD et gagner en autonomie au fil du semestre.
1. Mathématiques – Tout-en-un pour la Licence 1 (Dunod, 4ᵉ éd., 2022)
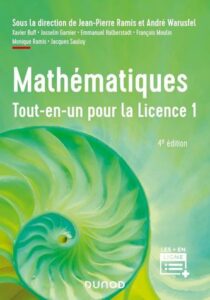
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Ce « tout-en-un » couvre l’intégralité du programme de L1 côté maths : notations et langage, algèbre, géométrie, analyse, probabilités et statistiques. L’organisation par modules et grands thèmes rend la navigation très intuitive, que l’on révise un chapitre ciblé (limites, continuité, suites/séries) ou que l’on fasse une remise à niveau plus large.
La progression est rigoureuse mais pédagogique, avec des rappels structurés, des exemples gradués et des exercices corrigés qui insistent sur les techniques–clé (raisonnement, calcul algébrique, changements de variable, équivalents asymptotiques, etc.). Pour un premier semestre souvent déroutant, ce volume joue le rôle de boussole : il harmonise les prérequis hétérogènes des entrants et donne une vision d’ensemble de ce que signifie « faire des maths » à l’université.
Atout supplémentaire : le livre sert aussi d’index de survie tout au long de l’année ; on y revient facilement pour éclaircir une preuve, retrouver une propriété standard (convexité, continuité uniforme), ou piocher un exercice d’entraînement ciblé. En un mot, un compagnon de route fiable pour stabiliser vos acquis, éviter les angles morts et aborder sereinement les partiels.
Comment l’utiliser ?
- Commencez par le sommaire détaillé pour cartographier votre semestre (chapitres réellement couverts dans votre UE).
- En L1, alternez lecture active → mini-exos : un résultat, un exemple, 3 exercices.
- Construisez une fiche-formulaire personnelle (théorèmes, méthodes, pièges).
- En révision, refaites uniquement les exercices ratés la première fois.
- Avant une séance de TD, lisez la page d’introduction du chapitre pour arriver avec le vocabulaire juste.
2. Analyse – Licence 1ʳᵉ année (Dunod, 3ᵉ éd., 2025)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Ce volume d’analyse recentre l’apprentissage sur les suites, fonctions d’une variable réelle, intégrales et courbes paramétrées, puis ouvre vers les équations différentielles et quelques méthodes numériques de base. La grande force du manuel tient à sa progression pas-à-pas : chaque notion est motivée, illustrée, puis consolidée par des exercices de difficultés variées avec réponses ou indications.
L’accent mis sur la maîtrise des preuves (implications, contre-exemples, quantificateurs) aide à franchir le cap entre « calculer » et « comprendre ». Les démonstrations évitent l’hyper-formalisme tout en restant impeccables, ce qui en fait un texte idéal pour apprendre à rédiger.
Le dernier chapitre, orienté méthodes d’approximation (interpolation, zéros, intégration), sert de pont avec l’informatique scientifique : parfait pour démarrer des TP Python de calcul numérique. Au final, c’est le manuel d’analyse opérationnel pour réussir contrôles continus et partiels, et asseoir des réflexes qui vous suivront en L2/L3 (convexité, régularité, théorèmes de convergence).
Comment l’utiliser ?
- Avant le cours, lisez la mise en contexte de chaque chapitre (10 min).
- En TD, entraînez-vous à rédiger intégralement une solution par semaine.
- Tenez une liste de contre-exemples (fonctions non continues, suites non convergentes).
- Pour chaque théorème, écrivez quand il s’applique (hypothèses) et comment on l’utilise (schéma de preuve).
- Croisez le dernier chapitre avec un notebook Python pour visualiser suites/erreurs d’approximation.
3. Toute l’algèbre de la Licence – Cours et exercices corrigés (Dunod, 5ᵉ éd., 2023)
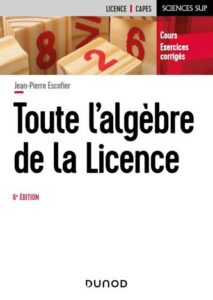
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Ouvrage de référence, ce livre couvre l’algèbre linéaire (espaces vectoriels, applications linéaires, matrices, diagonalisation), puis élargit à des structures (groupes, géométrie affine) en gardant un œil sur les méthodes de calcul et la résolution de problèmes.
Les chapitres débutent souvent par des exemples concrets qui servent de tremplin conceptuel ; la théorie vient ensuite, proprement énoncée, avec des rappels historiques qui donnent du relief aux notions. Les exercices – abondants et classés – permettent de travailler autant la technique (changement de base, rang, systèmes) que la compréhension structurelle (invariants, isomorphismes).
Résultat : on progresse d’une vision « outil » à une vision « langage », indispensable en L2/L3, en physique théorique comme en data science. C’est aussi un excellent partenaire de révisions : chaque chapitre peut se transformer en séance autonome (résultats essentiels → exercices ciblés → bilan).
Comment l’utiliser ?
- En L1/L2, attaquez l’algèbre linéaire de façon spiralaire (revenir sur bases/rang/diagonalisation régulièrement).
- Convertissez chaque définition en exemple + contre-exemple.
- Réalisez un carnet de techniques (méthodes pas-à-pas pour systèmes, valeurs propres).
- En révision, sélectionnez 10 exercices « basiques » + 5 « ponts » vers d’autres UE (méca, proba, optimisation).
- Pour l’oral/écrit, entraînez-vous à justifier chaque égalité en citant clairement le résultat mobilisé.
4. Toute la physique (Dunod, 2ᵉ éd., 2020)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Véritable encyclopédie de licence, ce volume balaye la mécanique, la thermodynamique, l’électromagnétisme, l’optique, puis des notions de physique quantique, avec formules, définitions, tableaux de données et nombreux schémas. Ce n’est pas un manuel de première lecture : c’est un référentiel compact pour structurer vos connaissances, vérifier une relation dimensionnelle, préparer un TD ou un oral.
L’écriture concilie concision et clarté, de sorte qu’on peut neutraliser rapidement un blocage : retrouver la forme d’un potentiel, la convention de signe en électrostatique, l’expression d’un flux ou un développement limité utile en optique géométrique.
Très utile aussi pour relier théorie et pratique : les ordres de grandeur et rappels mathématiques vous aident à modéliser proprement avant de coder/simuler. Si vous ne deviez garder qu’un compendium pour L1–L3, c’est celui-ci.
Comment l’utiliser ?
- En pré-TD, relisez la fiche-synthèse du domaine (ex. : lois de Newton → énergie → quantité de mouvement).
- Constituez votre table personnelle de constantes et d’ordres de grandeur.
- Refaites les exemples en unité SI stricte (cohérence dimensionnelle).
- Pour les partiels, bâtissez un plan de résolution standard (mécanique/EDO ; E-M/Maillages ; optique/dioptres).
- Appuyez les chapitres par de mini-simulations (Python) pour tester vos intuitions.
5. Chimie – Les fondamentaux L1 (De Boeck Supérieur, 2ᵉ éd., 2020)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Parfait pour la première année, cet ouvrage propose un mix très efficace : un QCM-d’évaluation en ouverture de chapitre, des rappels de cours solides, puis des exercices intégralement corrigés. On y retrouve l’essentiel de la chimie générale de L1 : atomistique et liaisons, cinétique, thermodynamique et équilibres, acido-basique/solubilité, oxydoréduction.
Le ton est pragmatique : on explicite les hypothèses, on illustre par des schémas propres et l’on entraîne aux calculs usuels (pH, bilans de matière, diagrammes de distribution). Les pas-à-pas des corrections sont suffisamment détaillés pour apprendre à raisonner sans sauter d’étapes, ce qui fait souvent la différence lors des examens.
Utilisé en « livre-atelier », il structure le travail personnel : diagnostic, (re)mise à niveau ciblée, pratique guidée. À la clé : des réflexes de base solides, réutilisables en chimie physique, matériaux, biochimie ou environnement.
Comment l’utiliser ?
- Commencez chaque chapitre par le QCM-diagnostic et notez vos lacunes.
- Faites une carte mentale des équilibres (acides/bases, précipitation, redox).
- Tenez un carnet d’unités et de conversions (attention aux log/pH).
- Entraînez-vous à l’analyse dimensionnelle avant tout calcul.
- En révision, refaites les problèmes en temps limité (simulateur d’examen).
6. Programmation en Python pour les sciences de la vie (Dunod, 2ᵉ éd., 2024)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Même si son ancrage disciplinaire est « sciences de la vie », ce livre constitue une introduction idéale à la programmation scientifique pour toute licence S&T. Le parcours est progressif : bases du langage, structuration du code, algorithmique de départ, puis données réelles, graphiques, et cas d’étude (manipulation de séquences, statistiques simples, automatisation).
Le parti pris pédagogique (exemples courts, notebooks, nombreux exercices corrigés) permet d’aller vite vers des scripts concrets, tout en adoptant de bonnes pratiques (tests, lisibilité, modularité). On y croise l’écosystème standard (NumPy/Matplotlib) qui servira en physique, chimie, ou data.
L’ouvrage fait le lien entre modélisation et implémentation, ce qui aide énormément pour les UE de TP/Projet et pour documenter proprement votre code. En somme : un tremplin pour passer de « je code un peu » à « je produis des analyses reproductibles ».
Comment l’utiliser ?
- Reprenez chaque section en notebook : code + mini-commentaires + sorties.
- Maintenez un glossaire de patterns (boucles, compréhensions, slicing, I/O).
- Coupez vos projets en fonctions testables (doctests/pytest de base).
- Recodez manuellement deux graphes par chapitre pour ancrer Matplotlib.
- Créez un repo Git par UE : scripts, données, README avec consignes d’exécution.
7. Méthodes numériques avec Python – Théorie, algorithmes, implémentation et applications avec Python 3 (Dunod, 2023)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Ce manuel passe en revue les méthodes de calcul scientifique qui sous-tendent la plupart des projets en sciences et ingénierie : arithmétique en virgule flottante, systèmes linéaires, interpolation, dérivation/intégration numériques, moindres carrés, équations différentielles ordinaires, zéros/optimisation.
Double atout : (1) une ancre théorique claire pour comprendre stabilité, complexité et erreurs ; (2) une mise en œuvre Python soignée (NumPy/SciPy) avec exercices et codes sources. On y apprend à choisir une méthode selon les données, à diagnostiquer les échecs (conditionnement, pas de discrétisation), à instrumenter ses scripts (journalisation, contrôles d’arrêts).
C’est le pont naturel entre cours de maths et TP d’informatique scientifique, idéal dès la fin de L1 pour préparer des projets de L2/L3 (traitement de signaux, modélisation de réactions, simulation mécanique). Un investissement qui fait gagner un temps considérable en projets tutorés et stages.
Comment l’utiliser ?
- Pour chaque méthode, notez hypothèses, complexité, erreur.
- Tenez un carnet d’expériences : paramètres → erreur → temps → interprétation.
- Comparez au moins deux méthodes par problème (ex. intégration : Trapèzes vs Simpson).
- Versionnez tout (Git) et figez les dépendances (requirements.txt).
- Rédigez une note technique par TP : but, données, méthode, validation, limites.
8. Présenter un rapport scientifique à l’écrit, à l’oral – Conseils pratiques (Cépaduès, 2ᵉ éd., 2018)
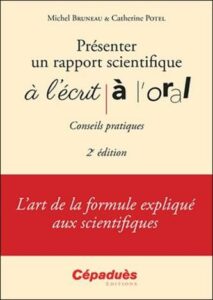
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Parce qu’on réussit aussi en sachant communiquer, ce petit guide s’adresse directement aux étudiants de sciences : rapports, mémoires, présentations orales, échanges pro. En une centaine de pages, il va à l’essentiel : structure d’un rapport convaincant, articulation problématique → méthode → résultats → discussion, gestion des figures et tableaux, bibliographie, mais aussi posture à l’oral, storytelling scientifique, diapos épurées, gestion du temps et des questions.
Le bouquin fourmille de recommandations opérationnelles (phrases-clés, check-lists, erreurs à éviter) qui « dédramatisent » la rédaction et vous font gagner une maturité appréciable pour les TP notés, projets, stages. Utilisé tôt en L1, il devient un réflexe : on apprend à écrire pour un lecteur réel, à hiérarchiser l’information, à soigner transitions et conclusions. En fin de cycle, c’est un excellent anti-sécheur avant un rapport de stage ou une soutenance.
Comment l’utiliser ?
- Pour chaque rendu, créez une check-list (titre, résumé, figures, refs).
- Écrivez vos légendes de figures avant de finaliser le texte.
- À l’oral, une idée par diapo ; supprimez tout superflu visuel.
- Entraînez-vous en conditions réelles (timer + questions croisées).
- Faites relire par un pair en lui donnant un objectif (« Comprends-tu la méthode ? »).
Conseils de mise en pratique
- Planifiez : alternez quotidiennement maths (raisonnement) et une matière expérimentale (physique/chimie) + 30 min de Python (automatisation, graphes).
- Activez vos apprentissages : résumez chaque chapitre en 10 lignes, puis créez une liste d’exercices pivot (les 15 problèmes qui « portent » 80 % de vos points).
- Rendez les savoirs visuels : tracez, simulez, comparez (erreurs, ordres de grandeur).
- Travaillez en binôme : s’expliquer mutuellement deux preuves par semaine améliore fortement la rétention.
- Documentez votre progression : un dossier par UE (fiches, exos, notebooks, mini-rapports).
Références
- Onisep — Fiche « Licence mention Sciences et technologies » (objectifs, parcours, débouchés)
- Ministère de l’Enseignement supérieur — Niveaux de diplômes & repères LMD/ECTS
- Université de Bordeaux — Portail Sciences et technologies (organisation L1 et poursuites)
- Sorbonne Université — Portail Mathématiques–Informatique (programme du 1er semestre)
- Université Claude Bernard Lyon 1 — Portail Physique–Chimie–Sciences de l’ingénieur (présentation & UE)
- Université de Lorraine — Domaines STSI et portails d’accès aux licences (récapitulatif)