Réussir sa licence de sciences du langage, c’est apprendre à penser la langue comme un système (sons, formes, structures, sens) tout en la replaçant dans ses usages, ses variations et son histoire.
La sélection ci-dessous réunit des ouvrages de référence éprouvés couvrant l’éventail du cursus (L1 à L3). Ils sont classés dans un ordre logique : panorama général → outillage grammatical → modules de base (phonétique, sémantique, pragmatique) → variation et oral → diachronie → grand dictionnaire de notions.
Pour chaque bouquin, vous trouverez une rubrique Comment l’utiliser ? avec des conseils très concrets.
1. Initiation à la linguistique française (Armand Colin, 3e éd., 2025)
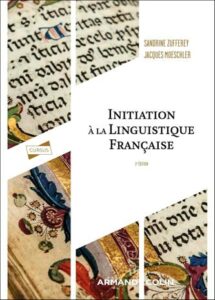
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Ouvrage-pivot pour démarrer ou remettre à plat ses acquis, ce manuel embrasse l’essentiel du programme de L1-L2 : phonétique-phonologie, morphologie, syntaxe, sémantique, pragmatique, sans oublier une mise en perspective par l’histoire des idées linguistiques (de Saussure à Chomsky). La 3e édition (2025) a été actualisée et propose un fil conducteur clair entre notions de base et études de cas, avec des exemples tirés du français contemporain.
L’intérêt majeur du livre est son équilibre entre théorie et pratique : définitions nettes, schémas lisibles, micro-exercices pour vérifier la compréhension, et encadrés qui montrent comment les mêmes phénomènes (comme les temps verbaux ou la référence) sont traités selon différents cadres. Les chapitres pragmatiques et sémantiques, coécrits par des spécialistes reconnus, aident à passer du “savoir que” au “savoir faire”.
C’est enfin un guide de méthode : comment problématiser un sujet, bâtir un plan, mobiliser des corpus simples. Bref, un manuel polyvalent qui installe vocabulaire, réflexes d’analyse et vision d’ensemble — idéal pour réussir ses premiers partiels et préparer les unités plus spécialisées.
Comment l’utiliser ?
- Lisez intégralement l’introduction et survolez les sommaires : cartographiez vos lacunes.
- Pour chaque chapitre, extrayez 10 notions-clés et fabriquez une fiche recto-verso.
- Refaites les exemples en changeant les phrases : vos propres données consolident la notion.
- En révision, croisez ce manuel avec vos polycopiés : harmonisez définitions et notations.
- Avant un partiel transversal, relisez les encadrés “bilan” pour relier les domaines.
2. Grammaire méthodique du français (PUF, 6e éd., 2024)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
C’est la grammaire de référence du supérieur : exhaustive sans être obscure, elle décrit le français moderne à la fois dans sa forme (morphologie, catégories, constructions) et son interprétation (valeurs, contraintes, ambiguïtés). L’ouvrage est conçu pour que l’on passe du simple au complexe : définition, repérage, contre-exemples, et prolongements vers l’analyse du discours.
Atout précieux en licence : la GMF fournit des critères opératoires (tests de constituency, diagnostics de fonction, commutations) qui rendent vos analyses argumentées ; elle permet de motiver un choix d’étiquetage plutôt que d’aligner des intuitions. Les rubriques sur le verbe, le nom et les déterminants, la subordination, les relatives et la pronominalisation couvrent exactement ce qui tombe en partiels.
Même si la première prise en main impressionne, elle devient vite un réflexe : chaque TD ou commentaire vous y ramènera, et vous y gagnerez en précision terminologique et en rigueur d’exposé.
Comment l’utiliser ?
- Avant un devoir, lisez la section “Principes” du chapitre concerné puis notez les tests à appliquer.
- Montez un index personnel (5–10 pages) des points que vos enseignants exigent le plus.
- Pour chaque erreur repérée dans vos copies, trouvez la page GMF qui la corrige et annotez.
- En groupe, entraînez-vous aux diagnostics : tests de clivage, remplacement, effacement, pronominalisation.
- Citez-la sobrement en examen (réf. abrégée) pour appuyer une analyse.
3. Phonétisme et prononciations du français (Armand Colin, 6e éd., 2024)
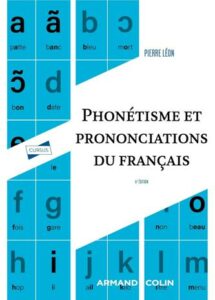
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Le classique qui met de l’ordre dans la matière sonore du français. En adoptant une progression claire (appareil phonatoire, API, inventaire vocalique/consonantique, prosodie), ce manuel connecte description et variations (régionales, sociales, stylistiques). La 6e édition actualise tableaux, exemples et cartes, et inclut des exercices d’entraînement gradués, très utiles pour maîtriser l’API et entendre les oppositions pertinentes.
Vous y trouverez aussi la prosodie (rythme, accent, intonation) et des éléments d’orthophonie utiles aux futurs enseignants et aux orthophonistes. Pour la L1-L2, c’est le compagnon idéal des TD : il aide à transcrire proprement, à repérer les neutralisations (ex. /ə/), à comprendre la liaison et l’enchaînement, et à éviter les confusions fréquentes (nasales, semi-voyelles).
Pour la L3, il fournit le vocabulaire et les méthodes d’observation nécessaires pour des mini-corpus oraux (lignes de F0, contours intonatifs). L’ouvrage fait le lien entre système et usage : il explique pourquoi la norme varie selon la situation et comment objectiver cette variation.
Comment l’utiliser ?
- Apprenez l’API par blocs (voyelles → consonnes → prosodie) et testez-vous en dictées phonétiques.
- Relevez 1 minute d’oral (radio/podcast), transcrivez, puis comparez à l’ouvrage.
- Constituez un mini-atlas de vos propres prononciations (liaisons, /ʁ/, nasales) et décrivez-les.
- Avant un exposé, listez 5 phénomènes à surveiller ([ə] chute, liaisons, allongements, accent de groupe, intonation).
- Utilisez les exercices pour calibrer vos barèmes d’auto-évaluation.
4. La sémantique (PUF – « Que sais-je ? », 5e éd., 2013)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Court, dense, redoutablement efficace. Ce “QSJ ?” donne le squelette conceptuel de la sémantique moderne : sens lexical vs compositionnel, relations de sens (synonymie, hyponymie, antonymie), champs conceptuels, référentialité, conditions de vérité, prototypes, et ponts vers la pragmatique.
Idéal pour fixer les définitions et dégager les distinctions qui structurent les sujets d’examens (sens/usage, dénotation/connotation, implicite/explicite). En 128 pages, l’ouvrage équilibre exposition et “ouvrants” vers des approfondissements. En licence, il sert de noyau dur : vous y revenez avant chaque partiel pour vérifier que vous ne mélangez pas niveaux d’analyse.
En L3, il fait un excellent préambule à des lectures plus spécialisées (sémantique formelle, lexicale, cognitive). Bref, un format agile pour muscler votre métalangage et clarifier vos plans.
Comment l’utiliser ?
- Fichez chaque chapitre en schéma conceptuel (flèches de relations sémantiques).
- Construisez un glossaire personnel (exemples à vous) ; citez-le dans vos copies.
- Entraînez-vous à typologiser les ambiguïtés (lexicales vs syntaxiques).
- Avant une épreuve, refaites 15 définitions à l’aveugle en 10 minutes.
- Croisez avec vos TD pour distinguer sémantique et pragmatique dans l’analyse.
5. L’énonciation (Armand Colin, 4e éd., 2024)
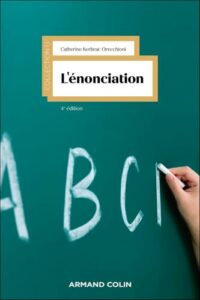
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Ouvrage fondateur pour comprendre comment le sujet parlant s’inscrit dans l’énoncé : deixis, modalités, polyphonie, implicite, actes de langage, stratégies interactionnelles. Cette 4e édition remet en perspective un champ central des sciences du langage : elle montre comment l’énonciation articule grammaire, sémantique et pragmatique en situation.
Le livre excelle à faire sentir que les formes (pronoms, temps, déterminants, connecteurs) signalent des positions énonciatives : qui parle ? à qui ? d’où ? avec quelle visée ? C’est crucial pour réussir commentaires et analyses de corpus : on passe d’un relevé de marques à une interprétation argumentée (prise en charge, distance, ironie).
La force du volume est sa didactique : typologies opérationnelles, exemples finement glossés, parcours du “restreint” (indices grammaticaux) au “large” (fonctionnement discursif). Combiné à la GMF, il fait le pont entre structure et usage — un atout pour tout sujet “à cheval” (grammaire → discours).
Comment l’utiliser ?
- Pour chaque corpus, dressez une grille énonciative : déictiques, temps, modalisateurs, discours rapporté.
- Repérez prise en charge vs distance énonciative et reliez-les à l’effet pragmatique.
- Entraînez-vous aux actes de langage : identifiez acte illocutoire + marqueurs.
- Croisez avec la GMF : rattachez les marques à leur fonction grammaticale et discursive.
- En exposé, illustrez chaque notion par vos propres exemples (authentiques, sourcés).
6. Introduction à la sociolinguistique (Dunod, 2e éd., 2017)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Ce manuel cartographie les grandes questions de la variation : styles et registres, variables sociales, contacts de langues, bilinguisme/diglossie, politiques linguistiques. En licence, il permet d’éviter deux écueils : croire à une “langue pure” hors usages, ou réduire la variation à de vagues “niveaux de langue”.
Chaque chapitre avance une problématique, des définitions de travail et des outils de terrain (échantillonnage, transcriptions, interprétation quantitative/qualitative). Très utile pour structurer un mini-mémoire : poser une hypothèse, motiver un protocole, justifier les limites.
L’ouvrage insiste sur la dimension sociale des faits de langue (marché linguistique, représentations, normes). Sa bibliographie serrée oriente vers des enquêtes phares tout en restant accessible au niveau licence. À l’arrivée : un cadre prudent et empirique pour décrire sans stigmatiser, analyser sans moraliser.
Comment l’utiliser ?
- Choisissez un terrain simple (réseau social, quartier, asso) et appliquez les grilles proposées.
- Tenez un carnet de terrain : contexte, extraits anonymisés, premières hypothèses.
- Faites un tableau “variables” → “facteurs sociaux” et testez deux hypothèses modestes.
- Rédigez une section méthodes calquée sur le livre (échantillon, limites, éthique).
- Reliez systématiquement variation linguistique et représentations (questionnaires courts).
7. Approches de la langue parlée en français (Ophrys, 3e éd., 2023)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Indispensable pour comprendre le français réel, celui des interactions ordinaires. Ce volume, devenu un classique, montre comment décrire la syntaxe, le lexique et la prosodie en contexte d’oral : constructions détachées, chevauchements, reprises, “petites” unités syntaxiques qui n’entrent pas dans les moules de l’écrit.
Le grand mérite du livre est de déscolariser le regard : on apprend à transcrire, segmenter, annoter l’oral sans le déprécier. Les études de cas éclairent des phénomènes essentiels (enchaînement des tours de parole, effets de prosodie sur l’interprétation, rôle des marqueurs discursifs), très utiles pour les dossiers de L2-L3 en analyse conversationnelle.
L’ouvrage donne aussi des procédures pour constituer de petits corpus d’oral (consentement, anonymisation, conventions de transcription) et tirer des observations étayées plutôt que des jugements intuitifs. Un complément parfait aux manuels de grammaire et de pragmatique.
Comment l’utiliser ?
- Équipez-vous d’un jeu minimal de conventions (micro-pauses, accent, chevauchements) et tenez-vous-y.
- Collectez 5 extraits d’1 min chacun (environnement légal/éthique clair) ; transcrivez.
- Repérez détachements, relances, marqueurs ; décrivez leur fonction interactionnelle.
- Ajoutez une couche prosodique (contours, allongements) à au moins deux extraits.
- Concluez par des régularités (pas des anecdotes) et leurs limites méthodologiques.
8. Introduction à l’histoire de la langue française (Armand Colin, 5e éd., 2020)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Comprendre la langue, c’est aussi comprendre son histoire. Ce manuel retrace les grands mouvements (du latin au français, évolutions phonétiques et morphologiques, normalisation, politiques linguistiques, diffusion internationale), en expliquant pourquoi certaines formes s’imposent, d’autres reculent, et comment les usages actuels héritent de strates anciennes.
Pour la licence, il outille trois compétences : (1) dater et contextualiser un fait, (2) articuler phonétique historique et morphologie, (3) lire des textes d’Ancien/Moyen Français sans se noyer, grâce à des repères morphosyntaxiques. La 5e édition propose un parcours resserré et des pistes bibliographiques.
On en ressort avec des réflexes d’étymologie raisonnée et de prudence : la “règle” d’aujourd’hui est souvent l’instantané d’une histoire longue.
Comment l’utiliser ?
- Constituez des lignes du temps thématiques (écritures, sons, morphologie, lexique).
- Faites 5 fiches-étymons (latin → français) et illustrez par des exemples actuels.
- Pour un exposé, choisissez un phénomène (ex. : disparition du subjonctif imparfait) et suivez-le sur 3 siècles.
- Comparez 10 lignes d’un texte ancien et leur réécriture moderne : listez les transformations.
- Reliez toujours histoire interne (système) et histoire externe (sociopolitique).
9. Dictionnaire des sciences du langage (Armand Colin, 2e éd., 2011)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Votre boussole terminologique pour toute la licence. Avec près de 1000 entrées couvrant grammaire, phonétique, sémantique, pragmatique, analyse du discours, acquisition, TAL, etc., ce dictionnaire fournit des définitions stabilisées, contextualisées et souvent accompagnées de bibliographie.
Atout décisif : il désambiguïse les termes qui changent de sens selon les écoles (valeur, thème/rhème, marquage, topicalisation, transitivité, etc.), un piège récurrent dans les copies. En TD comme en révision, c’est l’outil idéal pour vérifier une notion avant de l’employer.
Le système de renvois internes permet de construire rapidement une cartographie : vous partez de “déterminant” et vous rebondissez sur “défini/indéfini”, “quantification”, “spécificité”… Bref, un garde-fou scientifique qui économise des points à l’examen et structure vos mémoires.
Comment l’utiliser ?
- Avant chaque devoir, vérifiez 5 termes-pièges de votre sujet dans le dictionnaire.
- Notez les renvois : faites un mini-plan de notions liées (à glisser en intro).
- Quand une définition diverge entre cours et livre, explicitez le choix et sourcez.
- En révision, tirez au sort 20 entrées et définissez-les à l’oral en 2 minutes chacune.
- Tenez un glossaire personnel (exemples, contre-exemples, pièges).
Conseils pratiques pour tirer le meilleur parti de ces bouquins
- Fiches actives : chaque lecture doit produire des fiches (définitions + 1 exemple inédit + 1 piège).
- Lectures croisées : confrontez toujours au moins deux sources (ex. : GMF + Kerbrat pour un point d’énonciation).
- Mini-corpus : même pour la théorie, récoltez vos propres données (oral/écrit) ; l’analyse gagne en crédibilité.
- Pagination utile : tenez un carnet de pages-ressources (API, relatives, déterminants, actes de langage).
- Rythme : alternez “manuel long” (GMF, Histoire) et “manuel court” (QSJ) pour consolider sans saturer.
- Exigence terminologique : oser définir en introduction — c’est un marqueur de niveau licence.
Références
- Onisep — Fiche nationale « Licence mention Sciences du langage »
- Sorbonne Nouvelle — Licence Sciences du langage (présentation, programme, admissions)
- Université Lumière Lyon 2 — Sciences du langage (licence, brochures et organisation)
- Université Paul-Valéry Montpellier 3 — Licence Sciences du langage (parcours et contenu)
- Université Numérique des Humanités (UOH) — Ressources libres en linguistique
- CNRTL — Portail lexical et outils linguistiques (TLFi, lexiques, ressources)




