Réussir sa licence Humanités, c’est acquérir des réflexes d’analyse, d’écriture et de culture capables de circuler entre littérature, philosophie, histoire, linguistique et arts. La sélection qui suit rassemble des titres qui font gagner du temps et de la clarté : des bouquins qui expliquent la méthode, outillent la lecture et fournissent des repères sûrs.
Les livres sont classés selon une progression méthode → outils → disciplines, afin que chaque étape nourrisse la suivante. Pour chacun, vous trouverez un mode d’emploi « Comment l’utiliser ? » pour convertir la lecture en gestes concrets (fiches, entraînements, oraux).
L’objectif n’est pas d’empiler les références, mais de bâtir un socle durable, exploitable de la L1 à la L3 et au-delà. Choisissez deux titres pour démarrer, installez une routine de 20–30 minutes par jour, puis élargissez : c’est ainsi que se construit, livre après livre, une véritable compétence humaniste.
1. Méthodologie philosophique (PUF, 4e éd., 2018)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Ce manuel ancre les réflexes académiques qui font la différence dès la L1 : problématiser un sujet, analyser un texte, bâtir une argumentation, écrire une dissertation rigoureuse. Il ne s’adresse pas qu’aux seuls étudiants de philosophie : ses chapitres sur l’explication de texte, la synthèse et la prise de parole outillent toutes les filières des humanités où l’on attend clarté, rigueur et sens de la structure.
L’ouvrage conjugue rappels théoriques et exercices guidés ; il explicite les étapes (lecture active, construction de plan, transitions, conclusion qui ouvre) et les erreurs fréquentes (sauts logiques, exemples décoratifs, citations mal intégrées). En somme : un manuel d’exécution qui transforme des consignes souvent floues en gestes précis et répétables.
Atout majeur : la variété d’exemples corrigés, utiles pour se « caler » sur les attendus universitaires. Par sa portée transversale, ce livre est une base de travail pour vos trois premières années, y compris pour les exposés et les oraux.
Comment l’utiliser ?
- Faites-en votre check-list avant toute copie : sujet → problématique → plan → transitions → conclusion.
- Reproduisez un sujet corrigé : cachez le corrigé, rédigez le vôtre, puis comparez ligne à ligne.
- Constituez une fiche « banque de transitions » et « banque d’exemples » à partir des modèles proposés.
- En duo : échangez introductions et plans détaillés, évaluez-les avec la grille du livre.
2. Manuel d’analyse des textes – Histoire littéraire et poétique des genres (Armand Colin, 3e éd., 2023)
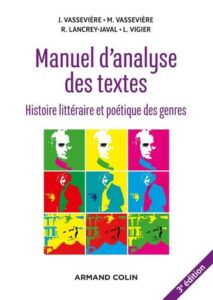
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Pensé pour les commentaires composés et les dossiers de littérature, ce manuel condense les instruments de l’analyse : figures, rythmes, focalisations, genres, registres, intertextualité… Chaque notion est définie sans jargon inutile, immédiatement suivie d’exemples et d’exercices.
Sa force est double : articuler la boîte à outils poétique (versification, prose poétique, rythmes) et l’histoire littéraire (mouvements, esthétiques, horizons d’attente). L’étudiant y trouve des schémas de lecture (du repérage fin au close reading) et des protocoles pour problématiser : repérage → hypothèses → test sur le texte → validation par indices.
La 3e édition a actualisé bibliographies et exemples, ce qui la rend très exploitable pour des dossiers contemporains. Résultat : commentaires plus denses (citations ciblées, pertinence des notions) et dissertations mieux charpentées.
Comment l’utiliser ?
- Avant un commentaire : surlignez 5 indices (rythme, sonorités, images, focalisation, lexiques), puis théorisez avec l’index du livre.
- En révision : transformez chaque chapitre en « fiches notion + exemple » de 8–10 lignes.
- En entraînement : refaites un passage déjà vu avec une contrainte (p. ex. n’utiliser qu’un corpus de notions sonores).
- À l’oral : utilisez les « questions-butoirs » pour structurer l’exposé en 3–4 étapes.
3. Le Bon Usage (De Boeck Supérieur, 16e éd., 2016)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Référence grammaticale francophone, Le Bon Usage est votre assurance qualité linguistique : accords, constructions, emplois, variantes, registres. Ce n’est pas un « manuel scolaire », mais un dictionnaire raisonné de grammaire fondé sur un vaste corpus de citations ; il présente usages, hésitations et tolérances avec une précision qui permet d’écrire juste et nuancé.
Pour une licence d’humanités, cela change tout : une copie grammaticalement sûre met en valeur l’argument ; une note de synthèse impeccable envoie un signal de professionnalisme ; un rapport d’enquête lisible gagne en crédibilité. L’index très riche permet de traiter chaque doute ponctuel (ponctuation, accord du participe, subordination, connecteurs) sans s’y perdre.
On s’y forme aussi au style universitaire clair : phrases équilibrées, reprises pronominales propres, emploi des temps homogène. Un investissement durable, utile au-delà des études (concours, rédaction pro).
Comment l’utiliser ?
- En écriture : gardez-le ouvert pour trancher un doute avant d’envoyer votre texte.
- En révision ciblée : cartographiez vos fautes récurrentes (accords, relatives, ponctuation), puis révisez les pages correspondantes.
- Constituez une « trousse de secours » : 15 points qui reviennent toujours (que/qui, leur/leurs, ce/se, participe passé…).
- À plusieurs : relisez vos travaux croisés en vous référant aux entrées pertinentes (notez la page).
4. Vocabulaire technique et critique de la philosophie (PUF, rééd. 2010)
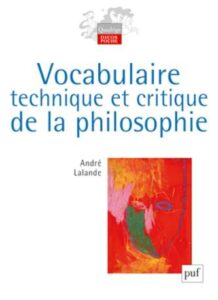
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Surnommé « le Lalande », ce dictionnaire construit un langage commun des notions philosophiques. Chaque entrée ne se contente pas d’une définition : elle retrace usages, débats et inflexions historiques du terme (substance, intention, phénomène, etc.).
Pour l’étudiant, c’est un double gain : précision (éviter les contresens) et culture conceptuelle (situer une notion dans un champ de controverses). On peut l’ouvrir pour sécuriser un point ponctuel, mais aussi pour affûter une introduction : une phrase exacte sur le sens d’un concept donne le ton d’une copie.
Très utile en littérature ou en histoire des idées, où l’on mobilise des termes philosophiques sans toujours les définir. Les rééditions Quadrige en font un compagnon robuste et maniable.
Comment l’utiliser ?
- En amont d’une dissertation : vérifiez 2–3 notions clés et repérez les distinctions internes (sens fort/faible, écoles).
- Dans l’introduction : une micro-définition sourcée (1 phrase) suivie d’une problématisation.
- En lecture de texte : comparez la notion chez l’auteur étudié avec l’arrière-plan historique donné par le Lalande.
- Fiches express : « Terme / Acceptions / Auteurs clés / Pièges ».
5. Cours de linguistique générale (Payot, 2016)
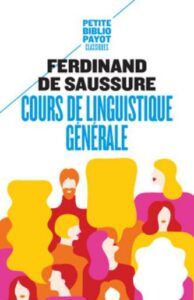
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Texte fondateur pour les sciences du langage, ce Cours (édité après la mort de Saussure à partir des notes de ses élèves) a irrigué la pensée du XXe siècle : distinction langue/parole, arbitraire du signe, synchronie/diachronie, valeur différentielle…
Pourquoi le lire en licence humanités ? Parce qu’il apprend à penser la forme : ce qui, dans un système (langue, récit, image), produit du sens par différences. Cette grammaire du sens outille autant l’analyse littéraire que la sémiologie de l’image, l’histoire culturelle ou la philosophie du langage.
La réédition Payot en poche est pratique et accompagnée d’appareils critiques récents. Conseil : lisez-le par blocs notionnels, en reliant immédiatement les concepts à un texte ou à une page d’archive. Bref, un classique qui apprend à voir.
Comment l’utiliser ?
- Faites un tableau « notion → exemple personnel » (poème, article de presse, affiche) pour chaque chapitre.
- Utilisez les couples conceptuels (signifiant/signifié, synchronie/diachronie) comme fils rouges d’un commentaire.
- Croisez avec vos cours de sémiologie : appliquez la « valeur » saussurienne à un réseau d’images.
- En révision : rédigez des définitions de 2 lignes par notion, sans jargon.
6. Apologie pour l’histoire ou Métier d’historien (Dunod, 2024)
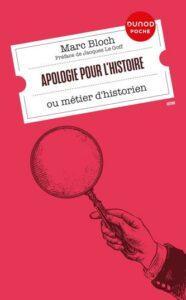
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Rédigée en clandestinité par Marc Bloch et publiée après sa mort, cette « apologie » reste un bréviaire méthodologique pour quiconque manipule des sources : qu’est-ce qu’un fait historique ? qu’est-ce qu’un témoignage ? comment s’exercent la critique interne et externe ?
Bloch y montre que l’histoire n’est pas simple récit, mais enquête : elle croise les traces, soupèse les biais, met en intrigue sans travestir. Pour une licence humanités, c’est un antidote contre l’anecdote : on y apprend à questionner qui parle, d’où, pour qui ; à lire un document administratif comme un texte littéraire (genre, contexte, destinataire) ; à historiciser nos concepts.
Les éditions récentes offrent un appareil critique actualisé et une présentation du contexte d’écriture. À lire lentement, crayon en main : une école de lucidité intellectuelle autant qu’un manifeste de métier.
Comment l’utiliser ?
- En TD : appliquez la « grille Bloch » (témoignage, transmission, critique) à un lot de sources hétérogènes.
- En dissertation : servez-vous des distinctions de Bloch pour problématiser « fait », « preuve », « causalité ».
- Dans un dossier : rédigez une note méthodologique séparée (sources, limites, biais) en vous inspirant de l’ouvrage.
- À l’oral : préparez 3 exemples « blochiens » qui montrent votre capacité à douter méthodiquement.
7. Histoire de l’art (Phaidon, 2023)
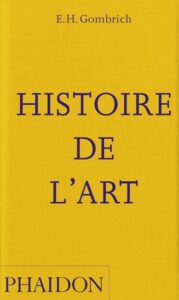
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Traduction française actualisée de l’incontournable The Story of Art d’E. H. Gombrich, ce volume propose une traversée claire, illustrée et constamment pédagogique de la préhistoire à la période contemporaine. La grande idée de Gombrich : il n’existe pas « d’Art » en soi, seulement des artistes et leurs problèmes.
Autrement dit, replacer chaque œuvre dans une chaîne d’expérimentations techniques, de questions de style, d’innovations et de reprises. Pour un étudiant en humanités, ce livre est un système de repères : périodes, formes, notions (perspective, composition, lumière…), jalons historiographiques.
Le texte excelle à relier regard et vocabulaire : on y apprend à décrire sans fétichiser, à contextualiser sans perdre la singularité d’une œuvre. L’édition de poche Phaidon (2023) est compacte, abondamment illustrée, parfaite pour réviser avant une visite de musée ou un exposé.
Comment l’utiliser ?
- Avant un cours/une expo : lisez 10 pages, listez 4 notions (support, technique, sujet, composition), testez-les sur 2 œuvres.
- Constituez une frise personnelle (siècles, mouvements, œuvres-phares) à partir des chapitres.
- À l’oral : entraînez-vous à décrire une œuvre en 90 secondes avec 6 mots techniques du chapitre.
- En dossier : citez un paragraphe-clef de Gombrich comme ouverture historiographique.
Conseils pratiques pour tirer le meilleur de ces bouquins
- Rythmez vos lectures (20–30 min/jour) et indexez-les : une notion = une page de carnet + une référence précise.
- Annotez en double couleur : bleu pour les définitions / vert pour vos exemples personnels.
- Fichez peu mais bien : une fiche tient sur une demi-page, avec exemple et contre-exemple.
- Transférez les méthodes : ce que Saussure explique sur la valeur s’applique à un poème ; ce que Bloch exige d’une source vaut pour un article de presse.
- Travaillez à deux : échanges d’intros, quizz sur les notions, relectures croisées avec le Bon Usage à portée de main.
Références
- Licence Humanités — Université Paris Nanterre (fiche officielle 2025–2026)
- Licence Humanités – Sciences de l’Antiquité — Sorbonne Université (contenu & organisation)
- Licence mention Humanités — Université Rennes 2 (parcours & compétences)
- Persée — Portail d’articles et revues en SHS en accès libre
- OpenEdition — Livres, revues, carnets de recherche & agenda SHS
- Gallica (BnF) — Bibliothèque numérique : livres, revues, manuscrits, images
- Catalogue SUDOC — Trouver et localiser des ouvrages dans les BU françaises




