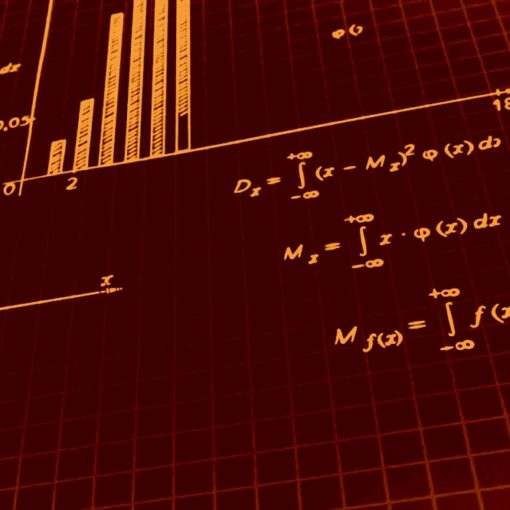Réussir sa licence ne tient pas au nombre de bouquins empilés sur le bureau, mais au choix de quelques références solides, à jour et directement mobilisables dans vos cours, TD et examens. L’idée n’est pas de tout lire, mais de lire mieux : cibler les bons chapitres, intégrer les notions, passer rapidement de la théorie à la pratique.
La sélection qui suit est organisée du cadre conceptuel aux outils : concepts et épistémologie → géographie humaine et de la France → environnement et aménagement → cartographie, SIG et méthodes quantitatives. Objectif : vous faire gagner du temps du L1 au L3, structurer des copies argumentées, construire une culture disciplinaire réutilisable en stage comme en concours.
1. Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés (Belin, 2013)
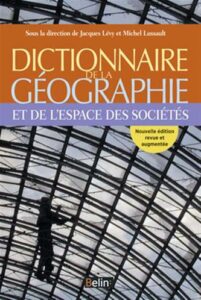
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Véritable « colonne vertébrale » de la discipline, ce dictionnaire dirigé par Jacques Lévy et Michel Lussault offre un panorama précis des notions qui structurent la géographie contemporaine : espace, territoire, réseau, échelle, mobilité, urbanité, etc. Chaque entrée associe définition, historicité, enjeux et bibliographie, ce qui permet de replacer les concepts au cœur des débats scientifiques et de les mobiliser avec justesse dans vos copies.
Le grand intérêt de l’ouvrage est de croiser systématiquement les approches (humaine, environnementale, politique, culturelle) et d’articuler les mots de la géographie avec les problématiques de l’aménagement et des politiques publiques. Cette édition revue et augmentée demeure la référence de base en licence : elle évite les contresens, donne des pistes de lecture et facilite la construction d’un vocabulaire analytique précis — indispensable pour problématiser une dissertation, commenter un document, ou cadrer un croquis. À garder à portée de main tout au long des trois années.
Comment l’utiliser ?
- Constituez votre propre glossaire en reprenant les définitions clés et en y ajoutant des exemples de cours/TD.
- Avant chaque partiel, révisez 10–15 entrées liées au thème du sujet.
- En copie, citez exactement les notions (avec auteur) pour renforcer l’argumentaire.
- Croisez les entrées (ex. territoire ↔ gouvernance ↔ mobilités) pour construire des plans problématisés.
2. Géographies – Épistémologie et histoire des savoirs sur l’espace (Armand Colin, 2019)
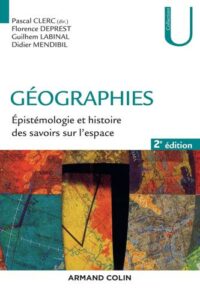
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Ce manuel collectif propose un voyage guidé dans l’épistémologie de la géographie : naissance des écoles, tournants théoriques, méthodes et controverses jusqu’aux renouvellements récents (spatial turn, approches critiques, cultural turn, etc.). Il éclaire la fabrique des savoirs sur l’espace et montre comment s’articulent modèles, terrains et outils.
Pour un·e étudiant·e de licence, c’est une boussole précieuse : elle aide à situer un chapitre de cours, un auteur, une méthode, et à comprendre pourquoi les mêmes objets (ville, frontière, environnement) ont été pensés différemment selon les périodes et les courants. L’ouvrage valorise la démarche scientifique : conceptualiser, formuler des hypothèses, choisir des méthodes et justifier des échelles d’analyse.
Vous y trouverez des repères historiques solides, un vocabulaire maîtrisé et des encadrés utiles pour passer du savoir au faire — atout décisif pour les oraux, les dossiers, ou le mémoire de L3.
Comment l’utiliser ?
- Lisez l’introduction et les chapitres de synthèse en début de semestre pour « cartographier » le champ.
- Rédigez des fiches « école/courant → concepts → méthodes → limites ».
- Replacez chaque sujet (ex. métropolisation) dans une trajectoire épistémologique.
- Servez-vous des encadrés pour construire des introductions problématisées.
3. Géographie humaine – Mondialisation, inégalités sociales et enjeux environnementaux (Armand Colin, 5e éd., 2024)
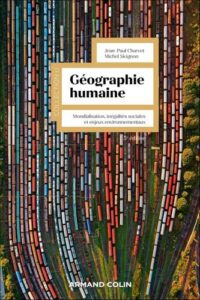
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Grand classique des cursus, cette synthèse met à jour les dynamiques humaines à toutes les échelles : transitions démographiques, systèmes productifs, recompositions urbaines et rurales, mobilités, inégalités socio-spatiales, vulnérabilités et adaptation. La 5e édition intègre pleinement les enjeux environnementaux et le tournant anthropocène, articulant économie, société, politiques et territoires.
L’intérêt pour la licence est double : d’un côté, une vision d’ensemble des mécanismes (concepts, notions, statistiques, cartes) ; de l’autre, des études de cas actuelles mobilisables en partiels comme en dossiers. La construction par thèmes, les schémas récapitulatifs et les encadrés méthodologiques facilitent l’appropriation des contenus et l’entraînement. Outil de référence pour L1-L3, il sert aussi de passerelle vers le L3/M1 (enseignement, aménagement, environnement).
Comment l’utiliser ?
- Pour chaque chapitre : 1 fiche notionnelle + 1 fiche « exemples/cas ».
- Révisez les « mots opératoires » (métropolisation, ségrégation, vulnérabilité) et associez-leur une preuve spatiale (carte, chiffre, étude).
- Entraînez-vous à transformer un encadré en plan de dissertation.
- Actualisez vos cas avec l’actualité territoriale (dossiers régionaux, politiques publiques).
4. Géographie de la France (Armand Colin, 2e éd., 2023)
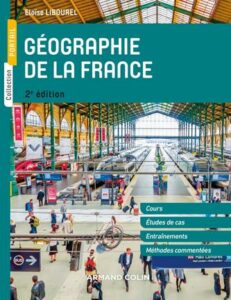
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Manuel pensé pour le niveau licence, il propose une France problématisée : dynamiques démographiques, risques, systèmes urbains et métropolitains, recomposition productive, environnement et politiques d’aménagement. La structure « Portail » (introduction → cours → méthodes) est très adaptée au travail autonome : notions clés, études de cas variées, pages d’entraînement et corrigés en ligne.
L’ouvrage permet de relier les chapitres de géographie humaine et d’aménagement à des territoires concrets, du local au national, sans tomber dans l’inventaire régional. C’est le compagnon idéal pour les épreuves centrées sur la France (dissertations, cartographies thématiques, croquis de synthèse). Il aide aussi à comprendre les réformes et dispositifs récents (intercommunalité, régionalisation, transition écologique).
Comment l’utiliser ?
- Fichez chaque chapitre avec 2 à 3 indicateurs et une étude de cas.
- Reproduisez les croquis en vous imposant une légende organisée (idées-forces → figurés).
- Entraînez-vous aux sujets « bilan/diagnostic » et « enjeux/acteurs » sur un même thème (ex. risques).
- Utilisez les compléments en ligne pour auto-évaluer vos acquis.
5. Géographie de l’environnement (Armand Colin, 2e éd., 2025)
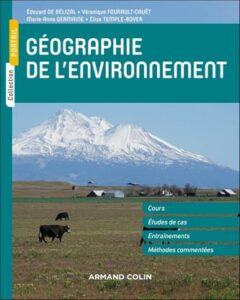
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Cette édition actualisée couvre les relations sociétés–milieux : changements globaux, risques, ressources, politiques de protection, paysages et transitions. Sa force est d’articuler cours, cas et méthodes (dissertation, commentaire de carte, croquis), avec des focus thématiques immédiatement mobilisables.
On y comprend comment l’environnement est à la fois objet biophysique, construction sociale et enjeu politique — un triptyque crucial pour réussir les UE d’environnement et les modules d’aménagement durable. L’ouvrage fait aussi le lien avec les controverses contemporaines (Anthropocène), donnant des clés pour discuter échelles, acteurs et instruments d’action publique. La maquette claire et les ressources numériques en font un manuel intensif, utile en L2-L3 et réexploitable pour les concours si vous poursuivez.
Comment l’utiliser ?
- Construisez un tableau « enjeu → acteurs → outils → échelles » pour chaque chapitre.
- Préparez des mini-dossiers (4–5 pages) sur un conflit environnemental en France et un à l’international.
- Rédigez des introductions problématisées en 7–8 lignes à partir des encadrés.
- Transformez les études de cas en schémas fléchés prêts à réemployer en partiel.
6. Géopolitique de l’aménagement du territoire (Armand Colin, 3e éd., 2018)
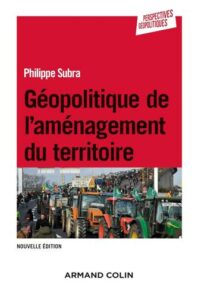
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Philippe Subra montre comment l’aménagement s’est politisé : jeux d’acteurs, conflits de localisation, arbitrages, controverses (ZAD, éolien, infrastructures, projets urbains), recompositions des gouvernances. L’ouvrage est précieux pour passer d’un aménagement « technique » à une lecture géopolitique, au plus près des rapports de force et des intérêts territoriaux.
Étudiants en géographie et futurs praticiens y trouveront des cadres d’analyse pour décrypter les politiques publiques, comprendre les oppositions locales et discuter les instruments (concertation, évaluation, participation). En licence, c’est un livre-clé pour problématiser un sujet d’aménagement, justifier un choix d’acteurs dans un plan, ou nourrir un commentaire de document par des controverses contemporaines. Un complément concret aux manuels plus théoriques, idéal pour nourrir études de cas et exposés.
Comment l’utiliser ?
- Fichez les registres d’arguments des acteurs (économiques, environnementaux, démocratiques).
- Montez un jeu de rôle (collectivité, entreprise, association, État) autour d’un projet.
- Préparez 2–3 exemples de conflits récents par type d’équipement (énergie, transport, commerce).
- Entraînez-vous à rédiger des notes d’aide à la décision (2 pages, plan analytique).
7. Manuel de cartographie – Principes, méthodes, applications (Armand Colin, 2e éd., 2025)
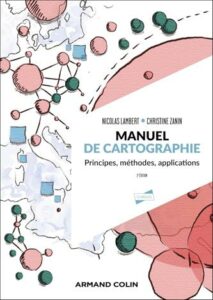
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Mis à jour par Nicolas Lambert et Christine Zanin, ce manuel de méthodes vous accompagne de la conception d’une carte à sa publication : sémiologie, figurés, choix d’échelles, discrétisations, projections, maquettes, mise en page, qualité graphique. Il aborde aussi les erreurs courantes (tris, aplats, palettes, lisibilité), l’harmonisation des légendes et l’éthique en cartographie.
Les pas-à-pas, schémas et exemples facilitent une mise en pratique immédiate — y compris pour vos croquis de partiels ou vos cartes de mémoire. La 2e édition enrichit les cas et clarifie les chaînes de production (du tableur au SIG), ce qui en fait un outil charnière entre enseignements théoriques et compétences techniques valorisables en stage. Indispensable pour gagner en lisibilité et convaincre par l’image.
Comment l’utiliser ?
- Créez vos gabarits (formats, grilles, palettes, légendes types) et réutilisez-les.
- Entraînez-vous à trois modes : choroplèthe, semi-quantitatif, flux (un exemple chacun).
- Construisez une check-list « lisibilité » (titres, sources, orientation, hiérarchie visuelle).
- Faites une relecture croisée : échangez vos cartes en TD pour un retour critique, puis itérez.
8. Les systèmes d’information géographique – Principes, concepts et méthodes (Armand Colin, 2e éd., 2023)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Ouvrage d’initiation conceptuelle aux SIG, il explique données, modèles, référentiels, géotraitements, requêtes spatiales, topologie, qualité et métadonnées. Il situe clairement les SIG dans une chaîne de production cartographique et d’analyse spatiale, en montrant comment articuler outils, méthodes et problèmes géographiques.
La 2e édition actualise terminologie et usages (données ouvertes, webmapping, interopérabilité) ; les chapitres sont pensés pour une progression autonome, utile en L2-L3. C’est l’ouvrage idéal pour comprendre ce que font vraiment les SIG — avant ou en parallèle d’un manuel spécifique à QGIS/ArcGIS — et pour rédiger des méthodologies de mémoire rigoureuses (sources, traitements, limites). À lire en parallèle de vos premiers TD pour gagner en assurance.
Comment l’utiliser ?
- Tenez un carnet de données (provenance, projection, qualité, droits) dès vos premiers TD.
- Reproduisez chaque concept avec un exercice (jointure spatiale, tampon, réseau).
- Écrivez vos workflows (du shapefile à la carte finale) et versionnez-les.
- Testez vos cartes en impression pour valider lisibilité et hiérarchies.
9. Manuel de géographie quantitative – Concepts, outils, méthodes (Armand Colin, 2019)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Accessible et progressif, ce manuel replace les statistiques dans la démarche spatiale : types de données, indicateurs, corrélations, autocorrélation, typologies, régressions, modèles simples. L’objectif est d’acquérir les réflexes d’analyse des distributions et des dépendances spatiales, d’argumenter un choix d’indicateur, et d’identifier les biais.
Les auteurs multiplient les figures et exemples issus de champs variés (urbain, environnement, mobilités), ce qui permet de passer rapidement de l’idée à la pratique (tableur, R, SIG). Pour une licence, c’est le livre qui donne une vraie autonomie quantitative : vous y trouverez de quoi justifier vos méthodes, clarifier vos limites, et enrichir vos copies de preuves chiffrées bien maîtrisées. Un investissement rentable dès le L2.
Comment l’utiliser ?
- Refaites les démonstrations au propre et commentez vos calculs (hypothèses, pas-à-pas).
- Construisez un mémo « indicateur → cas d’usage → limites ».
- Reproduisez 1 graphique + 1 carte par chapitre, avec légende interprétée.
- En mémoire : écrivez une section méthodes qui reprend les étapes du manuel.
10. Le commentaire de carte topographique – Méthodes et applications (Armand Colin, 3e éd., 2025)
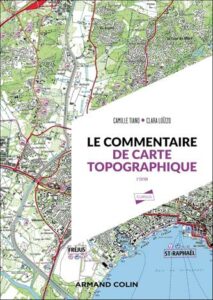
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Indispensable pour réussir les exercices méthodologiques, ce guide propose une démarche pas-à-pas : lecture des informations, problématisation, construction du plan, vocabulaire technique, croquis de synthèse. Les chapitres thématiques (topographie, hydrographie, rural, urbain, industriel, aménagement) permettent de relier la carte aux objets de géographie et de varier les angles (processus, acteurs, temporalités).
La 3e édition enrichit les exemples, propose des croquis originaux et des ressources numériques (glossaire, abréviations IGN, rapports de jury). En licence, il fait gagner du temps : on y apprend à voir vite et juste, à poser une problématique solide et à produire un commentaire clair, argumenté et spatialement étayé. Parfait pour les galops d’essai et les examens finaux — et réutilisable au-delà.
Comment l’utiliser ?
- Constituez une boîte à outils (vocabulaire, patrons de plans, figurés) et révisez-la avant chaque épreuve.
- Entraînez-vous sur 3 familles de cartes (relief/hydro, rural/agri, urbain/transport).
- Faites des « commentaires minute » (10–15 min) pour muscler l’analyse rapide.
- Terminez toujours par un croquis de synthèse propre, légendé, sourcé.
Quelques conseils pour tirer le meilleur de cette bibliographie
- Hiérarchisez vos lectures : 1–2 chapitres par ouvrage et par semaine suffisent pour progresser fortement.
- Fichez pour réutiliser : notions, cas, chiffres, croquis – visez 1 page A4 par chapitre. Croisez savoirs et méthodes : un concept (dico/épistémologie) → un cas (France/humain/environnement) → une carte (cartographie/SIG) → un indicateur (quantitatif).
- Actualisez vos exemples avec la presse spécialisée (Géoconfluences, sites ministériels, INSEE, Datar).
Références
- Licence Géographie et aménagement – Fiche 2025-2026 (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
- Programme de Licence 1 Géographie et Aménagement – Université Lumière Lyon 2
- Licence Géographie, Aménagement et Environnement – Présentation et programme (Université Toulouse – Jean Jaurès)
- Géoconfluences – Carte, croquis, schéma : définitions et usages
- INSEE – Géographie administrative : définitions et ressources (COG, zonages, téléchargements)
- IGN Géoservices – Éducation : Édugéo et ressources cartographiques pédagogiques