Réussir sa licence mention économie suppose d’assembler un socle précis : micro et macro, statistiques/économétrie, mathématiques pour économistes, sans oublier l’ouverture internationale et l’histoire de la pensée. Par-delà les cours, ce sont les bons manuels qui donnent l’ossature, clarifient les mécanismes et installent des réflexes durables.
La sélection qui suit réunit des bouquins reconnus dans les cursus universitaires. Elle est classée dans un ordre logique — des principes vers la micro et la macro, puis vers les outils quantitatifs, avant d’ouvrir à l’économie internationale et aux fondements historiques — afin de construire pas à pas votre socle commun et vos réflexes quantitatifs.
Vous n’avez pas à tout lire d’un bloc : associez chaque UE à son livre “pilote”, avancez par chapitres courts et mettez immédiatement la théorie en pratique (exercices, graphiques, mini-fiches). Pour chaque titre, une notice explique comment l’utiliser pour gagner du temps, éviter les erreurs classiques et viser la réussite aux partiels comme aux dossiers.
1. Principes de l’économie (De Boeck Supérieur, 6e éd., 2022)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Clé d’entrée idéale en L1, le « Mankiw-Taylor » embrasse toute l’introduction à l’économie, de la micro (comportements, marchés, défaillances) à la macro (croissance, chômage, inflation, politiques publiques). La pédagogie par cas et encadrés permet d’ancrer les concepts sans noyer le lecteur dans la technique.
La 6e édition française actualise les exemples et intègre des apports d’économie comportementale, ce qui aide à relier les modèles aux faits. Le livre se distingue par sa progressivité : chaque chapitre articule idées, mécanismes, puis implications de politique économique, avec synthèses et QCM de vérification.
Pour un étudiant de licence, c’est le manuel de référence pour (re)mettre à niveau et construire un vocabulaire commun avant d’aborder des cours plus quantitatifs. Il n’a pas vocation à remplacer un cours de mathématiques ou d’économétrie, mais il offre une carte claire du territoire — précieuse pour relire, hiérarchiser et relier vos TD.
Comment l’utiliser ?
- Lisez en amont de chaque CM le chapitre correspondant pour arriver avec les notions-clés déjà identifiées.
- Refaites systématiquement les questions de fin de chapitre et les QCM : elles pointent vos angles morts.
- Constituez une fiche « 10 idées clés » par chapitre (définitions + intuition + 1 exemple).
- Revenez-y en révision pour recoller les morceaux entre cours de micro et de macro.
2. Microéconomie (De Boeck Supérieur, 5e éd., 2025)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Signé Krugman & Wells, ce manuel conduit du concret vers l’abstrait : situations réelles, intuition économique, puis formalisation. La nouvelle édition française (2025) développe l’illustration empirique, multiplie les applications internationales et termine chaque chapitre par une synthèse et des exercices gradués.
Pour la licence, c’est un excellent compagnon de TD : préférences et choix, élasticités, concurrence et monopole, externalités, biens publics, information, marchés du travail et du capital — le périmètre couvre toute la micro “intermédiaire”.
L’accent mis sur les mécanismes d’incitation prépare bien aux cours d’économie publique et d’IO. Par son niveau, l’ouvrage se place entre une introduction « principes » et un traité plus mathématisé : idéal si vous voulez muscler la technique sans perdre l’intuition.
Comment l’utiliser ?
- Avant le TD, refaites les graphiques « pas à pas » : axes, déplacements, interprétation.
- Entraînez-vous aux exercices chiffrés (élasticités, surplus, coûts) pour automatiser les calculs.
- Tenez un glossaire personnel (8–10 termes par chapitre) avec une mini-illustration chiffrée.
- Après le partiel blanc, ciblez les chapitres faiblement maîtrisés pour des révisions à fort rendement.
3. Macroéconomie (Pearson, 8e éd., 2020)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Le Blanchard (adaptation française avec Daniel Cohen) reste le standard pour la macro de licence : cadre IS–LM, offre globale/demande globale, chômage et inflation, ouverture financière, politiques budgétaire et monétaire.
La 8e édition met à jour les exemples et garde la clarté « à la Blanchard » — peu de technique superflue, beaucoup d’intuition et d’allers-retours avec les données. C’est le livre pour comprendre ce que racontent les modèles (et ce qu’ils ne disent pas), avant de pousser vers des approches plus dynamiques.
Utile en L2–L3, il sert aussi de référence pour l’oral : l’ouvrage donne du vocabulaire, des schémas, et des ordres de grandeur pour argumenter. Si vous avez déjà une micro solide, ce manuel vous permettra d’assembler la partie « agrégée » de l’économie et d’aborder sereinement l’économie monétaire, l’ouverture et les chocs.
Comment l’utiliser ?
- Reproduisez les équilibres graphiques (IS-LM, OA-DA) en expliquant chaque déplacement en 2 phrases.
- Alignez chaque modèle sur un fait stylisé (ex. inflation/chômage) et une donnée (ex. zone euro).
- Faites des fiches « politiques économiques » : mécanisme → délais → limites → indicateurs.
- En fin de semestre, rédigez 2 mini-essais (500 mots) reliant un chapitre à une actualité macro.
4. Mathématiques pour l’économie (Pearson, 6e éd., 2023)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Classique des licences, le Sydsæter–Hammond–Strøm–Carvajal couvre l’arsenal indispensable : analyse (mono et multivariée), optimisation (avec/sans contrainte), intégrales, matrices, programmes linéaires et non linéaires.
La 6e édition française ajoute des chapitres sur convexité et intégrales multiples, enrichit l’optimisation et propose près de 1 000 exercices (avec activités en ligne). L’ouvrage relie systématiquement outils mathématiques et usages économiques (fonctions de production/utilité, conditions d’optimalité, statique comparative).
Il s’adresse aux licences économie (et CPGE) : si vous avez des lacunes, avancez par blocs (fonctions, dérivées, matrices) puis passez à l’optimisation. C’est le livre qui structure vos automatismes avant l’économétrie.
Comment l’utiliser ?
- Travaillez 1 bloc par semaine (cours + 10 exercices), puis un problème de synthèse.
- Pour chaque technique (ex. Lagrangien), écrivez une fiche « recette » (conditions, étapes, pièges).
- Verbalisez toujours l’interprétation économique du résultat (utilité, coût, productivité marginale).
- Croisez avec votre cours : notez les exercices « jumeaux » tombés en TD/partiels.
5. Économétrie (Dunod, 12e éd., 2024)
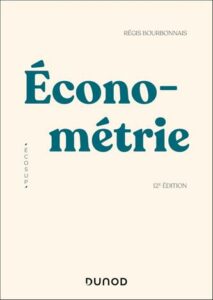
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Le manuel de Régis Bourbonnais alterne systématiquement cours et exercices corrigés, ce qui permet d’acquérir les réflexes de la régression linéaire (hypothèses, estimation, tests) tout en s’entraînant immédiatement. Les chapitres couvrent les fondements (moindres carrés, inférence, diagnostics : hétéroscédasticité, autocorrélation, multicolinéarité) et mettent l’accent sur l’interprétation propre des résultats, le choix des spécifications et la présentation correcte des tableaux. La 12e édition actualise les exemples et consolide l’approche « problème → méthode → vérification », très adaptée aux exigences L2–L3.
Outre le cœur OLS, le bouquin introduit les variables qualitatives et les modèles binaires (logit/probit), les séries temporelles (stationnarité, ARMA simple, prévision), ainsi que les données de panel et leurs spécificités. Des encadrés situent les logiciels courants (R, gretl, EViews) et montrent comment passer de la théorie aux sorties réelles, ce qui en fait un compagnon efficace pour les premiers dossiers empiriques. L’ensemble reste accessible sans sacrifier la rigueur : l’idée est de comprendre ce que « dit » un coefficient, ce que « valent » des erreurs standards et quand un modèle est mal spécifié — afin d’éviter les pièges récurrents en licence.
Concrètement, c’est un livre de méthode : partir d’une question causalité/mesure, formuler une hypothèse testable, choisir les variables et les transformations, estimer, diagnostiquer, puis rédiger une conclusion sobre (mécanisme, ampleur, limites, robustesse). Utilisé tout au long du semestre, il vous aide à gagner du temps, à produire des tableaux propres et à défendre vos choix économétriques avec assurance, à l’écrit comme à l’oral.
Comment l’utiliser ?
- Avancez au rythme d’un bloc par semaine : lisez le cours, faites 3–4 exercices corrigés, puis résumez en 8 lignes (hypothèses, étapes, diagnostics, limites).
- Répliquez au logiciel (R/gretl) un exemple du chapitre : code minimal, tableau clair (variables, unités, N, R², tests), capture des sorties en annexe.
- Tenez une check-list de diagnostic : spécification, multicolinéarité, normalité résiduelle, hétéroscédasticité, autocorrélation, variables omises ; notez la correction adoptée.
- Construisez un modèle “pilote” pour vos dossiers (gabarit de table de résultats + paragraphe d’interprétation de 4–5 phrases) et réutilisez-le pour chaque jeu de données.
6. Statistiques pour l’économie et la gestion – Théorie et applications en entreprise (De Boeck Supérieur, 2021)
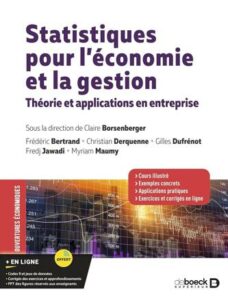
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Rédigé par une équipe d’enseignants-chercheurs, cet ouvrage propose une introduction complète et accessible aux statistiques de 1er cycle : descriptives et visualisation, probabilités, échantillonnage, estimation, tests, régression, modèles logit/probit et séries temporelles.
L’intérêt pour la licence : chaque notion est replacée dans une situation économique (enquête, prévision, scoring), avec un fil rouge « problème → méthode → lecture des résultats ». Les chapitres vont à l’essentiel, sans sacrifier la rigueur, et aident à bâtir les réflexes quantitatifs avant l’économétrie.
C’est un bon livre-pont pour consolider les fondamentaux et gagner en assurance dans les exercices (lois, tests, interprétation graphique), y compris si votre bagage en maths est hétérogène. Il fonctionne très bien en binôme avec Stock & Watson : la stat’ pour poser les bases, l’économétrie pour modéliser.
Comment l’utiliser ?
- Quand un chapitre d’économétrie bloque, revenez ici pour la brique statistique manquante.
- Faites des séries courtes mais fréquentes (15–20 min/jour) pour ancrer formules et raisonnements.
- Reproduisez les graphiques « à la main », puis sur tableur/R, pour sentir les paramètres.
- Rédigez une annexe « méthodes » standard pour vos rapports (hypothèses, tests utilisés, limites).
7. Économie internationale (Pearson, 12e éd., 2022)
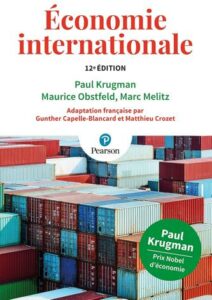
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Krugman, Obstfeld & Melitz offrent le manuel de référence en commerce international et macro ouverte. La 12e édition française couvre les théories modernes (avantages comparatifs, nouveau commerce et rendements croissants), la politique commerciale, puis les taux de change, la balance des paiements, les crises et les régimes monétaires.
La force du livre tient à sa double compétence : micro du commerce et macro-finance internationale dans un seul volume, avec des études de cas et des données récentes. En L3, c’est l’ouvrage pour donner de la profondeur analytique aux cours d’ouverture.
Pour des mémoires appliqués, le couple mécanisme théorique + faits stylisés est particulièrement utile : il offre une charpente claire pour discuter compétitivité, chocs de change, OMC ou union monétaire.
Comment l’utiliser ?
- Constituez une table des régimes de change (cas réels + mécanisme théorique associé).
- Pour chaque chapitre commerce, rédigez un exemple pays-secteur (données + intuition du modèle).
- Faites une fiche « outils de politique commerciale » (effets statiques/dynamiques, conditions).
- Entraînez-vous à expliquer un graphique de change (déplacement, interprétation, message de politique).
8. Histoire de la pensée économique (Dunod, 3e éd., 2022)
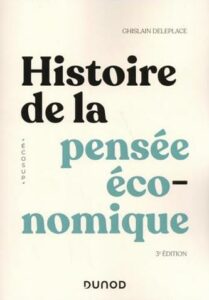
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Pour comprendre d’où viennent vos modèles, le manuel de Ghislain Deleplace propose un parcours sélectif : des classiques (Quesnay, Smith, Ricardo, Marx) à la révolution marginaliste, puis aux débats modernes.
L’ouvrage éclaire les continuités et ruptures de la discipline, sans exhaustivité inutile, mais avec suffisamment de matière pour relier doctrines et questions contemporaines (rôle de l’État, monnaie, croissance, instabilité).
En licence, l’histoire de la pensée vous donne des arguments et des cadres de comparaison : elle aide à situer les hypothèses, à identifier les controverses et à écrire des devoirs mieux problématisés — un atout pour les oraux.
Comment l’utiliser ?
- Pour chaque auteur, dressez une fiche « thèse/antithèse » (idées clés, critiques contemporaines).
- Ajoutez un exemple historique (politique ou crise) qui illustre l’idée.
- Reliez un chapitre de micro/macro à une filiation doctrinale (ex. keynésiens vs classiques).
- Terminez vos copies par une mise en perspective (ce que la théorie explique/ne couvre pas).
Conseils pour tirer le maximum de votre bibliothèque
- Priorisez par cours : 1 « tronc » (Principes) + 1 micro + 1 macro + 1 maths + 1 stats/économétrie. Le reste (international, histoire) alimente dossiers et culture.
- Petites séances fréquentes > longues sessions sporadiques : 45–60 min par jour suffisent si vous enchaînez lecture active → 5 exercices → mini-fiche.
- Écrivez : reformuler un mécanisme en 4–6 phrases fixe les idées mieux que relire trois fois.
- Travaillez à deux : alternez explication orale (enseigner) et résolution d’exercices (faire).
- Misez sur les éditions récentes quand elles existent (actualisation des données, chapitres ajoutés).
Références
- Onisep — Licence mention économie : programme, débouchés et accès
- Parcoursup — Fiche formation « Licence mention Économie » (attendus nationaux et critères)
- Université Paris 1 — Fiche Licence Économie 2025–2026 (maquette et parcours)
- Toulouse School of Economics — Licence 1–2 Économie : objectifs, contenus et poursuites d’études
- Ministère de l’Enseignement supérieur — Référentiels de compétences des mentions de licence




