Vous entamez une licence d’arts du spectacle et êtes en quête d’ouvrages vraiment utiles pour réussir TD, partiels, comptes rendus de spectacles et premières mises en scène ? La sélection qui suit rassemble des titres éprouvés dans les cursus L1–L3 (options théâtre et cinéma) : méthodes d’analyse transférables en devoir, outils de plateau applicables en atelier, repères historiques pour situer vos lectures et vos vues.
L’ordre n’est pas arbitraire : on démarre par le vocabulaire qui stabilise les notions, on passe aux grilles d’observation du spectacle vivant, on aborde la dramaturgie moderne et la mise en scène contemporaine, puis on consolide l’analyse filmique.
On vous explique ce que le livre permet de faire (décrire une scénographie, formuler une hypothèse de sens, structurer un travail d’acteur, analyser une séquence) et comment l’exploiter pas à pas. L’objectif n’est pas de tout lire d’un bloc, mais d’outiller votre semestre : un lexique pour écrire juste, une méthode pour argumenter, un manuel pour s’exercer, des références solides pour vos dossiers et oraux.
1. Dictionnaire du théâtre (Armand Colin, 4e éd., 2019)
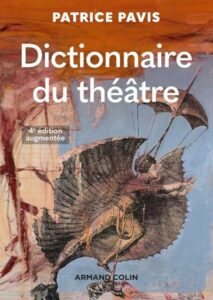
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Ce dictionnaire signé Patrice Pavis est la boussole de tout étudiant en études théâtrales. On y trouve définitions, historiques, exemples et renvois croisés pour des centaines d’entrées : « dramaturgie », « dispositif », « performativité », « théâtralité », « réception », etc. L’ouvrage ne se contente pas d’expliquer des notions : il en retrace la circulation entre disciplines et courants, ce qui en fait un guide précieux pour contextualiser vos lectures et vos comptes rendus de spectacles.
Sa force tient à la clarté de la langue et à l’étendue du panorama, qui embrasse aussi bien les traditions européennes que les pratiques contemporaines. Dans les travaux universitaires, il sert d’appui pour stabiliser la terminologie et éviter les contresens ; au plateau, il offre un vocabulaire partagé pour discuter scénographie, jeu ou adresse au public.
C’est un livre à garder à portée de main toute l’année : vous l’ouvrirez en préparant une fiche de lecture, une analyse de mise en scène ou une dissertation sur l’histoire des formes.
Comment l’utiliser ?
- Avant d’écrire, vérifiez chaque terme technique (définition + exemples).
- Créez votre mini-lexique personnel avec pages et citations clés.
- Suivez les renvois croisés pour cartographier un thème (ex. « dramaturgie » → « action » → « fable »).
- Dans un dossier, insérez 2–3 définitions sourcées pour cadrer votre problématique.
- Comparez la définition à ce que vous observez sur un spectacle vu récemment.
2. Lire le théâtre II – L’École du spectateur (Belin, 1996)
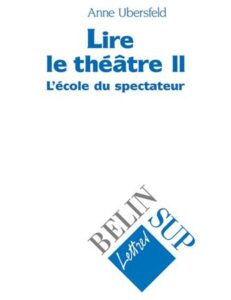
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Texte fondamental de la critique théâtrale francophone, ce volume propose une pédagogie du regard : comment « lire » un spectacle ? Anne Ubersfeld fait travailler l’œil et l’oreille en déployant une grille d’analyse qui articule espace, temps, jeu, rythme, son, lumière, dramaturgie. L’approche sémiologique reste accessible : chaque notion est reliée à des exemples concrets, montrant comment les signes scéniques produisent du sens.
Le livre aide à dépasser l’opinion (« j’ai aimé / je n’ai pas aimé ») pour entrer dans une description précise et argumentée, indispensable en commentaire composé, en compte rendu critique ou en examen sur œuvre. Son intérêt pédagogique est double : il forme la méthode (observer, décrire, interpréter) et il relie toujours la scène au texte, en montrant comment la mise en scène réécrit l’œuvre.
Ubersfeld rappelle enfin la place du spectateur : sa mémoire, ses attentes, son horizon culturel. En somme, un outil pour devenir spectateur analyste, capable d’articuler sensations et concepts.
Comment l’utiliser ?
- Après chaque spectacle, remplissez une fiche en reprenant les rubriques d’Ubersfeld.
- Testez la grille sur une captation (mêmes critères, pause/rejoue).
- Citez les pages-clefs pour justifier vos analyses (rythme, espace, lumière).
- Comparez deux mises en scène d’un même texte : ce que chaque signe déplace.
- En TD, répartissez les catégories d’analyse entre groupes et mettez en commun.
3. Lexique du drame moderne et contemporain (Circé, 2010)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Ce petit livre nerveux cartographie les mutations de l’écriture dramatique du tournant des XIXe–XXe siècles à aujourd’hui. De « Action » à « Voix », plus de cinquante entrées éclairent l’« autre manière » de faire drame : crises de la fable, dialogues décentrés, figures du rêve, dramaturgies du fragment, scènes de la littéralité.
Chaque notice, rédigée par des spécialistes, va à l’essentiel : définition, enjeux esthétiques, repères historiques, auteurs et pièces phares. Utilité directe en licence : le lexique vous permet d’identifier rapidement les problèmes poétiques d’un texte (qu’est-ce qui fait drame ici ?), d’orienter une problématique de commentaire, d’alimenter un dossier critique, et d’éviter les amalgames entre registres ou traditions.
Ce n’est ni un manuel « clé en main », ni un dictionnaire généraliste : c’est un outil de travail ciblé pour les cours de dramaturgie, l’analyse de texte et les exposés. Son format poche incite à le glisser dans le sac pour une vérification rapide entre bibliothèque et salle de répétition.
Comment l’utiliser ?
- Repérez 4–5 entrées en lien direct avec l’œuvre étudiée et relisez-les avant le cours.
- En commentaire, ouvrez l’introduction par une notion du lexique et son enjeu esthétique.
- Constituez une bibliographie « rebond » à partir des pistes données en fin d’entrée.
- Lors d’un atelier d’écriture, tirez une entrée au hasard et écrivez une courte scène.
- En révision, faites des duos « concept ↔ exemple de pièce » pour mémoriser.
4. L’Espace vide – Écrits sur le théâtre (Points, 2014)
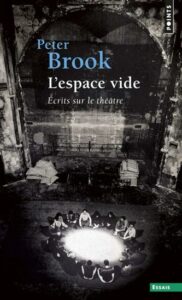
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Court, limpide et percutant, ce classique propose une vision du théâtre qui a marqué plusieurs générations d’artistes et d’enseignants. Peter Brook distingue « théâtre mort », « théâtre sacré », « théâtre brut » et « théâtre immédiat » pour interroger ce qui fait événement sur scène : la présence de l’acteur, l’adresse au public, l’invention d’un espace.
Son idée-force – « je peux prendre n’importe quel espace vide et l’appeler une scène » – sert de principe méthodologique : réduire, éclaircir, partager l’acte théâtral avec les spectateurs. L’ouvrage n’est pas un traité théorique abstrait, mais un manuel d’attitude : il incite à expérimenter, à relier tradition et modernité, à tenir ensemble éthique et pratique.
Pour un étudiant, il donne des mots pour décrire des choix de mise en scène et pour penser la relation au public. Il nourrit aussi les ateliers : qualité de l’écoute, précision des actions, justesse du jeu. Relu pendant les répétitions, il aide à recentrer le travail sur l’essentiel : la rencontre entre corps, espace, regard.
Comment l’utiliser ?
- Surlignez 10 citations et transformez-les en exercices de plateau.
- Notez, après un spectacle, dans quelle « famille » de théâtre (Brook) vous le rangeriez.
- En répétition, imposez une contrainte « espace vide » (scénographie minimale) et évaluez.
- En compte rendu, mobilisez une citation pour analyser un choix d’adresse.
- Croisez Brook avec une mise en scène contemporaine : ce que son cadre éclaire ou limite.
5. La formation de l’acteur (Payot, 2015)
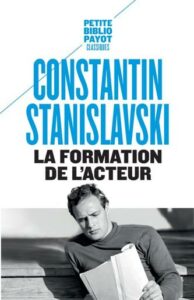
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Indémodable, ce texte fondateur expose un chemin de travail : objectifs, « si » magique, circonstanciels, actions physiques, attention, imagination. L’intérêt, pour un étudiant, n’est pas d’ériger « le système » en doctrine, mais d’y puiser une méthode quotidienne : construire des actions claires, donner des tâches au jeu, relier émotions et circonstances sans psychologisme flou.
Chapitre après chapitre, Constantin Stanislavski propose des exercices simples à fort rendement pédagogique (concentration, mémoire sensorielle, écoute). Le livre vous accompagne dans les cours d’interprétation, mais aussi dans l’analyse : comprendre ce que fait l’acteur, comment une intention devient lisible, pourquoi un geste « parle ».
Dans un dossier, citer Stanislavski ne sert pas d’ornement : ses notions aident à objectiver ce que l’on voit et à articuler jeu, mise en scène et dramaturgie. Lu avec un regard critique et comparé à d’autres approches, il demeure un socle pour fabriquer une présence juste.
Comment l’utiliser ?
- Tenez un carnet d’entraînement : exercice, sensation, difficulté, progrès.
- Convertissez chaque chapitre en mini-atelier de 20 minutes (objectif, action, évaluation).
- Assignez des « tâches » concrètes à vos scènes et vérifiez la lisibilité au plateau.
- En analyse de spectacle, décrivez une action physique précise et son effet.
- Préparez un monologue en séquençant buts et obstacles ; testez avec un pair.
6. La mise en scène contemporaine (Armand Colin, 2e éd., 2019)
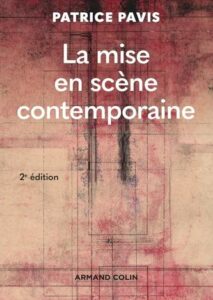
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Panorama dense et très utilisable, ce livre suit la généalogie de la mise en scène et les pratiques qui la redéfinissent : performance, dramaturgie de l’acteur, scénographies immersives, technologies, jeux interculturels. Patrice Pavis conjugue théorie et études de cas pour montrer comment se construit un point de vue scénique : traitement du texte, organisation de l’espace, circulation du regard, place du son et de la lumière, adresses aux spectateurs.
L’ouvrage est d’une aide directe pour l’« analyse de mise en scène » : il propose des cadres clairs, des catégories opératoires et une langue précise pour décrire des choix concrets sans les caricaturer. Utile aussi pour la pratique : comprendre les tendances (déconstruction, média sur scène, réécritures), identifier leurs enjeux et éviter les effets gratuits.
En mémoire ou en dossier, il permet de problématiser : qu’est-ce qu’« interpréter » aujourd’hui ? que devient la fable ? quelles politiques du regard la scénographie institue-t-elle ?
Comment l’utiliser ?
- Choisissez 2 chapitres par semestre et faites des fiches « concept → exemple de spectacle ».
- Pour un exposé, appliquez la grille de Pavis à une mise en scène précise.
- Dessinez le dispositif scénique et légendez-le (axes de regard, trajectoires, sources).
- En réécriture scénique, justifiez chaque choix par une catégorie (rythme, adresse, cadre).
- En conclusion de dossier, situez votre analyse dans une tendance (interculturel, média, etc.).
7. L’analyse des films (Armand Colin, 4e éd., 2020)
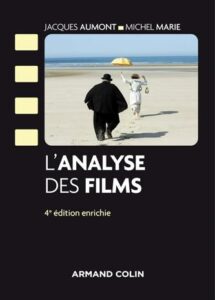
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Côté cinéma, c’est la méthode la plus solide et la plus enseignée en France. Jacques Aumont et Michel Marie balisent tout le parcours : qu’est-ce qu’analyser, quels outils mobiliser, comment articuler récit, image, son, montage, contexte, comment passer de l’observation à l’interprétation.
L’ouvrage détaille des procédures reproductibles (de la description plan par plan à l’hypothèse de sens), tout en montrant leurs limites. Sa vertu pédagogique : rendre l’analyse cumulative (on ne saute pas l’étape descriptive), mais aussi argumentée (on fonde ses conclusions).
Très utile pour les devoirs surveillés de séquence, les dossiers filmés, les présentations orales : chaque chapitre s’accompagne d’exemples, de schémas et de bibliographies brèves. Pour un étudiant en arts du spectacle, le livre permet d’unifier le regard théâtre/cinéma : penser le cadre, le rythme, l’adresse, la réception, même si les médiums diffèrent. À lire et à pratiquer de pair avec des visionnages réguliers.
Comment l’utiliser ?
- Choisissez une séquence de 2–4 minutes et réalisez une description minutée.
- Appliquez la « double entrée » : comment c’est fait (forme) / pourquoi (sens).
- Citez 1–2 analyses de l’ouvrage pour étalonner vos exigences.
- Constituez un dossier (captures, schémas, plan de montage) pour un examen.
- En oral, annoncez votre hypothèse, puis déroulez preuves → limites → ouverture.
8. L’art du film – Une introduction (De Boeck Supérieur, 2014)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Grande porte d’entrée vers les études cinématographiques, ce manuel offre un tour d’horizon très structuré : fabrication d’un film, principes de la forme, mise en scène, prise de vue, montage, son, genres, méthodes d’analyse et repères d’histoire du cinéma.
Sa pédagogie est redoutablement efficace : abondance de photogrammes commentés, glossaires et index, études de séquences pas à pas. Pour une licence, c’est le compagnon idéal des premières années : il met en place les bases techniques et analytiques pour ne pas se perdre, et il apprend à regarder lentement.
Il complète Aumont & Marie : là où ceux-ci affinent la méthode française, David Bordwell et Kristin Thompson déploient une cartographie exhaustive des outils et des traditions, avec une grande clarté conceptuelle. À utiliser comme manuel de révision avant partiels : définitions nettes, exemples canoniques, check-lists utiles pour ne rien oublier quand on démonte une scène.
Comment l’utiliser ?
- Faites un planning « chapitre → film du soir » (apprendre en regardant).
- Tenez un glossaire personnel ; réécrivez les définitions avec votre exemple.
- Reproduisez une mini-analyse de séquence selon le pas-à-pas proposé.
- Avant un partiel, relisez les synthèses de fin de section comme mémo.
- En groupe, répartissez les genres et bâtissez une frise historique commentée.
Quelques conseils de méthode
- Alternez théorie et pratique : toute lecture doit déboucher sur un exercice (fiche, analyse, mini-atelier).
- Capitalisez vos notes : une bibliographie commentée + un lexique personnel valent de l’or à l’heure des mémoires.
- Regardez live : multipliez spectacles et projections, tenez un journal du spectateur avec 10 lignes par œuvre.
- Travaillez en binôme : relisez vos analyses à deux ; l’argumentation s’affûte dans la contradiction bienveillante.
- Éditez vos preuves : schémas, croquis de plateau, captures annotées ; on démontre mieux en montrant.
Références
- Sorbonne Nouvelle — Licence Études théâtrales (programme 2025–2030)
- Université Paris 8 — Licence Études théâtrales : présentation et maquette
- Université Rennes 2 — Licence Arts du spectacle : organisation de la formation
- Université Lumière Lyon 2 — Licence Arts du spectacle : parcours et contenus
- Université Bordeaux Montaigne — Licence Théâtre : unités d’enseignement et ECTS
- ONISEP — La licence Arts du spectacle : matières, débouchés et poursuites d’études




