Entrer en licence d’anthropologie (sciences de l’homme, anthropologie, ethnologie), c’est apprendre à regarder autrement — à la fois le lointain et le très proche. Les bons livres ne remplacent pas les cours ni le terrain, mais ils donnent des leviers décisifs : des repères clairs, une méthode solide, des classiques pour prendre de la hauteur.
Voici une sélection de 9 ouvrages triés dans un ordre logique (du panorama à la méthode, puis aux références et aux grandes œuvres). Pour chaque titre, vous trouverez des conseils concrets pour l’exploiter et gagner du temps tout au long du cursus.
1. L’anthropologie (PUF, « Que sais-je ? », 2021)
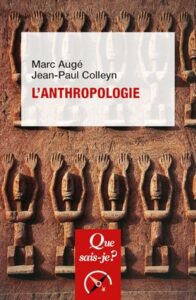
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Ce court volume d’initiation, coécrit par Marc Augé et Jean-Paul Colleyn, est la porte d’entrée idéale en L1. En une synthèse dense mais limpide, il balaye les principaux objets (parenté, symboles, rituels, techniques, économie, politique), les démarches (observation participante, comparatisme) et les grands courants (fonctionnalisme, structuralisme, approches contemporaines).
Le mérite du livre est double : d’un côté, il clarifie les mots — ethnographie, ethnologie, anthropologie — souvent confondus ; de l’autre, il donne à voir une discipline résolument ancrée dans le présent, capable d’étudier aussi bien les rituels de possession que la Silicon Valley. La narration, sans jargon inutile, multiplie les exemples concrets qui aident à fixer les notions.
Vous y trouverez également des repères historiques qui situent Lévi-Strauss, Mauss ou Malinowski dans une généalogie intelligible. Bref, un « petit livre » à garder à portée de main toute l’année : boussole quand les cours deviennent techniques, et atout en révision grâce à ses chapitres courts qui se prêtent à la relecture ciblée.
Comment l’utiliser ?
- Lisez-le en entier dès le début du semestre pour disposer d’une carte mentale globale.
- Soulignez les définitions clés (terrain, comparatisme, parenté) et constituez une fiche de concepts.
- Revenez à chaque chapitre en parallèle du thème étudié (parenté, religion, économie).
- En révision, transformez chaque sous-section en question de partiel et entraînez-vous à y répondre en 5–7 minutes.
2. Introduction à l’ethnologie et à l’anthropologie (Armand Colin, 2019)
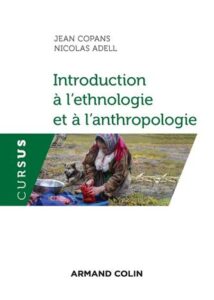
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Le tandem Jean Copans & Nicolas Adell propose un manuel de licence « à taille humaine », conçu pour le niveau Bac à Bac+3. L’ouvrage articule trois dimensions : une histoire raisonnée de l’ethnologie et de l’anthropologie ; un tour d’horizon de leurs grands domaines (parenté, échanges, techniques, politique, religion) ; et une présentation méthodologique claire (observation, entretiens, éthique du terrain).
Ce qui fait sa force : l’équilibre entre panorama et problématisation. On n’est ni dans la simple chronologie, ni dans la compilation d’exemples : chaque chapitre pose des questions — à quoi sert la comparaison ? comment penser le proche ? — puis montre comment les anthropologues y ont répondu. Les encadrés facilitent la mémorisation, et le style reste didactique sans perdre en nuance.
Pour un étudiant, c’est un manuel-pilote qui aide à relier cours magistraux, TD et premières explorations de terrain. Sa bibliographie courte et maligne oriente vers des lectures complémentaires adaptées au temps dont on dispose en licence.
Comment l’utiliser ?
- Faites-en votre manuel principal en L1/L2 : un chapitre par semaine en parallèle du cours.
- Tenez un carnet de mots-clés (3–5 notions par chapitre) avec définitions et exemples.
- Servez-vous des encadrés comme base d’exposés ou de mini-dossiers.
- Avant un contrôle, refaites les plans des chapitres en une page pour vérifier la logique des arguments.
3. Guide de l’enquête de terrain – Produire et analyser des données ethnographiques (La Découverte, 4ᵉ édition augmentée, 2010)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Indispensable pour passer de la théorie à la pratique. Stéphane Beaud et Florence Weber démystifient le terrain : préparer, entrer, observer, noter, analyser, écrire. Chaque étape est illustrée par des exemples précis (carnets, extraits d’entretiens, scénarios de restitution) et par des mises en garde méthodologiques : pièges de l’« allant-de-soi », gestion de la distance, anonymisation, éthique.
Le livre rappelle que la qualité d’une enquête repose autant sur la rigueur du recueil (notes datées, descriptions épaisses, documentation) que sur l’épure analytique qui en découle (coder, comparer, formuler des hypothèses). Les ajouts des éditions récentes abordent, entre autres, les usages du numérique et les enjeux déontologiques.
Beaud & Weber donnent surtout confiance : on comprend ce qu’il faut faire la semaine 1, 2, 3… et comment transformer des notes parfois « brouillonnes » en données exploitables. Pour un mémoire de licence, c’est un compagnon de route rassurant.
Comment l’utiliser ?
- Avant le terrain, dressez une check-list (autorisations, journal de bord, grilles d’observation).
- Pendant le terrain, appliquez la règle des notes quotidiennes (date, lieu, personnes, situations, verbatim).
- Après chaque séance, codez 3–5 étiquettes (thèmes) et tenez un mémo d’idées.
- Pour l’écriture, reprenez la structure proposée (contexte → méthodes → résultats → discussion).
4. La rigueur du qualitatif – Les contraintes empiriques de l’interprétation socio-anthropologique (Academia/L’Harmattan, rééd. 2012)
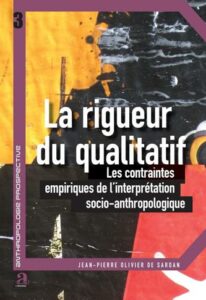
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Jean-Pierre Olivier de Sardan livre un manuel d’exigence : comment ancrer solidement ses énoncés dans des données qualitatives ? L’auteur décortique les relations entre réel de référence, données (observations, entretiens) et interprétations. Il montre que la « preuve qualitative » n’est pas un oxymore : elle se construit par la triangulation, la comparaison, l’explicitation des choix, l’auto-critique des biais.
Le livre est structuré comme une boîte à outils conceptuelle : notions opératoires (effets d’attente, surinterprétation, saturation, pacte ethnographique), règles de métier (reconstituer les chaînes d’énoncés, distinguer description et inférence), chapitres concrets sur l’écriture et la restitution.
Exigeant mais lumineux, il aide à passer d’un « récit de terrain » à une argumentation. En licence, où l’on apprend à faire peu mais bien, il évite l’empilement d’anecdotes et l’abstraction déconnectée.
Comment l’utiliser ?
- Après chaque collecte, écrivez une mémo-analyse (ce que je sais / ce que je crois / ce que je peux montrer).
- Pratiquez la triangulation : croisez notes d’observation, entretiens, documents.
- Marquez dans vos textes la frontière entre description, interprétation et spéculation.
- En relecture, cochez les « preuves » qui soutiennent chaque affirmation importante.
5. Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie (PUF, 2010)
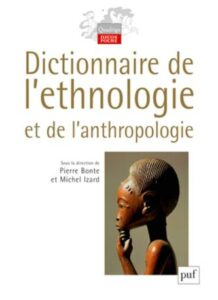
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
La référence francophone pour clarifier une notion, retrouver la bibliographie minimale, situer un auteur. Dirigé par Pierre Bonte et Michel Izard, le dictionnaire propose des entrées sur les concepts (alliance, échange, rituel, totémisme), les courants (évolutionnisme, fonctionnalismes, structuralisme) et des dizaines d’anthropologues.
L’intérêt n’est pas seulement définitionnel : chaque article donne l’historiographie de la notion, les débats associés, et met en perspective les usages contemporains. C’est un outil redoutable pour les devoirs argumentés : il permet d’éviter l’approximation et de citer juste.
Pour un exposé, il sert d’amorce fiable ; pour un mémoire, il aide à stabiliser le vocabulaire et à construire un cadre théorique sans se perdre. On lit une entrée en 5–10 minutes, on note deux références, on repart avec un repère solide.
Comment l’utiliser ?
- Avant un exposé, lisez 2–3 entrées (concept, auteur, aire) pour verrouiller les définitions.
- En rédaction, utilisez-le pour normaliser les termes (choisir une définition et s’y tenir).
- Construisez un glossaire personnel : recopiez les définitions essentielles en 3–4 lignes.
- En révision, faites des cartes « concept ↔ auteur ↔ exemple de terrain ».
6. Par-delà nature et culture (Folio essais, 2015)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Livre-monde de Philippe Descola, ce classique renouvelle en profondeur la manière de penser les rapports entre humains et non-humains. Plutôt que de reconduire l’opposition nature/culture, Descola propose quatre ontologies (animisme, totémisme, analogisme, naturalisme) qui décrivent des façons différentes d’identifier et de relier les êtres.
L’ambition est comparatiste : Amazonie, Asie, Occident moderne… L’écriture, précise et ample, tisse théorie et ethnographies pour montrer comment images, pratiques, savoirs, droits, territorialités s’ordonnent selon ces schèmes.
Pour une licence, c’est un livre exigeant mais formateur : il donne des outils pour problématiser des thèmes au programme (rituels, classifications, environnement, techniques) sans tomber dans les oppositions simplistes. Bonus : un lexique conceptuel exportable (anthropologie de l’art, du droit, de la nature).
Comment l’utiliser ?
- Lisez l’introduction puis les chapitres sur les quatre ontologies ; faites un tableau comparatif.
- Rattachez votre terrain (ou un cas étudié en TD) à l’une des ontologies et discutez ses limites.
- Constituez des exemples pour chaque ontologie (auteurs, sociétés, pratiques).
- En dissertation, mobilisez Descola pour décentrer ou nuancer une thèse trop binaire.
7. Les Argonautes du Pacifique occidental (Gallimard, 1989)
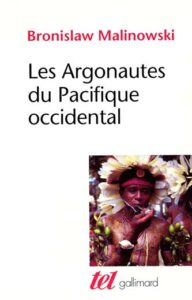
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Bronislaw Malinowski y raconte et analyse l’échange rituel kula chez les Trobriandais. Œuvre fondatrice, elle incarne la révolution du terrain : immersion prolongée, observation participante, description « épaisse ».
Au-delà du récit de voyage, c’est une démonstration : l’échange de colliers et bracelets, loin d’être « irrationnel », structure statuts, réseaux, pouvoirs, moralités. Malinowski y expose sa méthode (journal, cartes, généalogies) et discute des concepts (fonction, institution, règle).
Lire ce livre, c’est comprendre comment un phénomène apparemment « mineur » peut devenir clé de voûte d’un ordre social. C’est aussi une leçon d’écriture ethnographique et un réservoir d’exemples pour illustrer l’échange, le don, la circulation des objets de prestige.
Comment l’utiliser ?
- Lisez l’introduction et les chapitres sur la kula ; faites un schéma des circuits d’échange.
- Comparez la kula avec l’Essai sur le don (Mauss) pour repérer accords et divergences.
- Inspirez-vous de la description (carnets, croquis) pour vos propres notes de terrain.
- Mobilisez la kula comme exemple canonique en dissertation sur l’échange symbolique.
8. Les Nuer – Description des modes de vie et des institutions politiques d’un peuple nilote (Gallimard, 1994)
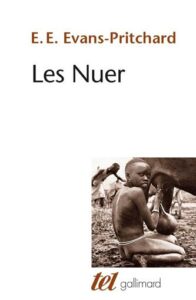
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
E.E. Evans-Pritchard propose ici une ethnographie devenue classique d’un peuple pasteur d’Afrique de l’Est. Le livre est une leçon de structure : il montre comment la parenté segmentaire (lignages, segments, alliances) soutient une organisation politique sans État.
L’écriture, précise et sobre, détaille les rythmes pastoraux, les représentations du temps et de l’espace, les procédures de résolution des conflits. Pour les étudiants, les « Nuer » sont une boîte à exemples : segmentarité, chefferies à pouvoir limité, fonction sociale du bétail, liens entre écologie et institutions.
C’est aussi un rappel méthodologique : bien choisir la focale (ici parenté et politique) et suivre pas à pas les effets d’un mode de vie sur des formes d’autorité.
Comment l’utiliser ?
- Faites une carte parenté/segments/tribus et un tableau « parenté → effets politiques ».
- Comparez les Nuer à un autre cas pastoral pour exercer le comparatisme.
- Prélevez 3 citations-concepts (segmentarité, lignage, autorité diffuse) pour vos fiches.
- Utilisez-le en dissertation sur « parenté et politique », « sociétés acéphales », « écologie et institutions ».
9. Sociologie et anthropologie (PUF, 13ᵉ édition, 2013)
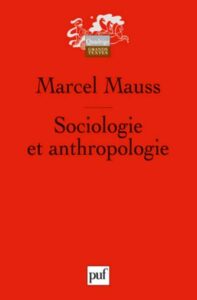
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Ce recueil majeur de Marcel Mauss rassemble des textes qui irriguent encore toutes les sciences sociales : Essai sur le don (et sa thèse du fait social total), techniques du corps, magie, prière, classification.
C’est un livre de fondations : on y voit naître des concepts qui structurent vos cours (obligation de donner/recevoir/rendre, circulation des personnes et des choses, expression corporelle, symbolique). La prose de Mauss est sobre mais exigeante ; l’appareil critique des éditions Quadrige facilite l’entrée dans les textes.
Pour une licence, c’est une lecture formatrice : on apprend à lire lentement, à isoler les thèses, à suivre une démonstration qui articule ethnographie, histoire et comparaison. Et c’est un compagnon transversal : que vous traitiez d’économie morale, de rituels, de corps ou de parenté, vous reviendrez au « Don ».
Comment l’utiliser ?
- Lisez l’Essai sur le don intégralement ; faites une fiche-thèse (3 obligations, prestations totales).
- Constituez un lexique Mauss (fait social total, hau, techniques du corps) avec exemples.
- Croisez Mauss avec Malinowski (Argonautes) et des études contemporaines.
- Utilisez une citation courte de Mauss en introduction ou conclusion de dissertation.
Conseils de lecture et de travail
- Rythmez : alternez panoramas (Augé & Colleyn, Copans & Adell), méthode (Beaud & Weber, Olivier de Sardan), références (Dictionnaire), classiques (Descola, Malinowski, Evans-Pritchard, Mauss).
- Fichez malin : pour chaque livre, une fiche « idées-forces → exemples → citations ».
- Entrelacez cours/terrain : testez chaque notion sur un micro-terrain (cafétéria, association, job étudiant).
- Écrivez tôt : tenez un journal des lectures (5–8 lignes) ; meilleur entraînement à la dissertation et au mémoire.
- Peu mais bien : mieux vaut maîtriser 5–6 exemples canoniques que butiner 30 notions superficiellement.
Références
- Persée — Portail national en accès libre pour les publications scientifiques (SHS)
- BÉROSE — Encyclopédie internationale des histoires de l’anthropologie
- ISIDORE — Moteur de recherche en sciences humaines et sociales
- Bibliothèque nationale de France — Dossier « Anthropologie et ethnologie »
- Musée du quai Branly — Médiathèque : ressources et fonds en ethnologie
- AFEA — Association française d’ethnologie et d’anthropologie (cartographies, laboratoires, formations)




